Texte inédit | Ballast | Série « La Commune a 150 ans »
Tandis que la Troisième République s’apprête à entrer dans Paris pour exterminer une révolution très largement ouvrière, ce brave Émile Zola peste contre les communistes, le « parti rouge », l’Association internationale des travailleurs et le « grand pontife de l’Internationale » (entendre Karl Marx), lesquels importeraient en France leurs affreuses théories. L’intéressé a alors 52 ans. Il vit en exil en Angleterre depuis 1849 et a publié le premier volume du Capital quatre ans avant l’éclatement de la Commune. Si l’Internationale — alors composée, pour l’essentiel, de collectivistes libertaires, de marxistes et de mutuellistes — ne joue aucun rôle dans ce dernier, 14 des 85 membres élus du gouvernement communal y sont affiliés. De Londres, Marx s’informe, correspond, commente et prodigue même deux ou trois conseils à ses quelques contacts communards. Rosa Moussaoui, grand reporter à L’Humanité, en fait le récit.
[lire le deuxième volet de notre série « La Commune a 150 ans »]
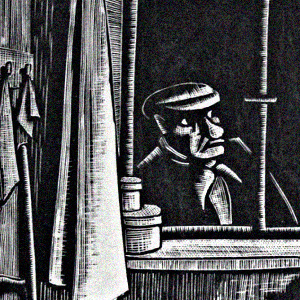
« Marx est d’abord perplexe, inquiet, surpris par le tour que prennent les événements. »
La défaite consommée et l’empereur Napoléon III capturé, Adolphe Thiers — ce « méchant avorton », comme Marx le nomme — affûte déjà contre le peuple de Paris les armes de la revanche. Dans une lettre transmise par le ministre Jules Favre2 à Bismarck, le chef du gouvernement provisoire replié à Versailles « supplie » le chancelier allemand, « au nom de la cause de l’ordre social », de le laisser accomplir lui-même « cette répression du brigandage antisocial qui a pour quelques jours établi son siège à Paris ». « Ce serait causer un nouveau préjudice au parti de l’ordre en France, et dès lors en Europe, que d’agir autrement, conclut Thiers. Que l’on compte sur nous, et l’ordre social sera vengé dans le courant de la semaine. » Ce pacte entre ennemis de la veille pour garantir l’ordre social fera dire à Marx, dans La Guerre civile en France, que « Les gouvernements nationaux ne font qu’un contre le prolétariat ».
Écrit sur le vif, des derniers jours d’avril jusqu’à la Semaine sanglante, ce pamphlet prendra d’abord la forme d’une Adresse de l’Association internationale des travailleurs (AIT), que précèdent plusieurs ébauches3. Il est nourri des lettres et rapports reçus des Internationaux4 de Paris, des coupures de presse rassemblées par Marx au fil de ces événements d’une exceptionnelle densité, des analyses accumulées des soubresauts révolutionnaires qui ont accompagné, en France, l’émergence de l’État central et de classes nouvelles liées au développement de l’industrie capitaliste. La Guerre civile en France est tout à la fois réquisitoire contre les Versaillais et leur « gouvernement de défection nationale », lecture critique des possibilités ouvertes par le premier gouvernement des travailleurs et hommage au peuple de la Commune, à son héroïsme, à sa faculté d’invention sociale et politique, ceci contre la diffamation des « journaux infâmes » et le « sale gribouillage journalistique bourgeois » grimant les communards en barbares incendiaires, prêts à brûler la propriété, la famille la religion.
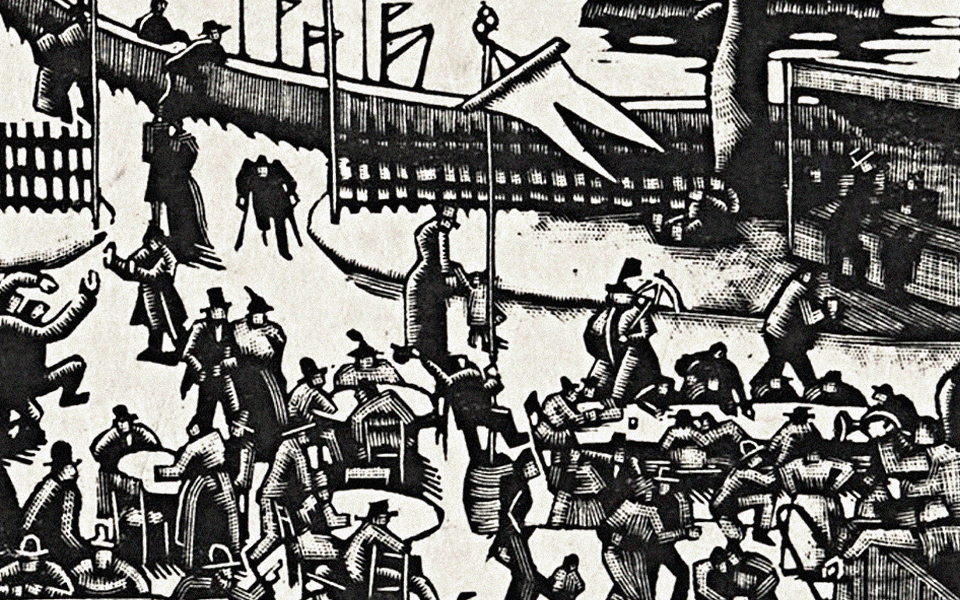
[Otto Nückel]
La forme politique enfin trouvée
Le rôle prêté à Marx auprès des Internationaux impliqués dans l’insurrection lui valut une vénéneuse célébrité : de son vivant, elle fit parler de lui bien plus que ses écrits, son colossal travail théorique. Pourtant, la thèse d’un complot de l’AIT soufflant sur les braises parisiennes ne tient pas debout. Il s’en expliqua longuement, à l’été 1871, dans plusieurs conversations retranscrites par la presse américaine. Dans un entretien paru le 3 août 1871 — objet, après publication, d’une mise au point —, Marx répond ceci au reporter du New York Herald qui l’interroge sur une prétendue conspiration ourdie depuis Londres : « Ce serait […] méconnaître complètement la nature de l’Internationale que de parler d’instructions secrètes venant de Londres, comme s’il s’agissait de décrets en matière de foi et de morale émanant de quelque centre pontifical de domination et d’intrigue. Ceci impliquerait une forme centralisée de gouvernement pour l’Internationale, alors que sa forme véritable est expressément celle qui, par l’initiative locale, accorde le plus de champ d’action à l’énergie et à l’esprit d’indépendance. »
« S’il ne tire pas les ficelles de l’événement, il n’est pourtant pas retranché dans la posture de l’observateur passif. »
Homme de plume mais piètre soldat, de santé fragile, sous la menace proférée par Bismarck d’une arrestation, le Maure — comme il se surnomme lui-même non sans malice — n’a pu se rendre à Paris. S’il ne tire pas les ficelles de l’événement, il n’est pourtant pas retranché dans la posture de l’observateur passif : aux communards qui lui écrivent pour solliciter son avis, il dispense ses conseils politiques — loin de toute injonction, sans jamais livrer le moindre mode d’emploi, le moindre programme écrit par avance. À trois décennies de distance, le philosophe reste fidèle à ces mots adressés, au printemps 1843, à la veille de son premier séjour parisien, à son camarade de la Gazette Rhénane censurée, Arnold Ruge : « Chacun de nous devra bientôt s’avouer à lui-même qu’il n’a aucune idée exacte de ce que demain devra être. Au demeurant c’est là précisément le mérite de la nouvelle orientation : à savoir que nous n’anticipons pas sur le monde de demain par la pensée dogmatique, mais qu’au contraire nous ne voulons trouver le monde nouveau qu’au terme de la critique de l’ancien. »
Marx est attentif à tout ce qui germe dans cette révolution « grosse d’un monde nouveau », aux expérimentations auxquelles elle donne lieu, aux brèches inédites qu’elle ouvre en reconfigurant le cadre, les formes et les modalités de la lutte pour l’émancipation du travail. Il est intrigué par ce « sphinx qui tourmente l’entendement bourgeois », finit même par y voir la « forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l’émancipation économique du travail ». L’AIT dispose alors en France d’une base solide : ses membres sont des chevilles ouvrières du mouvement syndical naissant et ils exercent au cœur de l’insurrection une influence certaine. L’emprise des idées proudhoniennes de mutuellisme, d’égal échange, d’équilibration de la propriété cède le pas à leur coopérativisme plus radical — et même à leurs conceptions collectivistes. Leur activisme ne fait pas de la Commune un monolithe placé sous l’hégémonie des Internationaux : elle est faite d’un alliage politique composite. Plusieurs courants la traversent et, dans ses instances, les membres de l’AIT sont loin d’incarner la majorité.
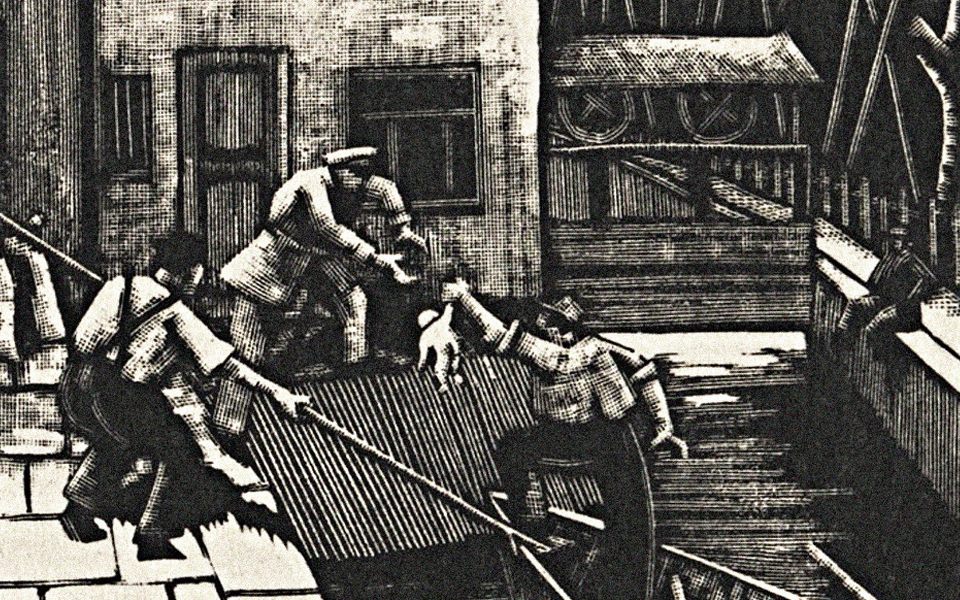
[Otto Nückel]
L’expropriation des expropriateurs
Marx entretient avec ses camarades parisiens une riche correspondance. Il a chargé un commerçant allemand de la liaison avec eux et des émissaires ont été dépêchés à Paris : Auguste Serraillier, un ouvrier cordonnier établi de longue date en Angleterre arrivé le 4 septembre 1870, jour de la proclamation de la République, ou encore Élisabeth Dmitrieff, partie pour une mission d’information, arrivée au moment où l’on proclame la Commune et aussitôt happée par l’insurrection. Elle en deviendra d’ailleurs une figure de premier plan, avec la création, aux côtés de Nathalie Lemel, de l’Union des femmes pour la défense de Paris, l’un des cœurs battants de la révolution. Impliqué à distance dans les événements, Marx s’informe avec avidité, encourage ses camarades parisiens, se tourmente du sort de son gendre et de sa fille, Paul et Laura Lafargue, évalue les rapports de forces, pressent tôt la défaite.
« Marx jette toutes ses forces dans le soutien aux insurgés, exhorte les prolétaires allemands à s’engager dans une solidarité sans faille avec leurs frères de classe français. »
Marx jette toutes ses forces dans le soutien aux insurgés, exhorte les prolétaires allemands à s’engager dans une solidarité sans faille avec leurs frères de classe français, étrille les mensonges dont la presse couvre Paris. « De tout le fatras qui te tombe sous les yeux dans les journaux sur les événements intérieurs de Paris, tu ne dois pas croire un mot. Tout est mensonger. Jamais la bassesse du journalisme bourgeois ne s’est mise plus brillamment en évidence », écrit-il, le 6 avril, au révolutionnaire allemand Wilhem Liebknecht, tout juste libéré, tout comme le fondateur du Parti ouvrier socialiste d’Allemagne August Bebel, au terme de la peine de prison consécutive à leur cri internationaliste dans le feu de la guerre franco-allemande.
La Commune est le fruit de l’un de ces « hasards5 » dont l’Histoire universelle est tramée. Marx se passionne pour les principes qui s’y énoncent et les politiques qui s’y déploient, pour les formes politiques qui s’y inventent et l’esquisse de la société future qui se dessine dans l’urgence et le huis clos d’une ville assiégée, aux ressources dérisoires. De cette expérience, il mesure la dimension novatrice et fondatrice, les réverbérations, le pouvoir d’expansion. Il révise ses vues antérieures sur la forme coopérative, se réjouit de l’abolition du travail de nuit des compagnons boulangers, applaudit « l’interdiction, sous peine d’amende, de la pratique en usage chez les employeurs, qui consistait à réduire les salaires en prélevant des amendes sur leurs ouvriers sous de multiples prétextes, procédé par lequel l’employeur combine dans sa propre personne les rôles du législateur, du juge et du bourreau, et empoche l’argent par-dessus le marché6 ».
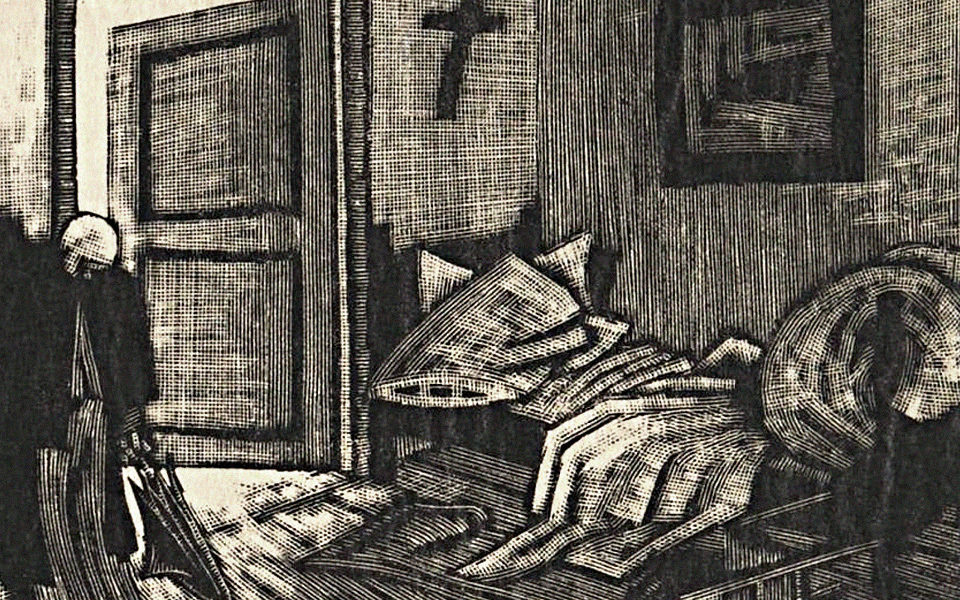
[Otto Nückel]
Il porte une attention toute particulière au travail de la Commission du travail et des échanges où Léo Frankel donne le la, se réjouit de la portée du décret du 16 avril sur la réquisition des ateliers abandonnés, pourtant peu appliqué, dans lequel il lit une volonté de mise en cause radicale des formes de propriété et d’accaparement que perpétue le régime capitaliste. Et, même, les ferments du communisme — tel qu’il le conçoit déjà dans L’Idéologie allemande : ni comme état, ni comme idéal sur lequel devrait se régler le réel, mais bien comme « mouvement réel qui abolit l’état actuel », l’ordre existant. « Oui, messieurs, la Commune entendait abolir cette propriété de classe, qui fait du travail du grand nombre la richesse de quelques-uns. Elle visait à l’expropriation des expropriateurs. Elle voulait faire de la propriété individuelle une réalité, en transformant les moyens de production, la terre et le capital, aujourd’hui essentiellement moyens d’asservissement et d’exploitation du travail, en simples instruments d’un travail libre et associé7. »
Défendre la Commune
« Il porte une attention toute particulière au travail de la Commission du travail et des échanges. »
Marx va jusqu’à transmettre aux insurgés les plans des Prussiens, leur dispense ses conseils militaires. Rôle assumé et revendiqué. « Le 11 mai, dix jours avant la catastrophe, j’ai envoyé […] tous les détails de l’accord secret entre Bismarck et Favre à Francfort. L’information m’arrivait du bras droit de Bismarck — un homme, qui, jadis (de 1848 à 1853), appartenait à la société secrète, dont j’étais le chef. Cet homme sait que je possède encore tous les rapports qu’il m’envoyait d’Allemagne et sur l’Allemagne. Il dépend de ma discrétion. D’où la peine qu’il se donne pour me prouver continuellement ses bonnes intentions », confie-t-il à l’historien Edward Spencer Beesly dans une lettre datée du 12 juin 1871. Dans cette même missive, il regrette que la Commune n’ait pas « écouté [ses] avertissements » : « Je conseillais à ses membres de fortifier le côté nord des hauteurs de Montmartre, le côté prussien, et ils avaient encore le temps de le faire ; je leur disais d’avance qu’autrement ils tomberaient dans une souricière. »
Après l’écrasement de l’insurrection, il se fera le fervent avocat de cette tentative prométhéenne et des hommes et des femmes qui l’ont portée, quand le camp de l’ordre les clouera au pilori, au lendemain des massacres. Dans le feu des événements, déjà, il plaide partout la cause des communards. « J’ai écrit plusieurs centaines de lettres pour exposer et défendre votre cause à tous les coins du monde où nous avons des branches, assure-t-il à Léo Frankel et Eugène Varlin, dans une lettre datée du 13 mai. La classe ouvrière était du reste pour la Commune dès son origine. Même les journaux bourgeois de l’Angleterre sont revenus de leur première réaction de férocité. Je réussis à y glisser de temps en temps des paragraphes favorables. »

[Otto Nückel]
L’horizon dégagé
Pour la première fois dans l’Histoire, les exploités se gouvernent eux-mêmes ; ils jettent les bases de transformations à la résonance universelle ; l’urgence qui pousse les militants ouvriers à inventer dans l’adversité, sous la menace, d’autres formes de vie, finit par élever au rang de nécessité le principe d’une appropriation des moyens de production. « La multiplicité des interprétations auxquelles la Commune a été soumise, et la multiplicité des intérêts qu’elle a exprimés montrent que c’était une forme politique tout à fait susceptible d’expansion, tandis que toutes les formes antérieures de gouvernement avaient été essentiellement répressives », remarque encore Marx dans La Guerre civile en France.
« Pour la première fois dans l’Histoire, les exploités se gouvernent eux-mêmes. »
Conscient des contradictions qu’elle cristallise et des disputes qui la traversent en dépit du syncrétisme — pour reprendre le mot du philosophe Stathis Kouvélakis — qu’elle opère entre les courants et traditions du mouvement ouvrier, Marx s’attache surtout aux horizons dégagés par la Commune, aux possibilités qu’elle met en lumière. Cela sans nourrir d’illusions sur l’étendue de son œuvre ni sur la portée concrète, dans un temps restreint et dans des conditions contraintes, des proclamations, des réalisations, des mesures sociales de cette révolution d’un type nouveau, qui introduit par ses inclinations socialistes une césure. « La grande mesure sociale de la Commune, insiste-t-il, ce fut sa propre existence et son action. Ses mesures particulières ne pouvaient qu’indiquer la tendance d’un gouvernement du peuple par le peuple. »
Le peuple de ce Paris insurgé s’inscrit dans la filiation des révolutions précédentes ; ses racines plongent dans la sans-culotterie et dans les barricades de juin 1848 ; la République dont il se réclame doit être, comme la revendiquaient les quarante-huitards, sociale et universelle, aux antipodes de celle qui organise déjà la confiscation des pouvoirs et l’exclusion politique du peuple sur les ruines du Second Empire. « La République avait cessé d’être un nom pour une cause du passé : elle était grosse d’un monde nouveau8. » Cette République-là porte en elle son propre dépassement, la promesse de détruire enfin « la machine bureaucratico-militaire » de l’État, qui se joue des alternances et de la succession entre régimes aux mains des puissants.
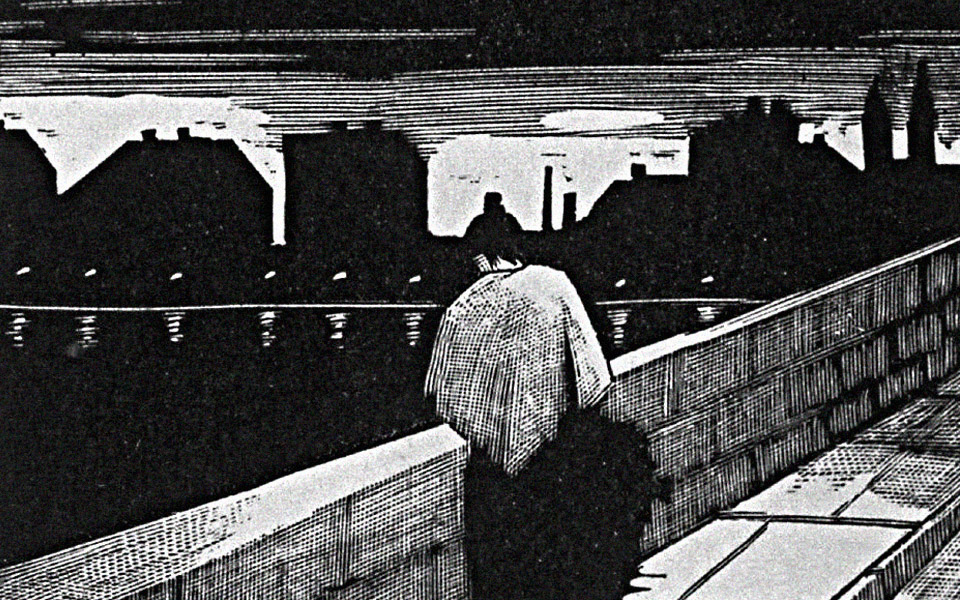
[Otto Nückel]
Marx avait longuement analysé dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte les raisons de l’adhésion d’une bourgeoisie tenue par son intérêt matériel à une forme d’État « omniprésent », « omniscient », « corps parasite » qui « enserre, contrôle, réglemente, surveille et tient en tutelle la société civile, depuis ses manifestations d’existence les plus vastes jusqu’à ses mouvements les plus infimes, de ses modes d’existence les plus généraux jusqu’à la vie privée des individus ». Image reprise dans le premier brouillon de La Guerre civile en France, où il voit dans L’État bonapartiste « une machinerie » enserrant « le corps vivant de la société civile, comme un boa constrictor ». « Détruire » ce monstre étatique tentaculaire : voilà « la condition préalable de toute révolution véritablement populaire sur le continent », écrit-il au lendemain de la Commune9.
Les bêtises anarchistes
« Les événements de Paris viennent bousculer les conceptions centralisatrices de Marx, l’interpellent par l’aspiration profonde à l’autogouvernement qu’ils traduisent. »
La question de l’État reste au cœur de la dispute entre communistes et anarchistes, qu’il étrille volontiers. Dans une lettre à Beesly, le 19 octobre 1870, évoquant la constitution d’une Commune de Lyon, il s’en prend avec virulence à ces « ânes de Bakounine et de Cluseret », qui « gâchèrent tout » en proclamant « les lois les plus insensées sur l’abolition de l’État et autres bêtises de ce genre ». Depuis le Congrès de Bâle, en 1869, une profonde défiance s’est installé entre Marx et Bakounine, le premier jurant même d’« excommunier » ce « Russe » qui « veut devenir le dictateur du mouvement ouvrier européen10 », et le second promettant à son camarade une « lutte à mort » à propos du « communisme d’État11 ».
Les événements de Paris viennent bousculer les conceptions centralisatrices de Marx, l’interpellent par l’aspiration profonde à l’autogouvernement qu’ils traduisent : il voit dans la Commune une « révolution contre l’État lui-même12 ». Bakounine ne pose d’ailleurs pas d’autre diagnostic : il lit dans cette révolution une « négation audacieuse, bien prononcée, de l’État ». La confrontation se durcira pourtant, jusqu’à la scission du Congrès de La Haye, en 1872, qui conduira à la dislocation de l’AIT. Pour l’heure, puisque l’État, au gré d’un développement industriel propre à aiguiser les antagonismes, a pris l’allure d’un « engin de guerre national du capital contre le travail » et « le caractère d’un pouvoir public organisé aux fins d’asservissement social, d’un appareil de domination d’une classe » instrumentalisé par les possédants pour conjurer la menace d’un soulèvement du prolétariat, alors, juge Marx, la classe ouvrière ne peut « se contenter de prendre tel quel l’appareil d’État et de le faire fonctionner pour son propre compte9 ». Là encore, sans parvenir à briser cet instrument de coercition, les communards, à ses yeux, ont donné une indication, ouvert un chemin : celui de la « réabsorption du pouvoir d’État par la société, en tant que sa force vivante au lieu de la force qui la contrôle et la subjugue », celui de la restitution « au corps social de toutes les forces jusqu’alors absorbées par l’État parasite qui se nourrit sur la société et en paralyse le libre mouvement ».
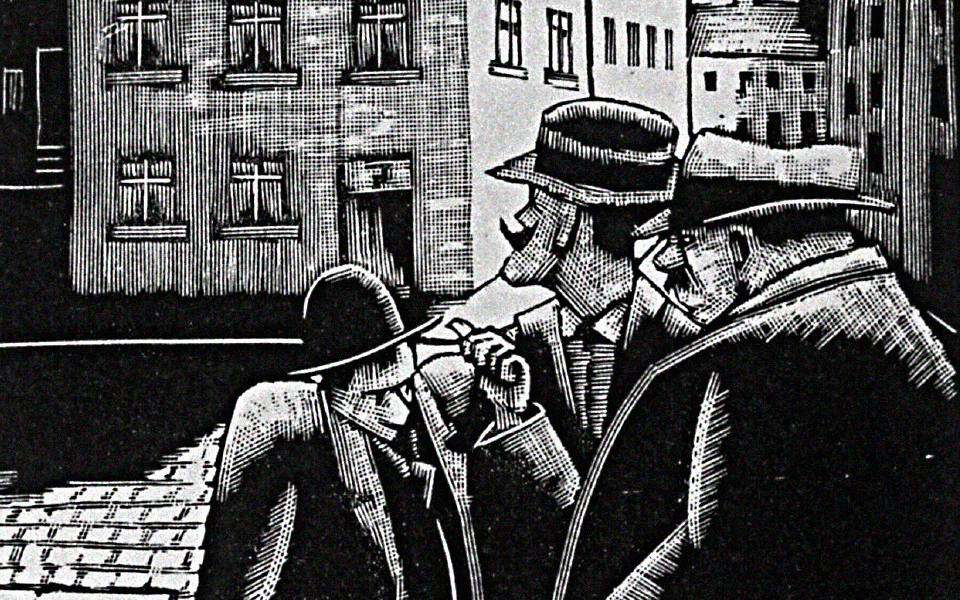
[Otto Nückel]
Les communards, trop « bons garçons »
Dans l’histoire de la lutte des classes que Marx ausculte sur le temps long, la Commune n’a rien d’un crépuscule : elle fait au contraire entrer le mouvement ouvrier, en dépit de sa tragique issue, dans un âge nouveau. Il n’en sonde pas moins les impasses et les « scrupules de conscience », les tâtonnements et les erreurs stratégiques. « Il semble que si les Parisiens succombent ce soit par leur faute, mais par une faute due, en réalité, à une trop grande honnêteté », regrette-t-il, dès le 6 avril, dans une lettre à Liebknecht. Les insurgés, pense-t-il, auraient dû s’engager dans la guerre civile déclarée par Thiers avec sa tentative de désarmer Paris par la force ; ils auraient dû assumer l’affrontement direct en marchant sur Versailles, sitôt la réaction défaite dans la capitale, plutôt que de laisser aux ennemis le temps de centraliser leurs forces. Dans cette bataille du temps, l’autre imprudence fatale, selon Marx, tient à l’organisation même, le 26 mars, d’une élection : « Pour ne pas se donner l’apparence d’un pouvoir usurpateur, ils ont perdu des moments précieux. » Dans une lettre à Varlin et Frankel, le 13 mai, il s’agace de ce « temps perdu » comme « des bagatelles et des querelles personnelles » et des « influences » autres « que celles des ouvriers ».
« Les communards auraient dû assumer l’affrontement direct en marchant sur Versailles. »
Avec le choix d’une « attitude purement défensive » en dépit « d’une menaçante concentration de troupes dans Paris et ses environs », les dés sont jetés. Dans la sévérité même de ses jugements perce toutefois une profonde empathie, une sincère admiration pour ce peuple des faubourgs auquel Marx voue un attachement qui outrepasse la seule rationalité politique. « Il aurait fallu que vous ayez pu assister à une des réunions des ouvriers français pour pouvoir croire à la fraîcheur primesautière, à la noblesse qui émane de ces hommes harassés de travail », avait écrit le jeune Marx à Ludwig Feuerbach, à l’aube de son premier séjour parisien, en 1844. Son regard sur la Commune garde quelque chose de ce mythe de Paris comme « bivouac des révolutions ». Dans une lettre à Kugelmann, le 12 avril, il exalte l’héroïsme des « camarades de Paris », comparés à des « titans » : « De quelle souplesse, de quelle initiative historique, de quelle faculté de sacrifice sont doués ces Parisiens ! Affamés et ruinés pendant six mois, par la trahison intérieure plus encore que par l’ennemi, ils se soulevèrent sous les baïonnettes prussiennes comme s’il n’y avait jamais eu de guerre entre la France et l’Allemagne, comme si l’étranger n’était pas aux portes de Paris ! L’histoire ne connaît pas encore d’exemple d’une pareille grandeur ! S’ils succombent, seul leur caractère bon garçon
en sera cause. »
Dans la conscience même du martyre qui se prépare, Marx entrevoit la dimension inaugurale de l’événement, son écho dans le monde et dans le temps, les implications innombrables et cruciales qu’il déplie pour le camp révolutionnaire : « La classe ouvrière n’espérait pas des miracles de la Commune. Elle n’a pas d’utopies toutes faites à introduire par décret du peuple. Elle sait que pour réaliser sa propre émancipation, et avec elle cette forme de vie plus haute à laquelle tend irrésistiblement la société actuelle en vertu de son propre développement économique, elle aura à passer par de longues luttes. » Luttes inscrites dans de multiples « processus historiques », propres à façonner les circonstances elles-mêmes, tendues non pas vers la réalisation d’un idéal, mais vers la libération des « éléments de la société nouvelle » que porte dans ses flancs mêmes l’ordre ancien qui s’effondre.
Illustrations de bannière et de vignette : Otto Nückel
- La Guerre civile en France, Éditions sociales, [1871] 1945.[↩]
- Ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement investi le 8 février 1871 et adversaire résolu de la Commune. Il est connu pour avoir accueilli par ces mots la nouvelle de la révolution du 18 mars : « Il n’y a pas à pactiser avec l’émeute. Il faut la dompter, il faut châtier Paris ! ».[↩]
- À l’occasion du 150e anniversaire de la Commune de Paris, ces textes sont rassemblés, avec les correspondances, articles et interventions au Conseil général de l’AIT, ainsi que des textes produits par la Commune et des controverses auxquelles elle a donné lieu, dans une précieuse anthologie parue aux Éditions sociales : Karl Marx et Friedrich Engels, Sur la Commune de Paris. Textes et controverses, précédé de l’avant-propos « Événement et stratégie révolutionnaire » de Stathis Kouvélakis.[↩]
- Membres des différentes sections de l’AIT.[↩]
- Lettre à Ludwig Kugelmann, le 17 avril 1871.[↩]
- La Guerre civile en France, op. cit.[↩]
- Ibid.[↩]
- Première ébauche de La Guerre civile en France.[↩]
- Op. cit.[↩][↩]
- Lettre de Marx à Engels, 27 juillet 1869.[↩]
- Lettre de Bakounine à Herzen, 28 octobre 1869.[↩]
- Première ébauche de La Guerre civile en France.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Zola contre la Commune », Émile Carme, mars 2019
☰ Lire notre article « Élisée Reclus, vivre entre égaux », Roméo Bondon, septembre 2017
☰ Lire « La Commune ou la caste — par Gustave Lefrançais », juin 2017
☰ Lire notre abécédaire de Louise Michel, mars 2017
☰ Lire notre entretien avec Mathieu Léonard : « Vive la Première Internationale ! », mai 2015



