Texte inédit | Ballast | Série « La Commune a 150 ans »
Que les femmes, absentes du gouvernement communal, aient joué un grand rôle lors de la Commune de Paris ne fait pas question : elles défendent les canons contre la troupe ; prennent en charge les camarades blessés ; érigent des barricades et ouvrent le feu sur l’ennemi ; siègent dans les clubs et les commissions ; écrivent dans la presse et s’engagent en faveur de la laïcité. Que la bourgeoisie ait redoublé d’injures à leur endroit n’en fait pas non plus : « pétroleuses », « femelles », « mégères », « soiffardes » et autres « laideronnes furibondes »… Louise Michel a longtemps incarné l’icône, presque unique, de la Commune au féminin ; on ne saurait pourtant faire le compte de toutes celles qui prirent part à la Révolution. Anna Jaclard en est. La jeune femme, russe d’origine, a 26 ans quand surgit la Commune. Elle intègre alors le Comité de Vigilance de Montmartre, cofonde un journal, participe à une commission visant à « organiser et surveiller l’enseignement dans les écoles de filles » et, en sa qualité d’ambulancière, soigne les blessés. Condamnée aux travaux forcés à perpétuité, elle s’exilera en Suisse. Portrait. ☰ Par Élie Marek
[lire le troisième volet de notre série « La Commune a 150 ans »]

« Adieu, intelligente et brave Russe — quelque chose de mon cœur d’il y a vingt ans s’en va avec elle. »
Elle a pour nom Anna Korvine-Kroukovskaya, mariée Jaclard depuis un jour mémorable de mars 1871 où le socialiste Benoît Malon célébra son union civile avec Victor Jaclard. Celui-ci, désormais veuf, est présent, bien sûr. On dit qu’il cessera bientôt de visiter la tombe de la défunte. Pour l’heure se resserre toute une assemblée, et celle-là fait silence. Anna, sur son lit de mort, a demandé qu’on ne prononçât pas un mot. Cela est respecté. De ce moment, Louise Michel se souviendra : « C’était la première fois, depuis 71, que je la revoyais. Elle était morte, couchée, pâle comme un marbre sur son lit environné de plantes aux larges feuilles faisant une ombre sur son visage. Je ne sais si j’aime mieux les Russes que les autres, peut-être, ils sont braves, c’est quelque chose. Devant ce lit tout blanc, environné de hautes tiges vertes, je ne sais quelle impression à la fois glacée et pleine d’espérance vous enveloppe. Adieu, intelligente et brave Russe — quelque chose de mon cœur d’il y a vingt ans s’en va avec elle. À quoi bon songer à nous, est-ce que la vague n’emporte pas les gouttes d’eau1. »
*
À plus d’un siècle de distance, chacun⋅e pourra se faire d’Anna Jaclard née Korvine-Kroukovskaya l’image qu’il ou elle souhaitera. Aussi se permet-on d’en proposer une. Si quelques clichés nous restent pour se la figurer, deux icônes peuvent être confrontées. D’abord une tunique tissée de fleurs qui, sur les bords de ce que l’on pense une gravure, s’estompe. Pour la porter une silhouette, de profil, qui fixe des lointains qu’on ne peut deviner. Des cheveux emmaillotés d’une bande de tissus surmontent un front qui descend abrupt jusqu’à la pointe d’un nez fin. Les traits sont polis et la figure également. S’il s’agit de la même femme, la photographie suivante présente Anna sous un jour tout autre. Des sourcils à l’horizon coiffent des yeux clairs que des cernes font plus étroits qu’ils ne le sont. Ces yeux-là ont fixé l’objectif le temps que des plaques s’en saisissent et scrutent depuis quiconque se penche sur le tirage. Du vêtement, les fleurs sont passées à la coiffure. Une robe sombre, boutonnée jusqu’au col et serrée d’une chaîne peine à noircir un tel portrait.
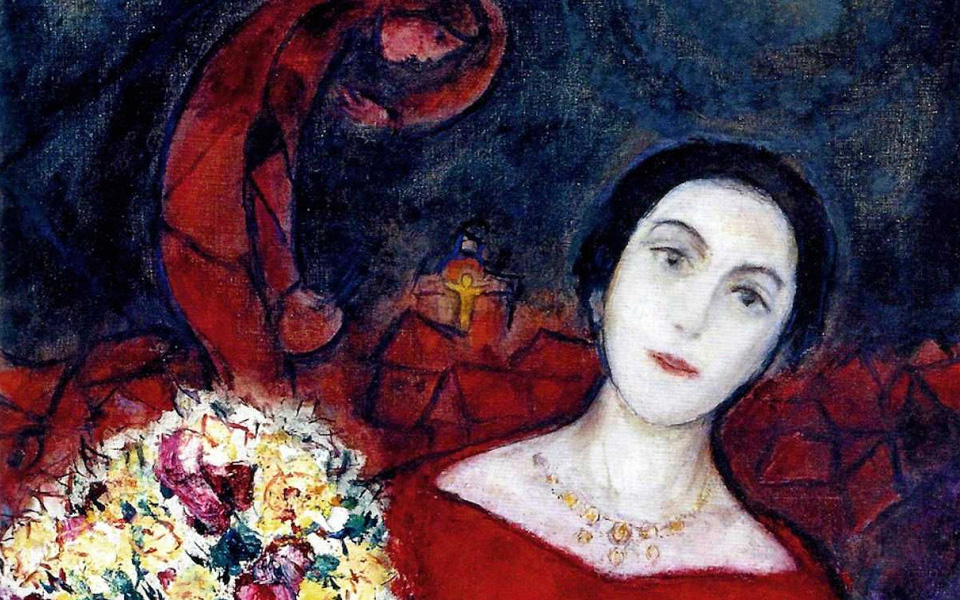
[Marc Chagall, Portrait de Vava, 1955]
*
Trente années après la mort d’Anna, les villes du pays où elle naquit changent de nom. On mène de concert collectivisation des moyens de production et mise en commun des terres. On arrête les opposants et opposantes par trop remuant⋅es et on décide par traité la fin des combats sur le front de l’Est. La ville toute proche de la propriété de Palibano où a grandi Anna ne perd pas le sien, de nom, ni n’a à craindre les débuts de la guerre civile qui prend la suite du conflit mondial. Car en cette ville, Vitebsk, trente années après la mort d’Anna, les deux révolutions de 1917 sont fêtées par l’architecture, le dessin ou la sculpture. Chagall est nommé directeur de l’École populaire des beaux-arts pour deux ans avant que Malévitch ne le supplante et n’impose son courant suprématiste dans l’avant-garde picturale. Dans les rues de la ville, des couleurs et des formes qu’aucun musée n’a abritées jusqu’alors ; dans les ateliers, une jeunesse paysanne pressée d’apprendre des peintres présent⋅es — Malevitch et Chagall, donc, mais aussi Iouri Pen, El Lissitzky, Vera Ermolaeva2.
« Qu’Anna lise les Écritures et se pique d’apprendre le français est une chose ; qu’elle introduise dans la demeure familiale les écrits révolutionnaires d’un dénommé Pissarev et d’un certain Herzen en est une autre. »
Anna ne connut Vitebsk que sous la forme d’un banal chef-lieu d’oblast3 et ne vit point les révolutions ceindre la Russie. Tout juste assistera-t-elle à l’abolition du servage une génération plus tôt, en 1861. Qu’elle soit née à Moscou en 18434 ou à Saint-Pétersbourg en 18445, il n’en demeure pas moins certain qu’elle fut élevée dans le confort de ceux qui regardent les serfs de leur domaine perchés sur un cheval. Le père est général d’artillerie et descend de l’aristocratie russo-lituanienne ; la mère est issue d’une famille allemande où la science est tenue pour importante. Anna, sa jeune sœur Sofia et son frère cadet Fiodor sont appliqué⋅es à l’étude, si bien qu’on fait venir des institutrices de France, de Suisse et d’Angleterre pour satisfaire la soif des enfants — mais, pour les deux filles, une telle éducation ne doit rien impliquer d’autre qu’une bonne tenue et de la discussion.
Qu’Anna lise les Écritures et se pique d’apprendre le français est une chose ; qu’elle introduise dans la demeure familiale les écrits révolutionnaires d’un dénommé Pissarev, journaliste enflammé qui mourut si jeune et d’un certain Herzen, père du socialisme russe, en est une autre. Il en est de même pour les activités extérieures à la maison. Les sœurs Korvine-Krukovskaya fondent un cercle où sont conviées les paysannes des alentours afin de transmettre l’instruction qu’elles ont reçue. Seront formées des institutrices, des sages-femmes, des infirmières6. Mais l’approche humanitaire, pour utile qu’elle soit, peine à satisfaire les deux jeunes femmes, qui rêvent de partir. Sofia s’en fera l’écho dans ses souvenirs : « On peut dire qu’à cette époque, entre 1860 et 1870, un seul problème préoccupait les classes cultivées de la société russe : le conflit entre les jeunes et les vieux. Une sorte d’épidémie se répandait parmi les enfants, surtout parmi les jeunes filles : le désir de s’enfuir de la maison paternelle7. »

[Marc Chagall, L'anniversaire, 1915]
Alors la fuite. C’est l’aînée, Anna, qui prend les devants, et ce en deux temps. Elle formule d’abord le désir d’étudier la médecine à Saint-Pétersbourg : il paraîtrait qu’une femme peut suivre des conférences, voire un cursus complet — quelques centaines y parvinrent un temps avant que de nouveaux statuts établis en 1863 n’interdissent leur entrée à l’Université et, l’année suivante, à l’Académie de médecine et de chirurgie8. Réponse du père : « Le devoir de toute jeune fille honorable est de vivre avec ses parents jusqu’à ce qu’elle se marie9. » Premier d’une suite de préceptes qui ne seront pas respectés. Car voici qu’en plus de lire ce qu’on lui interdit, Anna écrit et entreprend de faire publier ses nouvelles, son sexe couvert par le pseudonyme de Youri Orbelov. Deux d’entre elles trouvent place dans L’Époque, la revue de Dostoïevski, lequel débute aussitôt une correspondance avec la jeune autrice. Il se fend de compliments et d’autant de conseils : « Vous êtes une artiste. Cela signifie déjà beaucoup, et si par ailleurs il y a une perspective et du talent, vous n’avez pas le droit de le négliger. Une chose, seulement : étudiez et lisez. Lisez des livres sérieux. La vie fera le reste. Et il est également nécessaire de croire. Sans cela il n’y a rien10. »
« Très vite Anna les rejoint et se familiarise avec ce que le socialisme compte de courants divers. »
Mais lorsque Anna reçoit le fruit de ses publications, le père de nouveau s’interpose : « Aujourd’hui ce sont tes histoires que tu vends, demain ce sera toi11. » La famille fait verrou. Alors convient-il de le faire sauter par ce qui, en ce temps, le scelle : l’union. Une proposition émane de Dostoïevski d’abord. Ils se voient à plusieurs reprises à Saint-Pétersbourg. Mais Anna décline adroitement la demande — elle ne souhaite à ce moment de mariage que blanc. C’est, pour les jeunes filles d’alors, le plus sûr moyen d’échapper à la réclusion patriarcale, au point d’en devenir un motif littéraire : écrivain et révolutionnaire influent, Nikolaï Tchernychevski en fait l’une des péripéties de son Que faire ?, bréviaire de cette génération et inspiration bien connue de Lénine. Sofia s’engouffre avant sa sœur dans la brèche. Elle trouve en un jeune étudiant en paléontologie, Vladimir Kovalevski, un époux de circonstance — un « passeport vivant », selon l’historienne et écrivaine Michèle Audin — avec lequel elle passera finalement sa vie. Le père ne peut qu’accepter. Sitôt unis, Sofia et Vladimir partent pour l’Ouest afin de poursuivre leurs études. Anna, bien sûr, est du voyage. À Vienne, fugitives et fugitif se séparent : Vladimir s’y installe tandis que Sofia s’en va à Heidelberg apprendre la physique et ces mathématiques qui feront sa renommée12. Anna la suit, puis continue sa route jusqu’à Paris où elle arrive en mai 1869.
*
Tandis qu’en Allemagne Sofia Kovalevskaya renomme le logement qu’elle occupe avec quelques camarades étudiantes « Commune des femmes d’Heidelberg13 », Anna se fait embaucher comme relieuse dans une imprimerie parisienne — le père, ayant eu vent de son échappée solitaire, lui a en effet coupé les vivres. L’historienne Édith Thomas résumera ainsi la situation : « Cette grande aristocrate découvre en même temps la nécessité du travail, la misère et la révolte ouvrière14. » Les ouvriers et ouvrières du livre, typographes en tête, sont nombreux et nombreuses à participer aux rassemblements politiques qu’autorise depuis peu le Second Empire. Très vite Anna les rejoint et se familiarise avec ce que le socialisme compte de courants divers. Elle trouve auprès de Benoît Malon, membre de la jeune Association internationale des travailleurs (AIT), et de la romancière féministe André Léo deux camarades des plus sûr⋅es pour lui servir de guide. C’est Malon qui la présente au cours d’une réunion blanquiste15 à Victor Jaclard. Dès lors il ne se quittent plus, ou presque.

[Marc Chagall, Le marchand de bestiaux, 1912]
Victor porte une barbe d’herbes sèches et le cheveu court ; ses yeux, bruns, le sont un peu plus encore sous le pli du sourcil. Il est né à Metz trente ans auparavant et réside à Paris depuis cinq années. Professeur de mathématiques, il voulait y apprendre la médecine ; il a trouvé plus d’intérêt dans l’élaboration des mouvements ouvriers organisés. C’est Blanqui, d’abord, qui le séduit. Il le rencontre en 1865 à la prison de Sainte-Pélagie et l’aide à fuir la France quelques mois plus tard. Un parti tente de s’organiser autour de celui que ses soutiens surnomment « le Vieux ». Victor est des plus actifs — et donc des plus visibles. À la suite d’une manifestation, il passe la moitié de l’année 1866 en cellule. Puis, sans qu’il ne renie ses amitiés militantes, Victor se rapproche de Bakounine et adhère à La Ligue de la Paix et de la Liberté, d’inspiration anti-autoritaire, qu’anime le révolutionnaire russe. Les charges qui pèsent contre le militant s’alourdissent à mesure qu’il accroît son engagement dans telle ou telle organisation.
« Victor porte une barbe d’herbes sèches et le cheveu court ; ses yeux, bruns, le sont un peu plus encore sous le pli du sourcil. »
Ainsi, au cours d’une soirée de 1869, alors qu’il échange ses premiers mots avec Anna, l’homme se sait poursuivi. Et un an à peine après être arrivée, voici qu’Anna quitte déjà Paris, laissant derrière elle une ville qu’elle regagnera sous peu. À ses côtés Victor, son désormais remuant ami. Au-devant, Genève et la communauté des exilé⋅es russes qui comptent une jeune femme qui lui ressemble : Élisabeth Tomanovskaya, dite Élisabeth Dmitrieff. On a souvent comparé les deux femmes. Si Élisabeth Dmitrieff est plus jeune — 19 ans lorsqu’elles se rencontrent dans la ville suisse —, son parcours est en tout point similaire. Une enfance instruite sous la coupe d’un patriarche militaire ; un mariage blanc pour s’en éloigner ; des écrits qui lui inspirent ses premiers élans sociaux et la convainquent de s’expatrier, au point que l’historienne Kristin Ross perçoit dans sa lecture du Que Faire ? de Tchernychevski la cause quasiment exclusive de toute sa trajectoire existentielle et politique16. À Genève, Élisabeth Dmitrieff prend part à la diffusion des idées de l’AIT au sein d’une section russe entièrement dévolue à Marx (Netchaïev et Bakounine, dont les noms font alors frémir les polices de toute l’Europe ont été désavoués dans un même élan par les exilé⋅es regroupé⋅es en Suisse). Fraîchement arrivée dans la ville, Anna sociabilise avec ses compatriotes, découvre les réseaux locaux de l’AIT et son organe, Narodnoïe Delo (La Cause du peuple), semble d’accord pour traduire les écrits de Marx en russe.
Mais à peine se met-elle dans le sillage d’Élisabeth Dmitrieff que celle-ci s’échappe et gagne Londres. Là, elle côtoie Marx presque quotidiennement trois mois durant. Son but : « créer une convergence entre les écrits économiques de Marx et la croyance de Tchernychevski dans le potentiel émancipateur de la commune paysanne traditionnelle11 ». La production du théoricien, les décennies suivantes, restera marquée par cette rencontre. Mais le séjour d’Anna à Genève et celui d’Élisabeth Dmitrieff à Londres ne durent guère. La première retourne en France avec Victor en septembre 1870 — le pays est en guerre contre la Prusse, l’Empereur a été fait prisonnier et la République pour la troisième fois en un siècle se voit proclamée. Et, quelques mois plus tard, en 1871, la seconde s’en va participer à la Commune qui débute le 18 mars de cette année.

[Marc Chagall, Moi et le village, 1911]
*
Du 19 septembre 1870 au 28 janvier 1871, Paris est assiégée. Les conditions de vie peu enviables des plus pauvres avant la guerre deviennent pires encore. « Pas de lait pour les enfants. Les animaux du jardin des plantes apparaissent dans les boucheries sous le nom de viande de fantaisie
. On abat les arbres de Paris, mais le bois vert fume et ne chauffe pas17. » Les récits et lettres que deux femmes laisseront de cette période, Victorine Brocher et Alix Payen, témoignent de la dureté des conditions18 — la première, entre autres exemples, raconte qu’on lui donne du lait entièrement fait de plâtre et d’eau pour nourrir son enfant ; la seconde rend compte à ses destinataires du rationnement progressif que Jules Ferry, le maire de Paris, impose et de la faim qui peu à peu tenaille celles et ceux qui y sont soumis·es. On s’engage, volontaire ou par dépit, dans la Garde nationale pour défendre les remparts de la ville. Ainsi Victor est-il élu chef d’un bataillon, avant d’être révoqué puis conduit en prison, de nouveau, pour avoir participé à la tentative de soulèvement du 31 octobre19. Bien qu’il soit enfermé, il est élu maire adjoint du XVIIIe arrondissement — le maire, lui, est Clemenceau.
« Une même abnégation conduit ces femmes à se faire tour à tour ambulancières, infirmières, cantinières, soldates ou, pour certaines, tout cela à la fois. »
Dans ce quartier comme ailleurs, des comités de vigilance masculins, féminins ou mixtes, se mettent en place. Celui de Montmartre est un exemple : dirigé par la couturière Sophie Poirier, il permet l’organisation d’un atelier de confection de vêtements militaires et donne un emploi à une soixantaine d’ouvrières. Et lorsque la demande vient à manquer, l’atelier devient un vivier d’ambulancières. Ainsi le travail des femmes, objet de vives discussions à la fin de la décennie précédente, est-il un enjeu capital en ces temps de disette. Le Comité des Femmes fondé par le socialiste hétérodoxe Jules Allix en fait le cœur de son action. En son sein, Anna, ainsi que Louise Michel et André Léo, frayent avec des ouvrières dont les noms, s’ils n’ont pas marqué les registres, importent tout autant. Se joint à elles Élisabeth Dmitrieff lorsqu’elle arrive de Londres. Pendant le siège des Prussiens puis sous celui des Versaillais, une même abnégation conduit ces femmes à se faire tour à tour ambulancières, infirmières, cantinières, soldates ou, pour certaines, tout cela à la fois.
Les luttes d’influence n’épargnent cependant pas ces groupes. Des frictions naissent entre l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, émanation de l’AIT régie par Élisabeth Dmitrieff, et des personnalités comme celles d’André Léo. L’Union tente d’organiser la défense féminine et a lancé le 11 avril, jour de sa fondation, un « Appel aux citoyennes de Paris » pour que celles-ci prennent « une part active à la lutte » en cours20. Anna, elle, n’adhère pas à l’Union. Mais elle concourt aux mêmes buts. On retrouve ainsi sa signature à côté de celles d’André Léo, des citoyennes Poirier et Busard en bas d’appels du Comité de vigilance de Montmartre : « Les citoyennes de Montmartre, réunies en assemblée le 22 avril, ont décidé de se mettre à la disposition de la Commune pour former des ambulances qui suivent les corps engagés avec l’ennemi, et relever sur les champs de bataille nos héroïques défenseurs. Les femmes de Montmartre, animées de l’esprit révolutionnaire, veulent témoigner par des actes leur dévouement à la Révolution21. »

[Marc Chagall, Paris par la fenêtre, 1913]
Outre ces entreprises logistiques et sanitaires auxquelles elle prend part, Anna participe au quotidien La Sociale animé par André Léo, Eugène Vermersch et Maxime Vuillaume. Son nom n’apparaît pas dans les pages du quotidien à la ligne socialiste pluraliste, mais son implication est certaine. Surtout, elle agit pour l’éducation des filles dans la ville. En à peine deux mois, l’instruction est profondément réformée par le Comité central de la Commune et ses différentes commissions. On s’occupe de l’enseignement professionnel et technique des garçons et des filles ; on perquisitionne les écoles religieuses pour les rendre accessibles à toutes et tous ; le 21, premier jour d’une semaine qu’on dira « sanglante », « on proclame l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes11 » dans l’enseignement. Ce même jour, Anna est nommée dans une commission chargée d’organiser les écoles de filles avec, entre autres, André Léo et Noémie Reclus. Mais voilà qu’il faut se battre, se cacher et fuir.
*
« La percée de l’ennemi dans la ville fait que des barricades se dressent par centaines. Certaines sont exclusivement féminines. »
Les combats d’abord, et la place des femmes dans ceux-là. On sait que dix jours avant l’assaut versaillais, un « Bataillon des fédérées » a été mis sur pied dans le XIIe arrondissement. Mais, selon l’historien Quentin Deluermoz, la création de celui-ci, « fondé par un homme […] répond à une mission d’humiliation des soldats refusant le combat22 ». Par la constitution d’un tel bataillon (entre 20 et 100 participantes, selon les témoignages), il s’agit d’opposer des femmes capables de se battre à des hommes qui ne le sont pas, et par là de les contraindre à poursuivre la lutte. Une action symbolique toutefois vite doublée par la nécessité de se défendre de l’extérieur. La percée de l’ennemi dans la ville fait que des barricades se dressent par centaines. Certaines sont exclusivement féminines23. Une cinquantaine de membres de l’Union, encouragées par Élisabeth Dmitrieff, rejoignent ainsi celle de la rue Blanche, à Montmartre le 21 mai. De tout cela, Louise Michel témoignera : « Drapeau rouge en tête, les femmes étaient passées ; elles avaient leur barricade place Blanche, il y avait là, Elisabeth Dmihef, madame Lemel, Malvina Poulain, Blanche Lefebvre, Excoffons. André Léo était à celles des Batignolles. Plus de dix mille femmes aux jours de mai, éparses ou ensemble, combattirent pour la liberté24 ».
Si certaines, à l’instar de Louise Michel, n’ont pas attendu les derniers jours de la Commune pour combattre arme à la main, la mémoire des événements en fera peu cas : « la figure de la pétroleuse écrase alors les autres modalités d’action féminine » et participe d’une « construction sociale de l’oubli de la violence guerrière féminine11 Les exégètes immédiats n’y seront pas pour rien. Ainsi le journaliste Prosper-Olivier Lissagaray, dont son Histoire de la Commune de 1871 fit longtemps référence, s’arrête plus longuement sur la tenue et la sexualité d’Élisabeth Dmitrieff que sur ses agissements lorsqu’on lui demande dans La Revue blanche, en 1897, ce qu’il en a été des femmes pendant les événements : « Elle venait de Russie, où elle avait laissé en plan son mari… On la vit, pendant la Commune, vêtue d’une mirifique robe rouge, la ceinture crénelée de pistolets. Elle avait vingt ans et était fort belle. Elle eut des adorateurs. Soit que le peuple aux bras nus
lui plût peu à huis-clos, soit que l’amour fut pour elle un sport exclusivement féminin, nul ne put fondre ce jeune glaçon. Et c’est chastement qu’à la barricade, elle reçut dans ses bras Frankel blessé. Car elle était aux barricades, où sa bravoure fut charmante. Notons la toilette : grand costume de velours noir25. » On ne sait si Anna prend physiquement part à la lutte. Comme celle de son amie André Léo, sa trace se perd. Cette dernière, connue et d’autant plus vulnérable sera cachée par une amie jusqu’en juillet. Dans la presse, un entrefilet fait pourtant état de son arrestation, conjointe à celle d’Anna : « On annonce l’arrestation de Mmes André Léo et Jaclard, qui se sont si bien occupées des droits de la femme pendant la Commune. Elles sont prévenues d’excitation à la guerre civile, et de complicité de pillage et d’incendie26. » Depuis Versailles, un diplomate russe corrobore — cette « mégère » dit-il, de même que Victor, attend en cellule son procès27 et de pareilles allégations circulent à propos d’Élisabeth Dmitrieff. Pourtant, ni cette dernière, ni Anna, ni André Léo, ne seront arrêtées et toutes parviennent à fuir vers la Suisse. Victor, lui, n’a pas cette chance.

[Marc Chagall, Au-dessus de la ville, 1918]
La presse fait état d’une tentative de pendaison au premier jour de son enfermement dans la prison des Chantiers, à Versailles. L’intéressé n’infirmera ni ne confirmera. Deux décennies après les faits, il dira son amertume : « La Commune enfermée dans Paris, était enterrée avant d’être morte28. » Pourtant, après avoir combattu jusqu’aux dernières heures, Victor parvient à trouver où se cacher. Mais comme tant d’autres, une dénonciation le perd. L’intervention de la famille de sa compagne, par l’entremise de Sofia et Vladimir Kovalevski puis du père, rendu⋅es ensemble à Paris pour cela, le sauvera — le mariage, en ce cas, lui a peut-être bel et bien servi. Il arrive à Genève en octobre, où Anna l’y attend depuis plusieurs mois.
« Il s’agit d’apaiser les foules, de mettre ordre et mesure dans une société où la révolte, de nouveau, se fait craindre. »
Des communardes, on a dit l’oubli qui les concerne après la répression. Pourtant, « jamais une menace politique n’a autant été présentée sous la forme d’une menace sexuelle que dans les écrits portant sur la Commune de 187129 ». Plus de mille femmes sont inquiétées par la justice. Les peines sont variables et l’on s’arrête peu sur le caractère politique de leur engagement — certaines seraient même inculpées pour la seule raison d’être des femmes30. Si Anna est condamnée par contumace aux travaux forcés en décembre 1871, c’est pour un motif de droit commun. Mais tandis qu’à Paris on donne la chasse à celles que la postérité réactionnaire appellera « les pétroleuses », Anna parcourt la Suisse avec Victor avant de regagner la Russie. Ce dernier y termine ses études de médecine à Saint-Pétersbourg et assure la correspondance russe avec des journaux politiques français. Pour sa part, Anna se consacre au journalisme dans sa langue maternelle.
*
Paris. Un lundi. Ce 21 juin 1880, celui qui a proclamé voici dix années la IIIe République sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville de Paris est à la tribune, devant un parterre d’élus. Léon Gambetta est alors président de la Chambre des députés. Son discours marque les présents au point qu’il sera affiché dans toutes les communes de France. Son propos ? Réclamer, une nouvelle fois, l’amnistie pour les communards et communardes. Mais qu’on ne s’y trompe pas : la République ne souhaite pardonner le massacre qui a marqué ses premiers mois, non : il s’agit d’apaiser les foules, de mettre ordre et mesure dans une société où la révolte, de nouveau, se fait craindre. Quelques jours plus tard, une loi permet le retour de milliers d’exilé⋅es. Selon l’historienne Laure Godineau, ce fut une manière de « condamner fermement 1871 tout en prétendant l’oublier » — ainsi Gambetta clame-t-il dans son discours la nécessité de « jeter le voile sur les crimes, les défaillances, les lâchetés et les excès communs » pour que « l’oubli, le pardon, le silence [se fassent] sur la guerre civile31 ». Certain⋅es, à l’instar du géographe libertaire Élisée Reclus, réfugié en Suisse comme tant d’autres, refusent de rentrer dans un pays où le régime est plus opportuniste que social. Anna et Victor Jaclard, eux, profitent de l’amnistie et reviennent à Paris. Victor a alors quarante ans et ne cessera de s’investir dans la vie politique de la cité jusqu’à sa mort, en 1901 ; Anna compte quatre années de moins mais précèdera son conjoint d’une décennie dans la tombe. Un jour d’octobre 1887, celle-ci sera baignée d’une pluie fine et d’un silence chargé d’amitié.
Illustrations de bannière : Marc Chagall
- Louise Michel, À travers la mort. Mémoires inédits 1886–1890, La Découverte 2015.[↩]
- Sur cette épisode, voir Chagall, Lissitzky, Malévitch — L’avant-Garde Russe à Vitebsk, 1918–1922, Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou, 2018.[↩]
- Unité administrative et territoriale russe, dirigée par un gouverneur regroupant les pouvoirs civils et militaires.[↩]
- Woodford McClellan, Revolutionary exiles : the Russians in the First International and the Paris Commune, Frank Cass, 1979.[↩]
- « Jaclard Anna » dans La Commune de Paris 1871, éditions de l’Atelier, 2021.[↩]
- Jean-Jacques Marie, Les Femmes dans la révolution russe, Seuil, 2017.[↩]
- Citée dans Édith Thomas, Les « Pétroleuses » (1964), L’Armourier, 2019. Traduction de l’autrice.[↩]
- Ruth A. Dudgeon, « The Forgotten Minority : Women Students in Imperial Russia, 1872–1917 », Russian History, vol. 9, n° 1, 1982.[↩]
- Cité dans Jean-Jacques Marie, op. cit. Traduction de l’auteur.[↩]
- Cité dans Woodford McClellan, op. cit. Nous traduisons.[↩]
- Ibid.[↩][↩][↩][↩]
- Sur Sofia Kavalevskaya, voir Michèle Audin, Souvenirs sur Sofia Kovalevskaya, Calvage & Mounet, 2008.[↩]
- Anne Hibner Koblitz, Science, Women and Revolution in Russia, Harwood Academic, 2000.[↩]
- Édith Thomas, op. cit.[↩]
- Du nom d’Auguste Blanqui.[↩]
- Kristin Ross, L’Imaginaire de la Commune, La Fabrique, 2015.[↩]
- Édith Thomas, op. cit.[↩]
- Victorine Brocher, Souvenirs d’une morte vivante, Libertalia, 2017 ; Alix Payen, C’est la nuit surtout que les combats sont furieux, Libertalia, 2020.[↩]
- Une succession de déconvenues militaires et la confirmation qu’une négociation d’armistice se tient entre Thiers et Bismarck indignent les parisiens et parisiennes assiégé⋅es. Le 31 octobre, des journaux appellent à la proclamation de la Commune ; une occupation de l’Hôtel-de-Ville tourne à l’émeute ; la Préfecture de police est occupée. Toutefois, le soulèvement ne gagne pas l’ensemble de la capitale et s’apaise dans la nuit. Alors que le contraire leur a été promis, les principaux meneurs seront arrêtés.[↩]
- Cité dans Robert W. Schulkind, « Le rôle des femmes dans la Commune de 1871 », 1848. Revue des révolutions contemporaines, vol. 185, 1950.[↩]
- Cité dans Édith Thomas, op. cit.[↩]
- Quentin Deluermoz, « Des communardes sur les barricades », dans Coline Cardi et Geneviève Pruvost (dir.), Penser la violence des femmes, La Découverte, 2012.[↩]
- Alain Dalotel, « La barricade des femmes », dans Alain Corbin et Jean-Marie Mayer (dir.), La Barricade, Éditions de la Sorbonne, 1997.[↩]
- Louise Michel, La Commune (1898), La Découverte, 2015.[↩]
- « Enquête sur la Commune », La Revue blanche, tome XII, 1897.[↩]
- Dans la rubrique « Arrestations et exécutions », La Petite presse, 5e année, n° 1856, 10 juin 1871.[↩]
- Cité dans Woodford McClellan, op. cit.[↩]
- « Enquête sur la Commune », art. cit.[↩]
- Gay L. Gullickson, « La Pétroleuse : Representing Revolution », Feminist Studies, vol. 17, n° 2, 1991.[↩]
- Kathleen B.Jones et Françoise Vergès, « Women of the Paris Commune », Women’s Studies International Forum, vol. 14, n° 5, 1991.[↩]
- Laure Godineau, « L’amnistie des communards : autour du discours de Léon Gambetta, 21 juin 1880 », Nineteenth-Century French Studies, vol. 49, n° 3–4, 2021. Le discours de Gambetta est reproduit en annexe.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Kristin Ross : « Le passé est imprévisible », novembre 2020
☰ Lire notre entretien « Michèle Audin raconte Eugène Varlin », avril 2019
☰ Lire notre article « Zola contre la Commune », Émile Carme, mars 2019
☰ Lire notre article « Élisée Reclus, vivre entre égaux », Roméo Bondon, septembre 2017
☰ Lire « La Commune ou la caste — par Gustave Lefrançais », juin 2017
☰ Lire notre abécédaire de Louise Michel, mars 2017
☰ Lire notre entretien avec Mathieu Léonard : « Vive la Première Internationale ! », mai 2015


