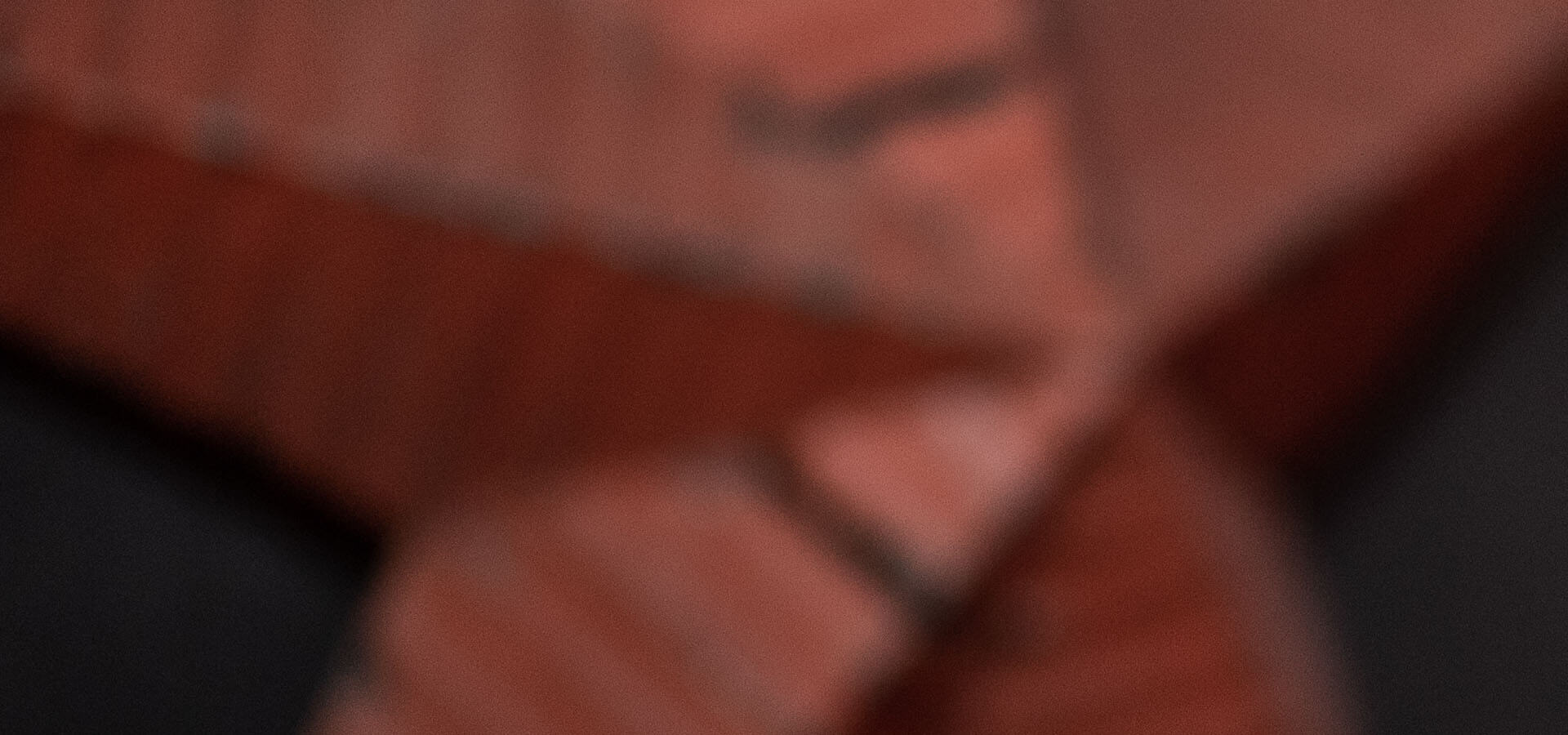Entretien inédit pour le site de Ballast
C’est là une bien vieille discussion que nous avons, dans ce café et ce deuxième volet : prendre le pouvoir ou le déserter ? Peut-être est-ce même la question politique clé, celle qui, des grands épisodes révolutionnaires aux ZAD, travaille tous les partisans de l’émancipation. L’économiste et philosophe n’en démord pas : il n’y a jamais que de l’institution. Resterait donc à habiter cette tension, à en modeler la forme, à la plier aux ambitions révolutionnaires pour affranchir le grand nombre des politiques du capital. Frédéric Lordon revient sur son soutien stratégique et critique à la France insoumise et ses liens avec la pensée libertaire, probablement moins inamicaux que la rumeur ne le dit. Mais voilà, pose-t-il : pour arracher les moyens de production, ne faudra-t-il pas une force organisée capable d’affronter ses si puissants détenteurs, avec fracas au besoin ?
[lire le premier volet] [lire en espagnol]

Je n’en ai pas la moindre idée. Je me demande même si on peut répondre ex ante1 à une question pareille. Je veux dire : le contour exact de la force ne se révèle-t-il pas dans le moment et dans le mouvement seulement ?
Trotsky avait bien quelques idées : renverser le pouvoir central, s’emparer de l’État, abolir la propriété du sol, répudier la dette, nationaliser à tour de bras et créer une armée pour mater la contre-révolution…
« Il me semble que le réalisme élémentaire en politique commande de voir où est la force, où est la dynamique, et d’en prendre acte si on n’est pas capable de faire mieux soi-même. »
Ça, c’est une idée stratégique quant à l’action. Il reste à former l’idée stratégique quant à la composition de classe capable de soutenir l’action. Au reste, cette idée-là, Lénine et Trotsky l’avaient bien un peu ! Je ne sais si c’est une manière de me dédouaner à peu de frais d’une carence évidente, mais tout de même, la situation de classes contemporaine est passablement compliquée, et rend spécialement ardu de trouver « le » mot d’ordre tranchant approprié à l’époque, tranchant, c’est-à-dire simple et transversal, un équivalent fonctionnel de « Le pouvoir aux soviets, la terre aux paysans, la paix au peuple, le pain aux affamés » de 1917. Et pourtant, sans ce germe, il n’y aura pas de précipité.
Votre dernier article atteste, en creux, un soutien à la France insoumise — ou, plutôt, d’une critique des forces qui ne l’ont pas soutenue. On se souvient aussi, au micro de Là-bas si j’y suis, en 2017, de votre appréciation à l’endroit de Mélenchon, en tant qu’il est porteur, « pour la première fois depuis très longtemps, […] d’une différence significative de gauche dans le paysage de l’offre politique ». Est-ce un appui au mouvement pour ce qu’il est ou, plus prosaïquement, à la force qui se trouve, à ce temps t, avoir la main sur la contestation électorale en France ?
On ne saurait mieux formuler la question. Il me semble en effet que le réalisme élémentaire en politique commande de voir où est la force, où est la dynamique, et d’en prendre acte si on n’est pas capable de faire mieux soi-même. La dynamique, évidemment pas n’importe laquelle : la dynamique à gauche. Or, ici, je vois trois choses. La première, c’est que Mélenchon a réussi en 2017 ce que tout le monde réclamait à cor et à cri depuis 30 ans sans y être jamais parvenu (et pour cause : il faut voir qui réclamait et comment, je veux dire avec quelle ligne politique) : à contester l’emprise du FN sur les classes populaires, à faire reculer l’abstention de ces dernières pour les ramener à gauche, et ceci sans rien perdre sur les autres segments sociologiques de l’électorat puisque le vote FI a été remarquablement transclasses. Toute position politique, dans la situation actuelle, qui n’est pas capable de prendre acte de ça me semble nulle et non avenue — évidemment sous réserve de la question préjudicielle de savoir si le jeu électoral-Ve République a quelque intérêt. En tout cas, on en connait parmi les initiateurs du « Manifeste pour l’accueil des migrants » qui, voyant là leurs propres critères enfin comblés, auraient dû en bonne logique manifester leur ralliement — sous toutes les modalités critiques qui leur conviennent. Mais il y a des défaillances de la logique qui n’en finissent pas de trahir les autres logiques.

[Stéphane Burlot | Ballast]
La deuxième chose, c’est que Mélenchon, à deux semaines du premier tour, a commencé à semer l’inquiétude sur les marchés financiers — où s’est formée une « prime de risque Mélenchon » sur les titres de la dette publique française. Salvini peut le faire aussi, ça n’est donc pas une condition suffisante, mais ça fait au moins une condition nécessaire. Condition de quoi ? De ce que le vrai pouvoir, qui est le pouvoir de la finance, vous identifie comme son ennemi. L’inquiétude de la finance à l’endroit de Salvini n’ira jamais très loin. Elle a compris à quoi elle avait fondamentalement affaire : à ce mélange de néolibéralisme et de proto-fascisme si bien porté par les temps qui courent — et l’orchestration de la gigantomachie2 entre Macron et Salvini, faux ennemis et vrais semblables, est une de ces impostures que seule l’immense bêtise éditorialiste croit devoir soutenir. À cet égard d’ailleurs — et c’est la troisième chose —, si l’on étend le périmètre des pouvoirs au-delà de la finance, et notamment en direction des médias, la haine universelle que s’attire la FI me semble un indice encourageant. Les médias mainstream, c’est le canari au fond de la mine : des indicateurs avancés. Mais dont les avertissements, pour être convenablement lus, demandent de se souvenir qu’ils sont des instances de consécration négative. C’est vrai d’ailleurs en toutes matières : littéraire, intellectuelle, et bien sûr politique. L’endossement par ces médias est l’indication la plus sûre de la parfaite innocuité dans le meilleur des cas, de l’irrémédiable nullité dans le pire. Ces médias sont devenus des instruments de mesure d’une totale fiabilité : si l’on met de côté le cas du FN, mais tellement grossier qu’il n’est plus discriminant en rien, il suffit de regarder à l’envers de l’aiguille, à part quoi on n’est jamais trompé. Que les médias débordent ainsi d’une haine incoercible à l’endroit de la FI, c’est sans doute ce qui peut lui arriver de mieux.
« La prévisible inondation d’enthousiasme dont la candidature de Glucksmann va faire l’objet dit déjà tout ce qu’il y a à en penser. Il les aura tous à ses pieds — onction de l’insignifiance. »
Et la compulsion de détestation est telle que tout ce qui de près ou de loin s’assimile à la FI aura droit au même traitement. Ainsi du Média, qui a fait l’objet d’un accueil exorbité comme on n’en a jamais vu, là où d’habitude la corporation se répand en « bienvenues » sucrées, et qui n’a plus été ensuite que le centre d’une fixation écumante, hystérique. Ainsi tombent les masques, et l’on aperçoit d’un coup que la « confraternité » journalistique n’était que le vêtement présentable des complicités idéologiques fondamentales. Mais on n’a jamais rien à perdre aux épreuves de vérité. Au moins on sait qui dérange quelque chose et qui ne dérange rien — au demeurant, c’était ça aussi l’une des intentions de mes textes sur les appels « climat » et « migrants » : qu’est-ce qu’ils dérangent ? Rien. Les intérêts dominants sont parfaitement capables de discriminer ce qu’ils peuvent tolérer, comme agitation inoffensive, et ce qui les menace pour de bon. À ce compte, la prévisible inondation d’enthousiasme dont la candidature de Glucksmann va faire l’objet dans la presse de gauche de droite ou de gauche incertaine dit déjà tout ce qu’il y a à en penser. Libération, Le Monde, L’Obs, Les Inrocks, Télérama, France Inter, France Culture, Mediapart évidemment : il les aura tous à ses pieds — onction de l’insignifiance. Dans ces conditions, le dégondage généralisé dont la FI a été le déclencheur ne peut être qu’un signe intéressant. Se faire haïr des marchés financiers, se faire haïr de la presse du capital, ce sont des accomplissements tout à fait honorables.
Est-ce que ceci suffit pour faire une adhésion pleine et entière à la FI ? Certainement pas. Pour plusieurs raisons d’ailleurs. La première tenant aux incertitudes qui entourent et la personne (pour ne pas dire la personnalité) de son chef et la ligne politique du mouvement, dont le flottement présent est visible. On a le sentiment que la FI n’a pas grand besoin de l’hostilité ambiante : elle est à elle-même son premier risque, et on la sent très capable de s’infliger toute seule de sérieux dommages — parmi lesquels ceux qui tiennent à ses hésitations stratégiques actuelles ne sont pas les moindres. Je passe sur les critiques du populisme de gauche qu’on lui oppose désormais presque par réflexe, non pas d’ailleurs que j’épouse cette doctrine — je sais très bien où sont mes différences —, mais parce que ces critiques sont le plus souvent d’une telle malhonnêteté intellectuelle, d’un tel refus de lire ce qui est vraiment dit, parfois capables de telles honteuses fabrications (très récemment, Roger Martelli n’a pas hésité à lui faire endosser par insinuation le « grand remplacement »3, c’est dire le point d’aveuglement où peut mener la détestation viscérale), qu’on en reste bras ballants. Pourtant, ça n’est pas qu’il n’y a rien à dire.

[Stéphane Burlot | Ballast]
Par exemple, ce n’est que dans des caricatures du « peuple » que l’opération politique de construction d’un peuple passe par l’exaltation patriotarde. À ce compte-là comme on sait : l’original, la copie… La ratification de ce que la sociologie spontanée des éditorialistes prête au « peuple » est rarement une riche idée. Alors où en est vraiment la FI ? D’un côté François Ruffin, qui par ailleurs a aussi ses taches aveugles, sur les banlieues notamment, avait fait campagne en Picardie contre le FN avec une idée simple et forte : « Votre problème ce ne sont pas les immigrés, ce sont les actionnaires », et ça, ça fait une ligne claire, juste, et gagnante. De l’autre, un « orateur » de la FI [allusion à Djordje Kuzmanovic, ndlr] s’offusque qu’on ait renoncé à un défilé militaire pour commémorer « la victoire contre l’Allemagne », et c’est accablant. Car on se demande s’il peut y avoir une seule autre chose à commémorer le 11 novembre que la fin de la boucherie. Or la FI, ou plutôt son état-major, ne cesse pas de produire une nuée de signaux contradictoires, qui disent la croisée des chemins stratégiques et donnent à s’inquiéter que ce ne soit pas le bon qui soit pris.
« La FI, ou plutôt son état-major, ne cesse pas de produire une nuée de signaux contradictoires, qui disent la croisée des chemins stratégiques et donnent à s’inquiéter que ce ne soit pas le bon qui soit pris. »
Retour donc à cette vérité de toujours que les formations politiques ne doivent jamais être laissées sans surveillance. Ni avant, ni après — l’élection. Encore moins après. À plus forte raison quand la FI porte un projet explicite de perturber quelques grands intérêts — où réside la considération qu’on lui doit. Or perturber de grands intérêts signifie s’apprêter à rencontrer de grandes résistances. Donc être capable de leur opposer une grande détermination. Et sinon se trouver défait en rase campagne, en très peu de temps d’ailleurs. Et puis quoi ? Et puis finalement, les institutions sont bien confortables, et si on n’« y » arrive pas parce que c’est trop difficile on se calera dans les fauteuils moyennant quelques compromis de façade. Je me suis toujours demandé par exemple si Mélenchon président ferait sauter, comme il l’a parfois évoqué, les structures de la propriété médiatique, ou bien s’il ne serait pas enclin à négocier un deal de non-agression, illusion d’atermoiement qui serait une terrible erreur : avec le retrait de la circulation internationale des capitaux et la définanciarisation, la déprivatisation/socialisation des médias est le prérequis sine qua non de toute expérience gouvernementale de gauche. Je crois, ensuite, que j’ai cessé de me demander si, en matière européenne, il actionnerait le plan B après l’échec du plan A, ou s’il ne se contenterait pas de quelques avancées cosmétiques afin de donner le plan A pour un immense succès et se dispenser du B. Etc. Tout ceci pour dire que l’essentiel en fait se joue ailleurs : dans les têtes, où il faut impérativement installer l’idée — contre-intuitive — qu’à la fin du cycle électoral (disons après le second tour des législatives), en fait tout commence. On voit tout de suite la difficulté : il s’agit de refaire ni plus ni moins qu’un habitus politique, de défaire l’habitus de la passivité, de la dépossession électorale, pour lui substituer un habitus de l’intervention populaire « permanente ». Un gouvernement décidé à bousculer les intérêts dominants n’a aucune chance s’il n’est pas appuyé par une rue puissante.
Sous réserve de savoir « si le jeu électoral-Ve République a quelque intérêt », nous disiez-vous tout à l’heure. Mais justement : pourquoi croire que ce jeu en vaut la peine ? Des libertaires ou des communistes balaient d’un revers de la main le champ parlementaire, tenu pour intrinsèquement verrouillé…
Parce que je persiste à considérer que les deux exercices ont du sens : celui d’une pensée stratégique dans les institutions du capitalo-parlementarisme, comme dirait Badiou, et celui d’une pensée qui envisage au contraire de les faire sauter. Les deux exercices ont du sens car ils appartiennent à des temporalités différentes, et qu’il est difficile de renoncer à ce qui peut être fait là, tout de suite, même si on en connaît les limites, mais au moins sans avoir à attendre « la révolution » ou, comme dit aussi Badiou… la sortie du néolithique. Par conséquent, la pensée de la sortie du cadre « régule » la pensée de l’opération dans le cadre, à laquelle elle fournit des avertissements plus qu’utiles, mais ne l’invalide pas en tant que telle : car ces deux registres appartiennent finalement à des plans stratégiques différents, hétérogènes — ce qui n’empêche pas qu’il faille être très attentif à ces conjonctures particulières où le second plan se déverse sans crier gare dans le premier, où la logique du « hors-cadre » fait brutalement effraction dans le cadre. En tout cas, il faut comprendre la puissance de l’attracteur électoral. Et comprendre aussi que cette attraction n’est pas totalement égarée. Comprendre la puissance de l’attracteur parce qu’il est assez logique que les individus voient dans le pouvoir politique et la prise de l’État le débouché évident d’une aspiration politique : par la saisie d’un instrument de transformation. C’est ici, bien sûr, que la pensée marxiste avertit, à raison, de l’illusion qui tient à une idée de l’État « instrument neutre », indifféremment offert à tous les projets de transformation. C’est une erreur typique de la pensée héroïque-individualiste de penser que le grand homme mis à la tête de l’État devient ipso facto le maître de l’instrument-État. Comme si la structure n’avait pas son épaisseur et sa vie propre.

[Stéphane Burlot | Ballast]
Et cependant l’illusion de la conquête électorale de l’État n’est pas entièrement illusoire quand elle voit, au moins intuitivement, que face aux puissances macroscopiques du capital qui mettent l’entièreté de la société sous coupe réglée, on n’opposera jamais qu’une autre puissance macroscopique. Et que, pour toutes ses tares, la seule qui soit constituée, disponible, c’est celle de l’État. Voilà, c’est un argument pragmatique d’échelle. Je veux bien tout ce qu’on veut : contourner les élections, l’État, mais je demande alors qu’on me montre la puissance macroscopique alternative capable de faire le travail. Le travail de rouler sur le capital. Ça n’est pas la peine de m’opposer que l’État est tellement colonisé par les hommes du capital qu’il est devenu État-du-capital. Non pas que la chose ne soit pas tendanciellement vraie aujourd’hui. Mais parce qu’elle ne fait pas une vérité d’essence, je veux dire pas une vérité pure — même dans le capitalisme. Ici : avalanche d’objections, de contre-objections à leur opposer. Je m’arrête, c’est une discussion tellement vaste qu’il est impossible de l’avoir maintenant.
Votre ouvrage On achève bien les Grecs a donné à voir les critiques implacables que vous avez formulées à l’endroit de Podemos et de Syriza. La France insoumise serait donc en mesure de résister davantage à l’Union européenne et aux politiques du capital ?
« Iglesias s’est affalé depuis l’été 2015, avouant qu’il ne ferait pas grand-chose de plus que poursuivre un programme social-démocrate des plus classiques — comprendre : des plus molasses. »
Un peu quand même, j’espère. Syriza, l’affaire était entendue dès le début. Sans la moindre velléité de tenir le rapport de force par une menace crédible de sortie de l’euro, et avec pour toute ressource de compter sur le bon vouloir démocratique de l’UE — il fallait être vraiment cinglé, ou complètement duplice —, le gouvernement Tsipras ne pouvait que finir piétiné. Podemos, c’est encore plus simple. Iglesias s’est affalé depuis l’été 2015, avouant qu’il ne ferait pas grand-chose de plus que poursuivre un programme social-démocrate des plus classiques — comprendre : des plus molasses. Quant à la question de l’euro, elle a déjà été formellement évacuée : on ne se donnera même pas la peine d’un simulacre à la Tsipras, c’est-à-dire on demandera poliment, on s’entendra dire non, et ça ira très bien comme ça. Peut-être même d’ailleurs qu’on ne demandera rien. Procédons par comparaisons homogènes : les intentions de papier de la FI sont dès le départ beaucoup plus fermes que celles de Syriza ou Podemos, notamment, mais pas seulement, dans la confrontation européenne. Et ceci n’est pas rien. La question, bien sûr, c’est : qu’est-ce qui reste des intentions dans la pratique du pouvoir ? Je viens de dire ce que j’en pensais, ou plutôt ce que je redoutais. Mais comme on n’en finira jamais de sonder les cœurs et les reins ou de lire le marc de café pour se faire une idée de la fermeté « réelle » des leaders politiques propulsés au pouvoir, il faut plutôt faire pivoter la question de « ce qu’il est permis d’espérer ».
Dont la réponse réside non pas dans l’idiosyncrasie4 cachée de quelques individus mais dans une configuration : celle que la rue formera, ou pas, avec un gouvernement de gauche, celle qu’un gouvernement de gauche laissera, ou pas, la rue former avec lui. Avec/contre évidemment. À cet égard d’ailleurs, il n’est pas illégitime de se demander ce que ça donnerait la police-justice de Mélenchon face à des mouvements sociaux un peu énervés. Aussi bien sa personnalité que les institutions de la Ve ne portent pas à la tolérance aux contrariétés. Or c’est bien de cela qu’il s’agirait : de nouer le bon rapport avec la rue comme puissance de contrariété, avec tout ce que ceci suppose d’affranchissement d’avec les formes ritualisées, embaumées, impuissantes, de la manifestation Bastille-Nation. Je dis « la rue » mais je pense aussi aux occupations d’usines, de bâtiments vides, de nouvelles zones d’expérimentation, aux prises de pouvoir sur le terrain, à toutes ces formes d’action qui font la puissance d’un débordement, et pour finir d’un rapport de force global dans la société.

[Stéphane Burlot | Ballast]
Tout ça fait donc un tableau contrasté. Mais, en définitive, de même qu’on « fait » avec les ressources passionnelles que nous offre la conjoncture, on fait avec ses ressources partidaires. Sauf conception angélique, ou totalement égocentrique, de la politique, il y a peu de chances qu’il se trouve une conjoncture où les unes et les autres nous conviennent parfaitement. Mais voilà, c’est ça qui est sur la table. Ça détermine une attitude — quelque part entre l’inconditionnalité et le mépris ou le refus outragé de tout ce qui n’est pas exactement soi. La première est dangereuse, mais les seconds sont désolants. Ne pas faire droit à la considération élémentaire que mérite une force existante, quand tout a à ce point inexisté à gauche depuis si longtemps, c’est de la jouissance de, et dans, l’impuissance.
« Un nombre relativement restreint d’individus, mais extrêmement déterminés, peuvent mettre à genoux une société entière », avez-vous déclaré un jour. Du blanquisme à Action directe, les sociétés ont pourtant tenu. À quoi songiez-vous ?
« On ne transforme pas les rapports sociaux en s’y soustrayant à quelques-uns. Un îlot anticapitaliste ne supprime pas le capitalisme : il y laisse tous les
continentaux. »
C’est une idée très présente dans mon esprit, mais dont je ne fais absolument rien ! Politiquement parlant, je veux dire. Je ne crois pas du tout à la possibilité blanquiste. La création du chaos dans l’espoir de défaire les ancrages, rouvrir des degrés de liberté et rendre possible de reconfigurer me semble une idée stratégique largement illusoire. On pense aux Démons de Dostoïevski, et on sait comment ça se termine. En fait cette évocation n’est pour moi que l’objet d’une méditation théorique sans conséquence. Mais il est vrai que j’éprouve assez vivement ce sentiment d’ambivalence que m’inspire l’ordre social : à la fois très solide, pesant, écrasant même, et simultanément très fragile, susceptible d’être déstabilisé par fort peu de chose. Fort peu de chose mais qui porterait — là, le Comité invisible a assurément perçu un truc — sur la continuité des flux. Les lieux névralgiques de la stabilité sociale sont moins à situer à l’Élysée que dans les données les plus prosaïques sous lesquelles s’organisent les circulations de la vie matérielle. Il suffit de voir ce que « peuvent » trois centimètres de neige en banlieue parisienne. Alors un petit groupe de personnes déterminées qui voudraient se faire l’équivalent fonctionnel de la neige…
Vous avancez que « la politique, la vraie, ça se fait par le grand nombre », donc par l’organisation, donc par un refus de l’horizontalité totale, donc par la capture et la dépossession. Dans En quel temps vivons-nous ?, Rancière pose, comme alternatives, les « oasis » et les « îles ». Bâtir une communauté anticapitaliste en marge du système, est-ce vraiment de la « fausse » politique ?
Non, mais ça n’est que l’amorce de la « vraie » — qui est en effet celle du grand nombre. La politique d’émancipation (je dois dire que je commence à manquer d’enthousiasme pour ce concept qui devient passablement insipide à force d’avoir été mâchonné, moi compris), c’est celle qui vise la transformation de tous les rapports sociaux où se trouvent inscrites les formes variées de la domination. Mais il suffit de formuler le problème en ces termes pour aussitôt apercevoir qu’il est d’échelle macroscopique. On ne transforme pas les rapports sociaux en s’y soustrayant à quelques-uns : on ne réalise par-là qu’une soustraction microscopique. Un îlot anticapitaliste ne supprime pas le capitalisme : il y laisse tous les « continentaux ». Pour autant, il démontre le mouvement en marchant. Ce qui est d’une inestimable utilité. À la condition bien sûr de préparer un retour vers le continent : la généralisation. Si l’isolat n’est pas porteur de cette logique du retour, il reste pré-politique — au sens que nous donnons ici à ce terme, car bien sûr en soi il est une politique. Le capitalisme pourra même se payer le luxe symbolique de la tolérance pluraliste tant qu’il percevra que quelques défecteurs ne lui font finalement aucun tort véritable. En revanche il prend les choses très au sérieux quand, comme ce fut le cas avec Lip en 1973, son protecteur étatique se met à redouter que tout ça finisse par « véroler tout le corps social et économique », ainsi que l’aurait dit aimablement Giscard à ce moment-là. Donc un isolat, oui, pour cultiver le bacille. Mais après il faut que ça se répande.

[Stéphane Burlot | Ballast]
Mais je me méfie aussi des espoirs inconsidérés dans les isolats qui sont des dynamiques fragiles, précarisées par le fait de ne pas toujours porter avec elles leurs propres conditions de possibilité — par exemple ça n’est pas simple d’être un isolat anticapitaliste au milieu de l’adversité capitaliste —, mais aussi réversibles. Les défections individuelles sont-elles le produit de bifurcations profondes ou d’un mauvais moment qui fait faire — temporairement — de nécessité vertu ? Par exemple, Pepita Ould-Ahmed a montré combien les clubs de troc argentins, qui n’étaient pas avares de ronflants discours alter-monétaires, voyaient en réalité leurs effectifs fluctuer en parfaite corrélation avec la conjoncture et, notamment, refluer dès que celle-ci s’améliorait. Je ne dis pas que ceci fait un modèle général ou dessine quelque fatalité. Il reste que la viabilité d’un « autre monde », quelle que soit la variété interne qu’on aspire à lui donner, passe nécessairement par quelque consolidation macroscopique — donc par le grand nombre. Abolir la propriété privée des moyens de production, c’est-à-dire la possibilité que le petit nombre mette la main sur les outils du grand, ça ne se fera pas à coup d’isolats. Le droit, c’est de la macro-politique.
En plus de cette appréciation politique, stratégique, existe-t-il chez vous un jugement d’ordre moral ? En gros, trouver élitiste ou égoïste celui ou celle qui dirait « Les masses sont aliénées, les gens sont des abrutis devant leur télé, je fais sécession, je me tire du régime capitaliste ! ».
« L’époque regorge d’expériences passionnantes de toutes sortes et de toutes échelles. Et parmi les plus connues : le Chiapas, le Rojava. »
Certainement pas, en tout cas pour ce qui est de la décision de sécession solitaire. Ce qui en revanche, dans le cas que vous me soumettez, appellerait à coup sûr du jugement de ma part, ce serait la partie de la proposition « les gens sont des abrutis devant leur télé », énoncé caractéristique de l’extrême gauche morale qui, sous ce rapport, ne vaut pas mieux que la gauche morale tout court : même sentiment d’exemplarité, même mépris pour tout ce qui est jugé ne pas être à sa hauteur, même incapacité à comprendre — qui n’est pas une surprise quand on voit parfois les incapacités à simplement lire. Et, ici, pour comprendre ce que signifie comprendre, il faut sans doute renvoyer, de nouveau, à La Misère du monde, et à un texte merveilleux où Bourdieu donne à voir son spinozisme comme nulle part ailleurs — il s’intitule… « Comprendre ».
En cherchant les expériences politiques qui ont votre faveur, au XXe siècle, nous n’avons trouvé que deux cas : les Soviets des premiers temps, avant captation bolchevik, et la parenthèse autogestionnaire de Lip — que vous venez justement d’évoquer. Autrement dit, des expériences souvent prisées par ces libertaires que vous secouez dans Imperium ! On sait votre regard ambivalent à leur endroit, teinté d’« admiration » et de « sérieux désaccords » : quelles seraient les conditions d’une alliance durable ?
Je ne voudrais pas trop laisser le sentiment qu’à part les Soviets et Lip, rien !, et qu’il n’y a que deux grelots dans ma tête. L’époque regorge d’expériences passionnantes de toutes sortes et de toutes échelles. Et parmi les plus connues : le Chiapas, le Rojava. Pour le coup, là on est dans la macroscopie. Sans aucun paradoxe, j’y vois des confirmations de mon point de vue : dans l’un et l’autre cas nous avons affaire à des structures institutionnelles (qui pourrait nier que le Chiapas et le Rojava sont des ensembles institutionnels ?) architecturant des communautés politiques, et pouvant à ce titre être dites de nature fondamentalement, c’est-à-dire conceptuellement, étatique, mais sous des formes qui les différencient du tout au tout d’avec les nôtres. C’est exactement ce qu’essayait de dire Imperium. Par construction (je dirais presque : par concept du concept), le concept excède radicalement les particuliers qu’il subsume5 et ne se laisse réduire à aucun d’eux — sauf à n’être qu’une simple dénomination, ou bien une catégorie taxinomique, mais pas un concept. Ainsi le concept d’État n’est-il livré par aucun des États contemporains, qui n’en sont que des réalisations particulières, ni en fait par aucun État empirique historique. Il n’y a donc aucun paradoxe à soutenir la nature étatique du Chiapas ou du Rojava. Mais c’est sans doute un effet de ma mauvaise nature universitaire que cette obstination conceptuelle quand, ici, l’essentiel est ailleurs : au Chiapas, au Rojava, il se passe ce petit miracle : quelque chose d’autre.

[Stéphane Burlot | Ballast]
En tout cas, pour ce qui est de vos conditions d’« alliance », le préalable à toute discussion possible, c’est que ce qui est écrit soit lu ! Imperium multipliait les avertissements de lecture tout à fait explicites : « Attention, ceci est une théorie positive6 de l’État ; faire une théorie positive n’est pas faire une apologie, ni procéder à une réhabilitation
. » Tout était écrit. Rien n’a été lu. Enfin par certaines catégories de lecteurs. Mais c’est ça le problème de la « pensée militante ». Ça n’est pas une pensée qui cherche à penser, c’est une pensée qui ne cherche qu’à reconfirmer. En ce sens, elle est — littéralement — inamovible : incapable de déplacement. Or penser, c’est se déplacer ; et, symétriquement, travailler (dans la théorie, le cinéma, la littérature, le théâtre, etc.) c’est produire des effets de déplacements — d’abord en soi, en espérant qu’ils se feront sentir sur les autres. Mais quid si les sujets de la réception ont décidé de ne pas bouger ? C’est ma phobie du monoïdéisme : l’inamovible. Or les idées ne bougent que les unes par les autres, dans leur tension réciproque. Il en faut donc au moins deux. Exemple : les institutions — encore et toujours. Les institutions, 1) c’est la merde, mais 2) de quelque manière, nous sommes condamnés à vivre dans un environnement institutionnel. J’habite ce lieu. Qui m’expose d’ailleurs à être incompris de tous les côtés. Cependant, pour ne pas avoir l’air de rechuter dans mes travers, je m’empresse d’ajouter que tout ça est loin de n’être qu’un problème conceptuel : c’est un problème politique pratique. Ne pas comprendre le fait institutionnel, c’est s’exposer à le voir resurgir, possiblement sous des formes détestables, alors qu’on croyait s’en être débarrassé.
Dans Maintenant, le Comité invisible avance que ce n’est pas de votre « faute » si vous n’êtes pas en mesure de penser une révolution sans institution. Cette divergence fondamentale a-t-elle partie liée avec une divergence anthropologique, à savoir ce que vous nommez dans Les Affects de la politique votre « réalisme anthropologique critique » ?
« Les anthropologies qui, quelles que soient leurs raisons, font l’impasse sur la violence m’ont toujours semblé nulles et non avenues. »
C’est sans doute un trait de complexion, que j’aime à fréquenter des bords réputés incompatibles. Mais au moment de faire mes synthèses, je ne prends pas tout indistinctement. Le legs de l’Autonomie italienne, la reprise situ d’une analyse de la crise exhaussée dans le plan de la critique des formes contemporaines de l’existence — le seul qui soit à la hauteur de la situation présente —, le doigt d’honneur permanent aux institutions, et puis aussi un certain air intellectuel et politique, c’est ce que je prends dans le Comité invisible. Maintenant, ce que je ne prends pas : la méconnaissance du nombre, c’est-à-dire de ce qu’une transformation révolutionnaire ne peut pas être une affaire réservée à des virtuoses (mais à ce sujet, il faut être honnêtes : ils se sont sensiblement déplacés), la croyance que la vie collective défaite de toute forme institutionnelle est une possibilité. La question anthropologique-institutionnelle est à coup sûr notre ligne de partage des eaux. L’anthropologie libertaire, à laquelle peu ou prou le Comité invisible s’affilie, pense avoir posé quelque chose avec le refus de l’anthropologie hobbesienne, requalifiée comme prétexte théorique, fausse nécessité instrumentalisée en vue de la domination d’État. Mais c’est très insuffisant si, comme c’est le plus souvent le cas, n’y est substituée que l’anthropologie complémentaire, symétrique inverse, de l’Homme être coopératif « par nature », en tout cas libéré de son « individualisme possessif », comme dit Macpherson, et au cœur duquel la violence n’est pas un problème fondamental. Or, pour ma part, je crois le contraire. C’est d’ailleurs presque une question de logique : le contraire de la proposition « l’Homme est toujours A » n’est pas « l’Homme n’est jamais A » mais « il est des cas où l’Homme est non-A ». Ce qui n’exclut pas qu’il soit A dans d’autres cas. On a compris : ici « A » = « violent ». Je crois que la violence est l’une des données essentielles du réalisme anthropologique. Les anthropologies qui, quelles que soient leurs raisons, font l’impasse sur la violence m’ont toujours semblé nulles et non avenues. On se demande parfois si les anthropologues libertaires ont lu un peu de littérature et, si oui, ce qu’ils en ont fait. Parce que toute la littérature ne parle que de ça : de la disconvenance passionnelle. Il faut un gros moral pour faire l’impasse sur un massif aussi énorme, si universellement raconté.
Et cette mention « critique », que vous ajoutez à « réalisme anthropologique » ?
C’est pour en faire autre chose que ce qu’il est d’habitude, à savoir une machine à ratifier l’ordre des choses. En réalité le problème du choc des anthropologies hémiplégiques — à ma gauche « l’Homme bon », à ma droite « l’Homme méchant » — est d’une telle absurdité qu’on se demande ce qui rend impossible à ce point d’en apercevoir l’évidente solution : « l’Homme » est capable de l’un comme de l’autre, et la seule question intéressante, là encore, est celle des formes institutionnelles qui organisent la vie collective, et qui se différencient selon leurs propriétés à activer davantage l’une ou l’autre des possibilités de « l’Homme » : la possibilité violente ou la possibilité coopérative. Tout ça est très sommaire, et il y aurait beaucoup à dire pour préciser les contours conceptuels de cette entité hautement problématique — l’« Homme » (qui, bien sûr, n’existe pas). Mais c’est peut-être déjà suffisant pour déterminer les termes d’une alternative : ou bien la condition humaine n’en a jamais fini avec la disconvenance passionnelle et alors il faut lui trouver des solutions d’accommodation, lesquelles ne peuvent consister qu’en quelque forme de médiation, au sens le plus général du terme, c’est-à-dire d’institution : une institution, c’est une médiation, quelque chose qui médiatise et informe les rapports inter-humains ; ou bien la convenance est garantie par la bonne nature humaine et alors, évidemment, on peut se passer de tout. On a compris où j’étais. J’y suis même plutôt deux fois qu’une.

[Stéphane Burlot | Ballast]
C’est-à-dire ?
Ma thèse est que, par institution, il faut comprendre génériquement l’opération de la puissance du collectif. Du collectif et non de la collection. Car en termes spinozistes le collectif est un mode, il est/a donc une puissance, et cette puissance s’exerce nécessairement. Évidemment pour accéder à cette conception de l’institution, il faut en abandonner les définitions par ostension : « l’institution, c’est ça », et l’on montre du doigt une institution particulière, le feu rouge, l’État français, la Sécurité sociale, etc. Mais c’est toujours la même erreur : l’échec de la conceptualisation par obnubilation sur un particulier. Un cas d’institution bouche l’horizon, sature nos affectabilités présentes, et nous en faisons l’institution. Mais c’est juste une inflation-transfiguration de notre affect, pas un concept. Avec l’institution comme manifestation de la puissance du collectif, on commence à avoir un concept. Évidemment un concept très sous-déterminé — mais comme tous les concepts. Auquel il faudra ajouter beaucoup de choses (particulières) pour lui faire rejoindre des cas empiriques (particuliers). Mais qui permet au moins de comprendre que, si par institution il faut comprendre l’effet de la puissance du collectif telle qu’elle s’exerce nécessairement, s’il faut comprendre que le fait institutionnel est le mode d’existence même du collectif en tant que collectif, alors l’idée de la vie sans institution apparaît pour ce qu’elle est : une pure chimère, et même une contradiction dans les termes. « De l’institution » se recréera nécessairement car nécessairement la puissance du collectif s’exerce ; le collectif n’existe pas autrement que dans les manifestations de sa puissance, dont il ne saurait en aucun cas être séparé. Mais il est vrai qu’il faut avoir l’œil pour savoir reconnaître là où il y a bel et bien « de l’institution » quand nous avons l’habitude de la voir sous certaines formes particulières seulement, et croyons au surplus que ces formes particulières épuisent le concept général. Et de nouveau : si la vie sans institution n’existe pas, la question intéressante est celle des formes, celle des « bonnes » institutions. En tout cas, il s’en suit qu’à mes yeux une philosophie de la destitution qui croirait pouvoir suspendre complètement et indéfiniment la ré-institution fait fondamentalement fausse route.
« La politique dans les institutions rend bête », dites-vous — tout en ne croyant, donc, qu’à l’éternel retour du processus institutionnel. Sommes-nous condamnés à vivre sous le régime infini de la débilité ?
« Croyez-vous que les propriétaires privés les rendront de bonne grâce ? Croyez-vous que les tenants du capital laisseront défaire sans réaction leur forme de vie ? »
Oui ! (rires) Mais en espérant trouver une ligne de débilité tendanciellement décroissante. Et en nous efforçant entre temps de fuir les institutions comme nous pouvons, évasion toujours difficile, et incomplète, mais ce n’est pas une raison pour ne pas la cultiver autant qu’il est en nous. En sachant aussi que l’Éden a-institutionnel n’existe pas, sinon comme terme asymptotique7.
Vous l’avez redit : vous reprochez à la gauche radicale de ne pas assez penser la question de la violence. L’écologiste étasunien Murray Bookchin avançait qu’il était possible de résoudre cette histoire en « vidant », c’est son mot, l’État, en le rendant indésirable par un lent processus — parallèle à la vie étatique — de construction d’un mouvement révolutionnaire de masse, par la base et un réseau de communes. À la fin de quoi, un grand coup de pied pourrait le faire s’écrouler. Que pensez-vous de ce « vide » à constituer ?
La même chose que des philosophies de la destitution et d’un modèle de la défection généralisée, qui laisserait derrière elle des villes administratives fantômes, des cités étatiques Potemkine, désertées, évidées, inutiles, en attente de la dernière chiquenaude qui mettra tout à terre. Mais, sauf retour généralisé à l’économie potagère autosuffisante, je ne peux pas y croire. À un moment il faut remettre la main sur les moyens de production. Croyez-vous que les propriétaires privés les rendront de bonne grâce ? Croyez-vous que les tenants du capital laisseront défaire sans réaction leur forme de vie ? Ne croyez-vous pas qu’ils disposent de moyens et de ressources immenses qu’ils jetteront jusqu’à la dernière dans la bataille ? Ce sera donc soit les isolats, soit la gigantomachie révolutionnaire. Je vois deux cas de grande transition « à froid » : soit quand l’ordre social a cessé d’être légitime jusque dans la tête de ses « élites » et que celles-ci abandonnent de le défendre — exemple, l’URSS, mais on voit aussi ce qui a suivi, qui n’a pas été spécialement bucolique ; soit, comme le rappelle fort bien Gelderloos, quand l’Histoire occulte opportunément des actions violentes qui ont préparé les conditions de succès des stratégies dites non-violentes — et alors celles-ci peuvent rafler la mise symbolique. Hors de ces configurations, et peut-être quelques autres, les ordres de domination tombent rarement sans quelque fracas.
L’une de vos propositions politiques, en plus de soutenir le salaire à vie théorisé par Bernard Friot, est la réhabilitation de la République sociale comme « démocratie totale » et « unique lieu de la gauche ». Mais que peut donc encore « la Sociale » quand « la République » a, depuis si longtemps, frayé avec les puissants ?
D’une certaine manière, j’ai déjà répondu à cette question : un signifiant isolé ne dit rien. Il ne signifie que rendu à l’ensemble énonciatif dans lequel il prend place. Quand Badiou relève le signifiant « communisme », c’est en le réinvestissant à neuf, c’est-à-dire en lui adjoignant un ensemble (imposant) d’énoncés complémentaires. Faute de quoi « communisme » reste pris dans le système énonciatif « goulag, stalinisme, livre noir, etc. ». Que le mot « République » ait été affreusement abîmé ne signifie pas qu’il ne puisse être restauré, à l’image de « communisme ». Mais pour ce faire, en effet, il va falloir l’extraire sévèrement de l’ensemble « laïcité, police républicaine, territoires perdus ». Du reste, je n’entretiens vis-à-vis de lui qu’un rapport tout à fait pragmatique et instrumental. S’il parvient à produire de nouveau quelque chose avec « sociale », « 1848 » et « la Commune », c’est parfait. C’est ce levier-là que j’ai cherché à faire jouer. Si l’Histoire offre de la ressource imaginaire, on aurait tort de ne pas s’en servir. On voit alors si ça a de l’effet. Et sinon, autre chose.
[lire le troisième et dernier volet]
- Au préalable.[↩]
- Combat des géants contre les dieux.[↩]
- « Imaginer que la détestation du eux est à même d’instituer un peuple en acteur politique majeur est une faute. À ce jeu, on nourrit l’idée qu’il suffirait de changer les hommes, à la limite de procéder au grand remplacement, pour retrouver des dynamiques vertueuses. »[↩]
- Caractères propres au comportement d’un individu particulier, personnalité psychique individuelle.[↩]
- Penser le particulier sous le général (un individu sous une espèce, une espèce sous un genre), considérer un fait comme compris sous une loi.[↩]
- Qui peut être posé, qui est de la nature du fait ou se fonde sur les faits.[↩]
- Se dit d’une chose vers laquelle on tend sans parvenir à l’atteindre.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Le municipalisme libertaire : qu’est-ce donc ? », Elias Boisjean, septembre 2018
☰ Lire notre entretien avec Benoît Borrits : « Casser le carcan de la démocratie représentative », septembre 2018
☰ Lire notre article « Le salaire à vie : qu’est-ce donc ? », Léonard Perrin, mars 2018
☰ Lire notre entretien avec Arnaud Tomès et Philippe Caumières : « Castoriadis — La démocratie ne se limite pas au dépôt d’un bulletin dans une urne », janvier 2018
☰ Lire notre entretien avec Danièle Obono : « Il faut toujours être dans le mouvement de masse », juillet 2017
☰ Lire notre entretien avec Olivier Besancenot : « Le récit national est une imposture », octobre 2016