Entretien inédit pour le site de Ballast
La notion de « commun » revient en force. Et, avec elle, la remise en question de la propriété (qu’elle soit privée ou nationale). Dans le sillon creusé par le socialisme libertaire d’un Proudhon, l’animateur de l’association Autogestion et chercheur-militant Benoît Borrits assure qu’il est possible d’envisager un Au-delà de la propriété, titre de son dernier ouvrage paru au printemps 2018 (Ed.La Découverte), ainsi qu’un dépassement de l’État : cela aurait tout d’une révolution, et c’est à ce projet — ambitieux, il est vrai — qu’il nous convie à réfléchir… le plus concrètement possible.

La fin de l’Union soviétique et des pays du « socialisme réel » a largement mis en veilleuse tout projet d’appropriation sociale. Pourtant, du point de vue de la pratique, les reprises d’entreprises par les salarié·e·s — auxquelles nous assistons depuis une vingtaine d’années dans différents pays (Argentine, France, Grèce…) — nous montrent que cette perspective est loin d’être éteinte, d’autant qu’elle est mise en œuvre, non par un État soit-disant ouvrier ou social, mais directement par des travailleur·se·s. Dans ces reprises, les travailleur.se.s refusent la fermeture d’une unité de production et affirment leurs droits d’utilisateurs des moyens de production contre le propriétaire qui entend en disposer. Le paradoxe est que ce processus débouche, s’il va à son terme, à la formation d’une coopérative qui est, en soi, une nouvelle forme de propriété. Si la coopérative de travail impose que les sociétaires soient les travailleur.se.s de l’entreprise — ce qui limite a priori le caractère privé de cette propriété —, il n’en reste pas moins vrai que le capital de la coopérative reste un capital et que sa logique tend à reprendre le dessus en cas de succès de l’entreprise. Il n’est pas rare de voir que, dans certaines d’entre elles, les membres fondateurs ont parfois des réticences à élargir le sociétariat1 aux nouveaux salarié·e·s, au point que les sociétaires deviennent minoritaires dans l’entreprise et deviennent de facto les nouveaux « patrons » de l’entreprise.
Vous retracez un ensemble d’expériences autogestionnaires et socialistes : révolutions russe, espagnole, yougoslave. Quelles leçons en tirer ?
« Le capital de la coopérative reste un capital : sa logique tend à reprendre le dessus. »
Si nous définissons le capitalisme comme étant la propriété privée des moyens de production, il semble alors assez naturel de considérer son antithèse comme étant la propriété collective des moyens de production. C’est dans ce chemin que la majeure partie des socialistes du XIXe siècle se sont engouffrés. Or ce projet de propriété collective a toujours échoué à déterminer quelle doit être le périmètre de cette collectivité. En passant en revue aussi bien les théories que les mises en pratique, on a pu comprendre, avec le recul de deux siècles d’expériences, combien ce projet était piégé. Nous venons d’évoquer la forme coopérative comme première tentative de propriété collective. Très tôt, les socialistes du XIXe siècle ont critiqué le caractère restreint de la collectivité limitée à l’entreprise. L’échelon supérieur qui a alors été envisagé est celui de l’État-nation : il fallait transférer la propriété des moyens de production d’agents privés à l’État.
Une voie expérimentée par les bolcheviks après la révolution d’octobre 1917…
Ils justifiaient cette étatisation par la supériorité de la planification sur le marché. Ne nous attardons pas sur le bilan calamiteux de cette expérience. Elle a cependant démontré que la planification intégrale d’une économie est une chimère, qui contredit la propriété collective à grande échelle. Dans les écrits tardifs de Marx, et chez Jaurès, on trouve clairement la critique d’une appropriation sociale qui se réaliserait par la seule nationalisation — est alors née l’idée d’une propriété nationale gérée par des collectifs de travailleur·se·s. D’une certaine façon, les communistes yougoslaves ont expérimenté cette voie avec des résultats non dénués d’intérêt. Mais il y a là une contradiction dans les termes : un propriétaire ne peut pas accepter que des décisions qui l’impliquent soient prises par d’autres que lui. Pour résumer, nous dirons qu’une propriété est excluante par nature. Cela se comprend aisément pour la propriété privée. Mais une propriété collective exclut aussi celles et ceux qui ne font pas partie de cette collectivité : elle apparaît à ces dernier·e·s comme privée. Il était donc nécessaire d’élargir cette collectivité. Mais en l’élargissant, on produit une bureaucratie qui exclut de facto celles et ceux au nom de qui cette propriété collective a été érigée, à savoir les travailleur·e·s et les usager·es. Le projet de propriété collective est une impasse. Seul Proudhon avait esquissé l’idée que l’alternative résidait dans la non-propriété.
De quelle façon ?
Son projet de Banque du peuple — en 1849 — nous donne une intuition féconde du contenu de cette non-propriété : l’important n’est pas de posséder les biens de production mais d’en disposer et les outils de financement doivent le permettre. D’une certaine façon, les libertaires et les conseillistes d’inspiration marxiste ne posaient pas la question de la propriété : ce sont les Conseils de travailleur.se.s qui, en qualité d’usager·e·s des moyens de production, devaient être dépositaires de la gestion de ces biens. Cette absence de notion de propriété devait être renforcée par la coordination des conseils de travailleur·e·s qui établiraient ensemble un plan de production. Le problème est que rien n’autorise à penser que cette planification soit possible et que les collectifs s’entendront naturellement sur des objectifs de production — ce que concèdent bien des observateurs libertaires de la révolution espagnole de 1936. En cas de désaccord, la solution réside soit dans la coercition, soit dans le recours au marché — et qui dit recours au marché dit retour à la propriété…
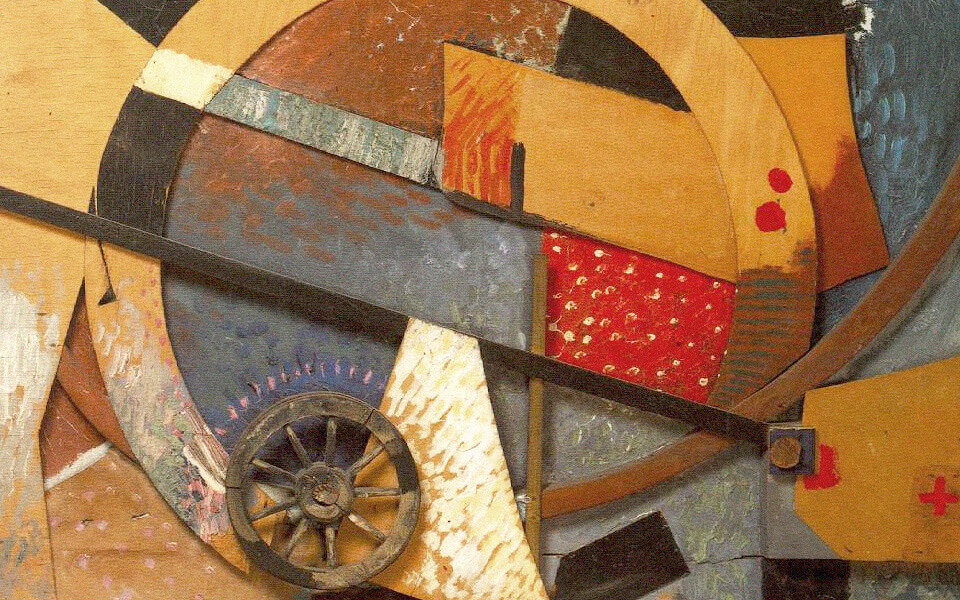
Kurt Schwitters, 1931
Vous imaginez des dispositifs pour sortir de la propriété des moyens de production, comme celui d’un système financier anticapitaliste. Mais n’est-ce pas une contradiction ?
La justification du financement d’un bien est sa durée d’utilisation. Si un collectif de travailleur.e.s doit utiliser une machine de production sur 20 ans, il est inacceptable d’exiger de celui-ci son règlement a priori : il faut donc qu’un autre agent économique avance cette somme pour payer celles et ceux qui ont fabriqué ce bien. Toute la question est donc de savoir qui est cet agent économique. Dans le système capitaliste, cet agent économique est un individu privé — une personne physique ou morale — qui avance cet argent dans un unique but : gagner encore plus d’argent. Peu importe donc l’objet de cet investissement, qu’il soit polluant ou pas, qu’il soit socialement utile ou pas, pourvu qu’il rapporte. Les unités productives d’aujourd’hui sont totalement dépendantes de la volonté des détenteurs de capitaux : l’entreprise doit contenter des actionnaires qui exigent un rendement pour le maintien de la valorisation de l’entreprise ou des banquiers ou des prêteurs individuels, qui peuvent être réticents à prêter un capital contre la promesse d’un taux d’intérêt.
« Une rupture fondamentale avec l’ordre capitaliste réside dans l’affectation des investissements. »
Ma proposition de système financier socialisé — qui n’est en aucun cas étatique — s’articule autour d’un Fonds socialisé d’investissement (FSI). Celui-ci se constitue sur une zone géographique donnée, probablement un pays dans un premier temps, sachant que la politique s’exprime prioritairement à cette échelle. Sa constitution initiale pourrait très bien se faire par une cotisation ou un impôt sur les entreprises qui contribuera à remettre en cause la rentabilité des entreprises privées pour permettre aux travailleur·se·s et usager·e·s de les reprendre. Ce fonds pourra alors accorder des prêts aux entreprises et sera alimenté en retour par les remboursements. Une rupture fondamentale avec l’ordre capitaliste réside dans l’affectation des investissements. En régime capitaliste, ceux-ci ne le sont que selon un critère de rentabilité. Dans notre système socialisé, la population déterminera les grandes orientations de l’économie en répartissant les crédits en enveloppes d’investissements pouvant correspondre à des finalités (transition énergétique, mobilité, outil industriel…), des modalités de crédit (crédit simple remboursé sur plusieurs années, ligne de crédit pour financer un Besoin en fonds de roulement, apports pour financer de la recherche et développement) ou encore une politique volontariste d’investissements dans certains territoires défavorisés. Parce que des budgets existeront pour diverses modalités d’investissements, il devient alors possible de financer la totalité des actifs de l’entreprise pour aboutir à la disparition des fonds propres, et donc des propriétaires. La voie est alors ouverte à une entreprise sans propriétaire, un commun productif qui serait directement géré par ses travailleur·e·s avec une intervention très fréquente des usager·e·s.
Vous dites également que la démocratie économique implique des prises de décision concertée entre les travailleurs et les usagers.
Si l’unité de production opère dans un environnement économique tel que les consommateur·rice·s puissent facilement trouver un concurrent en cas d’insatisfaction, l’intervention des usager·e·s n’est pas indispensable : imaginons un restaurant en ville qui produirait des plats infâmes servis de façon désagréable, on comprend que les travailleur·se·s se tirent une balle dans le pied s’il existe d’autres restaurants dans les environs. Si, par contre, l’unité de production se trouve dans un environnement monopolistique ou oligopolistique, on comprend que les usager·e·s doivent disposer d’un pouvoir de codécision avec les travailleur·se·s. Le plus simple est de garantir dans tous les cas un droit de mobilisation des usager·e·s pour constituer un Conseil d’orientation, qui dialoguerait avec le Conseil des travailleur·se·s pour les décisions essentielles sur le contenu, les prix et les modalités de distribution. Ce droit de mobilisation des usager·e·s devrait d’ailleurs s’appliquer dès aujourd’hui à l’égard des entreprises privées — ce qui permettrait de contester le pouvoir unique des actionnaires.

Kurt Schwitters,1921
Cette codécision entre travailleur·se·s et usager.e.s n’est pour autant pas le seul lieu de partage du pouvoir. Les unités productives doivent aussi se financer auprès du système socialisé. Ils vont donc devoir dialoguer avec les travailleur·se·s des banques autogérées et tenir compte des décisions macroéconomiques des citoyen·ne·s concernant l’orientation des investissements. De même, la structure des revenus est dépendante des décisions collectives prises en terme de socialisation des revenus. Nous avons au final deux types de communs qui s’articulent : des communs productifs, de nature associative (on le rejoint volontairement en tant que travailleur·se·s ou en tant qu’usager·e·s) et des communs sociaux, de nature géographiques (ce sont les résident·e·s d’une zone géographique donnée qui constituent un commun destiné à réaliser un objet social). Ces communs géographiques peuvent aussi être utilisés pour d’autres fonctions telles que la production de droit ou de services publics. Dans ces deux types de communs existent des usager·e·s/citoyen·ne·s et des travailleur·se·s qui doivent codécider en permanence.
On peut songer aussi aux travaux de l’écologiste Murray Bookchin sur le municipalisme libertaire…
« Je m’inscris dans un projet clair de dépassement de l’État. »
Je partage la préoccupation de Bookchin sur l’importance des usager·e·s et des citoyen·ne·s dans les prises de décision, mais il est tout aussi important de briser la subordination salariale : dans tous les communs que nous avons décrits, la codécision entre travailleur·se·s et usager·e·s/citoyen·ne·s est essentielle. De même, j’évoque une nécessaire coordination verticale remontant la chaîne de production, qui serait possible avec la présence des usager·e·s dans les organes de décision. Cette coordination ne saurait avoir un caractère systématique et obligatoire : elle doit s’inscrire dans une interaction avec d’autres sources de pouvoir, notamment en termes de socialisation des revenus et des financements. Je m’inscris dans un projet clair de dépassement de l’État.
Vous évoquiez le projet proudhonien de Banque du peuple. Son idée était que les ouvriers puissent obtenir les capitaux permettant de créer leur propre entreprise autogérée et, ainsi, ne plus dépendre des investissements capitalistes. Un système alternatif de financement pourrait-il vraiment suffire ?
Son projet est essentiel pour comprendre son approche de la non-propriété des moyens de production : il n’est pas nécessaire d’être propriétaire des moyens de production pour réaliser l’appropriation sociale mais d’y avoir accès et de les utiliser. C’est cette approche que j’ai reprise dans la conception du Fonds socialisé d’investissements pour faire disparaître les fonds propres des entreprises et donc la notion même de propriétaire. Ceci étant, Proudhon inscrivait sa Banque du peuple dans une démarche de construction d’alternatives au système, alternatives qui, par leurs développements propres, devaient se substituer au capitalisme. Si le projet de Banque du peuple avait été mené à bien, il est peu probable qu’il aurait changé l’économie. Nous assistons aujourd’hui à de nombreuses alternatives dans le domaine du financement, telles que la Nef ou les fonds coopératifs Socoden ou Scopinvest. Ces innovations sont essentielles. Elles nous montrent concrètement que l’on peut fonctionner avec des critères différents de la finance capitaliste ; elles sont sources d’inspiration pour aller plus loin…
Mais ?
Mais ces expériences sont limitées par l’environnement capitaliste qui nous entoure. C’est ainsi qu’une petite structure bancaire comme la Nef doit se refinancer comme les autres banques sur le marché et que sa petite taille la pénalise dans l’obtention de faibles taux d’intérêt. Socoden et Scopinvest sont des structures d’investissement en quasi-fonds propres qui, en diminuant l’engagement financier des sociétaires, favorisent les reprises d’entreprises par les salarié·e·s. Mais comme elles engagent l’argent collecté par les Scop, qui reste donc de l’argent privé, elles ne s’engagent significativement que sur les dossiers les plus sûrs. Il est donc nécessaire que ces alternatives se systématisent pour ne plus être en concurrence avec la finance privée ; c’est l’outil du commun géographique qui le permet : une population qui s’érige en commun pour définir des règles de prélèvement qui s’imposent à toutes et tous pour générer une ressource commune2.

Kurt Schwitters, 1921
C’est à une révolution que vous appelez, en somme…
Le processus de transformation sociale nécessite une initiative législative qui suppose son approbation par une majorité politique, majorité politique qui sera sans doute le produit d’une combinaison de mouvements sociaux et d’alternatives concrètes qui ont conscience de la nécessité de leur généralisation. L’objectif de cette majorité n’est surtout pas d’appliquer un programme précis au nom du peuple ou de la classe ouvrière mais de casser le carcan de l’État bourgeois de démocratie représentative au profit d’une démocratie des communs. Les citoyen.ne.s pourront désormais s’exprimer directement sur toute une série de domaines — par exemple, les allocations de budget d’investissements dans le cadre du FSI —, sans avoir à recourir à des représentants qui décident de tout : de la politique étrangère, du budget de l’État, des réformes à introduire sans jamais avoir à en référer à la base électorale. Dans ce processus révolutionnaire, il y a donc bien une combinaison entre la production d’alternatives concrètes — les reprises en Scop, les initiatives de construction de circuits courts, de production d’énergies renouvelables… — et la nécessité d’une alternative politique qui permette la systématisation de celles-ci par l’établissement d’une démocratie véritable.
« Le processus de transformation sociale nécessite une initiative législative qui suppose son approbation par une majorité politique. »
Il est de coutume de baisser les bras face à une mondialisation néolibérale, qui imposerait aux États ses règles inéluctables. C’est du moins ce que tentent de nous faire croire les dominants. Mais il est une autre réalité que l’on refuse de regarder en face : ce système ne tient plus désormais que grâce aux politiques de ces États qui, par des « réformes » successives, limitent la part des salaires dans la valeur ajoutée et favorisent les valorisations des entreprises déterminées par les anticipations de dividendes. Si, demain, un gouvernement devait pratiquer une politique inverse de hausse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, tout ce système serait en péril — ouvrant la voie à la reprise des entreprises par les travailleur·se·s et les usager·e·s. Il s’agit cependant de réussir ces reprises. Et c’est dans cette perspective que s’inscrit l’établissement de communs de socialisation du revenu et de financement.
Mais quelles seraient les chances de cette économie des communs de se développer dans un environnement a priori hostile, notamment au sein de l’Union européenne ?
Aujourd’hui, l’économie est plurielle. Elle comporte des coopératives qui se développent tout en dérogeant aux règles du capitalisme. Il n’est donc pas absurde d’imaginer une économie où, sur certaines zones géographiques, s’imposeraient d’autres règles. Le fait que ces zones géographiques se dotent de communs de socialisation des revenus et d’investissement doit leur permettre de faire face à la concurrence étrangère. Ainsi la socialisation des revenus permet d’assurer à toutes et tous un travail rémunéré à un niveau décent. De même, le Fonds socialisé d’investissement est une arme essentielle qui permet à une zone géographique de ne plus dépendre des capitaux extérieurs. En libérant les entreprises des actionnaires, en favorisant leur contrôle par les travailleur·se·s et les usager·e·s, en permettant aux citoyen·ne·s de se déterminer sur les orientations essentielles d’une économie ainsi que sur les modalités d’une répartition des revenus, cette économie des communs sera largement plus désirable que celle d’exclusion et de prédation dans laquelle nous vivons et elle ne tardera pas à s’étendre alors à d’autres zones géographiques.
Illustration en bannière : extrait d’une œuvre de Kurt Schwitters
- Qualité, rang de sociétaire.[↩]
- C’est ainsi que j’avais suggéré, dans Coopératives contre capitalisme, que le FSI soit initié par une cotisation sociale patronale, qui aurait la double fonction de ponctionner les profits privés des entreprises et de constituer une ressource.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Le municipalisme libertaire : qu’est-ce donc ? », Elias Boisjean, septembre 2018
☰ Lire notre abécédaire de Murray Bookchin, septembre 2018
☰ Lire notre entretien avec Christian Laval : « Penser la révolution », mars 2018
☰ Lire notre entretien avec Arnaud Tomès et Philippe Caumières : « Castoriadis — La démocratie ne se limite pas au dépôt d’un bulletin dans une urne », janvier 2018
☰ Lire notre entretien avec Bernard Friot : « Nous n’avons besoin ni d’employeurs, ni d’actionnaires pour produire », septembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Alain Bihr : « Étatiste et libertaire doivent créer un espace de coopération », mai 2015


