Entretien inédit | Ballast
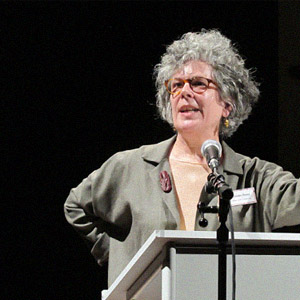
Quand j’ai abordé mes premières recherches dans les années 1980, sur Rimbaud et l’aspect politico-culturel de la Commune de Paris, c’était par le prisme de Mai 68. Je lisais beaucoup Henri Lefebvre et Jacques Rancière. Puis j’ai commencé à m’intéresser aux années 1950 et 1960 en France, comme prélude à Mai 68 et en tant que moment où le Paris historique se restructurait autant physiquement que socialement, à travers un démantèlement massif d’aménagements urbains plus anciens — ce que certains ont qualifié de « seconde haussmannisation1 ». Il m’a alors semblé judicieux de placer au centre de mon travail les questions de la vie quotidienne et de l’espace social. Ayant d’abord étudié la Commune de Paris, je pouvais plus facilement remarquer que les travailleurs majoritairement immigrés qui armaient ce projet de renouvellement urbain avaient un point commun avec les futurs communards du siècle précédent, fraîchement arrivés à Paris des provinces…
Lequel ?
« Je voulais penser ensemble deux histoires gardées séparées : l’arrivée abrupte d’appareils ménagers ; la torture en Algérie. »
Les deux groupes — communards au XIXe, travailleurs immigrés au XXe — étaient les instruments et les victimes de ces transformations. Ils ont été expulsés vers la banlieue et cantonnés dans de nouvelles formes de ségrégation urbaine, résultant de ce processus. Rimbaud, la Commune de Paris, et l’invention de l’histoire spatiale retrace la consolidation d’une classe sociale colonialiste dans les années 1870, décennie de l’expansion impérialiste française. Rouler plus vite, laver plus blanc aborde le déclin de cet empire, ses derniers soubresauts, la retraite à l’intérieur des frontières de la métropole et des cuisines toutes équipées. On pourrait dire que ces deux ouvrages représentent les bornes temporelles, les serre-livres de l’empire colonial français. Certaines catégories sociales n’ont pas changé (le travailleur journalier par exemple), tandis que d’autres se sont métamorphosées (la grande figure balzacienne du notaire, devenu jeune cadre dynamique, ou encore la midinette chère à Zola, devenue ménagère technicienne). Les deux ouvrages s’intéressaient à la littérature et se penchaient sur son statut et son rôle dans les mouvements et débats culturels. À la fin du XIXe, l’œuvre d’un seul poète extraordinaire était parvenue à représenter toute une gamme de thèmes socio-historiques, de débats, fantasmes, rêves et anxiétés de l’époque : Arthur Rimbaud. Il ne cherchait rien de moins qu’à écrire son siècle.
Je voulais donc penser ensemble deux histoires jusque-là gardées rigoureusement séparées : d’un coté, l’arrivée abrupte d’appareils ménagers et de voitures dans la vie quotidienne des français de classe moyenne ; de l’autre, la torture et tout ce qui se passait au même moment en Algérie. Cette mise en parallèle ne tentait pas seulement d’aller au-delà du consensus à propos du caractère inévitable du développement d’une culture capitaliste à l’américaine. Je cherchais également à saisir ce qui pouvait arriver si l’on considérait sérieusement ce que Lefebvre et les situationnistes envisageaient comme une forme de « colonisation de la vie quotidienne » dans la France d’alors. Je m’efforçais de prendre cette phrase au pied de la lettre pour formuler une théorie économique (et non pas culturelle) du racisme.

[Image extraite du documentaire Le Fond de l'air est rouge (Chris Marker, 1977)]
Que doivent ces livres au contexte dans lequel ils ont été élaborés ?
Ils ont été écrits durant les années Mitterrand, années teintes d’hypocrisie, à un moment où beaucoup d’anciens militants reniaient publiquement leur engagement dans le mouvement de 1968. Afin de créer une généalogie de leur propre adhésion au néolibéralisme, ils se sont distanciés de leur passé militant en réécrivant, d’une façon révisionniste, toute l’histoire de la tradition révolutionnaire française. Que ce soit dans la recherche académique ou dans les médias dominants, la Révolution française elle-même s’est vue réévaluée de telle sorte qu’elle paraissait presque insignifiante, ou du moins indiscernable de la Révolution américaine. En mettant largement en avant les concepts de continuité et d’homogénéité au lieu d’analyses insistant sur l’imprévisibilité et la contingence, les épisodes révolutionnaires étaient occultés, leur statut même d’événement étant alors dénié. Pour moi, le contexte politique s’assombrissait et, en s’assombrissant, posait de manière radicale la question suivante : quel passé pour quel futur ?
« La Révolution française s’est vue réévaluée de telle sorte qu’elle paraissait presque insignifiante, ou du moins indiscernable de la Révolution américaine. »
J’étais précisément attirée par ces moments qui étaient « effacés » par la gauche soi-disant « anti-totalitaire », tels que la Commune ou 1968. En travaillant sur Rimbaud ou sur la culture politique de la Commune, j’avais la conviction de maintenir en vie les dimensions subversives de la pensée et de l’action qui s’étaient manifestées pendant les événements de 1968. La Commune et 1968 ont après tout été des moments d’appropriation sociale de l’espace, et de la transformation de la vie quotidienne qui en résulte. Ce sont des moments où l’État a reculé, sa temporalité politique brisée ou interrompue, et où l’on pouvait commencer à remarquer l’existence d’une organisation commune de la vie matérielle qui n’avait rien à voir avec une logique de profit. C’est lors de tels moments que des discussions d’intérêt collectif ont lieu, où les experts et les spécialistes n’ont aucune place.
Des années plus tard, alors que j’étais invitée à Notre-Dame-des-Landes — exemple même de l’appropriation collective de l’espace —, j’ai pu participer à plusieurs discussions de ce type. Nous avons tenté, par exemple, d’établir ce qui était continu, et discontinu, entre ce que les insurgés de Paris avaient accompli en 1871 et la vie en train de se construire aux abords de Nantes. J’ai pu y noter un investissement massif dans l’organisation de la vie quotidienne en commun, la réalisation d’une espèce de laboratoire contemporain de la forme-commune. J’ai donc décidé de traduire et d’écrire la préface de Contrées, un livre élaboré par un collectif de zadistes. On pourrait dire que la cohérence de mon travail réside principalement dans mon intérêt pour les ressources oppositionnelles du quotidien. Comment rendre visible de telles ressources ? Dans le cas de la Commune ou de la ZAD, il s’agit de faire attention non pas à leurs idéaux, mais bien plutôt à ce que Marx appelait leur « existence en acte ».

[Image extraite du documentaire Le Fond de l'air est rouge (Chris Marker, 1977)]
Contrer le post-structuralisme dans les études littéraires avec Rimbaud ; sortir la Commune de ses 72 jours et de la danse apocryphe de Lénine ; défaire Mai 68 de ses stéréotypes individualistes : votre méthode se résumerait-elle à un art du contre-pied ?
Oui, on pourrait la décrire ainsi. En ce qui concerne ma relecture de certains événements majeurs de l’histoire de la gauche et de leur postérité, comme Mai 68 ou la Commune de Paris, il m’a semblé évident que la première étape nécessaire consistait à les défaire de la gangue de clichés et de banalités qui les invisibilisaient. On ne peut pas appréhender les événements passés sans effectuer un travail nécessairement polémique de démystification vis-à-vis des légendes, vols et confiscations qui entourent la représentation de tels moments. Par exemple, il faut battre en brèche l’idée que Mai 68 était un événement inoffensif pour l’État, ou encore que les communards avaient agi pour « sauver la République ». Commencer par un bon coup de balai est le seul moyen que j’ai trouvé pour examiner un événement historique et atteindre le désir qui l’a animé.
« Il faut battre en brèche l’idée que Mai 68 était un événement inoffensif pour l’État, ou encore que les communards avaient agi pour
sauver la République. »
Dans Communal Luxury2, il m’a fallu rejeter les multiples images projetées sur la Commune par les historiens et par tous ceux qui se réclament de son héritage, qu’ils y soient favorables ou non. Pour cette raison, je me suis limitée à la lecture de compte-rendus écrits par les communards, par certains de leurs compagnons de route ou contemporains. J’ai omis la documentation foisonnante produite par la suite par des théoriciens, philosophes politiques et hommes d’État. Je me suis attachée à supprimer tout ce verbiage afin de mettre à nouveau en scène le mouvement dans toute sa complexité. Cela ne peut être atteint lorsque les productions culturelles ou les mouvements politiques sont étudiés selon la logique du « il n’aurait pas pu en être autrement », ou suivant toutes sortes de justifications employées à différents moments de l’histoire du capitalisme. En parlant de « mise en scène » du mouvement, ou en écrivant que les événements du passé sont « joués » ou qu’ils doivent être « remis en scène » en fonction d’un contexte donné ou d’une conjoncture particulière, je ne les banalise pas, ni ne les rend hyperboliques ou sublimes — il s’agit simplement d’une condition à mon avis nécessaire pour les rendre (de nouveau) visibles.
Nous avons longtemps été pris dans une division du travail trop simpliste héritée de Walter Benjamin, séparant le politique et l’esthétique. Nous avons tous appris qu’il n’y avait rien de pire que l’esthétisation de la politique, et pourtant la politique est inséparable d’une telle dimension. Ce que les communards appelaient « luxe communal » était le produit d’une audace à la fois politique et esthétique. Il faut parfois renvoyer dans les coulisses la figure du « grand homme » afin d’appréhender avec plus de clarté un événement historique. Par exemple, l’intérêt académique des historiens de l’art de la Commune s’est focalisé sur la personne de Gustave Courbet, de même que les philosophes du politique se sont attachés à la rivalité entre Marx et Bakounine immédiatement après la Commune. Qu’est-ce qui devient perceptible si l’on renverse ou ignore ces obsessions académiques poussiéreuses ? En minimisant l’importance d’un géant tel que Courbet, ou en le renvoyant hors de scène, une figure comme celle d’Eugène Pottier devient enfin visible et soulève la question du statut des artistes décorateurs pendant la Commune. Lorsque Pottier entre dans le champ, il devient possible de voir comment la notion de « beauté publique » ou de « luxe communal », portée par les artisans, dépend d’un renversement de la hiérarchie en place dans le milieu artistique, qui aura lieu par la suite. Celle-ci accordait d’énormes privilèges tant en termes de statut qu’en termes financiers aux artistes peintres et sculpteurs — statut auquel les comédiens, artistes décorateurs et artisans n’avaient aucun droit sous le Second Empire.

[Image extraite du documentaire Le Fond de l'air est rouge (Chris Marker, 1977)]
Entendu ainsi, le luxe communal n’est pas simplement lié à l’idée d’une abondance égalitaire. C’est une façon de créer une esthétique quotidienne de la production, un acte d’auto-émancipation rendu visible. Cela permet alors de retracer l’émergence de nouvelles idées — la fin d’un luxe fondé sur les différences de classes —, dont le développement ouvre des perspectives de richesse sociale qui étaient complètement inédites jusqu’alors. William Morris est celui dont le travail a donné le plus de force à ces idées, exploitant les notions critiques de beauté et de production utile qui ont été centrales dans la transmission des idées communardes. En plus d’avoir théorisé ce que signifiait être un artisan dans un monde où l’art et l’utilité étaient des notions de plus en plus disjointes, Morris, après tout, avait lui aussi passé une grande partie de sa vie à produire des objets utiles, comme tant de communards. Ce qui semblait être initialement une demande esthétique de la part des artistes décorateurs était en réalité un plaidoyer pour la réinvention de la notion de valeur, ce à quoi une société accorde de l’importance. C’était un appel à réinventer la richesse au-delà de la simple valeur d’échange. L’étude des travaux de certains réfugiés de la Commune comme Élisée Reclus ou Paul Lafargue révèle que le concept de « luxe communal » peut même servir de fondement à la conception d’une société écologiquement viable.
Vous parliez de la rivalité entre Marx et Bakounine. Mais peut-on vraiment évacuer un débat à ce point structurant ?
« J’ai choisi de chasser Marx et Bakounine hors de scène, ou du moins de temporairement détourner les projecteurs de ces deux barbus. »
La gauche des années suivant la Commune est souvent perçue comme étant profondément divisée par la querelle entre Marx et Bakounine opposant marxistes et anarchistes, communément pointée du doigt comme étant la cause de la fin de la Première Internationale. C’est une querelle lassante, souvent rejouée dans les milieux militants, opposant ceux qui pensent que l’exploitation économique est à la source du mal, et ceux qui pensent que c’est plutôt l’oppression politique. J’ai choisi dans mon livre de chasser Marx et Bakounine hors de scène, ou du moins de temporairement détourner les projecteurs de ces deux barbus afin de voir si autre chose méritait d’être étudié. Et j’ai alors pu découvrir une flopée de personnages très intéressants, qui n’étaient esclaves ni du marxisme ni de l’anarchisme, mais qui parvenaient à utiliser habilement les deux courants de pensée. Il me semble que c’est ainsi que beaucoup de militants s’emparent aujourd’hui de leur vie politique, peut-être parce que bon nombre des figures sectaires des deux courants ont récemment quitté la scène politique.
J’ai bouleversé le casting habituel : Courbet a donc été remplacé par l’artisan Pottier ; du haut de ses 18 ans, Élisabeth Dmitrieff a détrôné l’iconique Louise Michel, devenue une sorte de sainte patronne de la Commune ; Eugène Varlin, incarnation du « bon travailleur » tout autant sanctifié que cette dernière, a été remplacé par le cordonnier soûlard Napoléon Gaillard ; le socialiste britannique William Morris a pris la place de l’anarchiste français Proudhon. Comme le livre le souligne, ces changements ont eu une série de conséquences et d’implications dans l’image de la vie quotidienne à l’époque de la Commune. Les choix que j’ai faits vont donc effectivement à contre-courant. Il serait possible de retracer chacune de leurs implications, mais je pense globalement qu’en essayant de mettre en évidence des figures négligées, il ne s’agit pas pour moi de les rendre « centrales » ou « plus grandes qu’un tel », ni de présenter une panoplie de sujets plus diverse que celle qui a pu être représentée par le passé : j’ai plutôt envie de voir de quoi les événements auraient l’air, et quelles nouvelles thèses pourraient être développées en plaçant les personnages dans de nouvelles situations, en changeant le cadrage ou en redistribuant les rôles — qui sera l’acteur principal, qui aura le droit de parole, qui déclamera le plus fort. Ce sont parfois des habitudes génériques qui encombrent la scène et dont il faut se débarrasser.

[Image extraite du documentaire Le Fond de l'air est rouge (Chris Marker, 1977)]
Et que permet ce pas de côté avec une figure comme celle de Rimbaud ?
En écrivant mon premier livre à son propos, j’ai été frappée par une fâcheuse manie : celle de le considérer comme un avant-gardiste impénétrable — comme si ses textes étaient imprégnés d’une aura obscure, séduisante mais décourageante. Pourquoi ne pas plutôt suivre Bertold Brecht, qui avait perçu la dimension réaliste de la poésie de Rimbaud ? Qu’arrive-t-il si on lit Une Saison en Enfer comme un roman d’initiation, un bildungsroman3, et non comme un chef d’œuvre de la littérature d’avant-garde ? Les habitudes génériques créent un monde de faits immuables. Elles renforcent des catégories qui amènent à une forme passive et digestive de perception ne s’attardant que sur les affects les plus communs. Le simple fait de changer de cadre générique peut constituer un acte politique. Le but, ici, est de déstabiliser notre compréhension de l’immuabilité des conditions, ou ce que Roland Barthes appelait dans les Mythologies « l’économie intellectuelle [petite-bourgeoise] des places reconnues ». Tout ce semblant de permanence et d’équilibre empêche non seulement l’émergence des subjectivités et des énergies politiques, individuelles comme collectives, mais il restreint également la mobilité des idées, la spontanéité et l’amorce de toute invention artistique. Élargir la chronologie usuelle d’un récit peut conduire à la remise en cause efficace de notre compréhension de « ce qui s’est passé ».
D’ailleurs, pour raconter Mai 68, vous ne partez pas de la mobilisation étudiante…
« L’intérêt n’est pas d’apprendre du passé, mais de désapprendre ce que nous pensons connaître du passé. »
Lorsque j’ai commencé mes recherches sur Mai 68, j’ai rencontré beaucoup de Français qui m’assuraient qu’il n’y avait aucun lien entre, d’une part, la guerre d’Algérie et la violence entourant sa fin à Paris au début des années 1960, et, d’autre part, l’insurrection étudiante quelques années plus tard. Un clivage temporel insurmontable existait dans l’esprit de beaucoup de gens, distinguant les turbulences du début des années 1960 et la complaisance caractéristique vers la fin de cette décennie — clivage qui a permis la naissance de clichés journalistiques tels que « Mai 68 fut un coup de tonnerre dans un ciel serein ». Au lieu de prendre les étudiants comme point de départ, j’ai décidé de commencer le récit de 1968 par ce qui avait en réalité été le premier soulèvement de masse de ces années : la manifestation des Algériens contre l’instauration d’un couvre-feu à Paris, le 17 octobre 1961. En faisant débuter Mai 68 en 1961, on voit se dessiner une forme de continuité entre les militants étudiants — minoritaires, certes, mais significatifs — et les efforts de libération nationale et anticoloniale qui avaient précédés. Cette continuité était invisibilisée, prise dans le brouillard des clichés selon lesquels « la France s’ennuie ». L’intérêt n’est pas d’apprendre du passé, mais de désapprendre ce que nous pensons connaître du passé, en libérant les événements des récits dans lesquels ils ont jusque-là été contenus. En tant qu’événement, et dans cette optique, la Commune a posé un défi tout particulier…
À quoi songez-vous ?
Comme Claude Roy l’a fait remarquer, aucun autre épisode n’a jamais semblé aussi clairement délimité, se pliant parfaitement à la règle des trois unités centrale à la tragédie : unité de lieu, de temps et d’action. C’est bien une tragédie qui nous est proposée. 72 jours d’action se déroulant au sein de la ville et culminant dans un cataclysme de feu et de sang. L’État rate sa tentative de désarmer les travailleurs parisiens, bat en retraite, et la Commune est déclarée. En d’autres termes, la temporalité politique de l’État est brièvement interrompue, et reprend finalement après 72 jours et le massacre de milliers de travailleurs. Le problème du récit habituel de la Commune est simple : si l’on commence avec l’État, on termine avec l’État. Je ne dis pas que je ne m’intéresse pas à ce que font les États, mais, si l’on veut rester cohérent avec la praxis de la Commune, il nous faut initier son récit non pas avec l’État mais avec la praxis qui cherchait à le rejeter. Il nous faut partir des pratiques collectives, et non des idées d’un penseur en particulier — au hasard, Proudhon — dont l’influence sur la Commune pourrait alors être mesurée. Pour cette raison, au lieu de commencer par les actions hasardeuses menées par l’État le 18 mars, je commence par les réunions, clubs et associations de travailleurs qui prospéraient à Paris à la fin de l’Empire, et je tente de recréer la phénoménologie de ces rencontres. Je m’interroge pour comprendre comment des individus variés — Parisiens et provinciaux, vieux militants quarante-huitards et jeunes membres de l’Internationale, hommes et femmes — se sont rencontrés pour la première fois lors de réunions locales, offrant une prise de parole inédite à certains travailleurs. L’expérience de ces rencontres et de la sociabilité particulière qui s’y jouait était déjà une forme de préparation à une vie menée selon les principes de l’association et de la coopération. C’est là que le désir d’une sorte de commune sociale a commencé à prendre forme. Je pense qu’il y a presque une volonté des historiens d’enfermer cet événement dans un cadre bien défini, de le comprendre comme un épisode de 72 jours se terminant tragiquement.

[Image extraite du documentaire Le Fond de l'air est rouge (Chris Marker, 1977)]
Quel est l’apport, au juste, d’une lecture de la Commune qui ne se borne pas à son écrasement ?
Aller contre cette volonté revient à penser la Commune par-delà le massacre perpétué par l’État pour y mettre fin. Cela revient aussi à ressentir les ondes de choc qui se sont diffusées jusqu’en Finlande avec Kropotkine, ou jusqu’en Islande avec William Morris. Ces répercussions ont par la suite propulsé les exilés et réfugiés communards en difficulté vers de nouveaux réseaux politiques et de nouvelles façons de vivre, en Suisse, à Londres et ailleurs. La prolongation de la pensée communarde au-delà de la Semaine sanglante dans les rues parisiennes, son élaboration au cours des rencontres entre les exilés et leurs soutiens, en Angleterre ou dans les montagnes suisses, font tout autant partie de l’événement que ce qui s’est passé à Paris. Cette prolongation, que j’ai analysée comme une forme de canevas, de réseau de relations et d’effets tissés autour de l’insurrection parisienne, a formé une sorte de « mondialisation par le bas » à la suite de la Commune. L’imaginaire socialiste formé immédiatement après la Commune était alimenté non seulement par l’insurrection, mais également par des éléments aussi variés que l’Islande médiévale, le potentiel communiste d’anciennes communes paysannes rurales de Russie et d’ailleurs, les débuts de l’anarcho-communisme, et une reconsidération profonde de la solidarité d’un point de vue qu’on qualifierait aujourd’hui d’écologique. Pour ainsi dire, ma méthode implique une reconfiguration active des événements passés et une compréhension de l’écriture de l’Histoire qui se rapproche de la poesis4, une fabrication plutôt qu’une reconstruction du passé. Je tente d’aborder le passé comme quelque chose d’incomplet, d’ouvert à de nouveaux futurs, mettant ainsi à jour des traces du futur déjà contenues dans le passé.
Comment se défaire des fameuses « leçons de l’Histoire » ?
« Les voix des ouvriers du passé méritent autant d’attention que les théoriciens qui ont par la suite utilisé ces mêmes ouvriers pour développer leurs idées. »
Ce n’est qu’en reconstruisant la phénoménologie propre à un événement, en collectant les voix des acteurs du passé et en passant du temps avec eux, qu’on peut appréhender ses effets les plus centrifuges et les plus éloignés. Ce n’est qu’en respectant la singularité d’un événement ou d’une lutte qu’on peut pleinement se le figurer dans notre vie quotidienne, pour qu’il se présente ainsi à nous comme un futur potentiel. La singularité de la Commune, par exemple, réside dans ce que ses acteurs ont fait et dit, ce qu’ils en ont pensé après coup, les termes qu’ils ont utilisés, empruntés, importés, rejetés ou abandonnés, et toutes les significations qu’ils ont pu donner à ces mots et aux désirs qui les motivaient. Il me semble qu’une formation littéraire aide à développer cette forme d’attention au langage : elle met l’accent sur la scène de la subjectivation, sur l’importance de commencer toute recherche par les sujets plutôt que par les concepts. J’ai souvent pensé que le polar avait le mieux transcrit la subjectivité politique qui avait émergé en 68, d’ailleurs, avec des auteurs comme Jean-François Vilar. Il y a dans cette méthode un héritage de la pensée de Benveniste, que je partage, il me semble, avec Rancière : la subjectivité est créée littéralement quand quelqu’un prononce le « je ». Ce pronom utilisé par tous permet une égalité fondamentale : chaque individu qui l’utilise s’approprie tout un langage dès lors qu’il l’énonce. Cette attention que je porte à l’énoncé m’a été inspirée par cette conviction de Rancière, selon laquelle les voix des ouvriers du passé méritent autant d’attention que les théoriciens qui ont par la suite utilisé ces mêmes ouvriers pour développer leurs idées. Pour ce faire, il faut cependant que leur environnement et leur condition sociale soient en quelque sorte « dénaturalisés », afin que les acteurs du passé, et tout particulièrement les ouvriers, nous apparaissent aujourd’hui en tant que sujets et non comme de simples données statistiques.
De quelle manière peut-on parvenir à cette opération ?
Pour les libérer de ce simple rôle de représentant de leur condition, il me faut parfois mettre en scène des rencontres inattendues, juxtaposer des éléments permettant de mettre en lumière le présent de ces ouvriers. Ou bien reconstruire la phénoménologie de l’événement en utilisant des perspectives transversales. Une fois ces ajustements effectués, je tente d’observer et d’écouter les dynamiques qui résultent de ces rencontres. Il ne s’agit pas de rechercher l’authenticité, de mettre au jour le travailleur authentique, la voix de l’authentique communard ou le seul récit authentique valable. Je cherche plutôt à comprendre comment les discours et les projets ont été formulés dans un monde spécifique, à un moment donné. Et il me semble effectivement que les excès d’un événement émancipateur tel que la Commune peuvent dépasser le temps qui lui est habituellement assigné, pour, aujourd’hui, nous ouvrir à des possibilités que ses acteurs n’auraient pas pu imaginer. Je ne veux surtout pas suggérer que l’Histoire nous offre des modèles ou des recettes : bien au contraire.

[Image extraite du documentaire Le Fond de l'air est rouge (Chris Marker, 1977)]
Qu’offre-t-elle, alors ?
Il faut se garder d’une approche fonctionnaliste envers les complexités du passé — tout comme nous l’évitons pour les nôtres. Le passé n’est pas didactique : sa relation avec le présent n’est pas une relation pédagogique, elle n’est pas non plus stable ni fixe. Le passé est tout à fait imprévisible. Par exemple, le Larzac est redevenu visible à un moment donné, a émergé comme possible source d’idées et d’inspirations seulement grâce au blocage victorieux que la ZAD a mené contre la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et grâce à la façon dont les vies collectives et individuelles ont pris forme pendant cette occupation. Le passé peut transformer notre conception du possible au présent, non pas en fournissant des leçons ou des modèles, mais en nous offrant au besoin l’image visible d’un acte d’auto-émancipation.
Vous semblez vous tenir à distance de la discipline sociologique…
« La sociologie se réfère toujours à un ensemble de facteurs déterminants qui, pour finir, confirment l’idée selon laquelle les événements n’auraient pu se dérouler autrement. »
Je ne lis que très peu d’ouvrages de sociologie — à cause de la perspective de normalisation inhérente à cette discipline. J’entends par là que la sociologie se réfère toujours à un ensemble de facteurs déterminants qui, pour finir, confirment l’idée selon laquelle les événements n’auraient pu se dérouler autrement. « Chacun à sa place, les vaches seront bien gardées. » Des catégories sont inventées dans lesquelles les faits sont expliqués selon les termes de leur propre existence — par exemple l’idée de « révolte de la jeunesse » en parlant de Mai 68. Ou alors c’est un environnement particulier qui est pris comme point de départ (l’usine, la banlieue, l’île, le quartier) et le fait même de commencer le récit en ces lieux destine leurs occupants à n’être rien de plus que l’expression naturalisée de leur milieu, des conditions, des circonstances. La sociologie a tendance à produire un discours normatif, presque tautologique, qui détruit la singularité d’un événement ou bien l’écrase sous les variables lourdes de la « longue durée ». C’est à la fois le cas pour la sociologie durkheimienne française ou pour la sociologie normative de Parsons (pire encore que la sociologie à la française), sur laquelle se fonde la discipline aux États-Unis. Les sociologues en tant qu’individus peuvent bien sûr faire des choix personnels et politiques qui sont radicaux, comme l’a fait Pierre Bourdieu après 1995, mais ces choix n’ont rien à voir avec leurs théories — l’activisme personnel de Bourdieu a pu changer mais ses théories sont restées les mêmes. Les politologues et les philosophes du politique ne sont guère mieux : ils commencent leurs recherches en se basant sur des concepts, et mobilisent par la suite les masses pour jouer le rôle de données prouvant la viabilité de ces concepts ou de leurs structures.
Vous liez la répression policière durant la Commune et Mai 68 à la militarisation de la colonisation, puis des guerres d’indépendance. Les violences policières que l’on connaît actuellement en France — que vous avez d’ailleurs dénoncées dans une tribune — entrent-elles en résonance avec l’histoire coloniale ?
Il existe toujours une proximité. Il suffit de regarder le plaisir que la police prend à faire respecter les règles de confinement liées à l’épidémie de coronavirus dans des endroits comme Clichy-sous-Bois. Les différences raciales et ethniques alimentent encore le modèle élémentaire de l’« altérité » sur lequel se fonde la violence policière. Des groupes comme les gilets jaunes ou les occupants des ZAD ont également eu à faire face à des violences policières excessives, mais ils ont été progressivement « altérés », justement, réduits dans les médias en hordes invasives ou en sauvages barbares — par les Finkielkraut, Bruckner et autres. La besogne de la police en a été largement facilitée.
Traduit de l’anglais par Maya Rousseaux et Roméo Bondon, pour Ballast.
Photographie de bannière : image extraite du documentaire Le Fond de l’air est rouge (Chris Marker, 1977)
- En référence aux grands travaux décidés sous le Second Empire par le préfet de Paris le baron Haussmann [ndlr].[↩]
- Je préfère me référer au titre original, Communal Luxury, pour sa construction en oxymore, qui convient plus au propos que la traduction française, L’Imaginaire de la Commune [ndla].[↩]
- Roman d’apprentissage : genre littéraire né en Allemagne au XVIIIe siècle, dont le canon est l’ouvrage de Goethe, Les Années d’apprentissage de Wilheim Meister [ndlr].[↩]
- Création, en grec.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien « Michèle Audin raconte Eugène Varlin », avril 2019
☰ Lire notre abécédaire d’Élisée Reclus, mars 2019
☰ Lire notre article : « Zola contre la Commune », Émile Carme, mars 2019
☰ Lire notre entretien avec Alessandro Pignocchi : « Un contre-pouvoir ancré sur un territoire », septembre 2018
☰ Lire « La Commune ou la caste — par Gustave Lefrançais » (Memento), juin 2017
☰ Lire notre entretien avec Jacques Rancière : « Le peuple est une construction », mai 2017
☰ Lire notre abécédaire de Louise Michel, mars 2017


