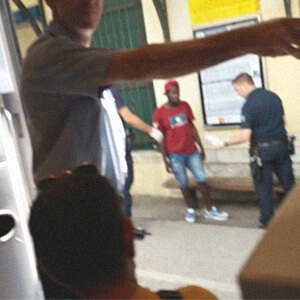Texte inédit pour le site de Ballast
Le préfet des Alpes-Maritimes vient d’annoncer que 45 000 personnes ont été reconduites à la frontière italienne à fin du mois dernier. Un chiffre en augmentation. « Le dispositif à la frontière est efficace, coopératif et humain », assure le haut fonctionnaire. « Les forces de l’ordre respectent scrupuleusement la loi et les interpellations se font avec un soin particulier. » C’est à la frontière franco-italienne — Nice, Menton, Vintimille — que, durant trois mois, l’auteure de ce carnet de bord s’est justement rendue à plusieurs reprises. Le soleil, la mer et la douceur de vivre du sud feraient presque oublier qu’une chasse aux migrants a lieu quotidiennement. Dans les trains comme dans la montagne. ☰ Par Sana Sbouai
Début juillet 2017
Vertige à la gare de Vintimille. Entre les flots de touristes — français pour la plupart — et les visages des badauds — heureux, en vacances, venus flâner au marché, acheter des cartouches de cigarettes moins chères que de l’autre côté de la frontière ou des contrefaçons de vêtements de marque de luxe —, de jeunes Subsahariens entament un ballet qui donne le tournis. Alors que le train en partance pour la France est stationné à quai, en attente d’un départ imminent, les jeunes hommes montent et descendent sans cesse des wagons, passent et repassent du quai au train, reprennent les escaliers qui mènent au quai suivant. Par petits groupes, ils bougent. La multitude fait espérer que les yeux des policiers italiens, des contrôleurs et des conducteurs de train perdent le compte et que, dans ce flot, certains parviennent à monter à bord d’un wagon et passent la frontière. Ce jour-là, El Bashir tente sa chance. Il raconte avoir 15 ans, et son visage juvénile en donne bien l’impression. Il vient du Soudan, répète plusieurs fois en anglais « afraid », avant de commencer à parler en arabe. Il raconte de manière complètement décousue, en parlant trop vite, son voyage : du Darfour à la Libye où il est resté un an, sa traversée de la Méditerranée dans un bateau qui charrie plus de 1 000 personnes, dont certaines sont mortes « au fond de l’eau ». Et, alors qu’il se souvient, joint ses longues mains et mime, lentement, un plongeon.
« El Bashir se ratatine sur lui-même. Il voudrait être transparent. Il voudrait être blanc. »
Trois mois qu’il est en Italie. Il veut aller à Marseille où un ami d’enfance, parti avec lui, est déjà arrivé. Il a peur que la police ne l’attrape à Menton-Garavan, première station française du trajet. « Quand ils voient quelqu’un comme moi, tu vois, avec ma peau, ils nous arrêtent » — avec son pouce et son index droits, il pince la peau de son avant-bras gauche, comme pour soulever un tissu qu’il voudrait que l’on regarde. « S’ils viennent, est-ce que je peux me cacher sous ton siège ? » Ses longues mains, dans un geste lent, plongent de nouveau vers le sol. Invisible, disparu sous l’eau. Invisible, disparu sous un siège ? El Bashir est bien trop grand pour se cacher sous un siège. Les yeux vides, il scrute la fenêtre. Le train a démarré. El Bashir se ratatine sur lui-même. Il voudrait être transparent. Il voudrait être blanc. Il voudrait une autre peau, là, maintenant. Le temps de passer cette frontière, au moins. « J’ai peur. Ils m’ont déjà attrapé. J’ai passé un mois en prison dans le sud de l’Italie… » Cette fois, sa main droite enserre son poignet gauche, complètement. « Je ne veux pas qu’ils m’arrêtent encore. »
Le train décélère et s’arrête en gare de Menton-Garavan. El Bashir regarde par la fenêtre et voit deux policiers marcher le long du quai. Il se raidit. Est-ce qu’il prie pour qu’ils ne le voient pas ? Il se lève, veut se cacher sous le siège, essaie de gagner du temps pendant que les policiers, montés à l’avant du train, inspectent chaque wagon. Peine perdue. El Bashir se rassoit. Les deux policiers arrivent à sa hauteur. Le premier avance, le dépasse et se poste en amont de l’allée ; le second s’arrête au niveau du jeune garçon et pose ses bras sur chaque siège de chaque côté de l’allée. Bras ouverts, comme pour une accolade ? Non, bras ouverts pour ne rien laisser passer. Sur chacun de ses avant-bras sont tatouées des lettres arabes, dans une orthographe approximative, des lettres que l’on a oublié de lier, comme des mains qui ne veulent pas s’unir.

Gare de Vintimille (par l'auteure)
« Bonjour monsieur, est-ce que vous avez des papiers ? » El Bashir, qui ne parle pas français, reste muet et ne tourne même pas la tête. « Ah ! On a un gagnant ! », lance le policier à son collègue. « Allez monsieur, on descend. » Et comme unique protestation, une voyageuse répond : « On a un perdant. » Le policier fait un signe de la main à El Bashir, qui se lève. Les policiers l’encadrent et, dans l’escalier, pour l’accompagner fermement, le policier aux bras tatoués pose une main sur sa nuque. Ironie de la vie : c’est devant la villa Africa que le wagon d’El Bashir s’était arrêté à quai. Son voyage s’arrête là, pour le moment. Reconduite à la frontière, retour en Italie. El Bashir a choisi un voyage sûr. D’autres entreprennent un périple à l’issue plus brutale et trouvent la mort en tentant le passage à pied, le long de la voie ferrée ou en passant par les sentiers de montagne. Doux amer, ce ciel bleu. Le train reprend son chemin. En contrebas, le long du rivage, des estivaliers profitent de l’été — avec leurs mains, ils nagent la brasse, le crawl, étalent de la crème solaire sur leur peau. Être bronzé, c’est toujours beau. Être bronzé, oui, mais pas trop.
Fin juillet 2017
« Des policiers et des soldats, toujours, et dans un coin de la rue, assis sur un muret, des hommes, immobiles, qui attendent. »
À l’entrée de la gare de Vintimille, on trouve comme comité d’accueil un petit groupe d’hommes armés : des policiers et des soldats, coiffés d’un chapeau avec une plume. Leurs silhouettes se découpent à contrejour dans l’encadrement de la porte et, à chacun de leurs mouvements, sur leur tête, la plume danse. C’est étrange ce qu’une plume, même sur la tête d’un soldat, peut avoir de délicat. À l’exact opposé de la scène qui va se dérouler un instant plus tard. Ici, c’est systématique : les personnes à la peau noire sont contrôlées. Ce jour-là, c’est une femme et les deux fillettes qui l’accompagnent, qui ont l’air de venir faire des courses à Vintimille. Comme tout le monde. Touristes ou locales, elles sont là pour profiter de leur journée ; ça se voit à leur allure : tee-shirt impeccable, jolies sandales, lunettes de soleil, elles sont bien apprêtées. À l’entrée du quai, les policiers les arrêtent — terrible image, qui ne semble offusquer personne. Pourtant, dans l’estomac, une brûlure ; dans la tête, les images tant de fois montrées de ces gens entassés dans des trains qui allaient vers l’enfer. La gare est sombre, le soleil, dehors, tape trop fort. Une fois la porte passée, la lumière nous engloutit : il faut un temps aux yeux pour apercevoir à nouveau. Des policiers et des soldats, toujours, et dans un coin de la rue, assis sur un muret, des hommes, immobiles, qui attendent.
Alors que la saison estivale bat son plein, Teresa Maffeis, militante niçoise de l’Association pour la démocratie à Nice, s’active sans relâche. Ce matin-là, elle a pris un train tôt pour assurer la collecte de vêtements organisée par un couple de Suédois habitant dans la vallée de la Roya. « On ne croit pas à la situation jusqu’à ce qu’on la voie de ses yeux », explique, encore abasourdie, la Suédoise. C’est après avoir accueilli deux jeunes gens perdus dans la forêt que cette réalité a fait son chemin jusqu’à elle. Teresa pousse le grand portail du local de Caritas, à Vintimille, pour permettre au couple d’entrer dans la cour du local et de décharger ses sacs. Les migrants forment déjà une longue file d’attente. Par petits groupes, ils accèdent à l’intérieur du bâtiment, où une vingtaine de bénévoles s’active pour la distribution du petit-déjeuner, pendant que d’autres s’affairent en cuisine.

Entrée de la gare de Vintimille (par l'auteure)
Le local Caritas fait partie des quelques lieux d’accueil de la ville pour les migrants. Sur l’un des murs de l’espace, une liste — rédigée en français, en anglais, en arabe et en araméen — donne les autres adresses où les migrants peuvent trouver de l’aide. Teresa se fraie un chemin afin d’aller saluer les uns et les autres ; elle se fait alpaguer, distribue bonjours et baisers. Puis elle décide de se rendre à l’église, deuxième point-relais de la liste. Elle a été ouverte à tous, puis n’a plus accueilli que les femmes et les enfants. Alors, devant les grilles, des hommes attendent, en plein soleil, et espèrent quand même pouvoir rentrer. Dans la grande cour de l’église, femmes et enfants jouent ou se reposent, pendant qu’en cuisine le déjeuner se prépare. De l’autre côté de la rue, l’ambiance est moins joviale. Sur un muret, des hommes attendent. Ils cherchent à savoir ce qu’il est advenu des migrants qui dormaient avec eux dans le camp de fortune aménagé le long de la berge de la Roya, sous les ponts routiers. Dans un anglais approximatif, ils interrogent les gens de passage : « Where ? Where ? » Cette nuit, ils ont tous dormi là, mais à 7 heures ce même matin, la police est venue « nettoyer », comme disent les habitants — « Faire une rafle », pour les associatifs. Un jeune homme cherche son frère. Il a 17 ans. Il est soudanais. Il parle un peu anglais. Derrière lui, en file indienne, d’autres jeunes gens veulent comprendre, mais personne n’ose prendre la parole. Alors, c’est le chef de file qui discute ; autour de lui les bras s’agitent. Il ressemble à une divinité indienne.
« La nuit, ils sont nombreux à parcourir les quelques kilomètres qui séparent Vintimille de la France en longeant les voies de chemin de fer ou l’asphalte. »
Quand les migrants en ville pour quelques jours ont besoin d’un endroit où se poser un instant, ils se retrouvent au café de Vélia. Derrière le comptoir, cette dernière ne s’arrête jamais : servir les clients, préparer des sandwichs, faire la vaisselle… Entre la machine à café et un poivrier géant, elle a installé deux multiprises pour permettre aux migrants de charger leur téléphone. Au-dessus, une feuille de papier indique que les appareils doivent être récupérés avant 17 heures. Dans la salle, des petits groupes de migrants sont installées à plusieurs tables sans toujours consommer. Sur le frigo, Vélia a collé une feuille avec le prix des boissons. Devant la porte, quelques valises et sacs pleins à craquer sont posés sur le trottoir. On pourrait être n’importe où, dans quelque ville cosmopolite, loin, ailleurs. Mais là, les bagages rappellent que les clients veulent partir, passer la frontière, aller en France pour, souvent, pousser plus loin leur périple. Et, pour partir, les migrants ont trois options : la voiture, le train, leurs pieds. Les routes, pour ceux qui veulent passer à pied, sont périlleuses : le long de l’autoroute ou du chemin de fer, ou par la montagne. La nuit, ils sont nombreux à parcourir les quelques kilomètres qui séparent Vintimille de la France en longeant les voies de chemin de fer ou l’asphalte. Certains y laissent la vie, percutés par des véhicules. C’est ainsi qu’en 2016, Millet, une jeune fille érythréenne de 16 ans, a été fauchée par un camion sous un tunnel reliant l’Italie à la France.
Et puis il y a les sentiers, à flanc de montagne. Un itinéraire de plus en plus long, pour éviter les policiers en faction à la frontière, mais aussi ceux, vêtus d’une tenue de camouflage, postés le long de ces chemins étroits et montagneux. Dans les hameaux qui bordent la commune de Vintimille, les habitants voient passer les migrants. Enzo Barnabà, historien italien, raconte l’histoire de ces sentiers : le passé italien du comté de Nice, les Italiens qui fuyaient le fascisme en les empruntant. Dans « Grimaldi, cohabiter avec la frontière », un article qu’il publia en 2012 dans la revue Migrations Société, Barnabà retraça : « Si on n’a pas les papiers requis, il ne reste qu’à passer clandestinement par des sentiers incertains et dangereux, conduits par des habitants du village qui n’ont pas de scrupules à arrondir les fins de mois en se transformant en passeurs et en (minuscules) contrebandiers. Ceux qui passent aussi clandestinement la frontière sont des antifascistes, des Juifs, des milliers de personnes — Italiens et étrangers — qui cherchent en France asile ou travail. Au fil des années, des centaines de personnes y laissent leur peau, surtout en cherchant à franchir de nuit celui qu’on finira par appeler le Pas de la mort. » Le Pas de la mort, c’est un chemin au bord duquel on ramasse des mûres sous les feuilles des figuiers. En été, les cigales chantent fort et accompagnent le bruit de la rivière en contrebas. On pourrait s’allonger sur un coin d’herbe et regarder la vue, à couper le souffle. La France est là, à un saut de puce. Et si on pouvait voler on y serait déjà. Dans une maison abandonnée, des vêtements de voyageurs s’entassent. Sur les murs, certains ont laissé une trace de leur passage.

Chemin de fer de Vintimille (par l'auteure)
Retour à la ville. À Vintimille, deux jeunes garçons ont réussi à monter dans le train, qui quitte la ville. Quelques courtes minutes après avoir passé la frontière, l’engin réduit sa vitesse et s’arrête en gare de Menton-Garavan. Deux binômes de policiers, postés en tête et en queue de train, montent à bord, tandis qu’un cinquième policier, qui semble être le chef, leur hurle des ordres. Dans le train, les forces de l’ordre scrutent les passagers, ouvrent les portes des toilettes, vérifient tous les recoins. L’un d’entre eux exulte : « J’en ai deux ! » Les deux voyageurs sont priés de descendre et rapidement dirigés, une main plaquée contre le haut de leur dos, vers le parking devant la gare où trois camions de police sont garés. « Sit ! », intime le policier en chef aux deux migrants apeurés. Un des garçons tient à la main un sac à dos bleu, un de ces sacs que l’on utilise pour aller à la plage. Comment peut-on y faire rentrer une vie ? L’autre n’a rien. Les deux jeunes, hagards, s’assoient sur les marches qui mènent au parvis de la gare, au pied de l’une des estafettes.
« C’est au tour du second adolescent de signer. Signer quoi, d’abord ? Un autre policier fait monter les deux voyageurs dans une fourgonnette. »
Le policier qui, après avoir crié « Sit ! », se sert du capot de l’estafette pour annoter des informations sur une feuille, se tourne vers les deux jeunes hommes et crie : « Name ! » Puis fait signe au jeune au sac bleu de se lever : « Sign ! » Le jeune s’exécute, mais le stylo n’écrit plus. Comme un écolier, il secoue le stylo. Toujours rien. « Wait ! », lance le policier. Aucun sens de la mesure. Incapable de jauger la situation, l’homme tient à marquer son autorité et ne cesse de vociférer face à ces silhouettes immobiles, muettes, prostrées, qui ne manifestent aucune résistance. Pourquoi un tel spectacle ? C’est au tour du second adolescent de signer. Signer quoi, d’abord ? Un autre policier fait monter les deux voyageurs dans une fourgonnette. Le chef, lunettes de soleil sur le nez, grand sourire aux lèvres, a enfin fini de crier. Il remet ses gants noirs et, des deux mains, adresse des au revoir aux migrants qui sont embarqués, pour finalement terminer son geste les pouces en l’air en signe de réussite. La camionnette roule quelques instants, remonte vers le poste-frontière situé à un kilomètre à peine de la gare. Les passagers sont déposés là, dans un local. De la main droite, un policier referme la porte en métal qui les sépare de l’extérieur. À sa main gauche pendouille le sac bleu du jeune homme arrêté dans le train.
Août 2017
Dans la cour du local de Caritas, à Vintimille, Godwin passe des matinées entières juché sur la rambarde des escaliers fabriqués en montants d’échafaudage et en planches. Avec Alfred, un migrant ghanéen, ils régulent les entrées et sorties des migrants venant chercher nourriture et vêtements dans le local de Caritas. Godwin et Alfred sont bénévoles. Ce jour-là, les demandeurs sont peu nombreux. « Ça peut monter jusqu’à 500 personnes par matinée », précise le premier. Lui est en Italie depuis « un an, un mois et quatre jours ». Il a un permis temporaire de séjour mais attend une régularisation et un permis de travail. Ce Nigérian de 33 ans est coiffeur et veut se remettre au travail rapidement. Rester au foyer dans lequel il est hébergé sans rien faire, ce n’était pas son truc. « Quelques semaines après mon arrivée en Italie, j’ai vite voulu sortir de la maison et être en contact avec des Italiens. C’est pour ça que je suis venu aider à Caritas et dans une autre association. » Godwin travaille comme bénévole quatre jours par semaine. Aux premières loges de l’aide humanitaire, il est devenu un observateur averti de la situation. Il explique que les migrants qui tapent à la porte de Caritas sont pour une grande partie des mineurs et, pour la plupart, seulement de passage : « Un, deux jours, rarement plus. Ils ne restent pas, ils partent vers la France. » Un chemin dangereux, explique-t-il : « Certains empruntent la ligne de chemin de fer à pied, la nuit. » Godwin n’a pas voulu en faire autant. Il attend d’avoir des papiers pour décider quoi faire et dans quelle ville s’installer. S’il doit aller en France, il veut le faire légalement et ne pas se risquer à un passage clandestin, trop aléatoire. Depuis le temps qu’il est là, il a été témoin de suffisamment de retours pour comprendre qu’aussi inutile que soit le système, les polices italiennes et françaises n’en continuent pas moins leur chasse à l’homme.
Italie. Vintimille. Train. Départ. Frontière. France. Menton-Garavan. Arrêt. Portes. Policiers. Traque. « J’en ai trois ! » Interpellation. Mains sur la nuque. Descente. Quai. Gants. Fouille. Parking. Estafette. Poste-frontière. Italie. Les habitants du coin racontent que, lassé de refaire, encore, le même parcours, un homme interpellé dans un train pour la France et reconduit en Italie s’est donné la mort en se jetant sous un camion, en juillet 2017, dans la commune italienne de Lattes, à quelques kilomètres à peine de Vintimille.

Inscriptions dans une maison abandonnée (par l'auteure)
Octobre 2017
L’été indien n’en finit pas, la mer est toujours couleur d’azur et le ciel dégagé. Les plages se sont vidées des trop nombreux touristes, mais les locaux continuent de se baigner dans l’eau fraîche. Depuis les wagons du TER qui relie Nice à Vintimille, les voyageurs les aperçoivent, points minuscules gesticulant dans la mer. L’ambiance est toujours à la détente, mais tout est plus calme. Le beau temps semble immuable sur la Côte d’Azur. Une donnée stable. Comme la présence de policiers ou de militaires des deux côtés de la frontière. À l’aller, pas de contrôle de la part des policiers français à Menton-Garavan, mais un accueil par des policiers et des soldats à Vintimille. Dans la ville italienne, les migrants continuent à errer, tout en se faisant discrets. Depuis l’été, l’église n’assure plus l’accueil des femmes et des enfants. Le long de la berge de la Roya, les migrants sont toujours installés dans le camp de fortune. On ne les verrait même pas si, de temps en temps, l’un d’entre eux ne se levait pas. On pourrait alors croire que des vêtements ont été abandonnés là, accrochés aux grillages, sous le pont routier, comme dans les maisons abandonnées le long des sentiers de montagne.
« C’est le début de l’hibernation dans la région de la Roya. On se dit que les forces de l’ordre auront peut-être, elles aussi, la main moins lourde. Raté. »
Au café de Vélia, des migrants continuent de charger leur téléphone portable et de discuter autour d’une tasse de café vide. Tout est endormi, c’est le début de l’hibernation, dans cette région. On se dit que les forces de l’ordre auront peut-être, elles aussi, la main moins lourde. Raté. Dans le train, deux jeunes hommes subsahariens sont installés côte à côte. Ils discutent à haute voix dans le wagon presque vide. Ils sont bien habillés, l’un d’entre eux scrolle sur sa tablette tout en discutant avec son voisin. Puis s’excuse, se lève et part à la rencontre du contrôleur, à qui il achète un billet. Pendant ce temps, un homme, visage anxieux, cheveux ras, rangers, bombers noir alors qu’il fait 25 °C, fait et refait le tour du wagon à étage. Il monte les escaliers d’un côté du wagon, pour redescendre de l’autre côté. Il presse le pas et ne perd jamais de vue, même du coin de l’œil, les deux voyageurs. Dans un des haut-parleurs, la voix du contrôleur annonce : « Prochain arrêt Menton-Garavan. » Les deux jeunes voyageurs continuent leur discussion. Celui installé près de la fenêtre dit alors : « Moi je m’en fous, j’ai le visa. S’il me dit : Descends !
, je descends et je remonte après. »
Le train s’arrête, les portes s’ouvrent, trois policiers pressent le pas en direction des deux jeunes hommes sans même prêter attention aux autres voyageurs. Les policiers ne contrôlent personne d’autre. Ils ne contrôlent que ces deux hommes noirs. C’est pourtant interdit, les contrôles au faciès. Les deux jeunes hommes, imperturbables, tendent leurs papiers d’identité au policier, qui les tutoie : « C’est quoi ça, c’est ton permis ? Mais t’as pas la même tête ! – Pourtant c’est moi monsieur, explique le jeune homme au policier, j’ai refait le permis et le passeport y’a pas longtemps, vous voyez bien que c’est moi. – Tu es trop jeune sur les photos : tu dois les changer ! » Le jeune homme rigole. Sans moquerie, mais de dépit. Et le policier de finir par rendre les papiers aux jeunes hommes, qui peuvent continuer leur chemin, passer la frontière. Mais pas comme tout le monde. Pas tranquillement. Pas sans peur. Pas avec toute leur dignité.
REBONDS
☰ Lire notre témoignage « De réfugié à fugitif », novembre 2017
☰ Lire notre entretien avec le Gisti : « Droit d’asile : ça se durcit d’année en années », novembre 2017
☰ Lire notre article « Se souvenir de la frontière : Gibraltar », Maya Mihindou, juin 2017
☰ Lire notre témoignage « Patrick Communal — Le droit au service des laissés-pour-compte », décembre 2016
☰ Lire notre témoignage « Ne pas laisser de traces — récit d’exil », Soufyan Heutte, juillet 2016
☰ Lire notre article « Réfugiés : au cœur de la solidarité », Yanna Oiseau, mai 2016
☰ Lire notre article « Crise des réfugiés : ce n’est pas une crise humanitaire », Yanna Oiseau, mai 2016