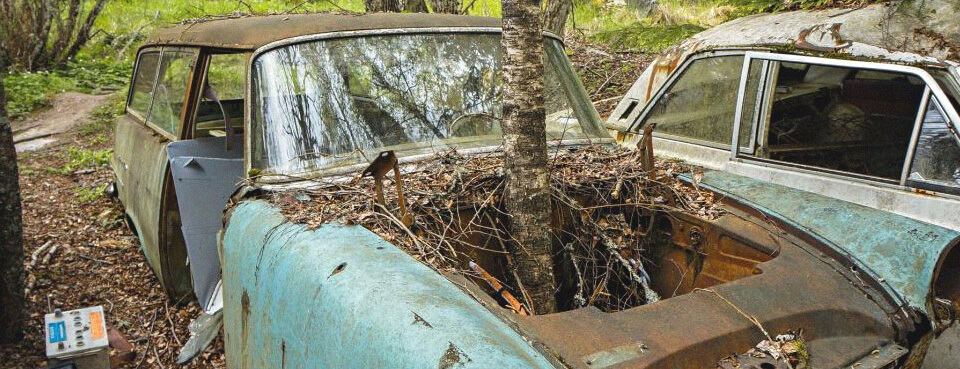Entretien inédit pour le site de Ballast
Rendez-vous est donné dans une brasserie, à l’est de Nantes. Le sociologue Jean-Baptiste Comby, auteur de La Question climatique, genèse et dépolitisation d’un problème public, nous présente les alentours : un des quartiers les plus pauvres de la ville, d’un côté ; un écoquartier, de l’autre — une illustration des problématiques qu’il soulève dans ses recherches. L’écologie est une question profondément sociale et matérielle, explique-t-il, mais d’aucuns mènent un travail sans relâche pour la repeindre en « croissance verte » et autre « développement durable ». L’inoffensive « morale éco-citoyenne », promue par les élites administratives, politiques, médiatiques et scientifiques, fait peser tout le poids de l’urgence écologique sur les seuls individus : à tort. Dépolitiser ces problématiques, c’est éviter que se pose la question, pourtant cruciale, de la compatibilité des exigences d’un monde soutenable avec les logiques propres au capitalisme…

J’ai effectivement étudié les reportages des journaux télévisés du soir consacrés entre 1996 et 2011 aux enjeux climatiques et aux économies d’énergie. Mais ce n’est qu’une partie de mon travail ; ce qui m’est apparu le plus fondamental a été de comprendre comment s’est construite socialement la question climatique dans le débat public — et donc de penser cette médiatisation comme le résultat de rapports de classe. En regardant à la fois les conditions sociales de la construction du problème, d’une part, et les conditions sociales de son appropriation (c’est-à-dire les rapports des individus à ces enjeux), de l’autre, j’ai pu montrer comment les cadrages dominants de la question climatique servent certains intérêts sociaux plus que d’autres. L’idée est ainsi de resituer cette étude de la médiatisation dans une analyse sociologique plus générale. J’ai donc observé les personnes qui, depuis le milieu des années 1990, se mobilisent sur le climat en France et essaient d’en faire un problème important : quelles sont leurs trajectoires et coordonnées sociales ? Quelles relations entretiennent-ils entre eux ? Quelles visions politiques du climat ont-ils ?
« Ces experts, hauts fonctionnaires ou militants d’associations environnementales ne sont pas dans une perspective de critique sociale. »
Pour revenir un instant au traitement médiatique : un des principaux constats est que plus on va parler des changements climatiques dans les médias, moins on va expliquer leurs causes et plus on va parler de leurs conséquences. Or quand on traite des causes, on peut en venir assez vite à des explications structurelles relevant de l’ordre social, et donc politique — ce qui n’est pas le cas avec les conséquences du problème. Cette tendance s’explique par les modes de fonctionnement du champ journalistique et la nécessité de rendre la question climatique audible pour tout le monde, d’en faire un problème omnibus, sans aspérités idéologiques. Ce n’est donc pas le résultat d’un calcul intentionnel. Cela correspond aussi à ce que sont politiquement les promoteurs de la cause climatique au cours des années 2000 : conformistes et disposés à proposer des lectures des enjeux climatiques compatibles avec l’ordre établi. Ces experts, hauts fonctionnaires ou militants d’associations environnementales, ne sont pas dans une perspective de critique sociale : ils veulent avant tout en faire un problème important, quitte à le nettoyer de ses aspérités idéologiques… Alors que cette question est au départ susceptible de remettre fondamentalement en cause les bases sociales du capitalisme !
Mais comment donner une vision complète d’un problème aussi abstrait et diffus autrement qu’avec statistiques et graphiques ?
Peut-être que le problème était abstrait au début des années 2000, auquel cas cela pouvait justifier un travail de mise en image, en forme, en sensibilité, en concret de cette thématique. Mais de là à ne faire que cela, c’est autre chose — et c’est ce que j’interroge. Qu’est-ce qui a fait qu’il est devenu obsessionnel pour les journalistes et leurs sources de rendre palpables ces enjeux ? Cette préoccupation en dit déjà long sur la façon dont ils conçoivent le problème. Elle s’illustre par exemple avec le succès de l’expression « réchauffement climatique », qui réduit le problème à une seule variable (la température) et à une seule variation (la hausse de celle-ci), alors que les climats sont aussi composés des régimes des vents ou pluviométriques — et que ces différents éléments peuvent se dérégler de diverses manières. Mais tout le monde s’est mis d’accord sur l’efficacité supposée de l’expression « réchauffement climatique », qui avait le mérite de traduire simplement le problème auquel a été associée toute une grammaire et une imagerie du réchauffement (couleurs vives, thermomètre, sécheresses, etc.). Rien ne permet, pourtant, de dire que les gouvernés n’étaient pas capables d’entendre des choses un peu plus subtiles et de comprendre qu’il y a des changements climatiques — lesquels prennent des tournures différentes selon les lieux et les périodes. Ce qui permet d’expliquer qu’ils puissent se traduire par des vagues de froid plus fréquentes et plus intenses, par exemple. C’est là une illustration parmi d’autres de l’effet de clôture du dicible engendré par l’impératif de sensibilisation : il fallait prioritairement rendre sensible pour faire prendre conscience. Tout ce qui risquait de contrarier cette dynamique était écarté. Cela nous dit aussi des choses sur ce qu’est devenu le « bon » journalisme : c’est celui qui, conformément aux exigences commerciales de l’audience maximale, est censé « concerner » en entrant immédiatement en résonance avec le quotidien des individus. C’est là une logique professionnelle profondément dépolitisante, puisqu’on invite ces derniers à rapporter les problèmes à leur quotidien et non à l’organisation sociale au sein de laquelle ils évoluent.
Journalistes, scientifiques et politiques agissent conformément à ce que vous appelez la « doxa sensibilisatrice », avec pour objectif de faire prendre conscience aux individus de la crise écologique afin qu’ils modifient leurs comportements — prendre les transports en commun, faire le tri, manger bio, etc. En quoi cela empêche-t-il un traitement politique de la question climatique en parallèle ?
Au début des années 2000, les médias ont constitué un lieu de mobilisation privilégié pour les scientifiques, les experts, les militants et les hauts fonctionnaires qui portent la cause du climat. Autrement dit, les journalistes occupent une place centrale dans la configuration qu’ils forment — et ce jusqu’au Grenelle de l’environnement, qui va avoir pour effet de détourner ces acteurs de l’arène médiatique. Cette réorientation permet d’ailleurs d’expliquer pourquoi on parle moins du climat à partir des années 2008–2010. On a souvent mis en avant le fait qu’il y avait une lassitude du public. Certainement que cela joue, mais c’est surtout le fait que les acteurs qui dépensaient beaucoup d’énergie et de moyens pour entretenir une actualité journalistique sur le climat vont, à partir de cette période, se consacrer au travail administratif et législatif.
« Les définisseurs autorisés de la question climatique appartiennent aux groupes privilégiés. »
Alors pourquoi une telle mobilisation au sein des médias au cours des années 2000 ? Ce que je montre, c’est que les politiques publiques sur le climat mettent l’accent sur la communication, les relations presse et la nécessité de fabriquer un débat public conséquent. Le problème climatique est passé à la moulinette des préceptes néolibéraux, qui centrent l’action sur les individus en vue de gouverner leurs conduites, pour parler comme le philosophe Michel Foucault. Afin de légitimer ces politiques essentiellement incitatives, il faut donc pouvoir dire que les Français sont hautement responsables du problème. Sont convoquées à cette fin des statistiques publiques soutenant qu’ils émettent « 50 % des émissions de gaz à effet de serre », mais aussi des spécialistes de la communication ou des chercheurs en psycho-sociologie de l’engagement, affirmant qu’on peut changer les comportements par la « sensibilisation », l’information, la pédagogie — donc par la communication, les médias, l’école ou les productions culturelles. C’est à nouveau une façon de détourner l’attention des causes structurelles, en déployant une vision néolibérale et post-moderne de l’individu (qui serait autonome, car en apesanteur du social, responsable de ses actes car doué d’une réflexivité sans faille, disposé à avoir des raisonnements comptables car rationnel). Une conception plus sociologique et politique de l’individu oppose à ces croyances que les comportements des individus sont d’abord le résultat de l’intériorisation différenciée de structures sociales, de contraintes matérielles et d’enjeux symboliques, comme le montre un certain nombre de travaux.1
Ce n’est pas simplement un aveu d’échec face à l’impossibilité de modifier les causes structurelles du changement climatique ?
Je ne pense pas que ce soit une action par défaut. Il y a une adhésion forte à cette entreprise politique de sensibilisation des individus pour les faire changer de comportement. Cette individualisation relève d’une dépolitisation — plus exactement d’une forme dépolitisante de politisation, de prise en charge politique. Rien, ou presque, dans l’histoire sociale des promoteurs des enjeux climatiques ne les incline à agir sur les causes structurelles du problème, lequel est pourtant généré par l’ordre social capitaliste. Ce dernier est mis à l’abri de la critique. Et avec lui les logiques qui assurent aux dominants leurs privilèges. Or les définisseurs autorisés de la question climatique appartiennent aux groupes privilégiés. Ils ne cherchent donc pas à transformer l’ordre social mais plutôt à l’améliorer pour rendre durable sa désirabilité. Ériger l’individu en échelle d’action pertinente permet cela, en drapant le conservatisme des vertus du progressisme.
Vous expliquez que l’injonction à un comportement éco-citoyen relève d’une morale de classe portée par des personnes appartenant à des catégories de population qui, bien que plus sensibilisées, ont un mode de vie plus polluant. Comment entendre ce paradoxe ?
Effectivement, il y a une certaine homogénéité sociale de ces entrepreneurs de la cause climatique, au début des années 2000, dans le sens où ils appartiennent aux classes dominantes tout en y occupant des positions secondaires, dominées. Ce sont des dominés chez les dominants. En ayant cette donnée sociologique en tête, on comprend mieux pourquoi ils portent un discours qui est critique, mais modérément. Ils ont fait de la question écologique un formidable laboratoire du réformisme contemporain. Cela permet aussi de comprendre pourquoi la question climatique est construite sur le registre du consensus. On aurait pu s’attendre à ce qu’il y ait des conflits, des débats assez violents, des controverses, des affaires ou d’autres registres moins consensuels mettant à parti différentes fractions des classes dominantes. Mais il y a quand même un accord qui s’établit entre fractions dominées et fractions dominantes des classes supérieures sur la pertinence d’une « critique » suffisamment dépolitisée pour être gérable et digérable par les pouvoirs économiques et politiques. Car, rappelons-le : la question climatique porte en elle de puissants germes de remise en cause des intérêts (des) dominants. La « doxa sensibilisatrice » va alors mettre tout le monde d’accord et permettre de reléguer au second plan d’éventuelles divergences.
« Au sein des classes populaires, la morale éco-citoyenne et les discours dominants sur le climat sont perçus comme relevant d’une écologie
de bonne conscienceoude riches. »
Ces conditions sociales ne sont alors pas sans incidences sur la manière dont les comportements individuels sont ensuite incriminés. On va mettre en avant des modifications de petits gestes ou de comportements compartimentés (alimentation, logement, mobilité, consommation), ce qui permet, tout en gardant le même style de vie, de valoriser le verdissement, ici ou là, de certains comportements. On peut donc intégrer la morale éco-citoyenne tout en gardant un style de vie compatible avec les standards des classes supérieures. Cette réforme de soi n’est pas une transformation de soi — qui, elle, supposerait aussi une transformation des structures sociales : marché du travail, modes de déplacement, aménagement du territoire, répartition des richesses, etc. On entend tout le temps un discours sur ces écolos pétris de contradictions, avec une lecture morale du type « Tu es écolo mais, quand même, tu fais ça… ». Tant que les structures sociales seront celles-là, et tant qu’on cherche à s’y intégrer, les normes du comportement écologiste rentreront effectivement à un moment donné en contradiction, non pas avec des choix individuels, mais avec les structures sociales qui déterminent et qui orientent ces choix. C’est donc une contradiction entre des aspirations éthiques et dépolitisées, d’un côté, et l’ordre social dans lequel on vit, de l’autre. Si on politisait cette contradiction, au lieu de la penser dans un registre moral, peut-être pourrait-elle générer davantage de contestation de l’ordre établi. Quand on veut gagner en reconnaissance sociale, on est généralement conduit à développer un rapport à l’argent, à la mobilité ou au temps qui ne favorise pas une mise en cohérence poussée de ses pratiques avec une morale écologiste. C’est notamment pour cela que ceux qui cherchent réellement cette cohérence sont contraints de sortir des jeux sociaux conventionnels en allant dans des éco-villages ou en s’organisant collectivement « en marge ».
Pour revenir au paradoxe que je décris, il part du constat que ceux-là mêmes dont les styles de vie émettent le plus de gaz à effet de serre, à l’échelle d’une année, sont aussi les plus disposés à adhérer à la morale éco-citoyenne, à la mettre en œuvre et à faire valoir leur bonne conscience écologique. Les politiques publiques dont nous parlions, centrées sur les individus, valorisent par exemple un ethos comptable (songeons aux crédits d’impôts et aux compétences administratives qu’il requiert) qui correspond aux manières dont les classes moyennes (et) supérieures tendent à gérer leurs budgets domestiques. L’orientation sociale de l’éco-citoyenneté apparaît plus nettement encore quand on met en perspective sa consécration au sein des franges privilégiées de la population, avec la lecture qu’en font les membres des classes populaires. Pour ces derniers, ce qui saute aux yeux, ce sont d’abord les coûts matériels de ces prescriptions morales — ce qui permet de rappeler les soubassements matériels de l’écologie qui, n’en déplaisent à certains penseurs postmodernes, n’est pas vraiment un « nouveau mouvement social post-matérialiste ». J’expose dans le livre un certain nombre de facteurs qui expliquent pourquoi, au sein des classes populaires, la morale éco-citoyenne et les discours dominants sur le climat sont perçus comme relevant d’une écologie de « bonne conscience » ou « de riches ».
Malgré tout, les thématiques mettant l’accent sur les inégalités environnementales, notamment portées par les mouvements de « justice climatique », sont plutôt en vogue — que ce soit pour montrer les inégalités entre pays riches et pauvres ou celles entre classes supérieures et inférieures dans un même pays…
Oui. On parle souvent d’inégalités environnementales, mais essentiellement des inégalités d’exposition aux nuisances environnementales, aux catastrophes naturelles, aux pollutions, etc. Il est bien étayé que les plus démunis sont les plus vulnérables et les plus exposés aux dégâts environnementaux du système capitaliste — les travaux de Romain Huret sur Katrina le montrent très bien2. Ce qui a en revanche été très peu fait, c’est d’analyser les contributions des différentes classes sociales aux pollutions. Ces inégalités-là sont encore peu visibles. Certes, on les discute au niveau international du fait de la tournure prise par les négociations diplomatiques, où on a essayé de trouver un équilibre entre les pays du Sud qui émettent moins de gaz à effet de serre que les pays du Nord. Il y a donc un discours assez établi au niveau des pays. Mais pas au niveau des classes sociales. Or, quand on pense en termes d’inégalités d’exposition et de contribution aux problèmes environnementaux à l’échelle d’un pays, on s’aperçoit que c’est la double peine pour les milieux populaires. Ceux-ci, dont les modes de vie contribuent le moins à la détérioration des écosystèmes, sont non seulement les premières victimes des nuisances environnementales, mais sont aussi (tenus) à distance de ces enjeux sur lesquels ils ont pourtant bien des choses à dire. La morale écologique promue par l’écologie mainstream, qui se présente volontiers comme étant l’affaire de tous, concernant tout le monde et devant parler à tout le monde, profite à l’inverse à des personnes qui ont des profils sociaux proches de ceux qui la mettent en place, c’est-à-dire prompts à préserver les structures sociales qui célèbrent des styles de vie énergivores. Pour eux, c’est coup double.
Parmi les sources qui co-construisent la question climatique avec les journalistes, il y a notamment les scientifiques. Vous mettez en avant le nombre de fonctions exercées par de nombreux spécialistes du climat, que ce soit dans les grandes entreprises, les administrations, ou les médias. Doivent-ils se cantonner à leur rôle de chercheur ou intervenir dans le débat public et tenter d’influencer les décideurs ?
« La participation des scientifiques au débat public est venue donner une caution académique aux logiques de dépolitisation. »
Cette question est en fait celle de l’autonomie du champ scientifique. Premièrement, les compétences d’un scientifique ne sont pas les mêmes que celles d’un expert. Quand le scientifique joue l’expert, il doit développer un certain nombre de compétences et de ressources qui ne sont pas celles valorisées dans le champ scientifique : capacité à parler simplement, à synthétiser et à hiérarchiser le propos… Les scientifiques qui se sont investis dans le débat public avaient fait leur preuve dans leur domaine et avaient donc le loisir de développer d’autres compétences, d’investir du temps pour autre chose. Ils n’étaient d’ailleurs pas si nombreux que cela. Deuxièmement, et c’est plutôt cela que j’interroge, à partir du moment où ils s’investissent dans le débat public, ils prennent inévitablement position. Et en même temps, ce qui les pousse à le faire, c’est précisément le sentiment de ne pas prendre position. Les scientifiques du climat sont peu politisés : ils n’ont pas vraiment de lecture idéologique du débat public. Ils sont donc disposés à prendre les choses telles qu’elles sont. Ils ne vont pas tellement s’interroger sur le fait que ceux qui les sollicitent le plus sont ceux qui ont les moyens, matériels et politiques, de les solliciter, c’est-à-dire des dominants dans le champ politique. De ce point de vue, leurs hésitations éthiques à coopérer avec des ONG étiquetées comme militantes sont significatives d’un souci d’indépendance à géométrie variable. Car pour faire avancer leur cause, ils n’éprouvent en revanche guère de scrupules à ajuster peu à peu leurs discours et leurs schémas de pensée à une vision politique de l’écologie qui se présente comme apolitique, mais qui est, de fait, conservatrice et conformiste. La participation des scientifiques au débat public est donc venue donner une caution académique aux logiques de dépolitisation qu’ils ont fini par intérioriser.
Selon vous, l’alliance entre journalistes et scientifiques pour exclure les climato-sceptiques — d’ailleurs très faibles en France — du débat public permet aussi d’écarter d’autres approches de la question climatique. N’est-ce pas un mal, ou du moins une étape, nécessaire ?
Si les climato-sceptiques sont aussi faibles en France, c’est notamment parce qu’il y a eu une très forte résistance — notamment de la part de tous ces acteurs dont on parle depuis tout à l’heure. D’une certaine façon, ils ont réussi, et on peut s’en réjouir sur un plan politique et moral. Les choses deviennent un peu plus suspectes quand on regarde les motifs et les arguments avec lesquels ils ont combattu les climato-sceptiques. Ils ne l’ont pas fait parce qu’ils étaient les fers de lance du capitalisme le plus néolibéral, mais parce qu’ils risquaient de venir semer le doute et le trouble dans la conscience des individus : il y avait la crainte de perdre la bataille de l’opinion publique. La bataille contre les climato-sceptiques a donc été engagée pour des motifs davantage communicationnelles voire moraux, que politiques. Ensuite, cela leur a permis de se faire passer pour ceux qui, contre les climato-sceptiques, allaient sauver la planète, et donc de dissimuler derrière un paravent progressiste le fait qu’ils œuvrent aussi à la perpétuation d’un système capitaliste socialement et écologiquement insoutenable. Car les opposants au climato-scepticisme ne conçoivent pas le capitalisme comme une organisation sociale. Ils n’envisagent donc pas la transformation sociale nécessaire au verdissement d’économies décarbonnées car sorties de l’emprise des logiques capitalistes. La bataille contre les climato-sceptiques est louable, à la grosse nuance près qu’elle est motivée par la conviction conservatrice selon laquelle on ne pourra pas changer le système si on n’a pas d’abord changé les individus. C’est là, comme nous l’avons dit, un raisonnement cardinal de l’idéologie néolibérale, un schéma de pensée qui n’est d’ailleurs pas sans prises dans les milieux écologistes.
On entend souvent que, puisque les grosses organisations environnementales suivent le discours dominant, c’est à la marge, dans des projets plus modestes et locaux, que se trouveraient les alternatives. Beaucoup mettent l’accent sur l’accumulation des petites actions individuelles (par exemple, les mouvements qui s’organisent autour de Pierre Rabhi et Cyril Dion, réalisateur du film Demain). Vous estimez quant à vous qu’elles « ne peuvent que difficilement être autre chose qu’une caution rafraîchissante de l’ordre établi3 ». Où se trouve le juste milieu ?
« Tant que l’écologie ne sera pas pensée d’abord comme une lutte idéologique contre le capitalisme, elle aura toujours le souffle un peu court. »
Il y a en effet une confusion idéologique entre les logiques néolibérales d’individualisation et le personnalisme du mouvement écologiste, qui met régulièrement l’accent sur la dimension personnelle de ce militantisme et se satisfait parfaitement de discours du type « Il faut être soi-même le changement qu’on veut voir dans le monde4 ». Discours dont l’idéologie capitaliste se délecte. Je pense que cette tendance est d’autant plus forte que ce mouvement est largement peuplé de personnes peu disposées à une critique radicale de l’ordre social, alors que les penseurs de l’écologie politique historique, eux, pouvaient l’être — que ce soit les penseurs Illich, Charbonneau, Gorz, Ellul ou d’autres. Il faut cependant se donner les moyens de ne pas mettre dans le même sac social et idéologique les dispositifs de changement de comportement individuel d’inspiration néolibérale et la volonté militante de modifier les modes de vie, parce qu’effectivement la seconde est plus politique que les premiers. On voit d’ailleurs que les efforts et les manières de modifier les habitudes ne sont pas les mêmes. Mais, en même temps, un militant écologiste qui se contenterait de réduire son empreinte carbone ne poserait finalement pas un gros problème au capitalisme, d’autant qu’on a maintenant un véritable marché économique du geste écologique.
Un enseignement politique majeur des alternatives écologiques est que pour développer un style de vie respectueux des écosystèmes, il faut s’organiser collectivement pour s’extraire durablement des logiques sociales dominantes. Cela montre bien que c’est quelque chose qui relève d’abord du collectif, donc du politique et du vivre-ensemble, pour ensuite permettre des changements individuels. Pour schématiser un peu les choses, on a : « faire de l’intérieur » (réformiste) et « faire à côté » (transitions et alternatives). Il existe un troisième positionnement politique possible, qui consiste « à faire à côté » tout en cherchant, sans relâche, à « défaire » ce qui existe pour « faire de, et à la place ». L’objectif devient dès lors de vraiment tenir ensemble le vivre autrement avec la critique du capitalisme, d’être à la fois pour des alternatives et contre l’institué, et d’essayer d’équilibrer les deux. Je crois que c’est la force des luttes contre les grands projets inutiles imposés et des résistances de type ZAD. Ce sont des lieux où se conjuguent au quotidien une grammaire de la lutte et du conflit, avec l’expérimentation d’alternatives. De mon point de vue, le juste milieu est là. Cela implique aussi de raisonner en termes de convergence des luttes et de bien voir en quoi la lutte écologique est avant tout une lutte sociale, politique, contre des intérêts dominants et contre des logiques réformistes qui visent à faire perdurer un ordre social qui détruit la planète autant que les classes subalternes. Tant que l’écologie ne sera pas pensée d’abord comme une lutte idéologique contre le capitalisme, elle aura toujours le souffle un peu court. Elle sera peu gênante. Il faut que le langage des luttes sociales imprègne beaucoup plus le langage écologiste.
Toutes les photographies sont tirées du blog Ride into the sun : Båstnäs, en Suède
- Philippe Coulangeon, Les métamorphoses de la distinction. Inégalités culturelles dans la France d’aujourd’hui, Paris, Grasset, 2011.[↩]
- Romain Huret, Katrina, 2005. L’ouragan, l’État et les pauvres aux États-Unis, Paris, EHESS, 2010.[↩]
- Jean-Baptiste Comby, « Des alternatives à géométrie variables », Savoir/Agir, n° 38, 2016.[↩]
- Pour paraphraser un célèbre propos de Gandhi, invariablement repris dans les milieux écologistes.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « L’écosocialisme, qu’est-ce donc ? », Pierre-Louis Poyau, décembre 2016
☰ Lire notre entretien avec Hervé Kempf : « On redécouvre ce qu’est la politique », juillet 2016
☰ Lire notre article « Le Buen vivir : qu’est-ce donc ? », Émile Carme, juillet 2016
☰ Lire notre entretien avec Jean Malaurie : « Nous vivons la crise mondiale du progrès », juin 2016
☰ Lire notre entretien avec Vincent Liegey : « Avoir raison tout seul, c’est avoir tort », avril 2016
☰ Lire notre entretien avec Razmig Keucheyan : « C’est à partir du sens commun qu’on fait de la politique », février 2016
☰ Lire notre entretien avec Naomi Klein : « Le changement climatique génère des conflits », décembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Paul Ariès : « La politique des grandes questions abstraites, c’est celle des dominants », mars 2015