Entretien inédit pour le site de Ballast
Nous avons rendez-vous à l’Université, dans le centre de Paris. Razmig Keucheyan a réservé une salle pour notre entretien. « À une autre époque, on se serait retrouvé au local du parti ! », lance le sociologue. Militant au Front de gauche — au sein du mouvement Ensemble —, la posture de l’intellectuel surplombant ne lui parle guère ; la critique, nous dit-il, n’est jamais aussi efficace que lorsqu’elle tient les deux bouts : l’analyse et la stratégie politique (la première mise au service de la seconde). L’écologie, notamment dans son dernier ouvrage La Nature est un champ de bataille, lui sert audacieusement de fil rouge afin d’attaquer de front les impasses et les contradictions des gauches radicales : rapport à l’État et à l’Union européenne, luttes sociales et populaires, mots d’ordre dépassés et identités collectives à redéfinir. Un entretien fleuve pour esquisser une alternative au prétendu cours des choses.
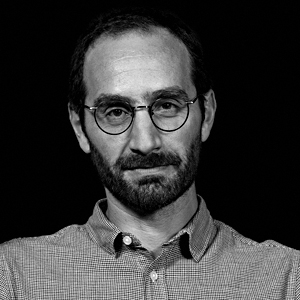
C’est très simple : les inégalités environnementales désignent les inégalités face à la nature. Les individus ou groupes d’individus — classes, genres, « races », etc. — ne sont pas égaux face à l’environnement. Les pollutions, les catastrophes naturelles, ou encore les altérations de la biodiversité sont subies de manière très différente selon la catégorie sociale à laquelle on appartient. Où mesure-t-on par exemple le plus souvent les pics de pollution les plus élevés en région Île-de-France ? Dans le 93 — notamment autour de l’autoroute A1 : le département le plus pauvre de France métropolitaine, qui est aussi celui qui accueille le plus d’immigrés récents. En plus, donc, des inégalités traditionnellement étudiées par les sociologues, et dénoncées par les mouvements sociaux (revenu, genre, diplômes, etc.), on trouve des inégalités environnementales — elles existent depuis les origines de l’époque moderne. Mais la crise environnementale dans laquelle nous sommes entrés les aggrave considérablement.
« L’une des questions politiques du moment est : comment faire converger les mouvements écologistes et la gauche héritière du mouvement ouvrier ? »
La notion d’inégalités environnementales permet de prendre le contre-pied de l’écologie dominante. Celle-ci conçoit le changement climatique comme affectant l’humanité dans son ensemble, de manière indiscriminée. Si vous lisez les textes de Nicolas Hulot, par exemple, c’est cette conception de l’écologie qui s’y exprime. Or c’est tout le contraire. Pour comprendre la dynamique de la crise environnementale, il faut s’en remettre à une analyse en termes d’inégalités. Et, dans cette perspective, une approche marxiste reste plus que jamais d’actualité. L’intérêt du concept d’inégalités environnementales est analytique, mais aussi stratégique. L’une des questions politiques du moment est : comment faire converger les mouvements écologistes et la gauche héritière du mouvement ouvrier, et notamment les syndicats ? Les relations entre les deux, on le sait, ne sont pas toujours faciles. Les inégalités environnementales peuvent être un moyen de concevoir cette convergence. Le vocabulaire des inégalités, c’est l’ADN du mouvement ouvrier, qui est apparu au XIXe siècle afin de lutter contre elles. C’est pourquoi en y ajoutant la dimension environnementale, en la combinant avec les autres, il est possible de construire un langage et des perspectives politiques communes…
Dans votre livre, vous insistez sur une des modalités de ces inégalités : le racisme environnemental. Pourquoi mettre l’accent sur ce cas particulier ?
Écrire des livres de sciences sociales suppose, aujourd’hui plus que jamais, de s’interroger sur les moyens de capter l’attention du lecteur. C’est la fonction de notions comme celle de « racisme environnemental ». Cette notion rapproche deux problématiques en apparence éloignées, à savoir le racisme et la crise environnementale ; elle renvoie au fait que les victimes du racisme, dans les pays du Nord comme du Sud, sont également le plus souvent les victimes d’un environnement dégradé. Qui furent par exemple les principales victimes de l’ouragan Katrina, à la Nouvelle-Orléans, en 2005 ? Les Noirs et les pauvres, parce qu’ils habitent dans les zones inondables, alors que les Blancs et les riches sont installés sur les hauteurs de la ville. Où eurent lieu les essais nucléaires français ? D’abord dans le désert algérien, puis en Polynésie. Or ces essais ont un impact durable sur la santé des populations concernées, ainsi que sur les écosystèmes. Le racisme comporte une dimension spatiale et environnementale ; ce n’est pas une simple affaire d’« opinions » ou de « préjugés » racistes. Dans les débats qui ont suivi la parution de mon livre, on m’a dit : « Tes exemples de racisme environnemental sont souvent anglo-saxons, qu’en est-il de la France ? »

[Katrina, 2005 | Eric Gay | AP]
Le racisme environnemental peut facilement être repéré en France : je viens d’en donner un exemple avec les essais nucléaires. En voici un autre. Une étude statistique, publiée par le Journal of Environmental Planning and Management, démontre qu’en France chaque pourcentage supplémentaire de la population d’une ville née à l’étranger augmente de 30 % les chances pour qu’un incinérateur à déchets, émetteur de pollutions et donc nocif pour la santé, y soit installé. Ces incinérateurs ont donc tendance à se trouver plus fréquemment à proximité de lieux d’immigration récente, notamment parce que les populations qui s’y trouvent ont une capacité moindre à se mobiliser contre leur installation, ou parce que les autorités préfèrent préserver les catégories aisées et/ou blanches de ce type de nuisances environnementales. Le racisme environnemental, par conséquent, n’est pas un phénomène typiquement américain. Bien sûr, l’histoire du racisme aux États-Unis a ses spécificités, tout comme elle a des spécificités dans d’autres contextes nationaux, et notamment en France. Mais la reconnaissance de particularités nationales en la matière ne doit pas conduire à oublier que le racisme en général, et le racisme environnemental en particulier, résultent de la dynamique globale du capitalisme : ils sont donc partout présents, sous des formes diverses. C’est la raison pour laquelle le livre s’ouvre sur cette problématique. J’ajoute que parler de racisme environnemental ne conduit nullement, en ce qui me concerne, à négliger la dimension de classe des rapports sociaux et environnementaux — bien au contraire. Dans la perspective que j’essaie de développer, classe, genre, « race » et environnement sont étroitement imbriqués.
Le « retour à la nature » s’est développé comme une expérience de classe : les classes supérieures y trouvaient un moyen de fuir la ville et ses industries bruyantes et sales. On retrouve cet élitisme environnemental dans les premières organisations de protection de l’environnement, blanches et diplômées. Pensez-vous que la situation a évolué ? L’image de « l’écolo-bobo » demeure omniprésente…
« La conception dominante fait de la nature une entité extérieure au social et aux rapports de classes, un lieu pur et intact. »
Cet « élitisme environnemental », pour reprendre l’expression du sociologue noir américain Robert Bullard, ne se retrouve pas partout. En Amérique latine ou en Asie, par exemple, les mouvements écologistes se sont historiquement construits autour de la question de l’accès aux ressources naturelles élémentaires. De ce fait, leur base sociale a toujours été plus populaire. La raison en est que cet accès est un enjeu de survie immédiate, ce qui suppose une dimension de classe plus prononcée dans la construction des problématiques environnementales dans ces régions. Même dans les pays occidentaux, différentes conceptions de la « nature » ont de tout temps été en lutte. La conception dominante, vous l’avez dit, fait de la nature une entité extérieure au social et aux rapports de classes, un lieu pur et intact où les représentants des catégories supérieures vont se reposer du « bruit et de la fureur » de la civilisation du capital. Mais dès les origines de l’époque moderne, la nature a aussi fait l’objet de formes de politisation « par en bas ». Souvenons-nous des écrits de Karl Marx sur le « vol de bois », ou de ceux d’E. P. Thompson sur le Black Act1. L’extériorité de la nature par rapport à la lutte des classes est contestée dès le début. Je ne pense pas que l’intérêt pour les inégalités environnementales dans les milieux écologistes dominants ait en quelque manière augmenté au cours des années récentes. On observe des expériences novatrices, comme les « Toxics tours » organisés par des militants en Seine-Saint-Denis, par exemple2. Ces « promenades écologistes », dont l’idée vient des États-Unis, cherchent à démontrer que les principales victimes des pollutions sont aussi les catégories sociales les plus pauvres. Mais ces expériences demeurent hélas limitées, et je n’ai pas vu les représentants de l’écologie mainstream se précipiter pour y participer…
Sur cette question de la convergence entre les questions sociales et écologiques, on critique souvent le mouvement écologiste. Le problème ne vient-il pas aussi du mouvement ouvrier, longtemps et encore dominé par une pensée productiviste ? Vous évoquez la catastrophe d’AZF, où écologistes et syndicats se sont opposés après l’explosion de l’usine — les premiers souhaitant la fermer définitivement quand les seconds se battaient pour préserver les emplois…
Les historiens qui se sont intéressés aux liens entre écologie et syndicalisme nuancent le jugement selon lequel le mouvement ouvrier aurait été systématiquement productiviste, et donc depuis toujours hermétique à l’écologie. Il est clair, néanmoins, que la dominante au XXe siècle aura été celle-là. L’adhésion au productivisme s’explique par des facteurs divers. D’abord, le modèle productiviste de l’URSS a longtemps prévalu dans des secteurs importants du mouvement syndical, et pas seulement ceux appartenant à l’univers communiste stricto sensu. Ensuite, le productivisme à l’œuvre lors des Trente Glorieuses a eu des conséquences positives en termes de progrès économique et social pour nombre de gens. Il faut se replacer dans le contexte de l’après-guerre, et comprendre ce qu’ont pu signifier en termes d’amélioration des conditions de vie les taux de croissance de l’époque. Dans cette perspective, l’adhésion au productivisme, et la sous-estimation de ce que le progrès (ou une certaine version du progrès) peut avoir de néfaste, se comprend aisément. Enfin, depuis la fin des Trente Glorieuses, l’émergence d’un chômage de masse implique que dans la hiérarchie des préoccupations syndicales, l’enjeu écologique passe souvent au second plan. C’est précisément la raison pour laquelle la question de l’emploi devrait être centrale dans les préoccupations des mouvements écologistes. Il existe étonnamment peu de travaux sur le lien entre transition écologique et évolution de la structure de l’emploi3.

[Katrina | DR]
La transition écologique va forcément conduire à la décroissance puis à la disparition des secteurs polluants de l’économie, et donc à la suppression des emplois concernés. Sur la base de ce constat, deux principes doivent être appliqués : d’une part, le maintien du revenu des personnes concernées pendant toute la durée de la transition, et, d’autre part, des investissements massifs par l’État dans la reconversion des infrastructures polluantes, et la formation des salariés dans la perspective des nouveaux emplois « soutenables ». Il va sans dire que les syndicats doivent être en première ligne dans le « pilotage » de cette transition qui ne peut en aucun cas se faire « par en haut ». La difficulté, bien entendu, est que nous vivons dans des États néolibéraux austéritaires. Ces États se sont eux-mêmes délestés des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de cette transition écologique ; raison pour laquelle la critique de l’État néolibéral est une tâche urgente pour tout mouvement écologiste, en tant qu’il empêche toute transition. Malheureusement, ce qui prévaut dans nombre de mouvements écologistes, même radicaux, c’est une absence complète de pensée de l’État.
Parmi les solutions en vogue dans les organisations internationales, ainsi que dans certaines ONG, nombreuses sont celles qui s’inspirent des mécanismes de marché pour protéger l’environnement. Il s’agit généralement de donner un prix à la nature, que ce soit pour créer un marché carbone ou évaluer la valeur monétaire des écosystèmes. Vous critiquez cette financiarisation. Mettre un prix sur l’environnement n’est-il pourtant pas un moyen de forcer la prise en compte de sa valeur ?
« La transition écologique va forcément conduire à la décroissance puis à la disparition des secteurs polluants de l’économie. »
Donner un prix à la nature n’a rien de nouveau. Cela existe depuis toujours dans le capitalisme. Ce qu’on appelle une « matière première » désigne une ressource naturelle qui entre dans la production d’une marchandise. Les matières premières ont un prix, c’est-à-dire qu’elles sont échangées sur des marchés. Or, à ma connaissance, donner un prix à ces ressources n’a pas empêché jusqu’ici qu’elles soient surexploitées, dégradées, ou que leur utilisation suscite le dérèglement climatique. Par conséquent, le seul fait de donner un prix à la nature ne règle en rien le problème. Il y a aujourd’hui quatre principaux mécanismes de marché « branchés » sur la nature : les marchés carbone, les dérivés climatiques, les banques de compensation biodiversité et les obligations catastrophes. Trois d’entre eux constituent à ce jour des fiascos complets ; le quatrième fonctionne relativement bien. Pourquoi la plupart de ces instruments financiers ont-ils échoué ? Pour une raison simple, qui apparaît clairement dans le cas des marchés carbone : si on n’impose pas des quotas d’émission carbone suffisamment stricts aux entreprises, le prix de l’entité échangée — ici, le quota carbone — baisse trop, et l’échange cesse d’être intéressant pour les entreprises concernées. Celles-ci ne sont en d’autres termes pas incitées à restructurer leur appareil productif pour le rendre moins émetteur de gaz à effet de serre.
Seule une volonté politique forte, qui abaisserait considérablement les seuils d’émission et ferait de ce fait remonter le prix de la tonne de carbone, permettrait de surmonter ce problème. Mais on voit bien que le fond du problème n’est pas économique : il s’agit bien d’une question de volonté de politique puisque c’est l’État qui fixe les seuils d’émission de quotas carbone. Plus généralement, ce que le marché n’arrivera jamais à intégrer, c’est l’existence dans la nature d’irréversibilités. Les marchés vivent dans une sorte de présent éternel, or la nature est évolutive. Prenons un autre exemple. Les banques de compensation biodiversité permettent à des entreprises de « compenser » des écosystèmes qu’elles détruisent à un endroit, en investissant dans la restauration d’écosystèmes à un autre endroit. Deux problèmes surgissent à partir de là. D’abord, comment rendre ces écosystèmes commensurables ? Qu’est-ce qui garantit qu’un écosystème détruit dans le sud de la France et un écosystème restauré dans le nord sont en quelque manière équivalents ? Pour cela, il faudrait disposer d’un concept de « valeur » appliqué à la nature, qui rendrait la comparaison possible. Certains économistes de l’environnement cherchent à élaborer un tel concept, mais c’est du pur délire… Ensuite, à supposer même que la comparaison d’écosystèmes soit possible, la nature détruite l’est la plupart du temps de manière irréversible. Le principe de la compensation consiste à agir après qu’une portion de nature a été détruite, alors qu’il s’agirait évidemment d’agir en amont. Mais pour cela, des contraintes fortes doivent être imposées à l’activité économique…

[Katrina, 2005 | Dave Martin]
Quel est le rôle de l’État dans ce phénomène ? Est-il un garde-fou contre la privatisation et la financiarisation de la nature ?
L’État (néo)libéral est tout le contraire du laisser-faire/laisser-passer — c’est ce que des auteurs comme Karl Polanyi ou Michel Foucault ont démontré. L’État œuvre constamment en faveur des marchés. Dans les années 1990, la « gauche de la gauche » a développé un discours simpliste affirmant qu’il faudrait en toute circonstance défendre l’État contre les marchés : on en est revenu, fort heureusement. Il faut bien entendu défendre les services publics — ce que Pierre Bourdieu appelait la « main gauche » de l’État. Mais l’État n’est pas seulement les services publics : c’est une entité complexe, dont une bonne part de l’activité consiste à défendre les intérêts des classes dominantes (au besoin par la force). En travaillant sur l’environnement, on s’aperçoit que l’intrusion de l’État dans les processus naturels n’est pas du tout une garantie pour que la nature soit protégée — bien au contraire.
« Mais l’État n’est pas seulement les services publics : c’est une entité complexe, dont une bonne part de l’activité consiste à défendre les intérêts des classes dominantes. »
L’État a deux principales fonctions en ce qui concerne la « production de la nature ». D’abord, il construit la nature pour les marchés. Les marchés carbone sont un cas par excellence de création d’un marché ex nihilo, où l’État construit une entité — le quota carbone — en distribuant des droits de propriété à des opérateurs privés pour qu’ils s’échangent cette entité, et en retirent un profit. L’État n’est donc pas du tout dans ce cas un garde-fou contre les excès du marché : il est ce qui permet l’émergence d’un marché qui exploite des processus naturels. Ensuite, à mesure que les destructions environnementales augmentent, l’entretien de ce que Marx appelle les « conditions de production » ne cesse de se renchérir : il faut toujours davantage de moyens pour dépolluer, pour maintenir en bonne santé (relative) les travailleurs, pour extraire des ressources naturelles toujours nouvelles, etc. Or c’est l’État qui assure financièrement les coûts croissants induits par ce renchérissement des conditions de production. Le capitalisme repose sur une logique simple : socialisation des coûts (en l’occurrence environnementaux), privatisation des bénéfices. La prise en charge par l’État du renchérissement des conditions de production permet au capital de continuer à exploiter la nature, sans avoir à en supporter les coûts. Pour comprendre quelque chose à la dynamique environnementale du capitalisme, il faut donc penser conjointement le triptyque que forment l’État, le marché et la nature.
Vous vous intéressez à la façon dont les militaires prennent en compte les questions environnementales et vous inquiétez de l’absence d’intérêt des théoriciens critiques pour les questions stratégiques, pourtant primordiales pour qui veut sortir d’« abstractions fort peu politiques ». Qu’est-ce que la doctrine militaire peut nous apprendre ?
Le monde dans lequel nous vivrons dans 50 ans ou un siècle sera en partie façonné par les militaires, tout comme le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui est en partie issu de la Guerre froide. Il suffit de penser à l’invention d’Internet. Ne serait-ce que pour cette raison, il est important d’être attentif à ce à quoi pensent les militaires aujourd’hui. Dans son cours intitulé La société punitive, Michel Foucault dit que la gauche a souvent été tentée de sous-estimer ce qu’il appelle l’« intelligence de la bourgeoisie », à savoir les modes de pensée des dominants. La gauche s’imagine souvent que la droite domine par la seule répression ou par la manipulation, et non par son intelligence. Faute d’être au pouvoir, la gauche, elle, aurait au moins l’intelligence de son côté. Or si on s’intéresse à la manière dont se construisent les hégémonies, il faut prendre au sérieux les « technologies de pensée » des dominants, et parmi elles les technologies de pensée militaires. Ainsi, j’ai été stupéfait de constater, en lisant les rapports militaires que j’évoque dans mon livre, que les armées sont en pointe sur la réflexion concernant le changement climatique. Du fait de son court-termisme, la classe politique a les plus grandes peines à se projeter dans le monde de demain. Les militaires y parviennent sans problème, multipliant les scénarios portant sur les effets sociaux et politiques de la crise environnementale.

[Katrina, 2005 | Robert Polidori]
Le fait qu’ils n’ont pas à remettre leur mandat en jeu tous les quatre ou cinq ans leur permet, il est vrai, de développer un autre type de rapport au temps politique. Les marxistes classiques étaient des grands lecteurs de stratégie militaire, et notamment de Clausewitz. La stratégie militaire avait trois fonctions chez eux. D’abord, ils lui ont emprunté toute une série de concepts et de métaphores pour penser la politique (il suffit de penser à la distinction entre « guerre de mouvement » et « guerre de position » chez Antonio Gramsci, mais il y en a bien d’autres). Les marxistes se représentent les partis politiques qu’ils bâtissent, qu’ils soient d’avant-garde ou de masse, sur le modèle des armées modernes, et les militants comme des soldats. Alain Badiou dit qu’au XXe siècle la politique révolutionnaire est « sous condition du militaire ». Enfin, la stratégie militaire sert aux marxistes à prendre le pouvoir et à le garder lorsqu’ils sont en position de le faire, comme dans la Russie de 1917. La question est : est-ce que aujourd’hui la stratégie militaire a une importance aussi grande pour la gauche ? D’abord, nous assistons clairement à une crise de la forme parti. Je ne pense pas qu’il faille congédier cette forme, mais il est évident qu’elle n’a pas survécu telle quelle au XXe siècle. J’ai toujours été membre de partis : je suis pour les partis politiques mais nous n’allons reconstruire aujourd’hui ni le parti léniniste d’avant-garde, ni un parti de masse à l’ancienne. Ensuite, la « civilisation des mœurs » de Norbert Elias (la pacification des relations sociales) a poursuivi son œuvre : c’est d’ailleurs pour cela, en partie, que les attentats du 13 novembre sont aussi sidérants pour nous. La mort de 130 personnes, qui, dans d’autres sociétés est hélas assez quotidienne et banale, est pour nous devenue inconcevable. Il est donc évident, aujourd’hui, qu’utiliser des modèles stratégiques issus de l’art de la guerre et les réimporter dans le champ politique est devenu plus complexe qu’il y a un siècle.
Au-delà du cadre de l’écologie, comment expliquez-vous la distance entre les pensées critiques et les réflexions de stratégie politique concrète ? Pour caricaturer : les théoriciens sont en colloques à travers le monde pour expliquer à quel point le monde va mal et les dirigeants de partis sont en négociations partisanes sur des détails…
« La question est : est-ce que aujourd’hui la stratégie militaire a une importance aussi grande pour la gauche ? »
Plusieurs tendances de fond s’entremêlent ici. D’abord, dans les années 1920 et 30, la glaciation stalinienne s’abat sur des pans entiers du mouvement ouvrier. Les questions théoriques, âprement débattues chez les marxistes de la période antérieure, vont désormais être de plus en plus directement assujetties à des considérations de tactique immédiate. Nombre d’entre elles sont placées sous la responsabilité du Comité central — ce qui montre d’ailleurs, au passage, qu’elles étaient prises très au sérieux par lui… Les intellectuels créatifs ont alors deux choix possibles : soit rentrer dans le rang et donc cesser d’être créatifs, soit rester créatifs et s’éloigner des organisations en voie de stalinisation. Cette disjonction est une des causes de la dissociation de la théorie et de la pratique que vous évoquez. Mais il faut s’empresser de nuancer. Ce constat ne signifie pas que le mouvement communiste a cessé de réfléchir dans les années 1920, ou que le marxisme créatif était toujours extérieur à lui. Des penseurs comme le Hongrois Georg Lukacs, l’Italien Galvano Della Volpe ou Louis Althusser, par exemple, sont demeurés membres des partis communistes de leurs pays. Par conséquent, si une logique de dissociation de la théorie et de la pratique politiques s’enclenche, des théorisations parfois très sophistiquées émanent de penseurs encartés. Ces théorisations prennent parfois des formes euphémisées ou sublimées, comme dans le cadre de la critique de l’« humanisme » à laquelle se livre Althusser, qui est en partie une intervention contre le stalinisme du PCF.
À cette première tendance de fond s’en ajoute une deuxième pour expliquer la dissociation de la théorie et de la pratique politiques tout au long du XXe siècle. C’est ce que Pierre Bourdieu appellerait l’« autonomisation des champs ». Avec l’approfondissement de la division du travail, les champs politique et intellectuel tendent à se différencier, et à fonctionner sur la base de « capitaux » différents. Dans ces conditions, la « traduction » des compétences acquises dans le champ intellectuel dans le champ politique — et inversement — devient de plus en plus difficile. Une troisième logique vient compléter les deux premières (la glaciation stalinienne et la division du travail) : la spécialisation des disciplines scientifiques. Dans ma discipline, la sociologie, on peut par exemple faire aujourd’hui toute sa carrière en se spécialisant sur des micro-objets, alors que les classiques (Marx, Durkheim, Weber…), qu’ils soient marxistes ou non, développaient des conceptions « totalisantes » du monde social. Cette logique de spécialisation interne à chaque discipline, qui est peut-être le destin normal de toute science, rend plus difficile la transformation du monde social : pour transformer ce dernier, il faut d’abord être parvenu à se le représenter dans sa « totalité »…

[Nouvelle-Orléans | Frank Relle]
Podemos aspire visiblement à allier les deux. Pablo Iglesias a présenté votre livre Une cartographie des nouvelles pensées critiques dans leur émission La Tuerka. Leur point de départ est le constat d’une défaite culturelle de la gauche depuis les années 1980 : son langage, ses mots d’ordre, ses symboles, ses figures ne seraient plus en phase avec la société civile. Êtes-vous d’accord ça ?
Podemos ne congédie nullement les symboles de la gauche traditionnelle. Bien sûr, il y a des déclarations provocatrices de Pablo Iglesias, formulées pour la plupart dans le cadre de débats avec d’autres secteurs de la gauche. Mais leur stratégie est à mes yeux plus nuancée que cela : ce que fait Podemos, c’est « articuler » les idées de la gauche traditionnelle avec un autre type de discours, le « populisme », qui consiste à se représenter la politique non pas d’après l’opposition droite/gauche, mais d’après des coordonnées « verticales » : ceux d’en haut contre ceux d’en bas, les élites corrompues et le système face à nous, le peuple, les 1 % contre les 99 %, etc. C’est ce type de discours qui avait fait le succès du mouvement « Occupy Wall Street », au moins en partie. Il y a dans le discours de Podemos un aller-retour constant entre ces deux référentiels, mais en aucun cas me semble-t-il un abandon pur et simple du référentiel traditionnel de la gauche. Ça marche assez bien jusqu’ici, il faut le reconnaître… Et les divergences existantes entre courants à l’intérieur de Podemos sont plutôt un signe de vitalité de l’organisation. Cette articulation du discours de la gauche traditionnelle avec d’autres types de discours se constate également en Amérique latine dans les années 2000. Les Boliviens, par exemple, articulent le référentiel de la gauche avec l’« indianisme »4. Cela permet de s’adresser à des secteurs de la société qui ne seraient pas d’emblée sensibles au discours traditionnel de la gauche. Et, par ailleurs, le diagnostic d’un caractère un peu « vieillot », sclérosé, fossilisé d’un certain discours de gauche, on ne peut être que d’accord ! Il est évident que, dans le contexte du néolibéralisme triomphant des années 1980 et 90, le réflexe des gauches révolutionnaires — puisque la social-démocratie a couru devant les libéraux — a été de « tenir sur leur base », et parfois de se crisper sur les fondamentaux. Il y a donc quelque chose de décapant dans l’entreprise d’Iglesias.
Il s’agit donc d’inventer une nouvelle stratégie, qui ne parte plus des grandes théories mais du sens commun : n’y a‑t-il pas là un danger de surenchère dans le renoncement ? Autrement dit, jusqu’à quel point accepter « le sens commun d’une époque », au risque de bazarder le fond révolutionnaire ?
« C’est toujours à partir du sens commun qu’on fait de la politique, et non en restant dans des groupuscules à l’écart de la majorité des gens. »
Au-delà du cas espagnol, la stratégie qui consiste à se rendre sensible au sens commun est une excellence méthode ! Notamment sur les deux points que sont la corruption des élites et l’accroissement des inégalités. Il faut aller chercher les gens là où ils sont — même si ce « là où il sont » peut-être confus et ne correspond d’emblée pas à nos analyses. Travailler au sein de cet espace « populiste » et y ajouter progressivement un discours « lutte des classes » est nécessaire. Les militants d’Anticapitalistas, un groupe marxiste au sein de Podemos, ont raison d’y être car il faut être là où sont les gens, pour y insuffler des éléments de critique radicale du système. C’est également la raison pour laquelle je suis au Front de gauche. Il y a chez Mélenchon des accents « populistes » salutaires. C’est toujours à partir du sens commun qu’on fait de la politique, et non en restant dans des groupuscules à l’écart de la majorité des gens.
En France, les problèmes se posent différemment. Un argument-poncif ressort partout : le Front national gagne la « bataille culturelle » quand la gauche radicale ne la mène même pas. Que signifie, concrètement, « mener une bataille culturelle » ?
Il y a un malentendu concernant cet argument de la « bataille culturelle ». On entend souvent dire, à gauche en particulier, que la droite est hégémonique parce qu’elle a gagné la « bataille culturelle ». Cela me paraît erroné. Le point crucial est qu’au cours des trente dernières années, le capitalisme a subi des transformations structurelles profondes : financiarisation, effondrement du bloc de l’Est et intégration de ces pays dans l’économie mondiale, tournant capitaliste de la Chine, restructuration des vieux appareils productifs, crise du mouvement ouvrier… Ces transformations, qui n’ont rien à voir avec une quelconque « bataille culturelle », ont objectivement fait le jeu de la droite et du néolibéralisme, et approfondit la crise des gauches. Ce n’est de toute évidence pas une question de nombre de communicants présents sur les plateaux de télé… Dans ce contexte de bouleversements des conditions de l’accumulation du capital, le camp néolibéral s’est avéré prêt à saisir des opportunités. Mais attention au sens de la causalité : c’est parce qu’il y a d’abord des transformations structurelles du capitalisme qu’une nouvelle hégémonie de la droite a été possible. Mener une bataille des idées, c’est toujours la mener dans un contexte de crise. Mais la crise elle-même a sa logique propre, et en l’occurrence elle a clairement favorisé la droite. Toute la question, pour la gauche aujourd’hui, est de trouver dans la crise actuelle des éléments structurels auxquels « accrocher » ses propositions. Mais pour cela, il faut commencer par analyser sérieusement le système et ses transformations, et ne pas s’imaginer que l’essentiel se joue au niveau d’une « bataille culturelle » étroitement conçue…

[DR]
Comment analysez-vous le rapport de la gauche avec les nouveaux modes de communication : audiovisuels et réseaux sociaux ?
Ce que Gramsci appelle « front culturel » ne se limite pas aux médias de communication. Un délégué syndical dans une entreprise mène également une « bataille culturelle » : par les débats qu’il suscite avec ses collègues, par le journal qu’il diffuse, par l’attention qu’il porte aux sensibilités qui s’y expriment, sur des sujets politiques ou tout autre chose. Par conséquent, mener une bataille culturelle, ce n’est certainement pas se précipiter dans les médias dominants à la première occasion. La construction de systèmes médiatiques autonomes me paraît un objectif essentiel. Actuellement, certains ont des audiences très élevées : le Monde diplomatique diffuse à plus de 150 000 exemplaires pour la seule édition en langue française, Jacobin va être vendu dans tous les Barnes & Nobles aux États-Unis, l’émission La Tuerka de Pablo Iglesias et ses camarades connait le succès que l’on sait, Democracy Now!, une télévision alternative animée par une figure de la gauche radicale américaine, Amy Goodman, fait un travail remarquable. Bien sûr, ce n’est ni BFMTV, ni Fox News. Mais il est faux de dire que la construction de médias alternatifs à diffusion massive n’a pas été possible au cours des dernières années. Ces médias permettent d’élaborer et de diffuser une pensée radicale autonome, affranchie des contraintes des médias dominants. On peut aussi évoquer l’utilisation par la gauche radicale des nouvelles technologies de communication. Vous connaissez peut-être les cours de David Harvey sur le Capital, qui ont été filmés et largement diffusés ? Il est dommage que la gauche soit à la traîne sur ce type d’initiatives. Les « MOOC », aujourd’hui à la mode dans les universités, pourraient eux aussi être exploités pour diffuser des idées alternatives, dans le cadre de nouvelles formes de pédagogies radicales. Historiquement, la gauche a toujours développé ses propres usages des technologies de communication existantes…
On voit parfois un certain « élitisme à gauche » par rapport à ces médias : comme si le discours révolutionnaire ne pouvait s’abaisser au niveau d’un débat chez David Pujadas…
« Il faut développer plusieurs versions d’un même discours qui correspondent aux dispositifs et aux publics visés. »
Gramsci était un grand admirateur de l’Église catholique. Une de ses forces, disait-il, était sa capacité de produire plusieurs versions du même discours : il y a ce que disent les théologiens — très sophistiqués, très théoriques — et une version plus élémentaire. L’élément crucial est que ces différentes versions doivent être élaborées et mises en discussion collectivement dans des organisations, et non être improvisées par des portes-parole autoproclamés.
C’est ce que Raymond Aron disait sur la réussite du marxisme : on peut l’expliquer en 5 minutes comme en 50 ans…
Exactement ! Il existe une dénonciation du dogmatisme d’un « marxisme vulgaire » qui oublie ce que ce dernier a pu avoir de positif, à savoir la diffusion d’une compréhension du monde social et d’une sensibilité politique à une très large échelle. Gramsci disait que l’Église catholique mettait beaucoup d’énergie à réprimer périodiquement la créativité des théologiens pour s’assurer que la distance entre les versions sophistiquées et populaires ne soient pas trop grande. L’intellectuel italien affirmait que les marxistes ne devaient pas réprimer les théoriciens mais s’évertuer toujours, dans le cadre du Parti, à mélanger, traduire, socialiser les savoirs. Ainsi, il faut donc développer plusieurs versions d’un même discours qui correspondent aux dispositifs et aux publics visés.

[Mark Ralston| AFP]
Avec d’autres, vous critiquez l’Union européenne et appelez à un retour stratégique à l’échelon national. Stathis Kouvélakis, ancien de Syriza et maintenant à Unité populaire, nous disait que l’appel à une identité nationale et populaire contre Bruxelles allait de soi dans les pays périphériques sous tutelle de la Troïka, qui plus est avec une histoire longue de « libération nationale » contre des régimes autoritaires. Est-ce transposable à la France ?
La réponse est dans la question : ce n’est évidemment pas transposable. La France est un vieux pays impérialiste, et il l’est toujours à l’heure actuelle. C’est aussi un pays dominant au sein de l’Union européenne, qui est tout autant responsable du sort infligé aux Grecs que l’Allemagne. Est-ce que cela signifie qu’aucun discours de type « national-populaire » n’est possible en France ? « National-populaire » est une expression employée par Gramsci pour dire qu’une lutte porte sur la définition même de la nation à chaque époque. Il existe de cette dernière des définitions essentialistes, conservatrices, et il en existe de populaires, radicales, universalisantes. Ce n’est pas ma sensibilité politique, mais je conçois parfaitement que l’on cherche à revitaliser ce que l’histoire de France a eu de progressiste et de révolutionnaire, en en faisant un « récit national » alternatif. Néanmoins, cela suppose trois choses — une que l’on retrouve chez Jean-Luc Mélenchon, deux autres qui sont totalement absentes de son discours.
« Ce n’est pas ma sensibilité politique, mais je conçois parfaitement que l’on cherche à revitaliser ce que l’histoire de France a eu de progressiste et de révolutionnaire. »
Le premier élément, c’est un « langage de classe » placé au centre de l’interprétation de l’histoire de ce pays. Sur ce point précis, il faut rendre hommage à Mélenchon d’avoir promu un tel langage dans l’espace public, et une relecture de l’histoire de France sous ce prisme. Le second aspect requis est un discours anti-impérialiste. Cela suppose de développer une critique radicale de la dimension coloniale de l’histoire de France et de ses menées impérialistes actuelles. De soumettre à critique l’industrie de l’armement française, par exemple. Cette dimension est absente du discours de Mélenchon. Plus généralement, la sensibilité à l’anti-impérialisme est très amoindrie dans la gauche actuelle, alors que dans les années 1960, du fait des grandes luttes anti-impérialistes (Cuba, Vietnam, Algérie…), elle était au cœur des préoccupations des organisations et des militants. Enfin, le troisième élément, indissociable des deux précédents, est la construction d’un discours et d’un mouvement antiracistes dignes de ce nom. C’est la reconnaissance du fait que le racisme n’est pas juste un problème résiduel, venu du passé, mais qu’il s’inscrit au cœur même du fonctionnement des sociétés capitalistes. Cet antiracisme conséquent est très absent des traditions majoritaires de la gauche actuelle. Or sans lui, le « nouveau peuple » luttant en faveur de l’émancipation qu’évoque Mélenchon dans ses écrits n’a aucune chance d’émerger.
Philippe Corcuff vous positionne dans un air du temps idéologique qui obstruerait l’horizon internationaliste de la gauche. Malentendu ou mauvaise foi ?
L’internationalisme n’est pas un but en soi, mais une méthode politique. Le but, c’est le socialisme, le communisme et l’émancipation du plus grand nombre partout dans le monde. L’internationalisme est une méthode pour parvenir à l’émancipation. Deuxième aspect crucial : il existe un internationalisme du capital. Il arrive dans l’histoire que les classes dominantes décident d’internationaliser les institutions politiques et économiques afin d’échapper aux rapports de force qui leur avaient été imposés par les dominés au cours de la période précédente. On ne comprend rien à la mondialisation néolibérale si l’on ne voit pas que cette « déterritorialisation » du capital permet aux dominants de se dégager des compromis sociaux d’après-guerre, ceux des Trente Glorieuses. L’Union européenne est une expression de cet internationalisme du capital. Le capital joue donc parfois l’échelon international contre le national, plus exactement contre les éléments progressistes qu’intégrait le national dans la période précédente. Ce constat invalide à lui seul l’idée, très présente dans la gauche aujourd’hui, selon laquelle l’échelon international serait toujours par essence progressiste, et le national toujours réactionnaire, suspect de nationalisme…

[Houston | Nick Oxford | Reuters]
L’internationalisme des dominés ne consiste pas à valoriser sans réfléchir l’international et à dévaloriser l’échelon national. Il consiste à trouver l’échelle pertinente pour faire valoir les intérêts des dominés dans une conjoncture donnée. Aujourd’hui, si on va à l’affrontement avec les institutions européennes, on retombera forcément sur l’existant, c’est-à-dire un ou plusieurs États-nations européens, probablement du Sud du continent, qui s’affranchiront de la domination des institutions européennes. Dans le meilleur des cas, ces États s’engageront ensemble dans une construction politique alternative à l’Union européenne. Au demeurant, l’analyse selon laquelle l’Union européenne consisterait en un « dépassement » des États-Nations est fausse. La construction européenne a largement renforcé les logiques nationales pour les grands pays, France et Allemagne en tête. Bien sûr, dans un contexte où le Front national sature le signifiant national, ce n’est pas facile de développer une critique conséquente de l’Union européenne. Mais ce n’est pas en faisant comme si la nation n’existait pas que le problème disparaîtra comme par enchantement…
Dernière question, au Razmig Keucheyan stratège. Nous semblons parfois dépourvus de « mots » pour définir notre camp : « communiste » paraît être sali à jamais par l’expérience soviétique ; « socialiste » renvoie au parti du même nom, qui rend la vie tous les jours plus difficile pour le grand nombre ; « anarchiste » est malgré lui rattaché au chaos plus qu’à une société égalitaire ; « gauche radicale / critique » sonne microcosme universitaire ou militant ; « écologiste » renvoie à une cause spécifique et non à une identité globale… Bref, qu’avons-nous à opposer au clivage « les patriotes contre les mondialistes » de Marine Le Pen ?
Le pire serait de vouloir trancher prématurément des débats que rien, dans la conjoncture politique, ne permet de clore. Il faut faire preuve d’une « lente impatience », comme dit Daniel Bensaïd. Pour l’heure, on ne peut donc que s’accommoder d’une certaine profusion terminologique. Si je devais choisir un des termes que vous citez, ce serait clairement « écologiste ». Ce terme comporte trois dimensions intéressantes. La première est qu’il s’agit d’un mot relativement nouveau historiquement, qui n’est pas aussi chargé de tragédies que « socialisme » et « communisme ». Ensuite, si elle est prise au sérieux, l’écologie est par essence radicale. Elle suppose des changements fondamentaux à la fois dans les systèmes productifs et les modes de vie. Enfin, l’écologie permet de combiner une critique quantitative et qualitative des sociétés contemporaines. En plus de revendiquer un partage du temps de travail et des richesses, elle permet de parler de la « qualité de vie », de développer une « critique de la vie quotidienne ». L’usage du mot « écologie » a un inconvénient : l’existence de partis écologistes compromis avec la gestion social-libérale du capitalisme. Mais c’est un inconvénient passager. Avec l’approfondissement de la crise écologique, l’écologie apparaîtra comme ce qu’elle est vraiment, à savoir une alternative au capitalisme…
Photographie de vignette : Hors-Série
- Voir sur ce point Philippe Minard, « Les dures lois de la chasse », dans E. P. Thompson, La Guerre des forêts. Luttes sociales dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, La Découverte, 2014.[↩]
- Voir l’entretien avec Jade Lindgaard sur le site Reporterre.[↩]
- Les travaux de l’association Negawatt offrent l’une des meilleures introductions sur ce sujet. Voir leur site.[↩]
- Voir par exemple Alvaro Garcia Linera, « Indianisme et marxisme ».[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Naomi Klein : « Le changement climatique génère des conflits », décembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Stathis Kouvélakis : « Le non n’est pas vaincu, nous continuons », juillet 2015
☰ Lire notre semaine thématique consacrée à Daniel Bensaïd, avril-mai 2015
☰ Lire notre série d’articles « Que pense Podemos ? », Alexis Gales, avril 2015
☰ Lire notre entretien avec Paul Ariès : « La politique des grandes questions abstraites, c’est celle des dominants », mars 2015


