Texte inédit pour le site de Ballast
Hélène Brion fut sympathisante révolutionnaire, militante pacifiste et féministe. À l’heure où ceux d’en haut se roulent dans le même bain de boue ; à l’heure où les laissés-pour-compte font grincer les urnes ; à l’heure où les autorités françaises se réjouissent de cette « année record pour l’industrie de l’armement » ; à l’heure où d’aucuns ricanent sur « la terreur féministe », un tel tableau attire l’attention. Brion fut incarcérée pour ses idées (sous le régime d’un certain Clemenceau) et consacra sa vie entière à l’égalité entre les hommes et les femmes : être socialiste est une condition nécessaire à l’émancipation, mais non point suffisante — on peut toujours dominer plus dominé que soi… ☰ Par Émile Carme
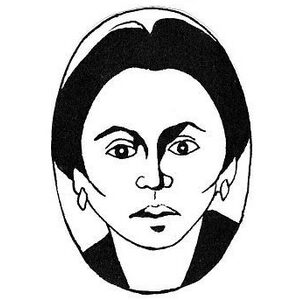
« Rétablissons les chaînes, celles de la transmission, pour ôter les autres que nous portons aux pieds. »
Elle naquit l’année où la flotte anglaise pilonna Alexandrie, alors sous domination britannique, pour mourir peu avant la signature des accords qui marquèrent la fin de la guerre d’Algérie — une vie de quatre-vingts ans. À cheval sur deux siècles : celui de la machine à vapeur, de la carabine, de l’ampoule et de la photographie ; celui du laser, de la télévision, du stylo-bille et de l’arme nucléaire. Fille d’un prénommé Léon Pierre, clerc, sous-chef de gare et sous-lieutenant (il fut fait prisonnier lors de la bataille de Mézières, en 1870, qui opposa, sinistre prélude d’os et de sang, la France et la Prusse) et d’une Octavie, elle-même fille d’un menuisier et d’une couturière. Il est d’usage de la présenter, d’essais en menues biographies, comme une orpheline ; il n’en est rien : Brion fit elle-même savoir que son père « fut là et peu là » mais qu’elle lui devait « tout ». Ses parents divorcèrent lorsqu’elle avait dix ans ; elle quitta son Auvergne natale pour gagner la capitale, deux années plus tard (la tour Eiffel fêtait alors ses cinq siennes), afin de poursuivre ses études. Un témoignage demeure, de l’une de ses enseignantes : la jeune Brion était studieuse, fière et digne. « Privée des tendresses de la famille, elle fut obligée d’apprendre bientôt à se diriger seule dans la vie4. » Comment parvenait-elle à vivre, livrée ainsi à Paris ? Les informations manquent à ce sujet. On sait seulement que son père vint par la suite s’y installer, avant d’y mourir en 1902, à peine âgé de cinquante ans.
Au terme d’un séjour d’une année en Allemagne, dans le cadre d’une bourse attribuée par le conseil municipal, Brion passa le concours d’auxiliaires, dans l’enseignement, le réussit puis exerça en région parisienne. Elle devint titulaire cinq années plus tard. Nous sommes en 1911. On la décrit comme très professionnelle, tour à tour rude et douce. Deux clichés photographiques, parmi les rares dont nous disposons, nous permettent de mettre un visage sur un nom : un portrait, format pièce d’identité, et une image prise devant le Conseil de guerre. La première la donne à voir le regard fixe, résolu ; long nez à l’arête assurée, pommettes larges, paupières bombées, chevelure brune coiffée vers l’arrière, lèvres fines, presque butées — un visage imperturbable, comme les masques de Teotihuacan. La seconde la montre entourée de cinq hommes (dont certains appartiennent aux forces de l’ordre) ; elle se tient de trois quarts, presque de profil, la joue collée à sa main gauche. Le même nez, long et droit ; la même bouche, définitive. Le visage est une âme qui prend la parole — « De grands yeux clairs, un visage calme, si franc, une candide simplicité, un dépouillement total », c’est ainsi que la décrivit la poétesse Henriette Sauret, sa contemporaine.

Commune de Paris, 1871 (DR)
Ébranler le monde
Sa trajectoire politique commença à la SFIO et à la CGT — un parti et un syndicat. Le premier, socialiste et section de l’Internationale ouvrière ; le second, organisation unitaire née de l’alliance entre fédérations professionnelles, Bourses du travail et chambres syndicales. La République avait tranché la gorge de la Commune de ses sabres tricolores : le mouvement ouvrier s’en trouva décimé, éclaté, affaibli. Versailles avait essuyé ses bottes dans le sang de Paris. Il fallut repenser la lutte, du moins ses modalités. L’insurgé Blanqui, du fond d’une cellule semblable à toutes celles qu’il eut la constance de connaître, avait démontré bien malgré lui que les coups de force, avant-garde et ombre, poudre et secret des confréries, plans tracés et attaques à l’aube, avaient fait leur temps : l’heure n’était plus aux embardées, fusils et coutelas, mais à l’organisation, méthodique, ample et populaire du peuple. Les masses et non plus la seule minorité agissante. Les communards, tout assaillants du ciel qu’ils furent, prouvèrent par leur échec — « cuisant » ne suffit pas à dire la débâcle — que le pouvoir d’État sait, a toujours su et le saura encore, comment réduire les fortes têtes. L’organisation de masse, donc.
« Versailles avait essuyé ses bottes dans le sang de Paris. Il fallut repenser la lutte, du moins ses modalités. »
Brion fut au comité confédéral de la CGT. La guerre, nous allons le voir, et la position d’Union sacrée défendue par son syndicat, l’en éloigna. Elle adhéra au Parti communiste en 1920, au lendemain du congrès de Tours — congrès fameux puisqu’il marqua la division du socialisme français en deux courants : ceux qui restèrent dans le giron de la SFIO (qui deviendra en 1969 le Parti socialiste que l’on ne connaît que trop) et ceux qui tinrent à rallier la IIIe Internationale (portée par un Lénine triomphant, héraut de la révolution prolétarienne mondiale sur les gravas et les déblais de l’ancienne Russie tsariste) afin de former le Parti communiste. Brion n’entendit pas rester dans un parti, prétendument socialiste, qui avait voté les crédits de guerre et retourné sa veste pour la pendre à la potence cocardière. La SFIO connaîtra, du reste, un futur à valeur de destin : elle sera de tous les mauvais coups — guerres d’Indochine et d’Algérie. De Marius Moutet, député et sénateur socialiste, jurant sans un sourire que « la politique coloniale de la France est une politique de libération d’abord, une politique d’éducation et d’assistance fraternelle ensuite5 », à François Mitterrand, ministre responsable, sous l’égide de Coty avant qu’il ne prenne sa place à l’Élysée, de la mise à mort — par décapitation — de nombre d’indépendantistes algériens, le socialisme institutionnel hexagonal se plaira à maintenir sa ligne, son fil, rouge du sang de « camarades » qui l’étaient sans doute moins que d’autres. Edwy Plenel, interpellant un certain Hollande au cours de l’année 2014, ne manquera d’ailleurs pas de lui rappeler : « [Les socialistes] s’accrochèrent à un monde d’hier, déjà perdu, ajoutant du malheur par leur entêtement, aggravant l’injustice par leur aveuglement. C’est ainsi qu’ils prétendirent que l’Algérie devait à tout prix rester la France, jusqu’à engager le contingent dans une sale guerre, jusqu’à autoriser l’usage de la torture, jusqu’à violenter les libertés et museler les oppositions. Et c’est avec la même mentalité coloniale qu’ils engagèrent notre pays dans une désastreuse aventure guerrière à Suez contre l‘Égypte souveraine, aux côtés du jeune État d’Israël. Mollet n’était ni un imbécile ni un incompétent. Il était simplement aveugle au monde et aux autres6. »
Après avoir cofondé l’Université populaire de Pantin, Hélène Brion se rendit en Russie en tant que déléguée du Comité pour l’adhésion à la IIIe Internationale. La Révolution allait fêter sa quatrième année et se montrait si belle qu’il ne semblait pas pensable de l’écrire sans majuscule. On ne l’attendait pas — la Russie, pays « arriéré », disait-on, pays qui, au regard des canons marxistes, n’avait pas atteint le niveau de développement qui lui permettrait ensuite, par quelque habileté dialectique, de renverser la table pour mieux y dresser, d’un même couvert pour tous, le communisme et la justice qui en découle — et cela la rendait d’autant plus grande. Les Romanov n’étaient plus et le peuple allait apparaître dans leurs pas disparus. Les tyrans tombés du trône ouvraient l’Histoire en deux : plus rien ne serait comme avant. Dès le mois de novembre 1915, Brion avait d’ailleurs noté : « Lénine me paraît un brave homme d’avenir. » Et d’ajouter, en avril 1917 : « Il importe de faire quelque chose pour sauver la Révolution russe. »

Lénine, 1919 (Photo : Apic/Getty Images)
Elle ne fut point la seule à sentir son pouls s’engouer — en Amérique, l’anarchiste Emma Goldman, elle aussi féministe (mais farouchement athée, contrairement à Brion), louait jusqu’à plus soif, avant de s’y rendre et d’en démordre, l’élan bolchevik ; en Allemagne, la communiste Rosa Luxemburg, féministe sans en jurer, applaudissait les révolutionnaires russes pour leur audace et s’émerveillait de ces « gens aussi intelligents que Lénine et Trotsky7 ». Son séjour dura entre six et huit semaines, selon les versions — Brion rentra en France au début de l’année 1921. Bientôt quatre ans de socialisme au pouvoir, oui. Quatre ans d’une âpre et brutale lutte. Engels et Marx, antécédemment, n’avaient pas menti sur la marchandise : « Une révolution est certainement la chose la plus autoritaire qui soit, c’est l’acte par lequel une fraction de la population impose sa volonté à l’autre au moyen de fusils, de baïonnettes et de canons, moyens autoritaires s’il en est ; et le parti victorieux, s’il ne veut pas avoir combattu en vain, doit continuer à dominer avec la terreur que ses armes inspirent aux réactionnaires8. » La mise en garde se fit constat et le présage fut frappé d’évidence : la Russie, de terreur en contre-terreur et de contre-terreur en terreur, s’enlisa dans la guerre civile. Les temps changent et s’arrondissent, galets roulants sous nos eaux douces : une chemise déchirée fiche à présent la frousse à tout un pays.
« Les temps changent et s’arrondissent, galets roulants sous nos eaux douces : une chemise déchirée fiche à présent la frousse à tout un pays. »
Brion arriva dans une Russie qui, pour reprendre les mots de l’historien Jean-Jacques Marie, n’était plus « qu’un champ de ruines » : « Plus de la moitié du parc existant de locomotives est inutilisable ; les gares sont presque toutes détruites, les rails souvent arrachés et les voies de garage encombrées de carcasses et de wagons à demi calcinés9 ». Que vit-elle ? Que rapporta-t-elle dans les pages de son manuscrit, Choses et gens de Russie rouge (188 pages sur cahier d’école), qui ne parut jamais — nous en ignorons les raisons, mais le document semblait prêt à l’édition : dédicace, sommaire (sept chapitres), annexes ? Le brassage d’individus venus des quatre coins de la planète l’émerveilla, de même que la laïcité et la « suppression » de la prostitution. « Au premier plan de ce tableau tracé par petites touches, dont la vivacité est accrue par l’usage du présent, on reste frappé par la perception — parfois irritée, parfois amusée — d’un pouvoir liant étroitement les privilèges matériels, en situation d’extrême pénurie, à la place occupée par chacun dans un appareil politique encore en formation10 », résumera l’historienne Sophie Cœuré. Nous avons pu consulter une copie du manuscrit dans les archives départementales de Seine-Saint-Denis. En page de garde, Brion cita Montaigne : « Ceci est un livre de bonne foy. » Son intention était affichée, franche et nette : « Faire connaître, comprendre, donc aimer la Russie soviétique. » Brion, malgré les difficultés quotidiennes, malgré le blocus dont la Russie souffrait, croyait en l’avenir : elle décelait là une foi nouvelle, un idéal œuvrant au Bien futur de l’Humanité — et, déjà, en ces terres communistes, « le droit de chacun et de chacune [était] une réalité tangible ». Ses pages assumaient la dure loi et la ligne drue des tranchées : deux camps ; les travailleurs contre la Réaction. Et l’ouvrage, d’une candeur lyrique, de se conclure ainsi : « Tourne tes yeux et ta pensée vers l’Est ! Là-bas, plus loin que Bethléem, un nouvelle étoile, un nouveau soleil se lève : son rayon rouge éclaire les âmes et anime d’une nouvelle vie tout ce qu’il touche. Lève-toi, qu’il t’éclaire aussi ! » Lyrique et coupable, si l’on considère la suite — mais l’URSS, malgré l’inique répression des marins insurgés de Kronstdat en mars 1921 (date à laquelle Brion était déjà rentrée de ce premier séjour), n’était pas encore le régime dément que Staline administrera à partir des années 1930 (en 2013, dans Modernes catacombes, le médiologue Régis Debray demandera qui, sauf à posséder des actions en Bourse ou à manquer de générosité, pouvait bien, dans les années 1920, « ne pas tourner le cœur et les yeux vers la grande lueur de l’Est
» ?)
À Moscou, elle logea à l’hôtel Dielovoï Dvor et à Petrograd à celui de la IIIe Internationale — elle fut accueillie, dans la cité aux canaux, par l’écrivain Victor Serge, anarchiste passé au communisme après avoir tâté des geôles françaises pour n’avoir pas donné ses camarades libertaires, dont il désavouait pourtant les méthodes « illégalistes ». Grand homme, assurément, que Brion charria néanmoins dans ses notes : « Resté très parisien, [il] se lamente : ne croyez-vous pas qu’il serait bon de pouvoir aller au café en ce moment… Mais quoi, rien à faire, il n’y a pas plus à acheter un grog qu’un petit pain. » Elle fit également la connaissance d’un Coréen végétarien des plus sympathiques, d’un Italien arriviste et râleur, d’un Suisse idéaliste et passionné. « Dans la rue, le froid, le vent, le contact des gens me fait du bien. » Combien de fois s’y rendit-elle ? Trois, assure-t-on. L’historienne Sophie Cœuré précisera toutefois que les deux autres séjours « sont moins attestés11 ». La Française fraya avec la base plus qu’avec les autorités, bien qu’elle put rencontrer Lénine — l’enfant de Simbirsk qui, après des années d’exil, revint en terres natales pour s’emparer du pouvoir à la tête d’un parti d’avant-garde. L’entrevue fut brève. « Le masque est rébarbatif, oui, mais le regard est bon, si intelligent ! Et le sourire est si rayonnant ! » Elle croisa également Trotsky, alors Commissaire du peuple pour l’Armée et les Affaires navales, lors d’un congrès de femmes communistes.
Brion, qui appelait à l’abolition du patronat et du salariat, n’était toutefois pas une théoricienne. Les dogmes sont des idées qui ne voient que d’un œil : l’institutrice sembla préférer le quotidien, bancroche et malsonnant, à l’impraticable hauteur des « penseurs ». Cœuré rapportera que ses notes russes « abordent avec une ironie non déguisée sa propre inculture politique » et qu’elle développait « un rapport à l’engagement communiste qui passe par l’émotion ». Projections utopiques, affects et constats sur le terrain se nouent au fil des pages de son récit. À son retour, elle effectua plus de quatre-vingts réunions afin de témoigner de son expérience et de l’enthousiasme que la révolution prolétarienne suscitait en elle. Mais elle ne tarda pas à s’éloigner du syndicalisme comme du Parti — ce qui fera dire à Cœuré qu’elle ne fut qu’une « passagère du communisme » — pour se consacrer pleinement à la lutte féministe, certaine que le sexe féminin se voyait, in fine, davantage opprimé par les hommes (en tant que groupe transclasse) que par les seuls capitalistes — nous y reviendrons. Signalons en passant que l’essai collectif Marxism in the Postmodern Age, paru aux États-Unis en 1994, fera de Brion une compagnonne de route de l’anarcho-syndicalisme.

Victor Serge, son fils et sa compagne (DR)
Le sang des hommes
La Première Guerre mondiale éclata le 28 juillet 1914, lorsque l’Autriche déclara la guerre à la Serbie. La suite est connue. Les États confièrent à leurs peuples le soin de s’égorger sans de leur sang salir leurs bureaux. La Patrie, l’Honneur, la Gloire : les lettres capitales se tiennent à l’écart des cadavres qui tombent pour elles — vingt millions, alors : une broutille, pour les alliances et le destin des cartes. Des chiens et des rats. Boue et boyaux. La neige, le gel, baïonnette au canon. Dieu, la Sainte Vierge, les sacs de terre empilés et les colis de marmelade. Ma bien chérie, écrivit l’un sur du papier mouillé ; ce sera bientôt le temps des cerises, dit l’autre. Je jure devandieux que je suis innocan — Léonard L., soldat 2e classe, fusillé pour « mutilation volontaire12 ». Les dents des Poilus claquant au vent sale des matins qui sont déjà des soirs. Charles Péguy crevant d’une balle dans le front, un samedi de septembre ; Apollinaire blessé d’un éclat d’obus dans une tranchée ; Céline grièvement atteint au bras lors d’une mission en terres flamandes ; Léon Werth, fumant sa pipe, l’humérus fracturé et Blaise Cendrars un bras, le droit, déchiqueté sous la mitraille. Jean Jaurès, lui, mourut avant de voir la mort des autres, un projectile dans le crâne tiré à bout portant. D’une guerre l’autre, la Seconde, les mots de l’écrivain Hyvernaud : « Je ne sais rien de la mort de Péguy. Personne ne sait rien de la mort de personne. Il avait écrit : « Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre… » Des alexandrins que j’ai appris par cœur, dans le temps. Tout le monde les a appris par cœur. Depuis, j’ai vu pas mal de ces cadavres heureux. Des vrais, et qui pourrissent sans poésie, écrasés au fond d’un fossé. C’est un spectacle qui invite à parler froidement de ces choses13. »
« Les États confièrent aux peuples le soin de s’égorger sans de leur sang salir leurs bureaux. La Patrie, l’Honneur, la Gloire : les lettres capitales se tiennent à l’écart des cadavres qui tombent pour elles. »
Hélène Brion avait trente-deux ans. Elle adhéra au Comité international des femmes pour une paix permanente. Écrivit, tracta et milita pour la cessation des combats. Appela à une fédération des nations à même d’empêcher, à l’avenir, le sang de boucher les pores de l’Europe. Le pouvoir lâcha ses chiens : elle fut plus d’une fois limitée dans ses déplacements et vit son appartement perquisitionné en juillet 1917. Clemenceau devint président du Conseil ; Brion fut, dans la foulée, arrêtée, mise à pied et incarcérée à la prison des femmes de Saint-Lazare. Par discipline militante et portée par l’élan collectif, l’institutrice avait d’abord soutenu la ligne de son parti, la SFIO : approuver l’Union sacrée appelée de ses vœux, dès 1914, par Raymond Poincaré. La gauche s’était ralliée. La CGT s’était ralliée. L’anarchiste Kropotkine s’était rallié. « C’est vrai, j’ai cru, confia-t-elle, entraînée comme tant d’autres, à la guerre du droit et de la justice ; mais je reconnais maintenant que je me suis trompée et je considère cette erreur comme la plus grande faute de ma vie14. » Elle passa devant le Conseil de guerre du 25 au 31 mars 1918 — au même moment, des grèves secouaient Saint-Étienne, Paris subissait le feu des Pariser Kanonen et les Alliés imposaient un blocus au nouveau pouvoir soviétique.
Des archives et des copies sont conservées à la bibliothèque Marguerite Durand, à Paris. Nous nous y rendons — un siècle plus tard. Des dossiers, des manuscrits et des microfilms répondant au nom de Brion. Nombre de coupures de presse donnent à lire, dans le détail, les audiences et l’époque qui les encadre. Celle qui venait de passer près de cinq mois en prison se défendit avec force et talent, ferraillant « de pied ferme15 » pour ses idées. Elle avait, nota un témoin, réponse à tout et faisait de chacune un discours. Prenant des notes, claquant des doigts pour s’emparer de la parole. Elle portait une jupe sombre, une chemise en flanelle grise et une lavallière noire. Le lieutenant-colonel Maritz présidait le Conseil, lunettes ovales et large moustache rebiquée. Les chefs d’inculpation ? Avoir « favoris[é] l’ennemi » et « exerc[é] une influence fâcheuse sur l’esprit de l’armée et des populations ». S’être livrée à de la « propagande pacifique ». Brion répondit que jamais elle ne chercha à embrigader ses élèves (de maternelle…) et qu’elle pensait qu’il était de son droit, et même de son devoir, d’exprimer ses opinions propres, en liberté, comme elle l’avait toujours fait. Elle reconnut avoir distribué des tracts et des brochures, botta parfois en touche, joua à celle qui ne comprenait pas les questions ou demanda pourquoi on ne la questionnait pas sur ses écrits féministes, pourtant plus nombreux et autrement plus antérieurs à son seul pacifisme. On lui reprocha la possession d’un livre consacré à Trotsky ; elle contesta le fait que l’on pût se baser sur ses notes privées, celles des carnets trouvés à son domicile, pour construire l’accusation. Quelques croquis illustrent les retranscriptions. Une photographie, disponible sur Internet, la montre aux côtés d’un agent des forces de l’ordre et de son avocat : elle arbore un chapeau rond, noir comme l’est son long manteau — les yeux fixent l’objectif. Nous tournons les pages du dossier. Une autre photographie, parue dans un périodique de l’époque, la révèle vêtue en costume masculin — la légende insiste sur ce point. Ici, on la taxe de défaitisme et d’anarchisme ; là, de « figure au moins anormale » du fait des habits qu’il lui arrivait de revêtir (des tenues de cycliste, parfois, puisqu’elle aimait, étrange idée, faire du vélo). Il est dit en sus qu’elle excitait les femmes à la révolte et qu’elle cria, dans le préau de son école maternelle, qu’elle aimerait mettre le feu au ministère de la guerre ; qu’elle aurait cassé des vitres et des réverbères ; qu’elle aurait perçu de l’argent allemand. Accusations qu’elle contesta. On insinua même qu’elle souffrait de folie et un examen médical fut un temps envisagé… Sa défense fut une attaque (un procès de rupture avant l’heure, à la manière de l’avocat Vergès lors de la guerre d’Algérie), arguant que l’on ne pouvait la juger comme sujet de droit puisqu’elle ne bénéficiait pas d’une citoyenneté égale : on l’accusait de collaboration avec l’ennemi ; elle répondait que la France devait d’abord la considérer comme une Française comme les hommes.

(DR)
Brion jurait n’être pas « antifrançaise », pas plus qu’elle n’était « pro-allemande » : elle espérait seulement la fin de la guerre entre les deux nations (et les autres, prises dans l’infernal engrenage). Son pacifisme se voulait pragmatique, raisonné, constructif : tenir bon, au front, puisqu’il n’était d’autres choix ; réfléchir, à l’arrière, à la manière de faire cesser au plus vite le carnage. Elle déclara alors, face à ses accusateurs : « Cette loi, que je récuse, me reproche d’avoir tenu des propos de nature à affaiblir le moral des populations. Je proteste avec plus de force encore, et je nie ! Ma propagande, discrète et nuancée, a toujours été un appel constant à la raison, au pouvoir de réflexion, au bon sens dont chaque humain a une part, si petite soit-elle. » Et de poursuivre : « Ce qui m’épouvante, dans la guerre, plus encore que les morts et les ruines qu’elle accumule, plus encore, infiniment plus que les malheurs matériels, c’est l’abaissement intellectuel et moral qu’elle entraîne. […] Oui, la guerre abaisse le niveau moral et débride les passions. Et elle abaisse aussi le niveau intellectuel. L’esprit cesse de travailler sur des sujets dignes de lui ; l’intelligence, la force créatrice, ne s’applique plus qu’à des œuvres de meurtre et de destruction : balle dum-dum, dreadnougts, sous-marins, super sous-marins, gaz asphyxiants, zeppelins, super zeppelins, tanks, gothas, etc. Je ne puis croire que ce soit pour cela que l’intelligence a été donnée à l’homme, mais je constate que le courant actuel est là, rien que là. Et les journaux qui font l’opinion vulgaire, couvrent de ridicule les savants qui osent penser et parler d’autre chose3. » Elle fut condamnée à trois ans de prison16avec sursis et révoquée de l’enseignement (elle fut réintégrée en 1925) : le dictionnaire du mouvement ouvrier Le Maitron évoquera un tribunal « presque séduit » par la jeune femme. À noter également que le petit-fils de Karl Marx, Jean Longuet — que Maurras qualifiait de « quart-de-boche » —, prit sa défense et fit entendre qu’elle était une bonne Française.
Le sexe esclave
Le temps passe mais tient ses privilèges : « féminisme » est un mot qui fâche et continue de froisser bien des oreilles. Le journal Causeur — qui, fidèle à son nom, aime à parler pour ne rien dire — dénonçait récemment « la terreur » qu’il répandrait : on lui rappellera seulement qu’à l’heure où ses lignes s’écrivent, on ne sache toujours pas que les maltraitances physiques et les agressions sexuelles, pour s’en tenir aux manifestations les plus criantes de la domination masculine, soient le fait de femmes. Le féminisme n’est pas un monolithe, tant s’en faut, mais on peut a minimamettre en évidence une ligne-force : lutter contre la prépotence du masculin sur le féminin (la sociologue allemande Ute Gerhard propose, dans son article « Concepts et controverses », la définition qui suit : « Ensemble des tentatives menées par des femmes pour leur reconnaissance, leur autodétermination, leur participation politique et le respect de leurs droits17 ».) Hélène Brion, de son propre aveu, fut avant tout une féministe — c’est à partir de ce noyau, de ce prisme et de ce cadre d’analyse qu’elle appréhendait le monde et articulait les différents pans du vivant entre eux. Son socialisme et son pacifisme étaient à ses yeux directement corrélés à son combat pour l’émancipation des femmes.
« On l’accusait de collaboration avec l’ennemi ; elle répondait que la France devait d’abord la considérer comme une Française comme les hommes. »
Celle dont Le Figaro railla le « bon sens féminin » fut membre de plusieurs mouvements : le Suffrage des femmes, l’Union fraternelle des femmes, l’Union française pour le suffrage des femmes, la Ligue nationale du vote ou encore Femmes de la libération humaine. Esquissons en quelques traits le décor alentour : deux années avant la naissance d’Hélène Brion, les femmes purent, en France, accéder à l’université ; le divorce fut rétabli lorsqu’elle eut deux ans (mais seulement pour « fautes précises ») ; le port du pantalon fut autorisé l’année de ses dix ans, à condition que la femme qui l’arborât tint, à la main, les rênes d’un cheval ou le guidon d’une bicyclette ; elle eut dix-huit ans lorsque les femmes obtinrent l’autorisation de plaider en tant qu’avocate ; une loi permit que les femmes mariées pussent jouir de leur propre salaire lorsqu’elle fêta ses vingt-cinq ans ; deux ans plus tard, les salaires entre instituteurs et institutrices devinrent égaux. En 1912, en Chine, des femmes envahirent le Parlement pour réclamer le droit de vote — que les Norvégiennes puis les Islandaises obtinrent (il faudra, on l’a dit, attendre 1944 pour la France). En 1917, Alexandra Kollontaï fut, sous le nouveau pouvoir bolchevik, la première femme ministre de l’Histoire — rappelons que Lénine fut l’instaurateur de la Journée internationale des femmes, le 8 mars.
En 1919, la native de Clermont-Ferrand créa le journal La Lutte féministe, qu’elle présentait comme l’« organe unique et rigoureusement indépendant du féminisme intégral ». On décèle, par « intégral » (en plus, peut-être, d’un pied de nez à son contemporain national Maurras), la volonté de cohérence de son propos : le féminisme comme appareil global de décryptage. Elle estimait que les femmes n’étaient pas, ou mal, représentées dans la presse — y compris à gauche, où la parole restait l’apanage des seuls mâles. Brion fit état de la position des plus inconfortables qui se trouvait être la sienne : la presse socialiste la rejetait du fait de son féminisme et la presse féminine la rejetait du fait de son socialisme. Sa parution donna la part belle à deux citations ; l’une de Félix Pécaut, républicain laïc et dreyfusard (« Femme, ose être ! »), l’autre de Madeleine Pelletier18, féministe anarchiste dont elle fut, sinon l’amie, la camarade (« Quiconque est vraiment digne de la liberté n’attend pas qu’on la lui donne, il la prend. »). La présence d’un homme, en sous-titre, n’est sans doute pas à négliger — quand bien même elle pointait du doigt « la collective et inconsciente (?) mauvaise volonté masculine à notre endroit19 ». Le périodique compta dix-huit numéros, jusqu’en 1921.

Alexandra Kollontaï, à gauche (DR)
« Qui est plus opprimées que nous, les femmes, maintenues esclaves au sein même des peuples libres20 ? », demandait Brion. Des décennies avant le célèbre slogan du MLF « Ne me libérez pas, je m’en charge », l’institutrice clamait : « N’ayons pas d’illusion pour notre libération, comptons surtout sur nous-mêmes ! » Rebondissant sur la fameuse apostrophe de Marx, jurant que l’émancipation serait l’œuvre des travailleurs eux-mêmes, Brion louait l’auto-émancipation des femmes. Elle disputa la légitimité de sa lutte au sein de sa propre famille politique. Le socialisme est la réponse à tout, assuraient ses camarades. Le féminisme, comme étiquette, détourne de la centralité de la lutte prolétarienne : dispersion inutile, manœuvre malhabile ! Mais Brion n’en démordait pas : il faut être « féministe », explicitement, noir sur le blanc d’un drapeau qui ne vient pas, celui de la paix (enfin garantie par la justice et l’égalité) entre les sexes, puisque les socialistes peuvent, en leur sein, sécréter du sexisme et ravitailler l’oppression — la preuve, martelait-elle, que la pensée révolutionnaire, si nécessaire soit-elle, ne suffit pas à garantir l’émancipation de tous (c’est-à-dire de toutes). Brion ajoutait que la seule grille économico-sociale (socialiste, marxiste, anarchiste) ne permettait pas de prendre la pleine mesure des enjeux : « Les femmes sont plus exploitées encore par la collectivité masculine en tant que femmes qu’elles ne le sont par le capital en tant que productrices. » Autrement dit : le mode de production capitaliste, rendu possible par la suprématie bourgeoise, n’épuise pas la totalité des flux de la domination — les hommes, en tant qu’ils sont hommes, c’est-à-dire collectif sexué et genré (biologiquement, socialement, symboliquement) recoupant l’ensemble des strates sociales, assujettissent les femmes. Bien qu’exploité par son patron, l’ouvrier peut exploiter sa femme. Ce que la féministe Flora Tristan — à l’endroit de qui Brion nourrissait force estime — avait résumé de la sorte : « L’homme le plus opprimé peut opprimer un être, qui est sa femme ; elle est la prolétaire du prolétaire même21. » Brion parlait de « la femme plus victime encore parce que femme que parce que travailleuse » : pour la même besogne ouvrière, la femme s’avérait moins payée — l’appartenance de classe n’expliquait dès lors pas tout.
« Le mode de production capitaliste, rendu possible par la suprématie bourgeoise, n’épuise pas la totalité des flux de la domination. »
Brion étendit l’espace de l’exploitation : les usines et les ateliers, soit, mais aussi la famille. Elle évoqua l’« esclavage perpétuel » qu’était le travail non rémunéré à la maison (ce que Christine Delphy, plus tard, identifiera dans L’Ennemi principal sous le nom de mode de production domestique, c’est-à-dire d’une « extorsion d’un surtravail au sein de la famille22 »). Au travail, la femme peut nouer des liens, multiplier les contacts, se syndiquer : elle peut contester cet espace. Le foyer, « son » foyer, s’avoue intouchable : nul syndicat n’y entrera pour la défendre. « L’homme peut se passionner pour son métier, chercher à se perfectionner, à améliorer les machines ou outils qui lui servent ; tout l’y convie, tout l’y invite, alors que tout repousse la femme vers ce qui est à l’heure actuelle à peu près le seul centre admis de son activité : la famille. » Brion dénonça la mentalité proudhonienne d’une frange du mouvement social (on se souvient de la franche misogynie de l’anarchiste). Face au désarroi, à la méfiance ou à l’effroi de ses camarades masculins, Brion invoquait, en guise d’explication, « l’instinct masculin habitué depuis des siècles à domestiquer la femme et qui s’affole à l’idée de son affranchissement possible ; c’est l’instinct brutal de domination du César romain ou du maître d’esclaves qui s’exaspère à l’idée que son bétail commence à lui échapper. » Simone de Beauvoir parlera du deuxième sexe ; Brion décrivit le sexe esclave et se leva contre l’arrogance paternaliste du militant (pourtant absent dès lors qu’il s’agissait de lutter, sur le terrain, aux côtés des femmes) et « la série de lieux communs sur le rôle de la femme » que les bons socialistes et communistes se plaisaient à égrener. L’historienne Christine Bard assurera en 2013 : « Les voix des féministes comme Madeleine Pelletier ou Hélène Brion, qui étaient socialistes, ont été étouffées par cette vision de l’exclusivité à donner au Parti23. » Même constat chez Cœuré : « L’itinéraire d’Hélène Brion s’inscrit ainsi dans l’échec plus général de la « rencontre éphémère » entre communisme et féminisme radical, avant la rapide mise au pas de l’autonomie d’un féminisme désigné comme petit-bourgeois24 ».
Brion prêtait-elle aux femmes certaines dispositions intrinsèques, ontologiques ? Dans son ouvrage Les Femmes, actrices de l’Histoire, Yannick Ripa écrit qu’elle « met[tait] la violence du côté du masculin et la morale du côté du féminisme25 » mais qu’il demeure délicat de se prononcer plus en profondeur, faute de précisions. Brion évoqua pourtant clairement la prédisposition des femmes au « bonheur du monde26 », se référa à la notion de « psychisme27 », fit état de grâces « naturelles26 » et approuvait les mots de l’économiste fouriériste Victor Considerant : « Le jour où les femmes seront initiées aux questions sociales, les révolutions ne se feront plus à coups de fusils ! » Une approche différentialiste qui réfute le caractère seulement culturel de certains traits : on se rappelle de la féministe Antoinette Fouque évoquant, par après, le génie des femmes, celui « d’une éthique de la générosité28 ». Quoi qu’il en soit, ce fut, nous l’avons souligné, notamment au nom du féminisme qu’elle s’éleva contre la guerre : « La guerre est le triomphe de la force brutale ; le féminisme ne peut triompher que par la force morale et la valeur intellectuelle ; il y a antinomie absolue entre les deux. Je ne pense pas que dans la société primitive, la force de la femme, ni sa valeur, étaient inférieures à celles de l’homme ; mais il est certain que dans la société actuelle, la possibilité de la guerre a établi une échelle de valeurs toutes factices, au détriment de la femme. » Brion se montrait persuadée qu’une révolte globale des femmes eût mis terme à la guerre. Le 26 mars 1945, elle adressa un courrier à Eleanor Roosevelt, la femme du président, afin de l’inciter à œuvrer, au nom du combat héroïque mené par les résistantes françaises, pour l’égalité entre les sexes, en terme de représentation, au sein des assemblées et des conférences politiques tenues de par le monde. Brion n’entendait pas que l’on pût, au lendemain d’une guerre atroce, la seconde qu’elle eut à connaître dans sa vie, discuter d’un nouvel ordre du monde en excluant les femmes des discussions internationales. Brion écrivit dans sa missive que le genre humain n’existait pas, « il n’est encore que masculin29
».

Victor Considérant, par Jean Gigoux
Mais sa plus grande œuvre — inachevée et non publiée — demeure son Encyclopédie féministe. Travail colossal, qu’elle mena sa vie durant, visant à répertorier, dans de multiples domaines (politiques, scientifiques, artistiques, sportifs, etc.), l’apport féminin à l’humanité — du fait divers aux plus grandes œuvres. Nous avons pu la consulter à la bibliothèque Marguerite Durand : des volumes épais (le tome I de 299 pages, le second de 869), remplis de coupures de presse, croquis, clichés photographiques, annotations… Une préface signée de sa main : « L’œuvre, je le sais, n’est pas à la hauteur de son titre. Mais si je voulais attendre qu’elle soit au point, ma vie entière passerait sans que ceci sorte d’un tiroir. Aussi mieux vaut ne pas attendre ! D’ailleurs je ne puis, seule, mener à bien une pareille tâche ; et le meilleur moyen de trouver de l’aide est de commencer et de montrer ce que l’on peut faire sans autre mise de fonds que la bonne volonté. » Brion proposait là une ébauche. Significatif addendum, à l’encre bleue, en 1950 (la préface fut rédigée en 1912) : l’auteure — Brion parlait d’ailleurs d’autrice — tint à préciser qu’elle commit « une lourde faute » tout au long de son encyclopédie en classant les femmes par leur nom de famille, c’est-à-dire, le plus souvent, celui de leur époux. Elle concluait l’ajout ainsi : « L’esprit de servilité est encore grand chez les femmes. »
« Brion étendit l’espace de l’exploitation : les usines et les ateliers, soit, mais aussi la famille. »
L’essayiste Bérengère Kolly avance, avec justesse, que « le féminisme est nécessairement sur un fil » : sur quelles bases fédérer ? comment tenir les deux bouts de la corde — reconnaître le caractère universel et spécifique de la lutte des femmes (du sous-prolétariat à la grande bourgeoisie — il n’est pas de classe sociale quand frappent la violence et les privilèges masculins) tout en maintenant l’indispensable fracture — et le combat qu’elle induit — de classes (une star mondiale du R’n’B et une présidente-directrice générale d’une société de transport restent et resteront les ennemies de classe d’une agente de propreté hospitalière en charge des parties communes) ? Hélène Brion prit en effet la défense des femmes fortunées, qu’elle tenait, elles aussi, pour des individualités dominées. Un fil à tenir, oui, entre, d’une main, la reconnaissance d’une oppression commune et, de l’autre, l’irréductible clivage économique et social qui met à mal la seule solidarité genrée — Virginia de la Siega rapporte ainsi, dans les colonnes de L’Anticapitaliste, un échange entre une femme de mineur et une autre de la bourgeoisie : « Alors dites-moi, Madame : votre situation a‑t-elle quelque chose à voir avec la mienne ? Ou la mienne avec la vôtre ? De quelle égalité allons-nous parler entre nous, si vous et moi ne nous ressemblons pas et avons tant de différences ? Nous ne pouvons en ce moment être égales, même en tant que femmes — ne trouvez-vous pas30 ? »
*
L’ouvrage Les Femmes, sujets d’histoire, paru en 1999, prétendra qu’elle eut deux enfants d’un émigré russe. Faux !, contestera Colette Avrane, auteure d’une biographie de la syndicaliste féministe Berthe Fouchère. « Pas de trace, nulle part, d’enfants et de vie de famille31. » Brion fut homosexuelle, écrira-t-elle en 2003 — l’historienne Sophie Cœuré entérinera, la même année (André Caroff, dans son article « Hélène Brion, l’insoumise », évoquera seulement des « amitiés féminines »). Les informations font largement défaut quant à sa vie privée et son homosexualité, si on la tient pour avérée, n’interféra pas explicitement dans sa vie publique. Il nous est impossible, à l’heure qu’il est, de reconstituer l’intégralité de son parcours, de l’Occupation — qu’elle passa dans les Vosges — à sa mort, le 31 août 1962, à la clinique diététique et gérontologique d’Ennery, en Seine-et-Oise. Elle mourut dans la misère, rapporte-t-on, à l’âge de quatre-vingts ans, et fut enterrée dans une fosse commune avant que l’un de ses cousins ne lui payât un caveau. Ce dernier existe encore : pas de croix ; une plaque à son nom, en lettres capitales dorées que le temps altère. Elle deviendra, en 2011, personnage de fiction — sous la plume de Martine Marie Muller, dans son roman La Belle camarade (consacré à Caroline Rémy — dite Séverine), et les crayons de Fabien Bedouel, avec la bande dessinée, au demeurant peu historique, Un Long destin de sang.
L’écrivaine libertaire Madeleine Vernet fit paraître en 1917 l’opuscule Une Belle Conscience et une sombre affaire afin de prendre la défense de son amie Hélène Brion. Nous avions découvert ce texte, par hasard, en cherchant des informations dans d’anciens documents de police ayant trait à l’anarchiste communiste Mohamed Saïl, dans les archives départementales de Saint-Quentin-en-Yvelines — mais était-ce un hasard ? Les réfractaires, sans se connaître, savent se passer le mot. Vernet y rapportait cet échange, à valeur d’épilogue : « Quelque temps avant son arrestation, elle me disait en me parlant des poursuites intentées contre elle : — Voyez-vous, Mad, il y a une chose qu’ils ne savent pas : c’est que quoi qu’ils fassent, ils ne peuvent pas m’empêcher d’être heureuse ! »
- Voir le site Internet <8mars.info>.[↩]
- William Guéraiche, Les femmes et la République : essai sur la répartition du pouvoir de 1943 à 1979, Éditions de l’Atelier, 1999.[↩]
- Hélène Brion, « Déclaration lue au Premier Conseil de Guerre, le 29 mars 1918 (Germinal, an 126) ».[↩][↩]
- Cité par Colette Avrane, « Hélène Brion, une institutrice féministe », Bulletin Archives du féminisme, n° 5, juin 2003.[↩]
- Marius Moutet, circulaire adressée aux gouverneurs, citée dans le compte-rendu de la Conférence nationale d’information pour le relèvement de la condition humaine outre-mer, 3–4 mars 1951.[↩]
- Edwy Plenel, « Palestine : Monsieur le Président, vous égarez la France », Mediapart, 23 juillet 2014.[↩]
- Rosa Luxemburg, La Révolution russe, Éditions de l’Aube, 2013, p. 41.[↩]
- Karl Marx & Friedrich Engels, Le parti de classe — Questions d’organisation, Tome III, « Luttes de tendances et dissolution de l’Internationale », François Maspero, 1973, p. 56.[↩]
- Jean-Jacques Marie, Lénine — La révolution permanente, Payot, 2011, p. 360.[↩]
- Sophie Cœuré, « Hélène Brion en
Russie rouge
(1920–1922) », Le Mouvement Social vol. 205, n° 4, 2003, p. 9–20.[↩] - Ibid.[↩]
- Paroles de Poilus, Librio, 1998, pp. 87–88.[↩]
- Georges Hyvernaud, La Peau et les os, Pocket|Le Dilettante, 2014, p. 96.[↩]
- Cité par Colette Avrane, art. cit.[↩]
- Extrait du dossier « Brion Hélène », article « La première audience », bibliothèque Marguerite Durand, à Paris.[↩]
- Florence Montreynaud avance, à tort, six mois de prison dans L’aventure des femmes XXe-XXIe siècle, Nathan, 2011. Catherine Valenti parle quant à elle de trois mois, dans son ouvrage Les grandes femmes de l’Histoire de France (EDI8, 2010).[↩]
- Ute Gerhard, « Concepts et controverses », Le siècle des féminismes, Éditions de l’Atelier, 2004, p. 48.[↩]
- Pour ses liens avec Madeleine Pelletier, voir Madeleine Pelletier, une féministe dans l’arène politique, Claude Maignien et Charles Sowerwine, Éditions de l’Atelier, 1992.[↩]
- Cité par William Guéraiche, Les femmes et la République : essai sur la répartition du pouvoir de 1943 à 1979, correspondance du 21 février 1945, à Marianne Verger, Éditions de l’Atelier, 1999, p. 69.[↩]
- Hélène Brion, Préface à la seconde édition, « Les partis d’avant-garde et le féminisme », La voie féministe, 1er novembre 1918.[↩]
- Flora Tristan, Vie, œuvre mêlées, 10|18, 1973, p. 7.[↩]
- Christine Delphy, L’Ennemi principal, tome 2, Syllepses, 2013, p. 57.[↩]
- Christine Bard, « La lutte des femmes et celles pour l’égalité et la justice ne font qu’une », L’Humanité, 8 mars 2013.[↩]
- Sophie Cœuré, art. cit.[↩]
- Yannick Ripa, Les femmes, actrices de l’Histoire : France, de 1789 à nos jours, Armand Colin, 2010.[↩]
- Voir son Encyclopédie féministe, archives Brion, bibliothèque Marguerite Durand, Paris.[↩][↩]
- Lettre à M. Roosevelt, écrite en mars 1945, disponible dans les archives Brion, à la bibliothèque Marguerite Durand, à Paris.[↩]
- Antoinette Fouque, Il y a deux sexes, Folio actuel|Gallimard, 2015, p. 132.[↩]
- Texte disponible dans les archives Brion, à la bibliothèque Marguerite Durand, Paris.[↩]
- « À propos des thèses de C. Delphy : L’oubli de la reproduction sociale », L’Anticapitaliste, n° 67 (juillet-août 2015).[↩]
- Colette Avrane, art.cit.[↩]


