Entretien inédit | Ballast
Peut-on échapper aux contraintes imposées par l’économie capitaliste sur nos corps, nos liens, notre ancrage dans le monde ? Comment s’émanciper du travail discipliné, tout en replaçant le « faire » au cœur de l’action collective ? L’ethnologue Guillaume Sabin a tenté de répondre à ces questions, en menant une enquête sur des « milieux » qu’il connaît par ailleurs de longue date : des fermes partagées aux hangars réinvestis en lieux de production et de création, en passant par un skatepark autogéré sur une ancienne friche industrielle… Autant d’espaces où s’invente une « économie de l’émancipation ». Dévier, paru aux éditions Libertalia, est le fruit d’une immersion sensible et active au cœur de ces ilots où l’on cherche à substituer la fabrication à la consommation. L’auteur revient dans cet entretien sur l’esprit qui a guidé son travail d’écriture et la signification politique des expériences qui forment la trame de son livre.

Mon premier « terrain de recherche » s’est déroulé en Argentine, au début des années 2000 : le contexte était celui d’une crise économique sévère, accompagnée de très forts mouvements sociaux — l’atmosphère était quasi-révolutionnaire. Je me suis rendu compte que ce que les gens me disaient était très éloigné de ce que racontaient sur le vif les sciences sociales et parmi elles la sociologie. Je ressentais un décalage entre ce que j’avais sous les yeux et une sociologie qui parlait de chaos, de crise et des mouvements sociaux sous le prisme de vieilles théories — par exemple l’obsession de la prise de pouvoir et de l’État. Certes il y avait une crise, mais il y avait aussi autre chose : il y avait une espèce d’espoir, de désirs d’échanges, c’était l’époque des assemblées de voisins, des usines récupérées. Et la prise de pouvoir n’était dans aucune bouche, ni dans aucune pratique que j’avais sous les yeux. On parlait surtout de mouvements et de coordinations autonomes.
Depuis, quand j’arrive quelque part, j’ai cette habitude d’essayer d’éloigner le plus possible ce que je sais, de tenir à distance les théories que je trimballe et qui sont liées à ma formation universitaire. J’y reviendrai plus tard, ce que je vais voir et découvrir m’amènera peut-être vers autre chose. Ça a été le cas pour Dévier : j’ai écrit les huit chapitres ethnographiques sur les expériences collectives avant les chapitres qui essayent de poser un regard un peu plus théorique.
Votre ouvrage alterne entre des parties ethnographiques, descriptives, et des interludes théoriques. Comment concevez-vous l’interaction entre ces deux dimensions de votre travail d’écriture ?
Cette alternance est avant tout une nécessité. Je n’ai pas choisi l’ethnologie par hasard. J’étais salarié dans l’éducation populaire et j’étais attiré par le côté touche-à-tout de la discipline. Puis j’ai découvert le plaisir de partager le quotidien des personnes avec qui je travaillais. Je crois que je serais bien incapable d’embrayer sur un projet d’écriture ou de réflexion sans être profondément nourri par les expériences que je vais partager sur le temps long et régulier. Il m’est tout simplement impossible de poser une théorie qui serait ensuite explicitée par du concret, validée par une dimension empirique qui interviendrait a posteriori — le chemin que j’emprunte est inverse.
« Quand j’arrive quelque part, j’ai cette habitude d’essayer d’éloigner le plus possible ce que je sais, de tenir à distance les théories que je trimballe. »
En Argentine, j’ai eu la chance de travailler avec une philosophe et psychanalyste féministe, Ana María Fernández, qui a été ma codirectrice de thèse. Elle a écrit un très beau livre sur les usines récupérées en Argentine et les assemblées de quartier1 où elle dit justement qu’il faut cesser de répéter ce qui a déjà été écrit, qu’il faut savoir parfois écrire contre les théories. Dans ce livre, elle rompt avec une forme de sociologie classique qui essaye de penser les mouvements sociaux à partir des théories préexistantes. Je crois vraiment que les théories peuvent aveugler : des chercheurs, des journalistes et des militants peuvent arriver avec un cadre de pensée qui les empêche de voir pourtant ce qui se passe sous leurs yeux. De ce point de vue, l’Argentine du début des années 2000 a été une source d’apprentissage très importante pour moi. J’ai toujours privilégié ma pratique de terrain, le partage avec la vie des gens — en l’occurrence les populations paysannes autochtones organisées et qui cherchaient à faire bouger les lignes — et la rencontre avec des collectifs militants, des travailleurs, ou encore des intellectuels qui ne regardaient pas le monde s’agencer au travers d’un prisme déjà existant — comme Ana María Fernández, comme le collectif Situaciones ou le philosophe Ignacio Lewkowicz.
Dans ce cas, pourquoi ajouter des parties théoriques dans votre ouvrage ?
C’est une question que je me pose toujours ! Si je m’arrête à la description d’expériences qui sont différentes, on pourrait croire que celles-ci sont faciles, presque normales. Or j’ai besoin de rappeler d’où on part, quel est le monde dominant, quelles sont les lignes de force de la société dans laquelle nous vivons, rappeler en quelque sorte que dévier n’a rien d’une évidence et suppose de lutter sans relâche contre les normes dominantes du moment. Partager le quotidien des personnes qui sont les protagonistes de Dévier, alors même que je connaissais ces personnes avant de me lancer dans cette enquête, m’a souvent bien plus surpris que d’autres expériences ethnographiques que j’ai faites, pourtant plus lointaines ; bien plus aussi que ce que je pouvais trouver dans mes lectures du moment. Il m’a semblé nécessaire de rendre compte de cet écart, de montrer qu’il se passait là quelque chose d’important — d’où des détours plus théoriques !

[Guillaume Sabin]
Qu’en est-il de la littérature sociologique ou ethnographique qui parle des mêmes milieux que ceux que vous décrivez ? Vous n’en citez quasiment pas dans votre livre, qui contient pourtant de nombreuses références théoriques, philosophiques ou ethnologiques.
Un collectif de jeunes gens croisé lors de cette enquête m’a dit : « Il y a quelqu’un qui fait à peu près le même travail que toi, qui est aussi ethnologue et sociologue ! » Il s’agissait de Geneviève Pruvost, que j’ai lue quand j’étais déjà bien avancé dans l’écriture de Dévier. Forcément il y avait énormément de points communs avec ce que j’étais en train d’essayer d’écrire et ce qu’elle analysait de son côté. J’étais heureux de voir qu’elle parvenait au même résultat, par exemple sur cette notion d’abondance, dans des lieux qui sont pourtant pauvrement dotés en ressources monétaires. Néanmoins, et sans vouloir faire de généralités, je me méfie de la sociologie — quantitativement dominante — qui fait surgir ses analyses d’un travail d’éloignement des « enquêtés », par exemple en faisant disparaître tout forme de témoignage direct ou de description précise des pratiques, en occultant par là même les multiples formes d’intelligence des personnes et des agencements collectifs.
C’est une littérature qui me fatigue, presque physiquement : souvent, elle occulte les ambiances qui disent pourtant beaucoup de la vie et de la vie en société ! Ce travail de mise à distance, je l’ai pratiqué pour la dernière fois dans mon travail de thèse, qui exigeait la lecture exhaustive de la littérature propre à mon enquête (la sociologie rurale, la sociologie des mouvements sociaux, etc.). Autant cela m’avait permis d’acquérir en Argentine une connaissance basique des acteurs et des forces en présence, autant j’en ressens moins le besoin en France, dans les milieux que je fréquente depuis de longues années, ce qui explique que je préfère citer des auteurs et des autrices, souvent philosophes, qui mènent un travail résolument conceptuel, plutôt qu’une sociologie qui peine, malgré le jargon, à aller au-delà d’une simple photographie de l’époque.
Vous avez fait le choix de la proximité avec votre « objet » d’enquête. Pourtant, un certain pan des sciences humaines n’enseigne-t-il pas que la distance est la condition nécessaire à toute enquête rigoureuse ?
« Je me méfie de la sociologie qui fait surgir ses analyses d’un travail d’éloignement des
enquêtés, en occultant par là même les multiples formes d’intelligence des personnes et des agencements collectifs. »
Le sociologue François Dubet a écrit de belles pages sur ce que signifie le partage du quotidien des personnes avec lesquelles on travaille et la manière dont on peut se nourrir de leur intelligence2. Et Claude Lévi-Strauss, bien avant lui, avait posé la question de savoir dans quelle mesure on peut décrire et analyser des expériences sans déjà avoir pris la mesure des subjectivités des personnes qui en sont les protagonistes — quitte à passer, ensuite, à un autre niveau, plus conceptuel, plus structural. Lui-même, qui a une réputation de quelqu’un de plutôt distant, assume dans son Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss que le point de départ doit être la compréhension des subjectivités : la manière dont nous concevons le monde, comment nous y agissons, comment nous l’agençons. Philippe Descola, élève de Claude Lévi-Strauss, n’aurait pas pu arriver au niveau d’analyse qui est le sien dans Par-delà nature et culture sans avoir fréquenté et retenu une leçon des Jivaros dont il a partagé le quotidien pendant plusieurs années. C’est bien cette plongée dans des subjectivités radicalement différentes des nôtres qui lui permet de faire une lecture autre de notre propre rapport à la « nature », et de proposer une lecture renouvelée de notre monde.
J’ai fait le choix de la proximité, après m’être demandé : est-ce que ce partage du quotidien relève d’autre chose que de la simple curiosité du voyageur ? Ce qui m’intéresse, c’est toujours cette volonté de passer de l’autre côté du miroir, de voir comment ça se passe de l’intérieur : qu’est-ce qui passionne les personnes auprès de qui je chemine ? De quoi parlent-elles ? Quels sont les gestes, répétés, qui permettent d’agencer le monde de telle ou telle manière ? Ce n’est pas un simple fétichisme pour le concret des choses : pratiquer de la sorte c’est voir des choses qui passeraient à la trappe si on faisait le choix de la mise à distance, en se limitant à l’exercice de l’entretien par exemple. Quand je parle de partage du quotidien, je parle de pratiques, mais aussi d’échanges nourris, de conversations développant une véritable dimension intellectuelle, y compris avec des gens qui n’ont pas été formés à l’université. J’ai été beaucoup nourri par des militantes et militants paysans, qui n’avaient pas fait d’études supérieures, qui parfois n’avaient même pas terminé l’école primaire, et qui déployaient une forme de réflexion puissante — qui faisait bouger mes lignes et qui me nourrit encore aujourd’hui.
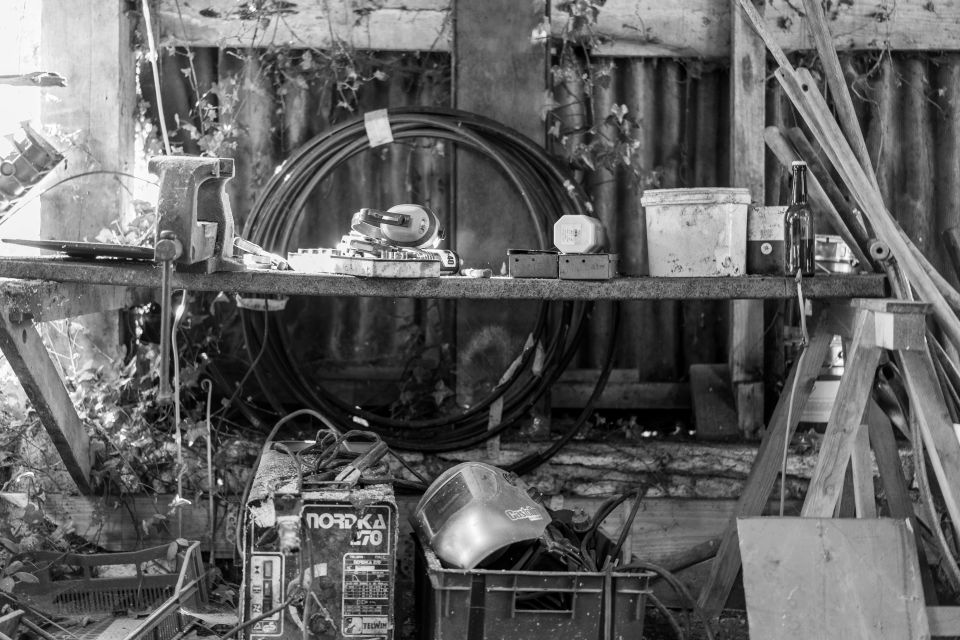
[Guillaume Sabin]
Vous prenez ainsi le contre-pied d’une sociologie qui cherche à dégager des « rapports sociaux fondamentaux » (Alain Testart), ou encore des « structures fondamentales » (Bernard Lahire) des sociétés humaines.
Bernard Lahire assume le fait que dans les recherches en sciences sociales on puisse déléguer la menée d’entretiens, tandis qu’il reviendrait à d’autres chercheurs d’en tirer des concepts plus généraux. Pour ma part, si je m’intéresse à l’ethnologie, c’est parce qu’il y a un domaine de l’action qui me passionne : en Argentine, j’ai eu l’occasion de rencontrer beaucoup de sociologues et d’anthropologues sur leurs terrains de recherche, certains y allaient la boule au ventre, tandis que d’autres misaient tout sur une distance artificielle. Pour ma part, partager le quotidien de personnes éloignées de mon propre cadre de vie est une passion, elle me nourrit et me procure du plaisir ! C’est pourquoi j’ai tendance à rester modeste : peut-être qu’il y a de bons intellectuels qui n’ont pas besoin de terrain de recherche, ou qui n’en sont pas capables, tandis que d’autres comme moi s’en nourrissent exclusivement.
Mais l’idée que l’on pourrait faire de la science uniquement à partir de matériaux livresques et de discussions sur des théories parfois poussiéreuses ne m’a plus du tout traversé l’esprit après mon expérience argentine — et c’est peut-être un défaut, d’ailleurs. Dans l’ethnologie, il y a également une proximité avec la littérature. Comme beaucoup, j’ai commencé mes études d’ethnologie avec la lecture des Argonautes du Pacifique occidental de Bronisław Malinowski : c’est autant un livre ethnographique qu’un exercice de style. Bien écrire, c’est non seulement plaisant, mais cela permet aussi de rendre compte de subjectivités particulières de manière adéquate. L’ethnologie est une forme de littérature. Il faut l’assumer.
Est-ce que les milieux présentés dans Dévier ont infléchi le style de votre écriture ?
« L’ethnologie est une forme de littérature. Il faut l’assumer. »
Le dernier chapitre descriptif de Dévier, autour de la personne d’Émilie, qui monte une petite épicerie solidaire itinérante en milieu rural, a constitué un défi d’écriture. Comment faire comprendre à des lectrices et lecteurs la puissance qui se dégage d’une expérience qui semble à première vue minuscule et qui concerne très peu de personnes ? Il faut trouver le juste ton pour en rendre compte, et restituer la modestie des gens qui fabriquent ces expériences, tout en en faisant comprendre le caractère proprement extraordinaire — par exemple la passion des relations et le désintérêt pour les biens de consommation. Pour chacun des textes ethnographiques qui composent Dévier, il faut trouver les mots qui dénaturent le moins possible ces expériences et les personnes qui leur donnent vie. Ce ne sont pas que des faits, de simples éléments statistiques : il s’agit d’ambiances singulières, d’ethos, comme disent les ethnologues.
Dans vos textes, les productions écrites des lieux que vous avez fréquentés occupent une place très importante.
En effet, j’ai voulu mettre en avant la manière dont les personnes elles-mêmes se racontent et racontent leur monde. Je n’ai pas voulu construire moi-même des liens entre des milieux très différents, mais laisser ces liens émerger d’eux-mêmes. Au départ, j’avais même l’intention de faire un blog sur l’économie de l’émancipation qui aurait permis de naviguer d’un lieu à un autre de manière plus simple que dans un livre imprimé, via des blogs, des liens hypertextes, des podcasts, etc., fabriqués par les protagonistes de Dévier. Il s’agit de prendre acte d’une certaine modestie de l’ethnologue : mes idées ne viennent pas de nulle part, je rencontre des gens qui en tentant de rendre compte de la manière dont ils agencent leur vie et de ce qu’ils fabriquent, produisent des textes — sur des sites internet, dans des fanzines, sous forme de livres, etc. — qui sont d’une force souvent supérieure à ce que je peux faire de mon côté. Mon obsession de ne pas déformer des expériences singulières me conduit à renvoyer à leurs propres productions. C’est un garde-fou et ça dessine tout un univers de textes et de récits qui participent de ces vies qui dévient. Il faut garder à l’esprit que les protagonistes de Dévier ne sont pas que des praticiens, mais aussi des lecteurs, des visionneurs de sites et de chaînes YouTube, qu’ils possèdent un regard distancié sur ce qu’ils fabriquent.

[Guillaume Sabin]
Est-ce que Dévier a été discuté par les protagonistes en question ?
Il y a eu des allers-retours, bien évidemment. Tous les textes ethnographiques ont été systématiquement relus pour échange et validation. Parfois, on m’a juste dit « rien à dire, on s’y retrouve » ; d’autres fois, on m’a signalé qu’on ne pouvait pas dire les choses de telle ou telle manière — et ces échanges relèvent alors aussi de cette volonté de rendre compte de singularités irréductibles. Ces allers-retours sont indispensables d’un point de vue éthique et intellectuel, c’est aussi une manière de construire de la confiance. Comme pour mon livre précédent, La Joie du Dehors, j’ai commencé à faire des présentations publiques de Dévier accompagné des personnes qui en sont la matière vivante et pensante — une autre manière, plaisante, de ne pas altérer les singularités.
Ces présentations à plusieurs voix permettent aussi de revenir sur un temps passé et de témoigner du chemin qui a été accompli depuis. Écrire des textes sur des tranches de vie, c’est comme poser des balises pour plus tard, se donner les moyens de penser le présent. L’année dernière, je suis retourné sur le terrain qui a donné lieu à L’Archipel des égaux. Luttes en terre argentine. Je ne m’y étais pas rendu depuis quinze ans et j’y suis allé avec la version imprimée en espagnol de mon travail publié en France. Ce retour sur le passé fut particulièrement intense, autant pour moi que pour les personnes qui revoyaient des photos de moments (assemblées, manifestations, rencontres) et de personnes dont certaines étaient décédées depuis, qui ont retrouvé des chansons que j’avais retranscrites et qu’elles avaient oubliées. Même si j’avais passé une année complète auprès des compañeros et compañeras du mouvement paysan autochtone Red Puna, à quinze années de distance ce n’était finalement qu’une tranche de vie d’un mouvement qui existait déjà depuis vingt ans au moment où je l’avais accompagné et qui depuis avait continué sa trajectoire.
Vous publiez votre ouvrage dans une maison d’édition militante, Libertalia. Est-ce à dire que vous vous adressez avant tout aux militants ? Que voulez-vous leur dire ?
« Écrire, c’est ainsi contribuer à ce que des collectifs et des personnes se renforcent, qu’ils puissent se dire :
c’est vrai, on est tout ça. »
Tout d’abord, il faut saluer la singularité d’une maison comme Libertalia, qui a clairement une identité militante mais ne s’y enferme pas — son catalogue, qui dessine un univers d’une très grande variété, en témoigne amplement. Dans d’autres maisons, il faut montrer patte blanche, faire partie d’une famille voire d’une généalogie. L’ethnologie a traditionnellement eu pour tâche de faire l’histoire des gens qui n’en auraient pas — c’est-à-dire qui ne l’avaient pas écrite. Pour ma part, ce qui m’intéressait dans Dévier, c’est le caractère commun des expériences décrites : elles sont à la fois extraordinaires, au regard de la société actuelle, et à la fois très ordinaires, bien qu’on en parle peu. Ce sont les récits de gens qui décident de travailler à temps partiel ou très partiel, de manière intermittente. Or on en rencontre partout ! J’ai eu des retours de gens qui avaient lu Dévier et qui m’ont dit qu’ils fréquentaient beaucoup de personnes partageant cette manière d’agencer l’existence, mais qu’ils n’avaient jamais pensé à la dimension politique de ce mode de vie. Écrire, c’est ainsi contribuer à ce que des collectifs et des personnes se renforcent, qu’ils puissent se dire : « c’est vrai, on est tout ça ». Tâche d’autant plus importante que ces collectifs sont aussi traversés par des doutes profonds, qu’ils doivent faire face à des échecs.
Benjamin, un des protagonistes de Dévier, m’a envoyé un mail après la lecture du livre et m’a dit, en substance, que celui-ci sera probablement peu discuté dans les milieux académiques et militants, mais que c’est un livre fait pour être discuté dans les cuisines — pour moi, c’est un compliment. Dans Dévier je parle beaucoup de cuisines, de repas collectifs ; je fais un clin d’œil à bell hooks qui, elle aussi, au détour d’un de ses livres, parle de la dimension politique des cuisines. Ces lieux dont on ne parle jamais : c’est tout à fait effroyable ! Ça illustre la manière dont un certain intellectualisme nous rend aveugles à la puissance de lieux, des rencontres qu’ils suscitent et qu’on a là, sous les yeux. Certaines cuisines dessinent un univers où s’élaborent des manières de partager des produits que l’on cultive collectivement, à partir de tout un univers matériel et idéel qui prend pied dans ce que j’appelle un régime de fabrication (par opposition à celui de consommation). Sur ce point, un livre comme Cantine. Précis d’organisation de cuisine collective, que j’ai découvert grâce à Aline et Coline, qu’on retrouve aussi dans Dévier, est un pavé politique qui passe par des recettes de cuisine, subversives parce que s’insérant dans des expériences gratuites, collectives, partageuses. Je pense que dans certains milieux militants intellectuels, on ignore totalement la portée politique de ces lieux et des pratiques dont ils sont le théâtre.

[Guillaume Sabin]
Les discussions dans les milieux militants « anticapitalistes » sont beaucoup centrées sur des questions de stratégie, de la mobilisation des masses, avec le retour en force du léninisme. Quel regard portez-vous sur ce phénomène ?
Je fréquente les milieux militants, que ce soit en France ou en Amérique Latine, depuis une trentaine d’années : j’ai vu trop de militants qui avaient un amour du microphone, du mégaphone et du discours, et que j’ai vus ensuite occuper des postes dans des milieux tout à fait normés — postes dont on peut penser que l’art du discours et de la séduction ne sont pas étrangers à leur obtention. Celles et ceux qui parlaient moins, surtout des femmes, continuent à mener des pratiques incorporées de solidarité, de soin des autres — à se tenir tout proche des cuisines. J’ai acquis une grande méfiance envers les théories générales et les grands discours sur la révolution. Plus les discours sont radicaux, plus ils courent le risque d’être désincarnés, détachés d’engagements concrets et situés. Revenons donc aux cuisines et à ce qui nous nourrit, dans toute la polysémie du terme.
Dans Dévier, il y a un large spectre de personnes qui ont fait certains choix de vie ou ont tout simplement rencontré des expériences collectives par la pratique et le « hasard » des rencontres. De l’autre côté du spectre — je pense à Anne et David des Hangars hagards, mais pas seulement — il y a aussi des trajectoires politiques assumées. Il ne faut pas ignorer la manière dont une réflexivité permanente nourrit aussi la force de certaines pratiques. C’est ce que disait à sa manière Maurice Godelier3, à travers la notion d’idéel : dans n’importe quelle pratique humaine, on mobilise des représentations, qui ne sont pas forcément de l’idéologie, mais des manières de se représenter les gens, les choses, le monde, et ces représentations autorisent ou interdisent certaines pratiques, certains gestes. Dans Dévier, il y a des personnes qui ont une bonne assise politique, au sens militant étroit du terme, ce qui fait leur force ; et d’autres qui sont arrivées autrement, par le faire. Entre les deux il y a plein de gens qui naviguent un peu à vue et viennent poser des questions au monde militant. Ce sont des personnes qui vont construire un étayage politique et militant dans la pratique. On trouve tout un panel de gens qui vont être subversifs « simplement » par le faire et le bricolage ; d’autres qui vont trouver plaisir au bricolage en l’ayant théorisé de longue date.
Comment ces collectifs envisagent-ils le futur ?
« Plus les discours sont radicaux, plus ils courent le risque d’être désincarnés, détachés d’engagements concrets et situés. »
Les expériences dont je parle ne sont pas des expériences « communautaires ». Les personnes qui y prennent part sont mêmes réticentes à parler de « collectif » alors même qu’elles participent bien d’entreprises collectives : il y a une méfiance envers une sur-organisation, la peur de se diluer dans quelque chose de trop organisé. Que deviendront ces personnes, ces expériences ? L’absence de projection assurée dans le futur s’accompagne d’une forme de modestie, comme dans les expériences de squat, qui, du fait d’une certaine fragilité, tendent à valoriser l’intensité du présent. Ce qui est certain néanmoins, c’est que ces trajectoires incarnées ne déboucheront pas sur un retour à une forme de normalité existentielle qui passerait par un travail à temps plein, un prêt immobilier et une manière d’habiter confinée.
C’est impossible, non pas par choix, mais en raison du plaisir même qui naît des activités libres propres au régime de fabrication, qui nécessite du temps, une liberté de mouvement et de pensée incompatibles avec le travail discipliné à temps plein. Il n’y a pas de pari sur l’avenir : il faut juste voir le présent tel qu’il est. Les personnes sont d’abord plongées dans des pratiques qui les concernent elles-mêmes, dans des « milieux » souples qui nourrissent et rendent possibles ces pratiques libérées — par intermittence — du travail discipliné. « Penser par le milieu », comme y invite Gilles Deleuze, c’est éviter de considérer le temps comme quelque chose d’uniquement linéaire, c’est aussi éviter de laisser croire que tout serait dû à une « socialisation primaire » qui, dès l’enfance, conduirait certaines personnes à se conformer et d’autres, au contraire, à dévier. Les choses sont bien plus ouvertes.

[Guillaume Sabin]
Vous insistez sur un verbe : faire. Pourquoi ?
Il y a une dimension subversive du faire dans un monde où on nous invite à « faire faire » par d’autres ce que l’on pourrait faire par soi-même. C’est la grande division sociale et macrosociale du travail et de l’intelligence inventée dès le début du capitalisme industriel, et qui permet aujourd’hui de tout monétariser — de sorte que le capitalisme peut continuer de se déployer. Qui aurait pu imaginer, il y a vingt ans, que des gens utiliseraient un téléphone portable pour se faire livrer leur repas à domicile ? Des choses proprement inouïes sont rentrées dans la norme. Il a déjà fallu pour ça imaginer que l’on pouvait manger autre chose que ce que l’on préparait soi-même ; avant ça, que l’on puisse préparer à manger avec des aliments étrangers à notre univers quotidien. Le fait de faire plutôt que de faire faire n’est pas une passion triste mue par le devoir de s’opposer au régime des consommations, c’est au contraire une source intarissable de joie — ce que le travail discipliné ne pourra jamais offrir.
Sortir du travail et du temps disciplinés : est-ce là le point commun avec les ouvriers du XIXe siècle étudiés par Jacques Rancière, auquel vous faites souvent référence ?
La pensée de Jacques Rancière, très proche malgré la distance temporelle qui la sépare des ouvrières et des ouvriers du XIXe siècle auprès de qui elle prend pied, est une pensée incarnée de la proximité qui me parle en effet davantage que les ouvrages qui cherchent à mettre à distance. Rancière m’a beaucoup inspiré pour poser le cadre de Dévier et le présenter aux personnes qui allaient en être le cœur, et notamment ce lien entre des singularités fortes et un désir de communs. Dans Dévier on trouve, fortement reliés, des choix individuels, des appétences, des dispositions que les gens veulent cultiver et faire grandir, et cette volonté d’augmenter ses propres capacités d’agir amène à créer des liens avec d’autres. La découverte d’un tel univers de fabrication au cœur même d’un vieux continent, l’Europe, qui a inventé le capitalisme et est plongé depuis plus d’un demi-siècle dans le régime des consommations, a été une grande surprise pour moi, qui suis par ailleurs familier de ce type de pratiques. Chez Rancière, il n’y a pas cette dimension d’une émancipation par le faire (ce que je nomme « artisanat du XXIe siècle ») puisque les ouvrières et les ouvriers dont il parle essaient justement de s’échapper de leur travail de manœuvre pour s’émanciper intellectuellement (des « intellectuels de contrebande », dit Rancière). Dans les deux cas, cependant, il y a une lutte pour une liberté du temps gagné sur le travail discipliné, c’est-à-dire soumis à un contrôle hiérarchique, à la rentabilité et au chronométrage. Il s’agit là clairement d’une lutte pour l’émancipation, d’abord individuelle, et non d’une libération des masses.
Pourquoi le faire serait-il nécessairement émancipateur ?
« Des corps qui rient ont une faculté de penser décuplée. »
Fabriquer son logement, une des manières de rentrer dans le régime de fabrication, ouvre sur une prise de conscience des capacités que chacune et chacun avons de penser les choses et de fabriquer nos univers matériels. Le faire qui est celui du bricoleur ouvre un univers complètement antinomique au capitalisme et à la société managériale. Parfois, l’émancipation ou la libération collective passent beaucoup plus par le corps que par la tête : dans le travail discipliné, on discipline l’esprit mais aussi et avant tout les corps. Lutter contre les normes dominantes n’est donc pas qu’un travail de pensée. Si j’ai quitté l’université et le domaine de l’enseignement et de la recherche, c’est en raison de cette contradiction phénoménale qu’incarnent certains chercheurs qui travaillent sur la désobéissance civile ou la démocratie radicale par exemple, et qui sont dans leur univers professionnel quotidien des rouages zélés d’organisations non-démocratiques et entièrement soumises aux jeux de pouvoirs. Ce constat banal indique néanmoins que penser n’est jamais suffisant pour passer à une forme d’action qui vienne subvertir et corroder les normes qui nous entourent. C’est une extrême naïveté du milieu intellectuel et d’un certain militantisme de penser que dire, écrire, dénoncer et conscientiser suffirait à réveiller les gens et les masses et à les faire dévier. Ce n’est pas que je n’y crois pas : j’ai tout simplement observé depuis près de trente ans que ça se passait autrement.
Vous liez aussi l’émancipation à la joie et au rire : en quoi s’opposent-ils à la discipline et à la hiérarchie ?
Ana María Fernández a fait la démonstration que dans des espaces collectifs, la joie et la puissance des imaginaires étaient inversement proportionnelles à la présence de personnes charismatiques aux discours préconstruits, qui viennent au contraire éteindre la capacité à déborder, à rire, à expérimenter4. C’est une leçon immense, qui donne à réfléchir sur ce qu’on raconte dans les organisations sociales hiérarchiques et aussi, hélas, dans certains milieux militants, à savoir l’importance des conducteurs d’hommes et de femmes, la nécessité des leaderships. Ana María est aussi l’une des premières personnes à m’avoir rappelé qu’il ne fallait jamais négliger la présence (ou l’absence) des rires : elle a vu dans des expériences, notamment d’usines récupérées, comment, au fil du temps, la joie et les rires avaient pu disparaître, signe avant-coureur de la fin d’une aventure ou du moins d’un nouvel agencement des choses. Le nombre d’espaces militants qui ont tout sauf un caractère joyeux sont mal partis pour transformer le monde. Cela nous ramène aux corps et vient signifier que ces corps rebelles, qui savent se moquer des hiérarchies, des grands discours et des directeurs de conscience ne s’opposent en rien à la pensée : des corps qui rient ont une faculté de penser décuplée.

[Guillaume Sabin]
Les situations que vous avez rencontrées échappent-elles à ces jeux de pouvoir interne à de nombreux collectifs militants ?
Telle est justement ma seconde grande surprise en travaillant dans les différents milieux que je décris dans Dévier : c’est l’absence de leadership et la volonté de ne pas occuper la position de chef ou d’expertise. Ça s’observe d’une manière très pratique : j’ai l’exemple d’un moment où on va travailler sur une parcelle collective, chez Maëlle, qui se lance dans la boulange itinérante. On est environ une dizaine, dont deux maraîchers professionnels, qui se permettent quelques conseils, tout en disant : « Je fais comme ça, mais on peut aussi faire tout autrement. » Ce sont des petits détails qui donnent néanmoins un aperçu des horizons sociaux portés par celles et ceux qui dévient.
S’agit-il de mécanismes institués délibérément ?
Ça peut exister, notamment à travers des tours de parole par exemple, des manières de laisser chacune et chacun s’exprimer sans intervenir ni couper la parole. Mais ce sont avant tout les personnes qui, dans leur subjectivité même, sont anti-autoritaires, refusent la hiérarchie et le travail discipliné — subjectivités nourries par certains « milieux » propices à ce mouvement indiscipliné et subjectivités qui nourrissent à leur tour ces milieux, leur permettent de prendre pied et de perdurer. Mais, finalement, dans Dévier, ces milieux s’agencent sans trop de formalisme — ce qui n’est ni bien, ni mal !
En quoi dévier se distingue donc de la désertion ?
J’ai un peu de mal avec l’idée de désertion. L’idée que l’on pourrait construire des communautés, des îlots, des oasis ou tout simplement une cabane isolée qui se trouveraient à l’abri des remous du monde m’est étrangère. Les interdépendances globales sont telles que nul n’en est à l’abri. À quoi cela sert-il, politiquement parlant, de vouloir s’isoler, à l’heure des grands délires obsidionaux ? Tous les protagonistes de Dévier ont un pied dans le travail discipliné et tout ce qu’il charrie. Ce pied dehors et ce pied dedans, chacune et chacun le valorise, parce que c’est le lien avec le monde tel qu’il est et qu’il faut bien assumer. Ça leur permet de ne jamais oublier ce que ce monde impose, aux corps et aux esprits, ça leur permet de garder à l’esprit que d’autres n’ont pas d’autre choix que de le subir à temps plein et de manière continue. Ainsi ont-ils appris qu’il ne faut jamais mépriser ce que les gens font et de quelle manière le monde nous traverse ; ils et elles ont appris à reconnaître la fragilité de nos propres parcours, et que certaines personnes n’ont pas toutes sortes de capitaux, culturels, relationnels, etc., qui permettent d’expérimenter le régime de fabrication et les joies qu’il procure. D’où le choix de ce terme, dévier : il y a une puissante force gravitationnelle qui nous retient, nous fait agir et penser, si bien que dévier n’a rien de naturel mais exige de lutter contre cette force, ses normes, ses vérités.
Photographies de vignette et de bannière : Guillaume Sabin
- Ana María Fernández : Política y subjetividad. Asambleas barriales y fábricas recuperadas, Tinta Limón, Buenos Aires, 2006.[↩]
- Voir par exemple François Dubet, La Galère : jeunes en survie, Librairie Arthème Fayard, 1987.[↩]
- Maurice Godelier, L’Idéel et le matériel. Pensée, économies, sociétés, Arthème Fayard, Édition de poche, Paris, 1984.[↩]
- Ana María Fernández, Las Lógicas colectivas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2008.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Geneviève Pruvost : « Lutter au quotidien contre un monde conventionnel », avril 2024
☰ Lire notre entretien avec Geneviève Azam : « L’autoroute A69 est écocidaire et injuste », octobre 2023
☰ Lire notre article « Revenir au bois : pour des alternatives forestières », Roméo Bondon, juin 2023
☰ Lire notre article « S’organiser pour l’autonomie alimentaire », Roméo Bondon, mai 2022
☰ Lire notre entretien avec Pierre Madelin : « Il existe des possibilités réelles de désertion », décembre 2020
☰ Lire notre entretien avec Pierre Déléage : « Si l’anthropologie a une vertu, c’est sa méfiance vis-à-vis de l’universalité des lois », juin 2020


