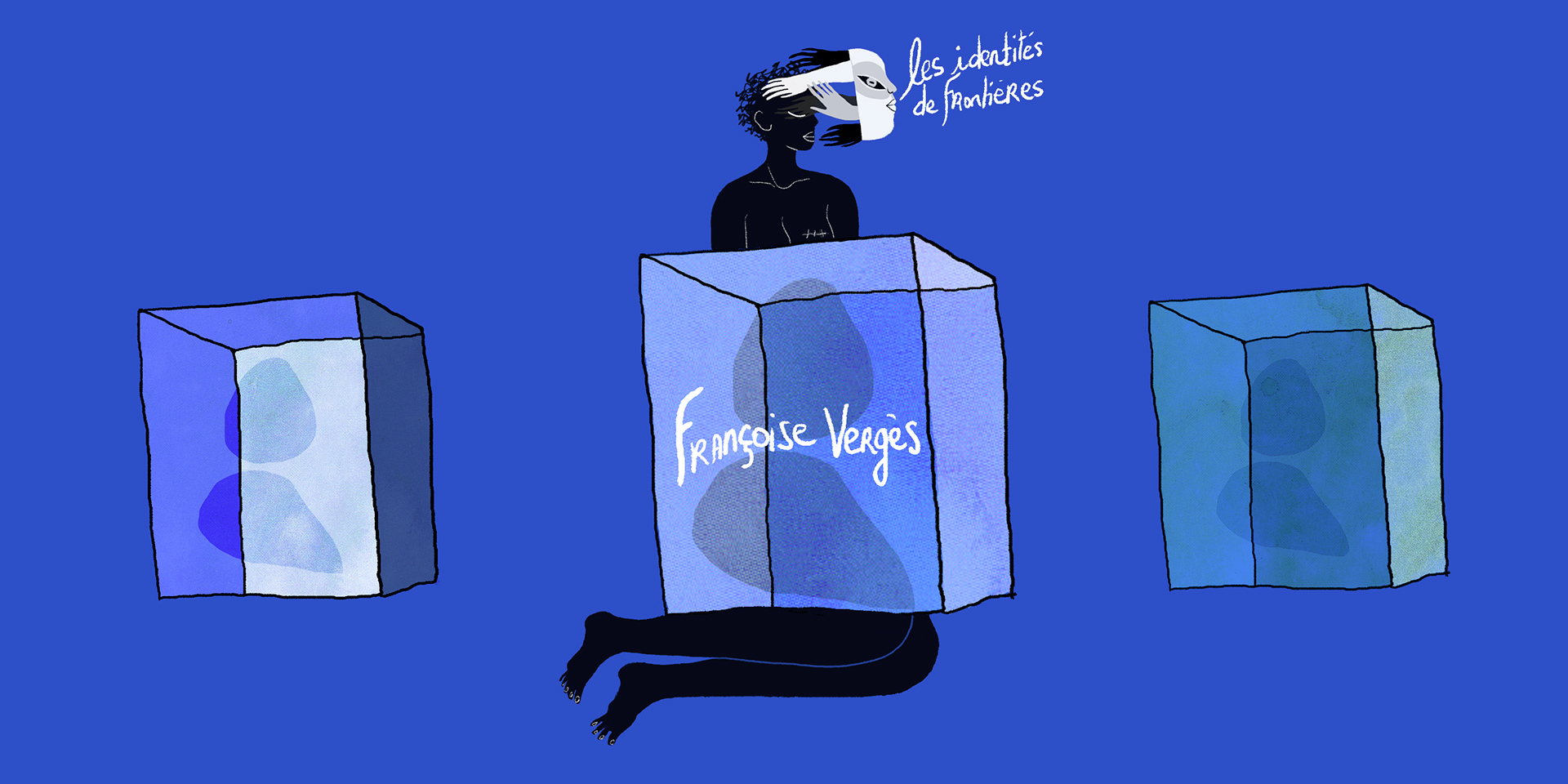Semaine « Les identités-frontières de Gloria Anzaldúa »
Partout, des statues sont déboulonnées ou questionnées ; plus discrètement, « cinq métisses assignent l’État belge en justice pour crimes », titre la presse. Elles exigent « réparation » pour avoir été arrachées, enfant, à leur famille au Congo et placées dans des institutions chrétiennes. Il est rare de lire le terme « métis·se » associé à cet aspect peu connu de l’histoire coloniale, dans laquelle il s’enracine pourtant en profondeur. Il importe donc de penser politiquement le métissage, galvaudé, comme on le sait, par l’imaginaire marchand. Copilote de l’université Décoloniser les arts, la politologue et historienne Françoise Vergès y invite ici — comme elle invite, d’un même geste, à regarder nos institutions, nos imaginaires et nos créations sous le prisme de la réflexion décoloniale. Comment imaginer autrement nos musées ? Comment investir autrement les espaces de savoir et de transmission ? Françoise Vergès a connu l’œuvre de Gloria Anzaldúa alors qu’elle vivait dans le sud des États-Unis : second volet de cette semaine consacrée aux identités de frontières, appréhendées à partir des écrits de la féministe chicana.

Je suis arrivée en Californie du Sud fin 1983, le 30 octobre exactement. Étant entrée avec un visa touristique, j’y ai vécu deux ans de manière illégale, exploitée par un couple de françaises pour lesquelles je faisais tout : le secrétariat, la cuisine, le ménage, le jardinage, les courses… C’était à San Diego. La situation des travailleuses et travailleurs mexicain·es était très visible. Lisant un peu l’espagnol, je m’intéressais à leur situation. J’ai quitté le pays en 1985 pour éviter d’être arrêtée comme « illégale », car ce coin des États-Unis était particulièrement raciste. Les Blancs parlaient déjà d’ériger un mur de séparation, d’organiser des milices privées et armées pour défendre la frontière… Je ne voulais pas rentrer en France et j’ai choisi de revenir aux États-Unis, en passant du côté mexicain pour formuler une demande de visa légale. J’ai donc vécu au Mexique, de l’autre côté de la frontière, pendant près de neuf mois, dans un petit village au sud de Tijuana, Rosarito — j’ai pu observer la matérialité de la frontière. J’allais au consulat une à deux fois par semaine pour suivre l’avancée de mon propre dossier et je faisais la queue avec les centaines de femmes, enfants, hommes qui avaient fui les guerres fomentées par les États-Unis au Honduras, au Guatemala et au Salvador, et qui tentaient d’accéder à El Norte. J’ai vécu de nouveau à San Diego, d’abord en vivant de petits boulots puis en allant à l’université. Je fréquentais le Centro de la Raza1 où travaillaient des artistes et des activistes qui abordaient les enjeux de la Raza et du mestizaje [métissage].
« La mestiza est ambiguë, elle ne se fige pas. J’ai trouvé importante l’idée d’enchevêtrement, que je préfère à celle d’
intersection. »
Qu’il s’agisse des questions soulevées par Gloria Anzaldúa dans une perspective décoloniale, raciale, de genre et de sexe, ou de la question du métissage et de la place des indigènes, ce sont des choses que j’ai « vécues », mais de l’extérieur. Tijuana est une ville-frontière où les jeunes nord-américains venaient s’encanailler tous les vendredis soir, adoptant des attitudes racistes, coloniales, stupéfiantes d’impérialisme. L’alcool étant moins cher qu’aux États-Unis et accessible aux mineurs — en Californie, il était interdit aux moins de 18 ans —, des troupes entières de jeunes américains et américaines venaient y boire, se laissant aller à tous les excès, sûrs de la protection que leur accordait leur statut de yankee. Une débauche de sexe et d’alcool où on pouvait analyser comment race, classe, sexualité, genre et sentiment de sécurité jouaient. Tout près d’une frontière où régnait déjà une violence absolue : des barbelés, des grilles… Une rivière sépare Tijuana et San Diego et, dans son lit, on voyait tourner les voitures de la Migra [la police des frontières, [ndlr]].
De la rencontre de cette frontière physique, tirez-vous un lien vers vos propres réflexions et vécus sur le métissage ?
La question du métissage m’a toujours interrogée, puisque je viens de la Réunion, une île « métisse » comme le dit la publicité touristique. J’ai beaucoup lu sur le métissage — une littérature qui était alors pour l’essentiel issue d’Amérique centrale et des Caraïbes hispanophones et anglophones, et qui m’a beaucoup aidée pour mon travail sur le colonialisme français. Il portait sur la figure du métis comme « monstre » ou « révolutionnaire », dans la littérature coloniale, qui a finalement été célébrée dans la seconde partie du XXe siècle après avoir été récupérée par le néolibéralisme, lequel y a vu l’emblème d’un futur multiculturel et divers. Anzaldúa et son livre sur la frontière ont également été importants, notamment sa vision de la collision culturelle, du choc : imaginer le choc qu’avait pu provoquer, non seulement la déportation des esclaves mais aussi — je me l’imaginais souvent — ce qu’ont pu être les sentiments, les perceptions d’un esclave arrivant sur l’île de la Réunion. Être en situation de déportation, et l’être dans un endroit absolument indécodable : j’essayais d’imaginer comment ce « choc » avait été surmonté, et quels sentiments contradictoires il avait pu générer… La mestiza est ambiguë, elle ne se fige pas. J’ai trouvé importante l’idée d’enchevêtrement, que je préfère à celle d’« intersection ». Car, parfois, c’est assez difficile de trouver la racine d’un élément tant les choses sont enchevêtrées : c’est un mot qui conserve une certaine plasticité. « Intersection » semble supposer que des catégories existent déjà, et que l’on peut savoir ce qu’il adviendra de telle ou telle chose.

[Maya Mihindou | Ballast]
« Nous revendiquons le droit d’être inachevés et contradictoires », écrivez-vous dans l’ouvrage collectif Politique des Temps. Ça rejoint cette idée d’enchevêtrement…
Ce qui me parle chez Anzaldúa, c’est son éthique de la flexibilité : elle autorise une certaine compassion — dans le bon sens du terme. Pas de la pitié, mais une bienveillance non paternaliste. Oui, il faut s’autoriser, au-delà des choix que l’on peut faire, à de l’inachèvement. Il faut se savoir « en devenir » et accepter que l’idée que l’on a d’une chose peut être révisée. Car il y a toujours de nouvelles connaissances, et nos connaissances se transforment.
Quels termes mobilisez-vous pour appréhender votre vécu « métis » ?
Je n’utilise pas vraiment ce mot car il a pris un sens figé : je m’en suis retirée. Tout comme « Je suis une femme ». Je préfère partir d’exemples concrets et me demander pourquoi, à tel moment, je me sens plutôt ceci ou cela. Ça ne peut se réduire à la description figée d’un passeport. Je n’y arrive pas. Je ne sais pas faire… J’ai énormément de mal à m’arrêter aux origines. Pourtant, le sol réunionnais court en moi : des couleurs, des souvenirs, les mémoires des luttes qui m’ont forgée. Mais je n’arrive pas à en faire une identité fixe. De la même manière que, pour Anzaldúa, être Chicana ne suffit pas. Ce n’est pas une identité excluante. J’ai remarqué, quand je voyage, que j’ai souvent la tête de quelqu’un du coin. De quelqu’un qui connaît cette ville ! (rires) Je me sens tout le temps en relation avec les gens, sans pour autant comprendre leur langue. L’étrangeté que je ressens n’est pas source d’anxiété.
« Ce travail sur des positions troubles, hybrides politiquement, dans la lignée des féministes chicanas, latinas, queer n’a pas été fait du côté français. »
Anzaldúa politise fortement ce terme de « mestiza », chose que la langue espagnole rend possible. En français, c’est plus compliqué : historiquement, le métissage est bien souvent issu de viols. Anzaldúa s’inscrit dans le sillon de la critique de la conquête espagnole, au cœur d’une réappropriation politique et culturelle anticoloniale, anti-impérialiste et antifasciste. Dans mon travail de thèse, j’ai étudié la gestion coloniale française du métissage sous l’esclavage et le colonialisme. On peut observer plusieurs moments et attitudes : l’horreur et le rejet devant le métis et la métisse sont suivis de lois pour empêcher tout métissage (les décrets interdisant les relations sexuelles interraciales sont nombreux) ; la peur du passing (que des métis·ses se fassent passer pour blanc·hes et « polluent la race blanche ») ; les métis·ses bénéficiant de leur appartenance à la « race blanche » et provoquant la colère et l’amertume des racisé·es ; l’instrumentalisation du métissage par un colonialisme républicain, le racisme puis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, l’appropriation du métissage par la mode, le tourisme, le marché… En langue française le mot a été accaparé tout de suite par l’idéologie universaliste : je reste donc sur la réserve.
C’est une identité qui est peu connue dans sa dimension historique, en France.
La littérature coloniale française met en scène une crainte des métis·ses : capables de trahir car capables de « passer »2, habité·es par la colère, le ressentiment. Dans un retournement du racisme colonial, le métis ou la métisse serait une menace. La littérature de propagande présentait deux destins pour le métis colonial : devenir soldat et servir le pouvoir en place, ou être parricide et devenir révolutionnaire. Pour la métisse : se prostituer, entrer dans les ordres religieux, ou tenter de « passer ». Dans le cas du passing, des romans mettaient en scène des situations tragiques, l’enfant qui « sort » avec la couleur indigène par exemple. Cette littérature coloniale, qui a connu un grand succès, a contribué à renforcer l’idéologie raciale de la pureté de sang. Le métissage conduit alors au meurtre du père, toujours blanc, assassiné par le fils métis, le « sang » de la mère indigène étant plus fort. Pour autant, en France, ces sujets ont été peu fouillés et théorisés, alors qu’aux États-Unis il y a eu une théorisation antiraciste et décoloniale sur le passing et sur le mestizaje, contestant le récit colonial espagnol ou nord-américain. À la Réunion, dans les années 1950, le discours sur le métissage s’oppose au discours de la pureté de sang : il n’y a pas de blanc pur, c’est une invention. Ce que chante le maloyeur3 Danyel Waro dans Batarsité : « Mwin pa blan / Non mwin pa nwar / Tarz pa mwin si mon listwar / Tortiyé kaf yab malbar / Mwin nasyon bann fran batar » [« J’suis pas blanc / J’suis pas noir / Ne me prends pas mon histoire / Croisé africain, créole blanc, malbar / Je suis de la nation des bâtards »]. Mais dans les années 1990, le pouvoir s’approprie le métissage — dès lors, comment continuer à défendre le métissage puisqu’il entre dans la colonialité actuelle, la fameuse « République métisse » ? Comment se réapproprier ce terme aujourd’hui ? Il faudrait le faire à partir d’une position de relecture anzalduenne.
Qui nous conduirait où ?
On pourrait se tourner vers les textes de féministes mexicaines qui ont révisé le récit de la trahison de femmes indigènes pour avoir couché avec le conquérant espagnol. Ce travail sur des positions troubles, hybrides politiquement, dans la lignée des féministes chicanas, latinas, queer n’a pas été fait du côté français. En France, on aime les condamnations, les célébrations et les positions binaires. Mais ce qui est intéressant chez Anzaldúa, c’est qu’elle est radicalement contre la suprématie blanche, radicalement contre le machisme, et complètement chicana — métisse. Elle tient plusieurs fils ensemble et refuse d’en lâcher un, de tenir une seule place.

[Maya Mihindou | Ballast]
Cette idée de l’identité qui se situe « à la frontière », ça résonne en vous ?
La question que je me pose, toujours, est la suivante : est-ce que j’ai assez regardé latéralement ? est-ce que j’accorde assez de place à ce que je n’ai pas vu ? Je dois accepter le fait qu’il y a peut-être un aspect qui ne m’est pas apparu dans l’analyse d’une situation, et que ce manque me sera rappelé ultérieurement. Je l’accepte, sans que ce soit posé comme une accusation, comme une critique négative du type « Vous n’avez pas fait attention à ça »… Une autre personne n’aura peut-être pas vu ce que j’ai pu voir, et l’idée est de savoir comment voir ensemble, comment agrandir la manière dont on appréhende les choses. C’est important, pour éviter les fixations qui entraînent des jugements qui disent : « Vous n’êtes pas de mon côté. » Cela requiert une exigence, une attention, une curiosité constantes. Ce n’est pas une position facile. Être dans la curiosité et tenir compte de ce qui vient, de ce qui n’est pas mon histoire mais qui est quand même mon histoire, de ces positions d’entre-deux, de bordera : on n’est pas dans l’État-nation, sans être pour autant dans le discours occidental de l’hybridité qui en sape toute radicalité. Être sur la frontière c’est la refuser au sens militaire, étatique, tout en reconnaissant l’ancrage que les gens peuvent avoir dans un lieu. Je n’ai rien contre l’ancrage, je ne suis pas dans ce discours occidental de l’injonction au mouvement. Cette position de frontière qu’a décrite Anzaldúa peut se penser de n’importe où.
L’image du pont comme lieu à construire, comme lieu où se retrouver, est souvent utilisée dans les écrits d’Anzaldúa. Cette image ne fait-elle pas écho aux imaginaires de la Relation4 et du Tout-Monde5 nés dans la Caraïbe ?
« Je n’ai rien contre l’ancrage, je ne suis pas dans ce discours occidental de l’injonction au mouvement. »
Le pont pour passer sur l’autre rive de la rivière, pour franchir ce qui peut apparaître comme un obstacle : réfléchir à sa forme, le construire, essayer de ne pas rester sur son coin… Pour moi, des Caribéens ont beaucoup compté et, aux États-Unis, on est davantage connecté à ces réflexions dans la littérature et la pensée car il y a beaucoup de gros travaux de traduction. En France, les Caraïbes sont très peu présentes… Il y a Césaire, certes, Fanon, qui n’est pas du tout vu comme un Antillais, et Glissant, qui n’est pas vraiment présent. Ne parlons même pas de l’absence des femmes autrices et théoriciennes ! Il y a un vrai manque de théorisation de ces sujets. On méconnaît aussi les notions de créole, de créolisation. Toute la question de ce qu’est « l’Outre-mer » a disparu à partir des années 2000 — en dehors, un peu, de la musique. Ça n’intéresse pas grand monde en France. J’avais écrit avec un ami un livre qui s’appelle Amarres — Créolisations indiaocéanique : il cherchait à questionner la manière dont Chamoiseau, Bernabé et Confiant faisaient l’Éloge de la créolité pour signaler que, dans l’Océan indien, on ne pouvait appliquer la même théorie. D’une part à cause des relations millénaires entre le continent africain, le monde persique et le monde asiatique, et donc de l’arrivée tardive des Européens comme pouvoirs impérialistes dans cette région ; d’autre part en raison de l’océan comme espace culturel d’échanges de langues, d’objets, de sons, de goûts, et de la présence plus forte de l’Asie. Pour rappeler, aussi, que ce n’est pas parce qu’on est ancré qu’on ne peut pas circuler… Amarres en créole réunionnais, ça veut autant dire « jeter l’ancre » que « tomber amoureux » ; ça indique à la fois un ancrage et la possibilité de mouvement. Ce livre a été bien moins discuté dans l’espace francophone qu’ailleurs ! Paru chez l’Harmattan, il a été traduit et discuté en anglais mais pas en France. Le monde « postcolonial » est encore très franco-français : il a une manière de voir française, des références françaises, une manière de se positionner très française : c’est-à-dire binaire, avec beaucoup de paroles et peu d’actions !
Gloria Anzaldúa a eu une relation tumultueuse avec l’Université, à une époque où les vécus de femmes de couleur n’étaient pas intégrées aux réflexions féministes. Elle tenait également à faire entrer d’autres méthodes de transmission, qui n’ont pas toujours été bien perçues…
L’Université a toujours été une institution disciplinaire très forte. Et elle l’a été d’autant plus avec les racisé·es. Seules les luttes des étudiant·es l’ont fait changer. Mais elle a toujours été répressive, particulièrement envers les femmes racisées, qui sont au mieux acceptées comme « artistes contemporaines » venant faire une « performance »… L’Université est un lieu rigide : il faut être assis derrière une table, en face à face. Cela enlève toute chaleur, toute relation humaine, pour ne laisser place qu’à des relations de parole hiérarchique. Il n’y a que les sens « écouter » et « regarder » qui sont mobilisés, sans laisser la possibilité de faire entrer quoi que ce soit d’autre dans une salle de classe. Tout y est de plus en plus surveillé, contrôlé, normé. Même la manière d’accepter des safe spaces est normée. Il y a peu de place pour les choses qui viennent bouleverser un peu ce qu’on pense, qui font friction, qui nous mettent dans l’inconfort devant un savoir. Je me souviens, dans des cours sur l’esclavage, qu’il semblait impossible d’évoquer les circuits esclavagistes en Afrique. Pourtant, c’est d’une banalité totale ! On ne parle pas de « complicité », je me fiche de ce terme, mais de toute une organisation qui va se créer, où certains s’engageront dans des milices armées pour faire des razzias quand d’autres se feront interprètes… Une économie spéciale s’installera avec d’un côté des gagnants, qui y verront une manière de valoriser leur statut, leur richesse, et de l’autre des perdants. Dire ça, c’est simplement faire entrer les Africains dans l’humanité : ils y entrent comme n’importe quel être social, par des contradictions. On confond les positions moralistes avec la vie sociale. L’inconfort est nécessaire pour sortir de cette approche moralisante que propose la pensée occidentale. Pour avoir été du côté des écrasés, des vaincus, je sais que les choses ont été plus compliquées que le « bien » ou le « mal ».

[Maya Mihindou | Ballast]
Vous avez mis en place, il y a plus d’un an avec la metteuse en scène guadeloupéenne Gerty Dambury et la femme de théâtre Leila Cukierman, une « université décoloniale ». Elle entend précisément proposer une autre approche de la transmission de l’Histoire, des arts et de la pensée…
On expérimente de plus en plus. Je n’arrive pas à m’arrêter à une seule forme. Il est toujours possible d’améliorer l’expérience à partir de remarques qui, parfois, restent dans un coin de nos têtes et nous reviennent plus tard. Nous avons fait une séance de réflexion sur la possibilité d’un musée décolonial : on ne cessait de se référer au musée de l’immigration et à d’autres, nous étions comme absorbé⋅es par ces structures alors même qu’on essayait d’imaginer notre musée décolonial. Comment penser en dehors, et autrement ? comment nous décoloniser ? comment nous libérer des contraintes et des formes pourtant opprimantes du musée qui ont été naturalisées et sont devenues la norme ? À la séance suivante, nous nous sommes questionné·es sur cette étape — pour moi il n’y a pas un programme fixé qu’il faudrait suivre et qui mènerait à une conclusion satisfaisante, mais une progression, des expérimentations, des reculs et des avancées. C’est ça, une pédagogie de la frontière !
Vous évoquez la question des musées, qui amène celle de la « restitution » d’œuvres acquises pendant la colonisation. Pourquoi préférez-vous parler de « réparation » ?
« À chaque fois, on doit se poser cette question : qu’est-ce qui doit être réparé et pourquoi ? Et ne pas forcément tomber dans la logique occidentale qui passe par le tribunal et la compensation. »
Il y a des rituels de réparation à penser. Il faudrait à la fois pardonner aux ancêtres et se réinscrire dans leur sillon de résistance. Au musée ethnographique de Vancouver au Canada, comme dans tous les musées ethnographiques, la collection a été créée sur le vol, le pillage, le mensonge ; un travail a ensuite été fait avec des communautés, des artistes et des commissaires indigènes, considérés non comme des « native informants6 » mais comme des contributeurs et des auteur·es de plein droit. Il y a encore beaucoup à faire mais certaines formes de restitution, réparation ou réinterprétation sont à méditer. Je donne un exemple : on trouve dans ce musée une série de masques qui avait été vendue par le chef d’un des peuples indigènes de la région. Son peuple avait été en partie décimé par les colons — le pouvoir colonial interdisait les rituels Potlatch, qui étaient au cœur de l’organisation sociale, culturelle et cultuelle de son peuple — c’était comme si son monde s’écroulait. Ne pouvant plus utiliser les masques, il les a vendus aux colons pour avoir de quoi nourrir son peuple. Ces masques atterrissent donc dans un musée. Deux générations plus tard, les descendants de ce peuple révisent l’installation pour rappeler le désespoir lié à ces masques, le pillage colonial, et exprimer le sentiment que les rituels liés aux masques n’avaient pas pu protéger son peuple. Ces artistes posent un geste. Ils ne contredisent pas le geste de l’ancêtre en disant « Il a mal fait », mais l’inscrivent dans un récit qui redonne au geste premier sa complexité, et dit clairement la responsabilité que porte le colonialisme.
J’ai trouvé intéressante cette réflexion sur la réparation en dehors du cadre de l’accusation et de la condamnation. Dire que si le chef avait fait ça, c’est qu’il ne pouvait faire autrement, qu’il n’avait pas « trahi » ou privé son peuple mais qu’il avait été forcé par une série d’événements à en arriver là. Ce désespoir qui avait dû être le sien serait réparé par des gestes de réappropriation, de célébration… À chaque fois, on doit se poser cette question : qu’est-ce qui doit être réparé et pourquoi ? Et ne pas forcément tomber dans la logique occidentale qui passe par le tribunal et la compensation. Les descendants de ce peuple ont accepté la perte de ces masques. Mais d’autres gestes de réappropriation, de réparation sont présents dans ce musée : des objets ne sont pas visibles, ils sont cachés même si le cartel d’explication demeure jusqu’à ce que le peuple auquel ils appartiennent prenne une décision. Certains peuples exigent le retour de leurs objets, d’autres refusent de dialoguer avec le musée, lieu de vol et de pillage ; d’autres encore considèrent les objets volés comme contaminés à jamais et impossibles à reprendre ; d’autres ont obtenu de faire des rituels de réappropriation à l’intérieur même du musée, loin des regards du public. Il y a tout un espace de possibles entre rendre visible, masquer, reprendre, abandonner… Je suis intéressée par le fait d’inventer, d’imaginer des rituels qui seraient, au moment où on les accomplit, ce qu’on a trouvé de plus pertinent. Dans 10 ans, peut-être qu’il en sera autrement : il n’y a pas de fixation à faire sur le rituel. Il est possible que la génération suivante veuille définitivement récupérer les masques. Et pourquoi pas ? La réparation ne se fait pas en une seule fois, en un temps. Dans la répétition des rituels, il y a à chaque fois un petit morceau qui est réparé. Du paisible advient petit à petit, plutôt que l’inconstante confrontation mortifère très occidentale où ne restent, en bout de course, que des vaincus, des vainqueurs, et la réparation qui passe par le tribunal. Bien sûr, il faut parfois le faire ! Il ne faut rien s’interdire.
Illustrations de bannière et de vignette : Maya Mihindou | Ballast
- Centre culturel et social centré sur les cultures latin@ et chican@ (l’utilisation de l’arobase indique une double utilisation du féminin et du masculin en un même mot) [ndlr].[↩]
- Le terme anglais « passing », que nous pourrions traduire par « passer pour », désigne les personnes perçues comme en accord avec la norme de genre ou de race socialement majoritaire.[↩]
- Le maloya est un genre musical majeur de l’île de la Réunion, héritage des esclaves africains et malgaches déportés sur l’île ; il fut sanctionné par l’administration coloniale [ndlr].[↩]
- « La pensée du rhizome serait au principe de ce que j’appelle une poétique de la Relation, selon laquelle toute identité s’étend dans un rapport à l’autre », Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Gallimard, 1990.[↩]
- « La totalité-monde dans sa diversité physique et dans les représentations qu’elle nous inspire : que nous ne saurions plus chanter, dire ni travailler à souffrance à partir de notre seul lieu, sans plonger à l’imaginaire de cette totalité. Les poètes l’ont de tout temps pressenti. Mais ils furent maudits, ceux d’Occident, de n’avoir pas en leur temps consenti à l’exclusive du lieu, quand c’était la seule forme requise. Maudits aussi, parce qu’ils sentaient bien que leur rêve du monde accompagnait la Conquête », Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde, Gallimard, 1995.[↩]
- Terme péjoratif qui renvoie au « bon indigène », au « nègre de maison » [ndlr].[↩]
REBONDS
☰ Lire notre notre article « Audre Lorde : le savoir des opprimées », Hourya Bentouhami, mai 2019
☰ Lire notre entretien avec Françoise Vergès : « La lutte décoloniale élargit les analyses », avril 2019
☰ Lire notre entretien avec Patrick Chamoiseau : « Il n’y a plus d’ailleurs », février 2019
☰ Litre notre abécédaire de Frantz Fanon, janvier 2019
☰ Lire notre traduction « Anarchisme et révolution noire — par Lorenzo Kom’boa Ervin », décembre 2017
☰ Lire notre entretien avec Eryn Wise : « Nous vivons un moment historique », décembre 2016