« Fin du monde, fin du mois, même combat », entend-on régulièrement. Mais, au-delà du slogan, l’alliance entre les questions écologiques et sociales a parfois du mal à être mise en pratique. Il en est de même sur le plan idéologique et intellectuel : des fractures existent. Tandis qu’un certain marxisme productiviste pèse encore parfois à gauche, on constate l’émergence et le succès médiatique des « penseurs et des penseuses du vivant », passant souvent sous silence la place des rapports de production au sein des luttes environnementales. Quelque part entre les deux courants, la voie qu’esquisse le philosophe Paul Guillibert retient l’attention : celle d’un « communisme du vivant ». Dans son dernier ouvrage, Exploiter les vivants — Une écologie politique du travail, paru aux éditions Amsterdam, il pose les jalons d’une pensée saisissant ensemble l’exploitation du travail humain et des autres êtres qui habitent la Terre. Nous en publions un extrait, dans lequel le récit de luttes passées et contemporaines révèle l’existence d’une « écologie de la classe ouvrière ».

L’écologie de la classe ouvrière
À l’usine sidérurgique de Tarente en Italie ou à la raffinerie de Grandpuits en France, des ouvrier·es, des militant·es et des habitant·es ont récemment défendu des projets de reconversion écologique de leur lieu de travail. Par leur combat, ils ont rappelé que les travailleur·ses ne défendaient pas seulement l’emploi comme condition d’une vie décente mais aussi des pratiques de travail plus respectueuses de leurs corps et des milieux dans lesquels ils vivent. À cet égard, les mobilisations environnementales dans la ville de Tarente éclairent les caractères fondamentaux d’une écologie des travailleur·ses.
« À l’usine sidérurgique de Tarente en Italie ou à la raffinerie de Grandpuits en France, des ouvrier·es, des militant·es et des habitant·es ont récemment défendu des projets de reconversion écologique de leur lieu de travail. »
Tarente est une ville de 200 000 habitant·es possédant une gigantesque usine sidérurgique s’étendant sur 1 500 hectares et employant plus de 10 000 salarié·es. Cette activité industrielle, source de nombreuses pollutions (dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, benzène), affecte la santé des travailleur·ses et des communautés habitantes. Comme le remarquent Barca et Leonardi, « Tarente représente un type spécifique d’écologie ouvrière
2 ». Suivant une distinction courante en anglais, ils distinguent « l’écologie ouvrière » de « l’environnementalisme de la classe ouvrière ». La première renvoie au type d’interaction entre les corps des travailleur·ses et les milieux au sein desquels ils évoluent. Les circulations de substances polluantes entre les lieux de production et les organismes des communautés ouvrières au sens large constituent la trame des relations entre les humains et leur environnement dans des contextes de travail. Ces échanges témoignent de la porosité du corps humain et de son inscription dans un environnement productif global. Le terme « écologie ouvrière » n’a donc pas un sens politique mais un sens descriptif, consistant à penser les interactions entre des organismes vivants et des environnements sociaux et naturels. L’écologie ouvrière se déploie dans un écosystème industrialisé. Les travailleur·ses productif·ves et reproductif·ves sont au cœur du métabolisme social, c’est-à-dire des relations de matières et d’énergie entre les sociétés et les milieux naturels. L’« environnementalisme de la classe ouvrière » désigne quant à lui l’agenda politique des communautés de travail qui luttent pour vivre dans des environnements moins pollués, plus adéquats à la santé des vivants qui les peuplent.
En réponse à la logique capitaliste de développement industriel impulsée par le gouvernement, la ville de Tarente s’est spécialisée à partir des années 1960 dans la production sidérurgique, ce qui a accentué la division géographique du travail entre le nord et le sud de l’Italie. S’est ajoutée à cela une division sexuelle du travail, où les ouvriers, principalement des hommes, devaient fournir les moyens financiers de la reproduction sociale de la famille dont les tâches domestiques étaient principalement effectuées par des femmes. Le coût social et écologique d’une production industrielle très polluante devait être compensé par les emplois fournis, donc par le salaire qu’ils offraient. La classe ouvrière faisait face à une situation que les chercheur·ses en environmental labour studies ont depuis longtemps étudié comme un « chantage à l’emploi3 ». Lutter contre les pollutions ou pour la santé au travail fait peser un risque sur la capacité de l’entreprise à fournir des emplois et donc à assurer la reproduction sociale de la communauté. Les travailleur·ses sont alors pris·es dans une contradiction entre leurs conditions de travail dégradées — d’un point de vue sanitaire et écologique — et la rémunération qui leur assure leur subsistance.
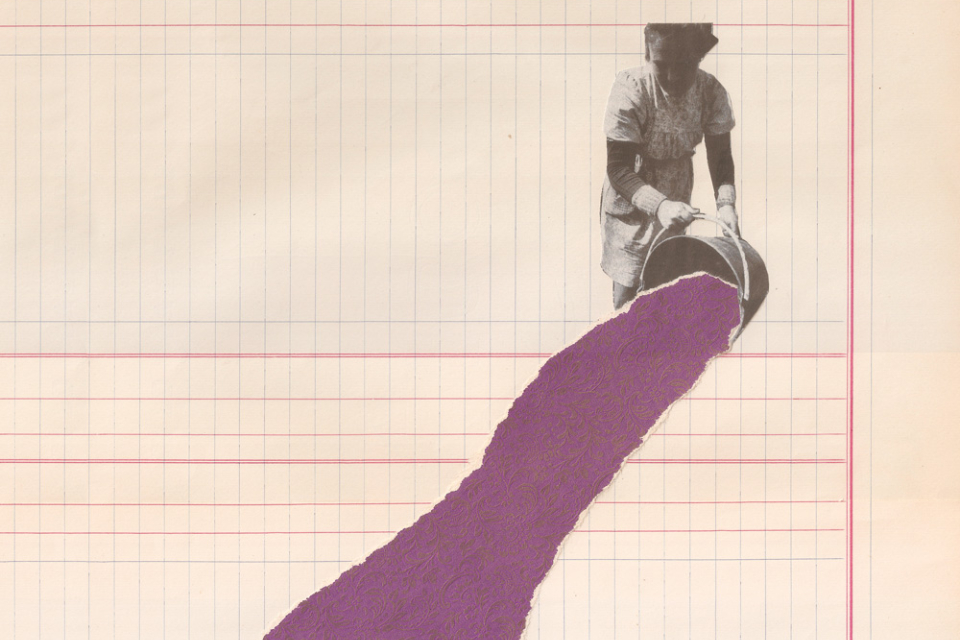
[Graça et Carlos Quitério | fitacola.com]
Pourtant, depuis les années 2000, la ville de Tarente a été traversée par une importante mobilisation d’ouvriers organisés dans des syndicats, de collectifs de femmes pour la santé environnementale et d’organisations écologistes locales contre les pollutions industrielles. Cette lutte, notamment menée par le collectif Donne per Taranto (Les femmes pour Tarente) et des syndicats de base, a abouti à la condamnation de l’entreprise ILVA en 2012, le tribunal déclarant que la direction de l’entreprise s’était rendue « coupable de catastrophe environnementale et de santé publique et ordonnant la fermeture de la plupart des fours de l’aciérie4 ». La décision n’a pas été intégralement appliquée mais elle a modifié les rapports de force au sein de la ville. Tandis que les confédérations syndicales sont largement restées sur la ligne d’une défense de l’emploi en développant des activités plus vertes, un syndicalisme de base et un syndicalisme communautaire ont émergé qui ont fait alliance avec les communautés habitantes et défendu une revalorisation du travail reproductif nécessaire à un métabolisme social non aliéné. Cette lutte est donc caractéristique de l’environnementalisme des travailleur·ses : elle lie les combats pour de meilleures conditions de travail à des revendications de justice environnementale. L’alliance des travailleur·ses et des communautés habitantes compose une lutte contre les pollutions et les inégalités d’exposition. Enfin, elle accorde une place essentielle au travail reproductif des femmes qui assurent la subsistance de la communauté ouvrière.
Le syndicalisme social ou communautaire incarné à Tarente par le Comité de citoyen·nes et de travailleur·ses libres et réfléchi·es (Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti [CCLLP]) touche une population plus large que les confédérations traditionnelles. D’une part, il intègre les précaires, les étudiant·es, les intérimaires, des citoyen·nes engagé·es et les communautés qui dépendent du travail rémunéré à l’usine. D’autre part, il établit des ponts entre les luttes ouvrières centrées sur les lieux de production et les combats pour de meilleures conditions de vie touchant à la reproduction. « En bref, le Comité semble performer une identité de classe étendue au sein des interrelations communautaires et écologiques5. » Le syndicalisme de base, incarné quant à lui par l’Unione Sindacale di Base (USB), soutient que le rôle du syndicat est la défense des droits des travailleur·ses dans une perspective de transition écologique mais que ses tâches sont distinctes de celles d’un activisme politique à l’extérieur de l’usine. Sans y être opposé, l’USB considère que l’organisation avec les communautés n’est pas une nécessité pour la constitution d’un front des travailleurs uni au sein de l’entreprise. Selon Barca et Leonardi, le syndicalisme de base et le syndicalisme social se retrouvent néanmoins dans la critique radicale du chantage à l’emploi mobilisé par le patronat.
« Jusqu’ici, les mouvements environnementalistes ont rarement pris en compte les conditions de travail, pourtant au cœur du métabolisme social et des destructions environnementales. »
Le cas de Tarente n’est pas isolé même si son ampleur et ses victoires sont plutôt rares à l’échelle mondiale. Des situations similaires ont commencé à se mettre en place à la raffinerie de Grandpuits ou dans le bassin industriel de Fos-sur-Mer, où s’est monté un Comité de surveillance de l’activité industrielle du golfe de Fos et son impact environnemental (CSAIGFIE). Ce comité « pour des industries pérennes et écoresponsables » regroupe des syndicalistes des usines de Fos et des habitant·es des communautés urbaines. D’autres initiatives témoignent d’un rapprochement entre écologistes et travailleur·ses comme le Réseau écosyndicaliste en France, Campaign against Climate Change Trade Union Group au Royaume-Uni ou One Million Climate Jobs Campaign en Afrique du Sud. De Tarente à Brisbane, ces initiatives illustrent le besoin de refonder des mouvements de travailleur·ses sur des bases écologistes renouvelées. Jusqu’ici, les mouvements environnementalistes ont rarement pris en compte les conditions de travail, pourtant au cœur du métabolisme social et des destructions environnementales. Cela tient sans doute aux contradictions socio-écologiques inhérentes aux mondes du travail dans le capitalisme.
La subsistance par le salaire
En effet, dans leur lutte pour l’environnement, les travailleur·ses ont combattu des conditions de travail jugées indécentes pour les corps et les milieux. Les pollutions industrielles touchent souvent celles et ceux qui participent aux procédés qui les émettent avant d’atteindre les environnements. À cet égard, les revendications pour une meilleure santé au travail possèdent, depuis longtemps, une dimension écologique forte. Dans les forêts du nord-ouest des États-Unis, les syndicats de bûcherons et de forestiers commencèrent à réclamer des politiques environnementales et sociales dès le début du XXe siècle6. À partir de 1907, les forestiers se syndiquèrent au sein de l’Industrial Workers of the World et menèrent une série de grèves pour l’amélioration des conditions de travail et de la gestion des forêts. Dans les camps de bûcherons, la vie était réduite à l’exécution d’un travail intense dans des situations sanitaires déplorables : une nourriture infecte et la moins chère possible, de nombreux accidents de travail, des maladies liées à la présence de vermine et aux activités effectuées sans protection contre le bruit ou le froid. Visités par les responsables fédéraux de l’hygiène, les camps étaient jugés insalubres. La constitution du syndicat International Woodworkers of America, en 1935, marqua un tournant dans les luttes des forestiers pour l’environnement. Dès son origine, l’organisation inscrivit la planification des ressources naturelles à son agenda politique. En 1938, Don Hamerquist, un bûcheron syndiqué, écrivait dans le journal du syndicat, The Timber Workers, que « les travailleurs doivent se battre durement pour la conservation et la reforestation avant que l’État ne ressemble au désert de Gobi ». Il concluait que les capitalistes du bois devraient être poursuivis pour « conspiration contre la postérité7 ».

[Graça et Carlos Quitério | fitacola.com]
Le syndicat combattait ainsi l’exploitation conjointe de la nature et des travailleur·ses : la lutte pour une conservation réelle des forêts, pour des récoltes durables, des reforestations, la prévention des feux et la gestion des ressources en eau se combinait chez lui avec une défense du syndicalisme, une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. L’une de ses principales préoccupations environnementales était les coupes à blanc, une pratique d’exploitation forestière extrême qui consiste à exploiter des forêts naturelles résistantes et à les remplacer par des plantations d’arbres artificielles qui ne reproduisent pas la biodiversité et les écosystèmes d’une forêt saine. Selon cette approche holiste de la relation entre travailleur·ses et environnements, les premier·es devaient se voir comme partie intégrante d’un écosystème général. Il n’est pas anodin que des préoccupations environnementales au sein du monde du travail soient apparues dans des contextes forestiers, en relation étroite avec des écosystèmes complexes. Mais elles témoignent aussi du fait qu’il existe depuis longtemps une compréhension globale des rapports entre des conditions de travail dégradées et des environnements saccagés. Cependant, les luttes des travailleurs des forêts expriment une contradiction entre la croissance de l’emploi et la préservation de la biosphère, contradiction structurante pour une écologie du prolétariat.
Les travailleur·ses et les personnes qui dépendent de leur revenu font face à un dilemme : défendre la réduction de la production ou bien défendre leur salaire. Idéologie du capital, cette alternative entre protection de la planète et préservation des conditions salariales ne relève pourtant pas d’une simple stratégie de diversion. Elle vise à constituer un bloc hégémonique transclasse où les travailleur·ses et les capitalistes font face à un mouvement écologiste décroissant qui s’opposerait à leur intérêt commun, la poursuite illimitée de la production. Idéologique, elle l’est encore puisqu’elle nie la possibilité d’une diminution de la production sans réduction du salaire ou du nombre d’emplois. Or, on peut très bien réduire le temps de travail et donc le volume de la production (toutes choses restant égales par ailleurs) sans toucher aux salaires ou aux emplois. Ce sont les profits qui en seraient réduits, non les revenus du travail. Pourtant, ce chantage à l’emploi dévoile également la position structurellement contradictoire des travailleur·ses dans les luttes écologistes.
« Une politique de transition doit nécessairement s’attaquer aux deux faces du Janus que constitue le productivisme capitaliste. La production ne doit donc pas seulement être décarbonée mais elle doit décroître. »
L’exploitation du travail et l’écocide sont tous les deux liés à la logique capitaliste d’accumulation de valeur, qui cherche à augmenter les profits par l’accroissement de la production de marchandises. À cet égard, une politique de transition doit nécessairement s’attaquer aux deux faces du Janus que constitue le productivisme capitaliste. La production ne doit donc pas seulement être décarbonée mais elle doit décroître. Aucune transition écologique n’est possible sans décroissance. Prélever moins de ressources, émettre moins de pollution et de déchets n’est pas compatible avec une augmentation de la production. Contrairement à ce que pose le programme officiel de « transition juste » portée par des syndicats et des organisations internationales, il ne suffit pas de créer des « emplois verts », c’est-à-dire des emplois dans des secteurs d’activité moins émetteurs de CO2 pour amorcer une bifurcation écologique. Construire des voitures électriques avec des batteries au lithium suppose toujours d’exploiter le travail salarié et de saccager des environnements naturels pour prélever des ressources.
L’idée de « transition juste » s’est répandue au cours des années 2010 dans toutes les grandes organisations internationales, de l’ONU à la Commission européenne, en passant par l’Organisation internationale du travail et l’International Trade Union Confederation, la Confédération syndicale internationale. Ce mot d’ordre a permis de lancer quelques campagnes intéressantes à l’échelle mondiale comme One Million Climate Jobs Campaign, en Afrique du Sud et au Portugal, ou Pas d’emploi sur une planète morte, en France et aux États-Unis. Dans l’ensemble, les projets de transition juste portés par les organisations internationales visent à rassurer sur le fait que la transformation écologique de la société ne sera pas payée par les plus pauvres — comme dans le cas de la taxe carbone en France, qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes — mais sera accompagnée d’une certaine forme de redistribution de la richesse sociale. Dans la majeure partie des cas, il s’agit donc d’une promesse assez floue de justice sociale destinée à faire accepter à une partie des travailleur·ses une transition écologique engagée « par le haut », afin de maintenir la structure générale de l’accumulation capitaliste. Lorsqu’elle n’est pas indexée à un agenda de justice environnementale ou de démocratie radicale, la transition juste est le nom d’un compromis écologique de classe. Pourtant, l’idée est née chez des syndicalistes américains qui n’avaient pas une vision aussi lénifiante de la transition.
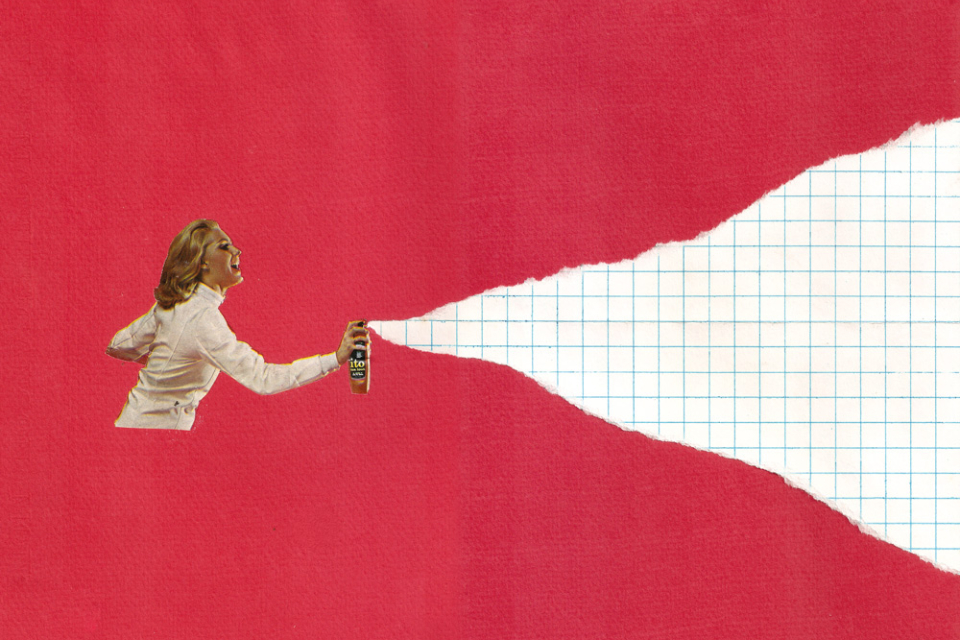
[Graça et Carlos Quitério | fitacola.com]
L’expression apparaît pour la première fois en 1995 lorsque deux syndicalistes américains, Les Leopold et Brian Kohler, demandent la constitution d’un fonds économique pour les travailleur·ses des secteurs qui doivent être démantelés pour assurer la transition :
Nous proposons qu’un fonds spécial soit établi ; un fonds spécial pour la transition juste que nous avons appelé dans le passé un superfonds pour les travailleurs. Pour l’essentiel, ce fonds fournira les prestations suivantes : un salaire complet et des avantages sociaux jusqu’à ce que le travailleur prenne sa retraite ou qu’il trouve un emploi comparable ; deuxièmement, des allocations pour frais de scolarité pendant quatre ans au maximum pour fréquenter des écoles professionnelles ou des établissements d’enseignement supérieur, ainsi qu’un revenu complet pendant les études ; troisièmement, des allocations ou des subventions post-éducation si aucun emploi à un salaire comparable n’est disponible après l’obtention du diplôme ; et quatrièmement, une aide à la réinstallation8.
Suivant le travail de politisation écologiste mené par Tony Mazzocchi, du syndicat Oil, Chemical and Atomic Workers Union (OCAW), Kohler et Leopold imaginent donc les conditions d’une transition juste pour les travailleur·ses de secteurs économiques qui devront être fermés ou démantelés. Ils envisagent la création d’un fonds fédéral pour leur assurer des conditions de vie au moins équivalentes à celles qu’ils avaient lorsqu’ils occupaient leur emploi. Ce fonds monétaire devrait aussi leur permettre d’acquérir de nouveaux savoir-faire. L’idée est d’autant plus remarquable que Kohler et Leopold l’ont simplement « transposée » de la protection de l’environnement à la protection du travail. En effet, au début des années 1990, le gouvernement fédéral américain a constitué un fonds pour la dépollution environnementale des sites industriels. S’il est nécessaire de financer la dépollution des écosystèmes industriels, il l’est tout autant d’assurer aux travailleur·ses des moyens de vivre. Cette analogie entre dépollution environnementale et transition écologique s’enracine dans les luttes des années 1970.
En 1973, Mazzocchi avait participé à l’organisation des premières grèves pour l’environnement et la santé au travail dans les raffineries Shell. L’un des slogans du mouvement, « Our lives are at stake. Workers fight for health and safety » (« Nos vies sont en jeu. Les travailleurs luttent pour la santé et la sécurité »), indiquait la tentative d’articuler santé et sécurité au travail, conditions salariales et durée de travail, préservation de l’environnement par la reconversion des filières toxiques. Cette proposition initiale, ensuite développée par Kohler et Leopold, montre à quel point la question de l’emploi est une question centrale de la transition écologique, du point de vue des travailleur·ses eux-mêmes. Dans un contexte de décroissance économique, qui est le seul compatible avec une véritable transition, on voit mal comment résoudre ce dilemme entre l’emploi salarié comme condition de subsistance (fondé sur la croissance économique) et la préservation des conditions d’habitabilité de la planète. Une écologie de classe impose au contraire une décroissance de la production globale et une augmentation des tâches liées à la reproduction écosociale des mondes vivants.
Illustration de vignette et de bannière : Graça et Carlos Quitério | fitacola.com
- Stefania Barca et Emanuele Leonardi, « Écologie ouvrière et politique syndicale », Les Mondes du travail, n° 29, 2023, p. 167.[↩]
- Ibid., p. 173.[↩]
- Nora Räthzel et David Uzzell, « Trade Unions and Climate Change : The Jobs versus Environment Dilemma », Global Environmental Change, vol. 21, n° 4, 2011, p. 1215–1223.[↩]
- Stefania Barca et Emanuele Leonardi, « Écologie ouvrière et politique syndicale », art. cité, p. 176.[↩]
- Ibid., p. 181.[↩]
- L’exemple des syndicats de bûcherons américains vient d’Erik Loomis, « Working-Class Environmentalism : The Case of Northwest Timber Workers », in N. Räthzel, D. Stevis, D. Uzzell (dir.), The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies, New York, Palgrave Macmillan, 2021, p. 127–148.[↩]
- Ibid., p. 133.[↩]
- Les Leopold, « Address to the Great Lakes International Joint Commission, 1995 », The Labor Institute, en ligne.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Mickaël Correia : « Imaginer une forme d’autodéfense climatique », septembre 2023
☰ Lire notre entretien avec Cara New Dagett : « Pour une lecture féministe du déni climatique », juillet 2023
☰ Lire notre entretien avec Nastassja Martin : « Où commence le vivant et où s’arrête-t-il ? », janvier 2023
☰ Lire notre entretien avec Paul Guillibert : « Vers un communisme du vivant ? », mars 2022
☰ Lire notre entretien avec Renaud Bécot « Au croisement des luttes environnementales et sociales », février 2022
☰ Lire notre entretien avec Andreas Malm : « L’urgence climatique rend caduc le réformisme », juin 2021


