Entretien inédit pour le site de Ballast
L’écologie et le monde ouvrier sont encore souvent vus comme irréconciliables. C’est que le productivisme a historiquement imprégné l’imaginaire et les pratiques de toute une tradition transformatrice. Pourtant, l‘histoire sociale et environnementale montre que des organisations syndicales ont pu s’emparer de certaines préoccupations environnementales : les catastrophes industrielles et les différentes pollutions causées par les usines — en particulier de la chimie et de la pétrochimie — ont ainsi suscité des questionnements, voire des remises en cause de « l’ordre usinier ». Ces questions étaient alors articulées à celle de la santé au travail. Et même plus : « Derrière son apparente évidence, la séparation entre l’intérieur et l’extérieur des espaces et des temps du travail est une construction historique répondant à des intérêts précis », avance l’historien Renaud Bécot. C’est notamment ce que montrent ses travaux, situés au croisement de l’histoire environnementale et de l’histoire sociale. Pour en parler, nous l’avons rencontré à Grenoble.

Ce type de catastrophe, avec des émanations de fumées pétrolières ou pétrochimiques, a un impact sur la santé des riverains et des salariés qui est toujours différé dans le temps. À Lubrizol, les services préfectoraux ont dit qu’il n’y avait pas de toxicité aiguë ni de risque immédiat. Mais on ne peut pas savoir ce qu’il en sera dans dix ou vingt ans : c’est en ce sens qu’interviennent différents enjeux de temporalités. La catastrophe de Lubrizol n’a pas encore eu lieu parce que les conséquences sanitaires ne pourront être évaluées que dans plusieurs décennies. D’ailleurs, le terme même de « catastrophe » est un obstacle à la compréhension de ce qu’il se passe.
En quel sens ?
« Une fois l’incendie éteint ou l’explosion passée, la catastrophe serait terminée, comme si ce qui se passait après n’en faisait pas partie. »
En employant ce mot, on a toujours une focalisation sur un moment, celui de l’accident, avec des images spectaculaires très largement diffusées dans les médias nationaux : à Feyzin dans les années 19601 c’était l’explosion de la raffinerie, à AZF2 l’explosion et le cratère creusé sur le site, à Lubrizol le panache de fumée au dessus de Rouen. Une fois l’incendie éteint ou l’explosion passée, la catastrophe serait terminée, comme si ce qui se passait après n’en faisait pas partie. En sciences sociales, on cherche donc d’autres termes. Celui de « désastre », par exemple, qui insiste moins sur un moment donné. Il y a aussi des nuisances industrielles qui ne sont pas visibles de manière aussi spectaculaire mais qui polluent des sols, des territoires : le mot « désastre » rend compte de ces pollutions chroniques.
Sans être une catastrophe de nature industrielle, ça a été aussi le cas avec l’incendie de Notre-Dame de Paris : des images très fortes et largement diffusées. Mais, à présent, les questions de contamination au plomb sont peu visibles dans l’espace médiatique.
C’est peu visible, mais c’est une mobilisation importante pour les personnes qui la portent. À mon sens, il y a deux enjeux qui doivent être soulignés à propos de Notre-Dame. Premièrement, sont rejouées des controverses sur l’impact sanitaire du plomb, récurrentes depuis plus d’un siècle. L’historienne Judith Rainhorn3 a travaillé sur l’utilisation de la céruse, un composé à base de plomb employé notamment dans les peintures en bâtiment. Elle montre que pendant tout le XIXe siècle, il y a eu plusieurs phases de mise en visibilité des risques liés à la production et à l’utilisation de la céruse. Et, très souvent, ces moments étaient refermés par des contre-offensives de la part des industriels, qui avaient d’ailleurs des relais dans l’espace politique. Il fallait de nouveau prouver que le plomb était un pathogène, malgré les travaux qui avaient déjà apportés ces preuves et qui étaient alors oubliés. La même controverse se répétait ainsi à quelques décennies d’intervalles… Notre-Dame en est un prolongement, parce qu’il est difficile de faire admettre aux autorités publiques que le plomb diffusé autour de la cathédrale pourrait entraîner des conséquences sur la santé des riverains ou des salariés qui travaillent sur la reconstruction. Deuxièmement, on voit une coalition de différents groupes militants qui cherchent à rendre visible le fait qu’il y a eu des dispersions de plomb et les potentiels effets sanitaires que cela a pu entraîner. Il y a à la fois l’Association française des victimes du saturnisme — dans une démarche de santé publique hors des lieux de travail —, et des organisations qui travaillent sur les enjeux de santé au travail, comme l’association Henri Pézerat ou la CGT. Cet ensemble de forces est marquant parce que ce n’est pas une jonction toujours simple à faire !

[Ralston Crawford]
Nous aurons l’occasion d’y revenir. La loi de 1898 sur la réparation des accidents du travail repose sur l’indemnisation des victimes, un principe qui a été étendu aux maladies professionnelles en 1919. Accidents du travail et pathologies professionnelles relèvent alors d’un régime de type assurantiel, avec une compensation financière. Comment s’explique cette mutation ?
Pendant tout le XIXe siècle, il n’y a pas de lois spécifiques sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles ; le droit du travail n’en est encore qu’à ses prémices. Les ouvriers victimes d’un accident au travail peuvent fonder juridiquement leurs plaintes sur les lois applicables à l’ensemble de la population, et se tourner vers les tribunaux civils pour obtenir réparation du préjudice subi4. Les employeurs courent donc le risque de se retrouver devant une cour de justice et d’être sanctionnés financièrement, sans pouvoir anticiper le montant. Pour le résumer sommairement, cela empêche les employeurs de connaître par avance le « poids » d’un accident du travail sur leurs comptes. Si l’ensemble du patronat ne soutient pas cette loi, parce qu’il s’agit d’une intervention dans la sphère des relations professionnelles, une partie y est favorable pour pouvoir anticiper le coût des accidents.
Quelles sont alors les implications de ce nouveau paradigme ?
« Auparavant, quand on parlait d’une pollution industrielle, ça pouvait déborder les murs de l’usine. »
Il y a trois aspects. Le premier : dès qu’un accident survient sur le lieu et le temps de travail, la responsabilité de l’employeur est engagée sans avoir à en faire la preuve, ce qui, dans les faits, est plus compliqué. Deuxième élément, qui est un peu la contrepartie de cette présomption d’imputabilité : le montant de la réparation pour les ouvriers victimes de l’accident est versé par l’employeur. C’est la réparation forfaitaire, établie selon un barème (qui ne compense pas l’ensemble du salaire). Troisième principe, implicite : les ouvriers ne peuvent plus judiciariser les accidents dont ils ont été victimes. À partir de 1898, les procédures judiciaires deviennent quasiment inexistantes, ou sont du moins très difficiles. Ce sera le cas jusque dans les années 1970, où l’on assiste à plusieurs tentatives pour réintroduire ces enjeux devant la justice, mais ce sera globalement un échec au cours de cette décennie (mais cela se soldera globalement par un échec).
Ça constitue donc un pivot important…
Oui, car ces lois de 1898 et 1919 conduisent finalement à enclore le débat sur l’espace et le temps du travail. Auparavant, quand on parlait d’une pollution industrielle, ça pouvait déborder les murs de l’usine et être porté aussi bien par des travailleurs à l’intérieur de l’industrie que par des riverains. Cela ne veut pas dire qu’il existait des liens automatiques entre les motifs de protestation au sein et en-dehors de l’entreprise, mais la ligne de démarcation juridique ne constituait pas un obstacle aussi fort qu’au XXe siècle. Ces lois renforcent une séparation entre l’intérieur et l’extérieur de l’entreprise.

[Ralston Crawford]
On est malgré tout tenté de voir comme une avancée cette sorte de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Mais vous parlez d’une « forme d’acceptation sociale des accidents » : la loi a eu pour effet de les normaliser ?
Cette loi repose sur l’idée que l’accident du travail serait une fatalité : le fonctionnement de l’industrie impliquerait des accidents et la marche du progrès serait de les accepter. Il y a donc une forme de normalisation. Mais l’ambivalence de la loi se reflète effectivement dans les positions des organisations du mouvement ouvrier de l’époque. Elle est plutôt contestée lors de son adoption : des socialistes comme Jules Guesde ainsi que des syndicats s’y opposent car le principe de monétarisation leur pose problème. Mais assez rapidement, une fois la loi en application, les militants syndicaux la voient comme un des rares leviers à leur disposition quand ils veulent faire reconnaître un préjudice subit par un ouvrier. D’ailleurs, à partir de l’entre-deux-guerres, aussi bien à la CGT que dans le syndicalisme chrétien puis à la CFDT après 1964, cette loi est présentée comme une conquête sociale, voire même comme une conquête du mouvement syndical qui aurait de tout temps demandé cette loi. Or, la situation est beaucoup plus nuancée.
Pourquoi ?
« Cette loi de 1898 repose sur l’idée que l’accident du travail serait une fatalité : le fonctionnement de l’industrie impliquerait des accidents et la marche du progrès serait de les accepter. »
D’une part, au cours du XXe siècle, les organisations syndicales se sont appuyées sur le paradigme de la compensation monétaire des risques, qui était au cœur des lois de 1898 et 1919. Ces lois sont apparues comme les principaux leviers, voire les seuls, dont disposaient les syndicalistes pour faire reconnaître une responsabilité patronale lorsque surviennent accidents et maladies. En utilisant ces lois dont l’application initiale était restreinte à certaines pathologies, les syndicalistes ont aussi cherché à faire reconnaître davantage de maladies professionnelles. Ces démarches reposaient sur un consentement tacite au principe de compensation monétaire des risques du travail : ce phénomène se comprend uniquement si l’on considère que ces lois étaient les seuls leviers dont disposaient les syndicalistes pour obtenir une reconnaissance minimale des préjudices de santé subis dans le cadre du travail. D’autre part, si cette logique de monétarisation des risques domine dans le monde syndical au XXe siècle, elle n’écrase pas non plus toutes les organisations ni toutes les expériences syndicales. Une critique très vive s’est développée, avançant l’idée qu’il faudrait sanctuariser la santé ouvrière, c’est-à-dire soustraire les enjeux de santé du périmètre de ce qu’il serait acceptable de négocier dans les relations professionnelles. Dans les années 1970, les syndicats, notamment certains secteurs de la CFDT, puis certains syndicats au sein de la CGT, ont porté cette contestation5.
Vous l’avez mentionné : dans les années 1960-1970, des mouvements syndicaux ont justement cherché à dépasser cette césure entre l’entreprise et le lieu de vie…
Mes propos se fondent essentiellement sur une recherche menée dans les territoires de la pétrochimie. Il y a un point important que l’on n’a pas nécessairement en tête aujourd’hui : une bonne partie des personnes qui travaillent dans les secteurs de la pétrochimie et de la chimie vivent dans un périmètre assez restreint autour de celui de l’entreprise. Elles peuvent donc être touchées par les pollutions dans leur travail comme sur leur lieu de vie. Ça ne veut pas dire que la jonction est évidente, mais il y a des circulations entre l’intérieur et l’extérieur de l’entreprise, et la possibilité de se connecter à des associations de riverains existe bien. Les luttes pour la santé au travail et celles contre la pollution industrielle commencent à se rencontrer à partir du milieu des années 1960 — notamment après l’explosion de la raffinerie de Feyzin. Des syndicalistes réinvestissent les comités d’hygiène et de sécurité (CHS), et se rendent compte que ces CHS ont un certain nombre de pouvoirs qui n’ont pas été utilisées jusque-là. Par exemple, la possibilité de mener des enquêtes dans les entreprises, d’observer ce qu’il se passe dans les ateliers, de solliciter des expertises extérieures pour appuyer des propositions syndicales… Une génération de militants — initialement de la CFDT, très rapidement suivis par des syndiqués CGT —, se spécialise dans le domaine de la santé au travail. Ils réfléchissent à la manière dont les CHS seraient susceptibles d’alerter les riverains sur les pollutions à l’extérieur et aux liens qu’ils pourraient tisser avec des associations, des comités de riverains, des municipalités ouvrières, etc., pour appuyer des revendications syndicales.

[Ralston Crawford]
Cette première jonction s’approfondit au début des années 1970. Dans certaines municipalités au sud de Lyon, des commissions extra-municipales de luttes contre les nuisances se mettent en place. C’est un levier que des syndicalistes utilisent pour exiger des entreprises qu’elles dévoilent certaines informations, ou pour faire pression sur les employeurs. Au sein de la CFDT, des unions locales sont remplacées par des « Unions interprofessionnelles de base » (UIB) : le changement n’affecte pas seulement la terminologie, mais témoigne d’une volonté de transformation des pratiques au sein de ces structures. Des salariés sur le territoire concerné, des habitants, des chômeurs, des femmes au foyer participent et interviennent dans ces UIB. Ce n’est donc pas uniquement une structure qui viserait la coordination d’actions syndicales dans différentes entreprises. Les UIB ont une appréhension spécifique du territoire, ce qui permet de mieux se saisir des questions environnementales et des pollutions. Elles facilitent donc les liens en dehors de l’entreprise, avec des associations, des scientifiques, etc. Par exemple, dans les années 1970, l’UIB d’Oullins Pierre-Bénite a fait intervenir le directeur du Centre international de la recherche sur le cancer.
Vous parlez de contestations de « l’ordre usinier », qui expriment selon vous un « environnementalisme ouvrier » : deux mots que l’on n’a pas l’habitude de voir associés. Qu’entendez-vous par là ?
« Dans l’environnementalisme ouvrier, la réflexion ne se limite pas à l’impact environnemental des activités productives. »
Je ne suis pas le seul à utiliser cette expression : des collègues italiens, canadiens, étasuniens, l’emploient pour décrire ce qui se passe dans le mouvement syndical dans ces pays dans les années 1960 et 1970. Des militants syndicaux s’intéressent à partir de cette époque aux enjeux environnementaux, soit par le prisme des luttes contre les pollutions industrielles, soit par celui d’une protection d’espaces dits naturels pour permettre un accès des classes populaires à ces espaces. L’administration de l’environnement (créée dans les années 1970) mettait en avant la protection de la nature pour elle-même, et avec une approche que ces militants jugeaient « technocratique ». Les syndicalistes, eux, à l’inverse, inscrivent leur réflexion dans les enjeux de classe, notamment ceux liés à la santé des classes populaires — exposition aux pollutions industrielles dans l’espace de travail et en dehors, accès à des ressources ou des territoires dont ils ne peuvent avoir usage.
On retrouve là des liens avec la notion de justice environnementale : les classes populaires vivent dans des lieux avec davantage de nuisances environnementales et de risques industriels.
Cela rejoint en partie les constats des travaux sur la justice environnementale, réalisés aux États-Unis depuis la fin des années 1980. Lorsqu’on parle de ce courant en France, pense à la concentration d’activités industrielles dans un endroit, avec une importante présence de population ouvrière, dans le cas américain, de population latino et/ou noire-américaine. Ces constats rappellent la filiation entre la justice environnementale et le mouvement pour les droits civiques. C’est effectivement un héritage essentiel pour comprendre les mouvements américains pour la justice environnementale. Cependant, il existe une seconde filiation qui est davantage méconnue : ce sont les mobilisations sur les questions environnementales du mouvement syndical étasunien des années 1960-1970. Les syndicats de la chimie et du pétrole se sont en effet mobilisés à plusieurs reprises : il y a eu des grèves importantes pour demander une réglementation environnementale plus contraignante. J’insiste sur ce point car dans l’environnementalisme ouvrier, en France et en Italie en tout cas, la réflexion ne se limite pas à l’impact environnemental des activités productives. Juste après la Seconde Guerre mondiale, la redistribution de richesses comme contrepartie de l’expansion des forces productives était appuyée par les syndicats, et ce sans interroger le contenu du travail. L’environnementalisme ouvrier naît en partie en réaction à cette position, tandis que la finalité de la production redevient cruciale pour les organisations syndicales. Les militants se demandent alors s’il est envisageable de réorienter les activités productives en fonction des besoins identifiés comme essentiels ou superflus.

[Ralston Crawford]
Cette question des besoins trouve-t-elle un écho avec les mouvements écologistes de l’époque ?
Cela dépend de la manière dont on définit les mouvements écologistes. Au tout début des années 1970, il est difficile de savoir quels mouvements se revendiqueraient explicitement de l’écologie. Dans cette période, des personnes portent cette réflexion — certains responsables de la CFDT, notamment — sans s’impliquer dans les mouvements qui se qualifieraient d’écologistes. Au début des années 1970 le projet central de la CFDT est le socialisme autogestionnaire, qui passe par la planification démocratique de l’économie. Fredo Krumnow (numéro 2 du syndicat, en quelque sorte) dit qu’il faut aussi penser aux critères environnementaux de cette planification. Sa réflexion porte sur l’idée que la démocratisation des choix de production, de la définition des finalités du travail, etc., pourrait être un vecteur de transformations qui seraient également vertueuses sur le plan écologique, à condition de susciter une réflexion sur la définition des « besoins » des sociétés. Distinguer ce que sont des besoins « essentiels » de ceux qu’il qualifie de « superflus » constitue un enjeu majeur pour lui. Il ne présuppose pas une définition arrêtée de ce que seraient ces besoins essentiels, il suggère plutôt que ceux-ci ne pourraient être définis qu’au terme d’un processus de délibération démocratique. Et c’est seulement ainsi qu’il serait possible de réorienter des activités productives pour se concentrer sur les besoins considérés dès lors comme essentiels et limiter les productions moins utiles socialement et moins viables écologiquement. Ce type de réflexions peut rencontrer une sympathie lors de mobilisations qui préfigurent, en partie, l’émergence des courants écologistes (les mobilisations autour du Larzac, contre l’implantation d’une usine chimique à Marckolsheim en Alsace, etc.). Néanmoins, c’est difficile de dire qu’il y aurait ici un lien direct avec des écologistes.
« Au début des années 1970 le projet central de la CFDT est le socialisme autogestionnaire, qui passe par la planification démocratique de l’économie. »
En revanche, on peut observer un tournant autour de 1974. D’une part, la structuration des courants écologistes devient plus nette : plusieurs journaux s’en revendiquent, des réseaux se structurent, la campagne de René Dumont à l’élection présidentielle contribue aussi à une mise en visibilité de ces courants, etc. D’autre part, l’année 1974 est celle de l’annonce du plan d’équipement électronucléaire en France et, par conséquent, des réseaux de contestation du programme nucléaire se structurent et prennent une ampleur nationale. Dans la construction de ces mobilisations, la CFDT occupe un rôle particulier, en produisant un ouvrage de contre-expertise dès 1975. Ce livre permet aussi de diffuser la réflexion cédétiste sur les besoins. Ces mobilisations contre l’énergie nucléaire deviennent ainsi un espace de rencontres entre syndicalistes et écologistes, et la réflexion sur la définition des besoins trouve ici un écho auprès de courants écologistes.
Là où la CGT reste davantage dans une vision productiviste, cette réflexion sur les besoins se voit donc portée plus volontiers par la CFDT de l’époque. Mais cette question disparaît progressivement de tout le paysage syndical au fil des années…
La situation est un peu plus ambivalente. Certes, un certain nombre de militants ont pu prendre leurs distances par rapport à la CFDT, notamment après le recentrage. Après celui-ci, la réflexion sur la finalité des activités productives est bien moins présente dans les expressions cédétistes. Mais cela n’est pas lié qu’à des transformations internes aux organisations syndicales… À la fin des années 1970, le rapport de force s’est aussi complètement transformé, le chantage à l’emploi devient plus fort : dans ces conditions, il devient plus difficile pour les syndicalistes de poser ces questions. Les trajectoires biographiques de plusieurs militants CFDT sont d’ailleurs intéressantes. Certains quittent leurs secteurs industriels pour un autre métier, d’autres partent de la CFDT pour aller dans des organisations syndicales où ils estiment que ces questions sont davantage portées. Il y en a qui séparent leur engagement syndical d’un autre engagement à l’extérieur de l’entreprise, où les questions des besoins, de transformation écologique de l’économie vont être affirmées hors d’un cadre de subordination salarial. Il y a une nouvelle démarcation dans l’engagement à la fin des années 1970 et dans les années 1980.
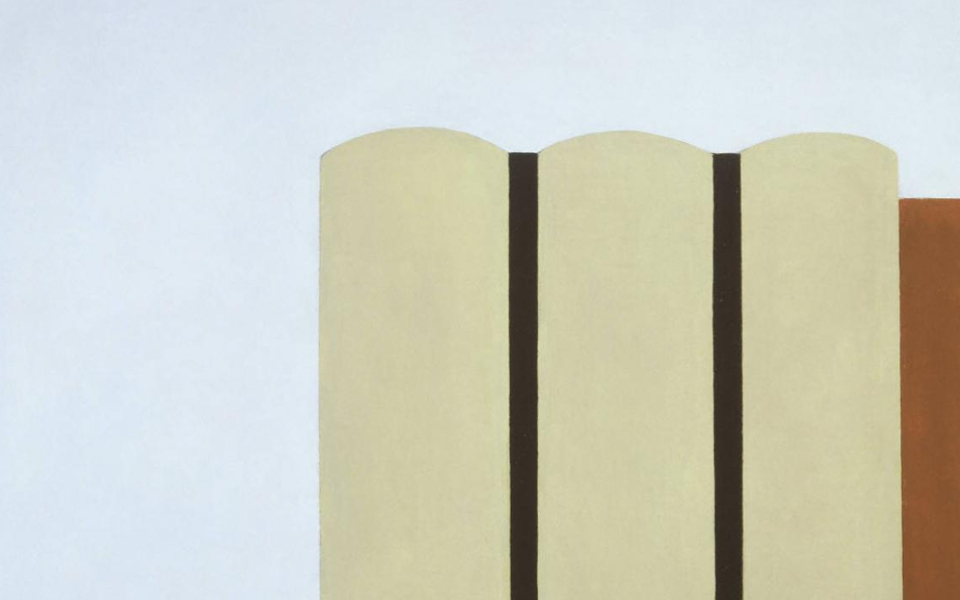
[Ralston Crawford]
Vous parliez précédemment des CHS et d’une forme d’expertise syndicale qui s’était constituée au fil du temps. Ce savoir là a-t-il été transmis ou s’est-il perdu ?
C’est compliqué. Des militants ont cherché à transmettre cette expertise, il y a eu régulièrement des articles dans la presse syndicale, des formations étaient organisées, etc., mais il y a indéniablement une rupture. Une partie de la génération de militants qui s’est formée s’épuise, certains ressentent une forme de désillusion car ils ont le sentiment de ne trouver personne pour prendre la suite parmi les jeunes syndiqués. Autre facteur, qui reste vrai aujourd’hui : les militants investis sur les questions de santé au travail ont l’impression qu’on leur fait confiance sur ce thème, mais qu’on considère leur action comme périphérique par rapport au cœur de l’action syndicale. Cela rend difficile la transmission. Des réseaux très actifs sur la santé au travail continuent quand même leur activité, dans lesquels des militants s’investissent, mais leur action se développe presque en dehors des syndicats. Par exemple, la première publication en 1985 du livre Les Risques du travail, avec des interventions de médecins, toxicologues, syndicalistes, etc., est une manière d’essayer de transmettre leur expertise. Dans les années 1980, des associations de victimes de maladies professionnelles commencent aussi à se constituer. Elles théorisent le fait que même si elles peuvent travailler avec des syndicats, il leur est nécessaire de maintenir une forme d’autonomie, car c’est ce qui leur permet d’être plus critique sur le cadre juridique de la compensation monétaire dont on discutait. Tous ces facteurs contribuent à une rupture d’héritage.
Et du côté de collectifs ou d’associations actuelles, comme le Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle en Seine-Saint-Denis (Giscop93) ou l’association des anciens verriers de Givors, leur action s’inscrit-elle dans une continuité historique des mobilisations syndicales passées ?
« Des réseaux très actifs sur la santé au travail continuent quand même leur activité, mais leur action se développe presque en dehors des syndicats. »
Il faut d’abord distinguer ces deux structures. Les deux s’inscrivent dans des territoires marqués par les conséquences sociales et écologiques de la désindustrialisation, elles prennent donc en charge des problèmes qui peuvent présenter une similarité, mais elles n’ont ni le même statut, ni la même fonction. L’association des anciens verriers rassemble d’abord d’anciens salariés d’une même entreprise pour prolonger les solidarités qui pouvaient exister dans ce collectif de travail, et parfois faire valoir leurs intérêts par une action revendicative. Quant au Giscop93, c’est d’abord un groupe de recherche sur les cancers d’origine professionnelle. C’est-à-dire que les recherches sont menées pour mieux connaître et sensibiliser sur le rôle du travail dans la l’apparition des maladies, pour faciliter ensuite le parcours d’accès aux droits et la reconnaissance pour les ayants-droits, et finalement pour encourager des pratiques de prévention dans les lieux de travail pathogènes. Bref, les anciens verriers sont réunis dans une association qui peut avoir des activités revendicatives, alors que le Giscop93 est une institution qui répond à un intérêt général en cherchant à perfectionner l’action publique en matière de santé et à fluidifier l’accès aux droits pour tous et toutes.
Ensuite, il est difficile d’avoir une réponse homogène, car cela dépend des histoires sociales de chaque territoire industriel. Sur le plan historique, les Unions interprofessionnelles de base dont on parlait ne sont pas des associations, mais vraiment des structures syndicales, puisqu’elles étaient intégrées à la CFDT de l’époque. Aujourd’hui, dans le cas de Givors, même si l’association n’est pas liée à un syndicat en particulier, il y a une continuité très nette entre son action et l’activité syndicale des anciens verriers. Dans les années 1970, on recense plusieurs mobilisations sur la pollution industrielle, la santé au travail, dans ces territoires du sud-lyonnais. À Givors, il y une forte implantation du Parti communiste et de la CGT dans la plupart des entreprises, et en 1971, le maire communiste Camille Vallin créé une association environnementaliste. Des contre-expertises sont menées pour prouver un certain nombre de pollutions industrielles dans le « couloir de la chimie ». Donc les mobilisations sur la santé au travail de ces dernières années sont facilitées par des discours qui ont déjà été entendus il y a plusieurs décennies. Pour d’autres territoires, comme l’étang de Berre et la région de Fos-sur-Mer, il y a aussi eu historiquement des mobilisations sur les pollutions industrielles. Au cours des années 1970, une association de médecins se constitue pour essayer de recenser les maladies liées à ces pollutions ; l’association n’existe plus mais été active pendant des années. Cet arrière-plan participe à nourrir des discours critiques sur la pollution industrielle et son impact sanitaire, et peut fournir des ressources scientifiques, discursives, aux collectifs de salariés ou d’anciens salariés qui se mobilisent aujourd’hui pour construire leur action.
Illustration de bannière : Ralston Crawford
- Raffinerie de pétrole au sud de Lyon qui a connu une explosion en 1966.[↩]
- Explosion de l’usine d’engrais azotés AZF située à Toulouse en 2001, ayant entraîné la mort de 31 personnes.[↩]
- Voir notamment la tribune « Autour de Notre-Dame, un silence de plomb » et l’article « Le plomb, le peintre et la flèche de Notre-Dame. Politiques de l’ignorance à propos du risque saturnin en longue durée ».[↩]
- Dans une recherche importante, l’historien Alain Cottereau avait bien démontré que les tribunaux civils pouvaient être investis par les travailleurs au XIXe siècle, ce qui ne fut plus le cas par la suite. Voir Alain Cottereau, « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 57, n° 6, 2002, p. 1521-1557 [ndla].[↩]
- Les travaux d’histoire de la santé au travail ont beaucoup insisté sur le fait que la contestation du principe de compensation monétaire n’aurait pu se déployer qu’à partir des marges du salariat, dans les luttes des OS et des travailleurs immigrés dans les années 1970, qui n’étaient pas les franges du salariat les plus influentes dans les organisations syndicales. C’est en partie vrai, mais en partie seulement, puisque ces contestations furent aussi portées par des syndicalistes. Surtout, au-delà de la période de forte conflictualité sociale des années 1968, cette contestation du principe de compensation monétaire des risques a continué à vivre dans certains secteurs des mondes du travail. Et la transmission de ces réflexions et pratiques repose bien sur des organisations qui peuvent conserver une mémoire et la transmettre, c’est. C’est le cas des organisations syndicales, puis d’associations de victimes des maladies professionnelles — mais qui sont souvent animées par d’anciens syndicalistes [ndla].[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Matthieu Lépine : « Les accidents du travail ne sont pas des faits divers », juin 2021
☰ Lire notre abécédaire d’André Gorz, mai 2021
☰ Lire notre entretien avec Fatih Mehmet Maçoglu : « Le socialisme, c’est préserver le vivant », septembre 2019
☰ Lire notre entretien avec Pierre Charbonnier : « L’écologie, c’est réinventer l’idée de progrès social », septembre 2018
☰ Lire notre témoignage « À l’usine », juin 2018


