Le danger écofasciste, la langue des serpents, la fabrique des hommes, l’amitié par trois fois, l’enseignement du journalisme, les vies d’un révolutionnaire, les trois dernières décennies de Rancière, un meunier du Frioul, un sabotier de l’Orne et Jérusalem : nos chroniques du mois de juin.
☰ Écofascismes, d’Antoine Dubiau
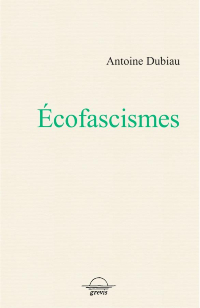
Éditions Grevis, 2022
☰ L’Homme qui savait la langue des serpents, d’Andrus Kivirähk

Quelle identité et quelle place revendiquer à l’échelle internationale lorsqu’on ne pèse guère plus qu’un million d’habitant·es ? quand l’on sort de plusieurs siècles d’occupation, qu’elle fut germanique, lituanienne, suédoise, russe, soviétique ? Que faire de cette Union Européenne à laquelle on adhère depuis moins de vingt années ? d’une culture stable pendant plusieurs millénaires avant la christianisation forcée ? C’est justement à cette époque charnière, au XIIIe siècle, qu’Andrus Kivirähk situe L’Homme qui savait la langue des serpents. D’abord, on ne comprend guère ce qui se trame dans cette Estonie médiévale. Dans les larges forêts du pays, les animaux se soumettent à qui les appelle et un curieux Sage sacrifie à tort et à travers pour satisfaire des génies. Le pain est un met infâme, des hommes de fer chevauchent avec mépris dans les plaines alentours, des moines fondent des monastères dans quelque clairière. Puis, à mesure que les forêts se font plus distinctes, que ses drôles d’habitant·es nous sont mieux connu·es, que leurs voisin·es nouvellement chrétiens se parent de leurs atours les plus beaux — c’est-à-dire ceux de grand·es idiot·es —, se dévoile une satire contemporaine du pays balte. À la suite de Leemet, jeune enfant, on découvre la langue des serpents, un idiome de sifflements qui permet de communiquer avec toutes les bêtes sylvestres. L’apprentissage est laborieux mais, sitôt les premiers mots connus, Leemet découvre un monde : « Je ne me contentais plus de voler dans les bois comme avant, je leur parlais. » Dès lors les paysan·nes paraissent plié·es dans leurs champs, « tout ça pour pouvoir se payer un petit bout de terre où ils pourraient moissonner à la faucille, le cul dressé vers le soleil » ; dès lors ours et serpents semblent à l’enfant dignes de plus de considération que ces humains qu’il méprise et qui, pourtant, ne cessent de l’attirer. Car Leemet n’aura de cesse d’être tiraillé entre une modernité repoussante et un archaïsme dont il devient peu à peu le seul représentant. Tout l’art de L’Homme qui savait la langue des serpents est de louvoyer entre ces univers, péripéties et rocamboles aidant. [R.B.]
Le Tripode, 2015
☰ On ne naît pas mec — Petit traité féministe sur les masculinités, de Daisy Letourneur

Zones, 2022
☰ Une si longue lettre, de Mariama Bâ

La parution récente, pour la première fois en France aux jeunes éditions Les Prouesses, d’Un chant écarlate, le second et dernier roman de Mariama Bâ, est un bon prétexte pour se plonger, en amont ou en aval de cette lecture, dans Une si longue lettre, qui fit connaître l’autrice sénégalaise en 1979. « Amie, amie, amie ! Je t’appelle trois fois », lit-on après quelques pages. Le nombre, souligné, compte. Trois fois une amie est appelée — c’est donc que l’affaire est grave. Une affaire qui mérite une lettre retraçant le chemin d’une vie. Ramatoulaye, la narratrice, écrit à son amie Aïssatou à l’heure où l’ancien mari de cette dernière est enterré. Mari ancien, car Aïssatou a choisi de quitter cet homme qu’elle devait partager en vertu d’une polygamie acceptée et défendue. C’est pour Ramatoulaye l’occasion de raconter des faits similaires, avec une issue bien différente. Le récit de sa relation avec Modou Fall, syndicaliste en vue et médecin charmeur, est aussi une description du Sénégal de l’indépendance. Une partie, du moins. Celui d’une femme élevée dans un milieu musulman traditionnel et tôt orpheline de sa mère. Si son père fut ministre, Mariama Bâ n’en fut pas moins touchée par les inégalités dues à son genre. Celles-ci sont apparues de manière éclatante au cours de sa vie comme elles le sont dans celle de son personnage. Ainsi du mariage avec Modou Fall « dans notre ville muette d’étonnement » et de la cupidité d’une belle-famille qui s’impose sans gêne ni honte dans son quotidien ; de l’affront d’un partage non consenti avec une cadette, avalisé par les proches, l’imam, les notables de la ville, l’impossibilité de s’y opposer ; du deuil qui attire les prétendants comme les mouches et la difficulté de les repousser. Seule alors, et persistant à l’être, Ramatoulaye mesure « aux regards étonnés, la minceur de la liberté accordée à la femme ». Une longue lettre, donc, comme la moindre des choses pour décrire une existence charnière, engoncée entre des héritages contraires. Et à qui adresser ces mots sinon à une amie, par trois fois amie ? « L’amitié a des grandeurs inconnues de l’amour. Elle se fortifie dans les difficultés, alors que les contraintes massacrent l’amour. » [E.M.]
Le Serpent à Plumes, 2001
☰ Le Temps du reportage – Entretiens avec les maîtres du journalisme littéraire, de Robert S. Boynton

Comment enseigne-t-on le journalisme ? Comment mener une enquête et l’écrire ensuite ? Ces questions sont complexes, ne serait-ce que par la diversité des pratiques que recouvre le terme de « journalisme ». La série d’entretiens menés par Robert S. Boynton, lui-même journaliste, est un outil précieux, notamment pour les autodidactes. L’ouvrage est né d’un questionnement qui a surgi lorsqu’il a commencé à enseigner la pratique, après dix ans à écrire pour le New Yorker. « J’avais en tête que ce que je leur enseignais n’était finalement que ma méthode […] qui n’était que le fruit de ma propre réflexion. Pourquoi aurais-je dû partir du principe que la mienne conviendrait à d’autres ? » Il décide alors d’inviter d’autres journalistes à partager leurs méthodes. Dans un métier fortement individualisé, l’expérience a plu aussi bien aux étudiant·es qu’aux professionnel·les. La vingtaine d’entretiens à bâtons rompus nous entraîne aux côtés des plus grandes plumes du slow journalism aux États-Unis. Ce qui intéresse l’auteur, c’est en effet le type de reportages qui a fait le succès du New Yorker : des enquêtes de longue haleine à l’écriture soignée, qui, partant d’histoires particulières, tentent d’éclairer des pans de la société. Les interviewé·es racontent à la fois leurs démarches d’enquête, la façon dont elles et ils mènent leurs interviews — est-ce qu’on enregistre ou pas ? —, et comment se crée un lien parfois personnel avec celles et ceux qui écrivent. Sont aussi, plus prosaïquement, évoqués leur système de prise de note, d’organisation de celles-ci ; comment ils synthétisent des milliers de page, déterminent le plan de leur article et conduisent leur processus d’écriture — il est d’ailleurs intéressant de noter que pour nombre d’entre elles et eux, c’est souvent la phase la plus difficile. L’ouvrage, réalisé au début des années 2000, date un peu et se limite géographiquement aux États-Unis — donc à une certaine vision. Mais on en ressort avec l’envie d’écrire, mieux armé méthodologiquement pour ce faire. [L.]
Éditions du sous-sol, 2021
☰ Mémoires d’un révolutionnaire 1905-1940, de Victor Serge

Lux, 2010
☰ Les Trente inglorieuses — Scènes politiques, de Jacques Rancière

régulier
de la machine consensuelle » : l’ordre du monde libéral, ou l’abolition affichée — sous couvert de « paix » et de « modernité » — des divisions historiques du conflit et de la lutte des classes. C’est-à-dire, au regard des catégories chères à l’auteur, la dissolution de l’idée même de politique. « Ces trente années ont ainsi vu l’accomplissement de la contre-révolution intellectuelle« , résume-t-il. Ce consensus et les résistances qu’il provoque apparaissent sous sa plume en trois grands blocs : l’édification d’un « racisme d’en haut » — étatique, médiatique, intellectuel — visant la population française musulmane ; l’impérialisme « démocratique » étasunien ; les diverses ripostes populaires. Rancière accuse d’abord d’une partie du monde intellectuel — et de « la gauche » — d’avoir, sur fond de lutte contre l’extrême droite officielle et de l’indéfinissable « populisme », détourné les notions d’universel, de laïcité et de République. « Le républicanisme
est ainsi devenu une extrême droite d’un type nouveau, une extrême droite de gauche
. Un front républicain contre Marine Le Pen ? Mais elle est 100 % républicaine au sens que ce mot a pris aujourd’hui. » Dissolution du politique que le philosophe décèle également dans le discours martial et antiterroriste occidental : « le Bien », c’est, par la prétendue « harmonisation heureuse du droit et du fait« , et plus encore du « droit illimité« , l’imposition à marche forcée dudit consensus. On retrouve enfin les esquisses émancipatrices familières à tout lecteur de Rancière — familières mais discutables : « ouvrir des brèches » est l’unique espoir pour briser « le temps clos« . Critique du marxisme, des grandes ambitions « stratégiques » révolutionnaires et de toute « démocratie » représentative, le penseur loue ainsi, de Nuit Debout aux gilets jaunes, l’avancée du geste égalitaire par la grâce, imprévue, de « moments singuliers« . [B.P.]
La Fabrique, 2022
☰ Le Fromage et les vers — L’univers d’un meunier du XVIe siècle, de Carlo Ginzburg
« J’ai dit que, à ce que je pensais et croyais, tout était chaos, c’est-à-dire terre, air, eau et feu tout ensemble ; et que ce volume peu à peu fit une masse, comme se fait le fromage dans le lait et les vers y apparurent et ce furent les anges […] ; au nombre de ces anges, il y avait aussi Dieu, créé lui aussi de cette masse en ce même temps. » Autour de cette cosmogonie matérialiste, Menocchio, meunier du Frioul, construit une série de convictions hérétiques qui attirent sur lui l’œil de l’Inquisition et le mènent au bûcher à la fin du XVIe siècle. Et c’est en suivant les traces laissées par ses procès, avec pour ambition de faire entendre une parole subalterne, que Ginzburg s’attèle à faire l’histoire d’une proposition d’apparence si singulière. D’où lui viennent de telles idées ? On ne peut comprendre la parole de Menocchio qu’en la replaçant au croisement de deux dynamiques historiques d’ampleur : l’onde de choc de la Réforme protestante, qui a brisé l’unité religieuse, et l’invention de l’imprimerie. Mais ce qui intéresse Ginzburg, ce n’est pas tant le fait massif de la diffusion de l’écrit que de savoir quels livres Menocchio a pu consulter et de décrire sa manière si particulière de les lire. Et ce qu’il montre, c’est que ce « n’est pas le livre en tant que tel, mais la rencontre entre la page écrite et la culture orale qui formait, dans la tête de Menocchio, un mélange explosif ». En se plaçant à hauteur d’une vie d’individu, l’auteur pointe ainsi la nécessité de varier les échelles d’analyse. Il fait aussi l’hypothèse que pour l’historien « l’exception est plus riche que la norme parce que la norme y est systématiquement impliquée », et que porter le regard sur un « cas limite » permet de repérer dans un même mouvement les régularités sociales et les discordances dans une série. Il va même plus loin ici puisqu’il envisage les conceptions hétérodoxes de Menocchio comme la voie d’accès « à un fonds de croyances paysannes vieux de plusieurs siècles mais jamais tout à fait éliminé. » Et si ces dernières conclusions ont été critiquées, on ne saurait trop insister sur la fécondité d’un livre majeur qui pose les bases de la démarche microhistorique. [B.G.]
Flammarion, 2019 [1976]
☰ Le Monde retrouvé de Louis-François Pinagot — Sur les traces d’un inconnu (1798-1876), d’Alain Corbin
Autre exemple de la richesse du champ couvert par la microhistoire, le livre de Corbin s’inscrit dans le prolongement du travail de Ginzburg mais diffère tant par sa méthode que par le choix de son objet. Pinagot, contrairement à Menocchio, n’est pas cet « exceptionnel normal » qui permet de saisir en même temps les mécanismes d’imposition des normes et la marge de manœuvre des acteurs. Il ne s’est pas distingué par une attention particulière du pouvoir qui aurait attiré quelques siècles plus tard l’attention du chercheur. Pas d’autres traces que celles, administratives et impersonnelles, qui attestent de sa naissance et de sa mort ou de sa présence sur les listes électorales et les registres cadastraux. Et le choix de lui consacrer un livre a été laissé au hasard des archives que fréquentait l’auteur, guidé par un projet impossible : écrire la biographie d’un inconnu. C’est donc autour de cette absence que s’organise le travail de l’historien : « [M]a tâche […] consistait à s’appuyer sur des données certaines, vérifiables ; à enchâsser en quelque sorte la trace minuscule et à décrire tout ce qui a gravité, à coup sûr, autour de l’individu choisi ; puis à fournir au lecteur des éléments qui lui permettent de recréer le possible et le probable. » Faire l’histoire de ce sabotier de l’Orne nécessitait ainsi de reconstituer l’univers social, culturel et sensible dans lequel il a vécu. Il fallait pour cela décrire les formes de sociabilité villageoise, les règles de présentation de soi et les stratifications sociales. Raconter aussi les moments de disette qui vident le village de ses habitants, les mutations du travail et des usages de la forêt et l’apprentissage de la citoyenneté. Mais tout cela ne doit pas nous faire perdre de vue que ses pensées, ses joies ou ses douleurs demeurent malgré tout hors d’atteinte : « Pinagot sera pour nous le centre inaccessible, le point aveugle du tableau que je dois constituer en fonction de lui — fût-ce en son absence —, en postulant son regard. […] Il nous faudra pratiquer une histoire en creux, de ce qui est révélé par le silence même. » [B.G.]
Flammarion, 1998
☰ L’Erouv de Jérusalem, de Sophie Calle
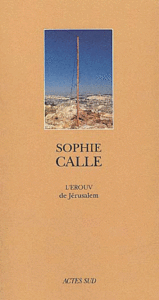
Actes Sud, 2002 [1996]
Photographie de bannière : Johannes Pääsuke
REBONDS
☰ Cartouches 75, avril 2022
☰ Cartouches 74, mars 2022
☰ Cartouches 73, février 2022
☰ Cartouches 72, janvier 2022




