Entretien inédit pour le site de Ballast
« Dans mes papiers de personne née sous X, il est écrit : Mère marocaine-père français…
» Ainsi s’achevait notre entretien avec la réalisatrice Amandine Gay, à l’occasion de la sortie de son premier film, Ouvrir la voix. Nous reprenons le fil de l’échange où nous l’avions laissé : les identités de frontières par le prisme des personnes adoptées à l’international, imbriquées dans ce qu’elle envisage comme un continuum colonial. Une histoire à soi est en salle : il nous immerge, cette fois, dans les archives de cinq Français adoptés au Rwanda, au Brésil, en Australie, au Sri Lanka et en Corée du Sud. Adultes, ils et elles racontent l’enfance, les tremblements adolescents et leur regard d’adultes : aucun ne peut se satisfaire d’un discours qui ferait d’eux des chanceux, rescapés de lâches abandons. Pour se construire, il leur importe de se replonger dans la réalité politique de leurs origines et dans celle de la circulation d’enfants des pays du Sud. Suite à la mobilisation de personnes adoptées, parfois accompagnées de leurs familles, les cadres changent : on observe moins d’adoptions internationales. Amandine Gay fait partie d’une génération d’archivistes ; plus que tout, son travail refuse la page blanche.

La sociologue étasunienne Patricia Hill Collins a conceptualisé la notion de « outsider within ». Elle interroge, de sa place de femme noire universitaire, ce que ça signifie d’être simultanément absente des cadres théoriques et des sujets de recherche, tout en se trouvant particulièrement visible dans une carrière universitaire qui compte si peu de personnes noires, où les cursus n’ont pas été pensés pour elles. Elle y dévoile une forme d’hyperintégration — parce qu’on finit par faire partie des institutions — en même temps qu’une marginalité renforcée par cette hyperintégration même. Cette idée a été reprise par les adoptés transraciaux aux États-Unis dans un ouvrage publié en 2006, intitulé Outsider within, writing on transracial adoption : un premier recueil conçu par des universitaires et artistes adopté·es, qui ont abordé ce sujet en le décortiquant sous l’angle de la sociologie, mais aussi avec une perspective décoloniale. J’utilise le terme d’outsider within en anglais dans mes écrits car il est difficile à traduire : être à la fois à la marge et au centre. Cette posture explique pourquoi, si on ne souffre pas de pathologies liées à son adoption et sans être dans le déni, certains auront un regard perçant et une capacité d’analyse sur le fonctionnement du groupe majoritaire tout en occupant une place minoritaire.
Être adopté ne suffit pas en soi à faire une identité : c’est ce qui est renvoyé aux personnes ayant cette trajectoire. Comment y répondez-vous ?
« Mon statut d’
adoptéene se joue pas seulement au moment où je sors du statut de mineure étrangère. »
C’est une erreur d’analyse du phénomène de l’adoption de considérer qu’être adopté n’est pas une identité, quand tu es caractérisé tout au long de ta vie par cette perception qu’ont les autres de toi. De la même façon que les assignations raciales. Une identité, c’est quelque chose à laquelle tu es assigné. Soit tu t’en revendiques, soit tu t’en émancipes, mais tu n’as pas les moyens de dire « Non je ne suis pas une adoptée ». De la même façon que je n’ai pas les moyens de dire « Je ne suis pas noire ». Je pourrais faire le choix de n’être que la fille de mes parents adoptifs, que le réel rattraperait. Par exemple, quand j’ai été confrontée à des problèmes de santé nécessitant une hystérectomie1, je n’avais pas sous la main les antécédents médicaux de ma famille biologique, qui auraient été utiles à ce type d’opération.
Ainsi, mon statut d’« adoptée » ne se joue pas seulement au moment où je sors du statut de mineure étrangère isolée pour devenir la fille de Marie-Claude et René Gay. À 36 ans, le fait d’être adoptée a toujours un impact sur ma vie quotidienne. Un impact sur ma santé, comme sur la catégorisation raciale — minoritaire — à laquelle je suis associée. L’adoption transnationale et transraciale est compliquée dans des pays qui peinent à aborder frontalement les questions raciales, qui peinent à comprendre l’importance de la communauté comme lieu de transmission de compétences culturelles, mais également de compétences d’autodéfense face aux discriminations et aux agressions racistes. Pour les personnes adoptées, ce n’est pas simple de se familiariser avec ce que peuvent être les cultures noires dans leur complexité. Mon appartenance aux communautés noires se trouve teintée par le fait que je suis une personne adoptée.
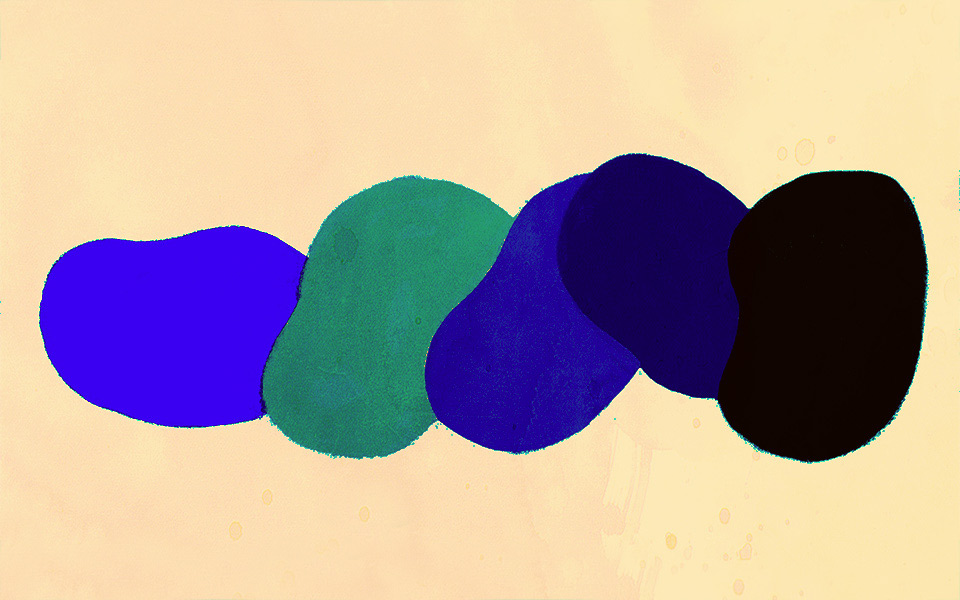
[Maya Mihindou | Ballast]
Il y a des similitudes entre cette tabula rasa imposée aux personnes adoptées à l’international de façon plénière2 et un certain discours républicain qui refuse à une partie de la population un retour critique sur l’Histoire, notamment coloniale. Comment liez-vous ces réalités, politiquement ?
J’ai longtemps cru que mon expérience de personne noire en France était trop impactée par le fait d’être adoptée pour avoir la légitimité de rejoindre des combats de personnes noires. Et puis, en en côtoyant davantage, d’abord comme basketteuse, je me suis rendu compte que nous avions beaucoup en commun, notamment cette expérience de l’acculturation. Quand on est lié à l’espace colonial français, qui prône l’assimilation et gomme les particularismes pour inviter à se fondre dans le « creuset républicain », on comprend que l’universalisme républicain est tout à fait particulier, et bien peu « universel » : il exige de tous ceux et celles qui ne sont pas blanc·hes, hétérosexuel·les ou hommes cis, de faire du mieux qu’ils ou elles peuvent pour ressembler au maître étalon de l’humanité.
« Nous avons des informations parcellaires sur notre provenance. Finalement, ce qui nous lie, c’est l’histoire de la dépossession et de la violence. »
Mais il y a d’autres points communs. Quand, sur des générations, votre famille s’est déplacée de pays en pays, c’est plus compliqué de savoir d’où l’on vient, de savoir où ses parents sont nés et ont grandi. La question des langues se joue là aussi, car elles ne se transmettent pas toujours. Les informations s’évaporent beaucoup dans les diasporas noires, et pas seulement quand on est né·e sous le secret. C’est une fois devenue jeune adulte que j’ai réalisé que nous n’étions pas si différents. Car sur le spectre de la désaffiliation et de la rupture avec les communautés et cultures d’origine, je suis effectivement à l’extrémité. Mais, en fait, c’est un continuum. Ça se mesure davantage en terme d’échelle qu’en terme d’essence noire. Nous sommes tous et toutes dans ce continuum colonial du contexte français qui induit que nous avons des informations parcellaires sur notre provenance, et plus ou moins accès à l’histoire de nos ancêtres. Finalement, ce qui nous lie, c’est l’histoire de la dépossession et de la violence.
Vous évoquez régulièrement les passerelles qui existent, chez les personnes adoptées et celles qui grandissent avec un héritage de plusieurs continents : les « Afropéens » ou métis. Une expérience commune qu’on peut historiciser : il y a eu, dans plusieurs colonies françaises, des enfants arrachés à leurs parents pour être envoyés dans l’Hexagone, ou, parfois, placés dans des orphelinats pour métis. Ces parcours, peu connus, rappellent notamment celui d’une personne de votre film, touchée par la réalité des vols d’enfant, au Sri Lanka…
Quand j’avais 20 ans, mon mémoire de fin d’études, à l’IEP3, portait sur les enjeux du traitement de la question coloniale en France, spécifiquement sur le continuum colonial et la façon dont les Noirs pouvaient être représentés dans le cinéma, dans les médias, etc. Sous différents angles, tous mes travaux abordent ces questions. On ne peut effectivement pas comprendre l’adoption transnationale et transraciale contemporaine sans comprendre que la dépossession des enfants des communautés noires, en France, débute avec la traite négrière. Dans les sociétés de plantation, les personnes qui étaient réduites en esclavage avaient le statut de « bien meuble ». Quand une femme accouchait, ses enfants n’étaient pas sa propriété mais celle du maître. Ils pouvaient être déplacés ou vendus sur d’autres plantations. Cette histoire de la dépossession se retrouve sous d’autres formes, posant d’autres questions : comment gérer les personnes appartenant à la frontière raciale — tous les enfants nés des rapports avec les maîtres, généralement non consentis ? À partir du moment où ils sont de pères français blancs, faut-il les catégoriser du côté noir ou blanc ? Comme on ne veut pas les catégoriser du côté des Blancs, une classe de Noirs libres va être créée pour remédier à ce souci de frontière qui vient perturber la hiérarchie raciale qui existe dans les sociétés de plantation.

[Maya Mihindou | Ballast]
Ces enfants ont un statut politique dès le départ. Surtout les enfants issus de cette rencontre entre les autochtones et les personnes réduites en esclavage, et ensuite les indigènes — dans la phase de colonisation, avec le code de l’indigénat. Si on ne s’intéresse pas à cet aspect de l’Histoire, il est difficile de comprendre la prédation existant sur les ventres des femmes du Sud. Mais, observé sous un angle historique, on constate que c’est une pratique qui émerge à partir de la traite transatlantique et qui se poursuit au moins jusqu’au début du XXe siècle, au moment où une régulation internationale de l’adoption transnationale est mise en place par la Convention de la Haye, signée en 1993 et ratifiée par la France en 1998. Après-guerre, une quarantaine d’années se passent sans réel cadre cohérent concernant l’adoption transnationale, avec une non considération des inégalités Nord/Sud. Une inconscience, aussi, des inégalités économiques et des préjugés racistes qui définissent ce qu’est être une « bonne » ou une « mauvaise » mère, les enjeux de la préservation familiale, etc.
« Le dernier pensionnat d’assimilation, en Guyane française, a fermé en 2012. »
Les statistiques ethniques ne sont pas autorisées en France4, mais dans les pays où on dispose de telles statistiques (Canada, États-Unis), on s’aperçoit que les enfants qui sont surreprésentés dans les services de Protection de la jeunesse pour des motifs qui ne sont pas liés à de la violence sont des enfants autochtones ou noirs. On peut se dire que c’est affaire de hasard. Ou on peut établir un lien avec la traite transatlantique et les conquêtes. Quels enfants ont fait l’objet de pratiques d’assimilation ? Dans mon livre, je parle de ce lien entre communautés noires et communautés autochtones de Guyane et de la Caraïbe. Avant d’être génocidés, les enfants de ces communautés étaient l’objet de convoitise de la part des pays colonisateurs qui, après la controverse de Valladolid, ont mis en place le Code noir. Les Noirs étaient réductibles à l’esclavage tandis qu’il était encore possible de convertir les autochtones à la religion catholique — puisqu’ils étaient, aux yeux des colons, dotés d’une âme. Sauf, bien sûr, en cas de résistance. Pour l’éviter, la stratégie était de prendre les enfants autochtones à un âge encore malléable afin de rendre possibles les conversions et leur rééducation dans des pensionnats d’assimilation avant qu’ils ne deviennent de vrais autochtones, autrement dits de vrais « sauvages », et qu’on ne soit dans l’obligation de les tuer.
Les déplacements d’enfants des communautés autochtones débutent à ce moment-là. Le dernier pensionnat de ce genre, en Guyane française, a fermé en 2012. C’est un axe du continuum colonial : l’enjeu représenté par les enfants autochtones et noirs, les enfants indigènes, les métis d’Indochine, est au cœur des politiques natalistes françaises, au cœur des politiques coloniales françaises, au cœur du racisme d’État français. Sur le long terme, la présence de ces enfants a un intérêt pour la colonie : fabriquer de « bons Français » — des Français faisant allégeance à l’État et non à leur communauté d’origine, en les assimilant aux communautés blanches, en les coupant de leur communauté pour qu’ils deviennent des citoyens productifs pour l’État. La dimension historique et géopolitique est ici fondamentale. Ce sont depuis ces mêmes gestes, remis au goût du jour, plus « humanisés » qu’au moment des conquêtes coloniales. Et il y a une acceptation de cette réalité dans l’inconscient collectif. Il semble familier de prendre des enfants à l’autre bout de la Terre pour en faire des Français.

[Maya Mihindou | Ballast]
Dans le cadre de votre film, vous avez collecté de nombreuses paroles de personnes adoptées à l’international. Qu’en est-il des adoptions nationales ?
Il ne faut pas oublier que l’adoption transnationale, au départ, concernait aussi les personnes blanches. À l’époque d’Anne-Charlotte [l’une des personnes interviewées dans le film, adoptée en Australie par une famille française dans les années 1960, ndlr], il y avait des personnes du Québec adoptées en France, et toute une génération de personnes nées en Irlande. Toutes les sociétés occidentales, européennes et catholiques, où le fait d’être une mère non mariée était un tabou énorme et une honte pour les familles, étaient concernées. En même temps que l’essor des mouvements féministes et de la contraception, entre le début des années 1940 et le début des années 1970, il y a eu énormément de séparations d’enfants. À ce moment-là, d’ailleurs, il n’y avait pas de pénuries de bébés blancs en France car de nombreuses femmes accouchaient sous le secret. Et d’autres enfants adoptables en Irlande, au Québec ou, comme Anne-Charlotte, en Australie. Il y a eu des bébés blancs disponibles à l’adoption en France jusqu’aux années 1970. Puis, les droits des femmes blanches progressant, il y a eu comme une pénurie. Des personnes comme Anne-Charlotte, australienne adoptée à l’international, il y en a de fait moins : elles étaient moins nombreuses et moins mobilisées. Ces personnes n’ont pas toujours su qu’elles étaient adoptées. Pour le film, c’était important d’avoir quelqu’un comme elle pour rappeler cette dimension historique et réaliser que l’adoption transnationale et transraciale existe justement parce que les bébés blancs sont devenus indisponibles ! Mais, effectivement, des profils comme le sien étaient plus difficiles à rencontrer. Le choix de l’adoption transnationale permettait de montrer avec une plus grande aisance les ramifications politiques, en posant les enjeux des rapports Nord/Sud. C’est plus évident en ce qui concerne l’adoption transnationale qu’avec l’adoption générale ou locale.
C’était une volonté au départ, dites-vous, de choisir des adultes qui soient assez « solides » pour confier leur histoire et leurs archives. Il y a une base commune dans les témoignages : ces personnes adoptées, traversées par des conflits, n’ont pas grandi dans des familles dysfonctionnelles ou violentes, mais dans des familles aimantes. Pourquoi ce choix ?
« Comprendre qu’on est inclus dans cette histoire de dépossession et d’assimilation, propre à nos communautés, là, ça nous apporte des solutions. »
Nous avons fait plus de 93 entretiens pour le film et retenu cinq personnes adoptées. Nous avons rencontré des personnes à tous les moments de leur vie, des situations les plus glauques aux plus banales. Mais il y avait divers enjeux, et le premier est pragmatique : pour faire un film d’archives familiales, une personne en rupture avec sa famille n’aurait pas pu accéder aux archives avec l’accord de tout le monde. Donc le niveau de conflit a joué. Le second enjeu était de dire que, finalement, il était plus puissant politiquement et émotionnellement de montrer que ce qui est central n’est pas la question de l’amour. Car la façon de montrer l’adoption de manière classique et dépolitisée, c’est justement de s’accrocher à cette croyance que « l’amour est plus fort que tout. » Un enfant isolé d’un côté, une famille en manque d’enfant de l’autre, on les rassemble et hop !, tout le monde est heureux. Et si l’enfant porte des traumatismes précédant l’adoption, ils seront guéris par l’amour. Je trouve plus pertinent de montrer que l’amour aide effectivement les personnes qui font face aux multiples difficultés de l’adoption transnationale ou transraciale à avoir une chance de s’en sortir à la fin. Mais ce n’est pas le sujet.
Ce qui nous permet de nous en sortir, c’est le politique. C’est de prendre conscience que nos histoires sont incluses dans des histoires de domination et dans les rapports inégaux entre les premières familles et les familles adoptantes, entre pays de départ et pays d’accueil de l’adoption. On arrive à s’en sortir quand on arrive à rattacher tous ces wagons. Et quand on comprend qu’on est inclus dans cette histoire de dépossession et d’assimilation que j’évoquais tout à l’heure, qui est propre à nos communautés quand elles ont été en lien avec l’histoire de la France, là, ça nous apporte, en tant que personnes adoptées, des solutions. Nous voulions balayer, d’emblée, l’argument de la « mauvaise famille » pour nous concentrer sur des enfants adoptés dans de « bonnes familles » pleines de bonne volonté, et souligner que l’amour comme la bonne volonté ne suffisent pas pour être heureux et équilibré psychologiquement.

[Maya Mihindou | Ballast]
Ce qui nous permet de nous en sortir, c’est la compréhension par nos parents du racisme systémique en France ; c’est qu’ils soient capables de réaliser ce que signifie d’être blanc dans ce contexte, d’être ouverts à l’idée que leurs enfants aient besoin de revenir vers leur pays d’origine sans se mettre en concurrence avec les parents biologiques et sans se sentir submergés par la conception, très occidentale, de l’exclusivité parentale. Cette conception empêche de voir les enfants comme appartenant à la communauté, mais les place comme propriété du couple nucléaire dans sa version la plus caricaturale — le papa et la maman de la Manif pour tous. Ce qui m’intéresse, c’est que les gens puissent se poser ces questions-là et sortir d’une approche simplement individuelle (« La famille est-elle assez bienveillante ? ») pour aller vers l’enjeu principal : est-ce que les institutions préparent correctement des parents blancs à accueillir au sein de leur famille des enfants qui ne le sont pas ? Des enfants des pays du Sud, des enfants des anciennes colonies françaises ? Pour ma part, je suis moitié marocaine, moitié martiniquaise. Mais je connais des personnes nées sous X dont les parents de naissance sont algériens et qui ont été adoptées dans des familles dont les grands-parents se sont battus en Algérie pour la France. Est-ce que ça peut vraiment bien se passer ?
Aujourd’hui, dans les démarches d’adoption internationale, ces réflexions sont-elles encadrées différemment ?
« Je connais des personnes dont les parents de naissance sont algériens, adoptées dans des familles dont les grands-parents se sont battus en Algérie pour la France. Est-ce que ça peut vraiment bien se passer ? »
Le problème majeur en France, c’est que la décentralisation a donné aux départements les compétences en matière d’adoption. Tous les acteurs et actrices de l’adoption, que ce soit dans les familles d’adoption ou chez les adopté·es, rappellent qu’en France il y a 101 départements, et 101 politiques d’adoption. On ne peut pas se permettre, dans un pays comme la France, qui a une histoire coloniale et esclavagiste, de ne pas avoir une politique d’adoption qui soit unifiée. Par exemple dans la façon dont on délivre les agréments, et la manière d’aborder les questions raciales dans la préparation des candidats adoptants. Il faudrait une réflexion de fond, et un processus qui soit le même pour tous les départements, dès lors que l’on pose aux candidats la question de leur « préférence raciale ». Leur expliquer pourquoi la question leur est posée, pourquoi on leur pose des questions sur le passé de leurs propres parents, ce qu’ils savent des enjeux culturels et historiques de leur pays, pour savoir s’ils sont en mesure d’accompagner leurs enfants.
Il faudrait aussi que les institutions s’assurent que les parents pourront accompagner leur enfant sur des choses très banales et quotidiennes. L’atelier sur la gestion des cheveux crépus et frisés pendant le Mois des Adopté·e·s est dans cette veine. Les personnes adoptées font un travail d’éducation politique au sein de leur famille et de leur entourage sur ce que signifie être noir ou asiatique en France, et on attend d’elles qu’elles pallient le travail des institutions qui encadrent l’adoption — des institutions financées par nos impôts. C’est bien de s’organiser entre nous, mais ce n’est pas notre travail ! On le fait bénévolement. Alors des associations comme la Voix des adoptées ou Racines coréennes, qui organisent des séminaires de formation sur la recherche de ses origines, sur les enjeux psychiques et émotionnels, et offrent un soutien pour trouver des associations en Corée du Sud (où il est même possible, à présent, de séjourner dans des guesthouses de personnes adoptées, d’obtenir des subventions pour apprendre le coréen, etc.). En se rapprochant d’associations, on a accès à de nombreuses informations collectées par des personnes adoptées avant nous, qui font de la transmission. L’État français a délivré des visas pour l’adoption internationale. Ça devrait être à ce même État de fournir un billet aller-retour pour les personnes adoptées à l’international devenues majeures. L’enjeu est vraiment là : une absence de coordination des politiques d’adoption au niveau des départements, et l’absence de prise de responsabilité sur le long terme par l’État qui, par ailleurs, favorise l’adoption en délivrant des agréments et des visas. Il faudrait s’intéresser à l’adoption pendant toute la durée de vie des personnes adoptées.

[Maya Mihindou | Ballast]
Vous avez entrepris des démarches qui vous ont permis d’échanger, par un intermédiaire, avec votre mère de naissance. Ce sont des démarches qui sont devenues possibles assez récemment, n’est-ce-pas ?
Bien sûr. Et encore une fois, ça a été possible suite à la mobilisation de personnes adoptées nées sous le secret. Les X en colère, par exemple. Il y a eu un certain nombre de collectifs et de rassemblements qui ont fait du lobbying auprès de l’État ; qui ont déplacé la conversation non plus du côté des émotions et de l’amour mais du côté du droit. Les personnes nées sous le secret sont les seuls groupes, en France, qui font l’objet d’un déni de droit : celui de connaître ses origines et celui d’avoir accès à ses antécédents médicaux.
L’histoire de ces mobilisations est peu connue…
Pourtant, c’est suite à des décennies de mobilisation de personnes adoptées nées sous le secret depuis 1941 (année où l’accouchement sous le secret tel qu’il existe aujourd’hui a été mis en place, sous le régime de Vichy) que le Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) a pu voir le jour. C’était en 2002. La modification de la loi n’a pas fait disparaître l’accouchement anonyme ou l’accouchement sous le secret — qui ne signifie pas forcément le secret à l’état civil. On préfère conserver l’anonymat de la mère de naissance, tout en permettant à une personne de faire une demande d’ouverture de son dossier auprès du CNAOP à partir de ses 18 ans, la structure s’engageant à faire une recherche biographique pour retrouver les mères de naissance (les pères de naissance ne sont presque jamais retrouvés).
« Nous, né·es sous le secret, œuvrons à trouver un compromis entre l’intérêt de femmes précaires qui accouchent sous le secret et l’intérêt de celles et ceux qui auront tout au long de leur vie besoin d’informations sur leur origines géographiques. »
L’enjeu du CNAOP concerne également les moyens mis par l’État dans la post-adoption. Pour le moment, le gros de l’argent que l’État met dans l‘adoption est alloué aux candidats à l’adoption ou à la post-adoption immédiate, c’est-à-dire à l’arrivée des enfants dans les familles. Il y a des consultations pour les parents et enfants adoptés, mais ensuite plus rien. Le CNAOP existe, mais avec des équipes très réduites, un budget également réduit, qui doivent faire des recherches pour des centaines de personnes adoptées en demande d’ouverture de leur dossier. On se retrouve avec des mesures anachroniques et inadaptées. Le temps d’attente quand on dépose une demande au CNAOP va de 3 à 5 ans…
Je le répète : être adopté est une identité que l’on porte tout au long de sa vie, qui n’est pas prise en compte par les institutions. On ne peut pas continuer à avoir si peu de considération, tant financièrement que politiquement, lors de la post-adoption, quand on a tellement de personnes adoptées en France — 200 000 au moins. Pour les personnes adoptées à l’international, un nouveau collectif d’adoptés et de parents adoptants s’est créé, qui exige une commission d’enquête auprès de l’État français sur les adoptions illégales en France depuis 1970. La Suède vient de le faire, les Pays-Bas également. Ces derniers ont suspendu l’adoption internationale jusqu’à ce qu’ils puissent mettre en place des procédures réellement éthiques, car l’enquête a révélé des dysfonctionnements. Il y a un réel mouvement de mobilisation des adoptés visant à modifier les lois de l’État français sur le sujet. Nous, né·s sous le secret, œuvrons à trouver un compromis entre l’intérêt de femmes précaires qui accouchent sous le secret et qu’il s’agit de respecter, et l’intérêt de celles et ceux qui auront tout au long de leur vie besoin d’informations sur leur origines géographiques.
Illustration de bannière : Maya Mihindou | Ballast
Photographie de vignette : Cyrille Choupas | Ballast
- L’hystérectomie est une opération chirurgicale visant à enlever tout ou une partie de l’utérus.[↩]
- Contrairement à l’adoption simple, l’adoption plénière oblige à rompre tout lien de filiation avec la famille d’origine de la personne adoptée.[↩]
- Institut d’études politiques.[↩]
- Elles sont interdites par la loi Informatiques et libertés qui date du 6 janvier 1978 : « Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. »[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Françoise Vergès : « La question du métissage m’a toujours interrogée », juin 2020
☰ Lire notre entretien avec Nadia Yala Kisukidi : « Le conflit n’est pas entre le particulier et l’universel », juin 2020
☰ Lire notre traduction « Le nouveau mestizaje », Gloria Anzaldúa, juin 2020
☰ Lire notre notre article « Audre Lorde : le savoir des opprimées », Hourya Bentouhami, mai 2019
☰ Lire notre entretien avec Patrick Chamoiseau : « Il n’y a plus d’ailleurs », février 2019
☰ Lire notre entretien avec Angela Davis : « Nos luttes mûrissent, grandissent », mars 2015


