Entretien inédit pour le site de Ballast | rubrique Relier
Une organisation autogérée et un journal mensuel : voilà ce qu’est Alternative libertaire. Fondée en 1991, celle qui jure n’être pas un parti milite en faveur d’une société communiste libertaire et défend, pour ce faire, la lutte des classes (le prolétariat moderne entendu comme « unité nouvelle, beaucoup plus large » que la seule et traditionnelle classe ouvrière : c’est bien « l’ensemble des groupes sociaux sans pouvoir réel de décision sur la production » qu’il convient de fédérer et de mobiliser), le syndicalisme révolutionnaire et la démocratie autogestionnaire et fédéraliste (contre l’État et le parlementarisme, fussent-ils « républicains »). Son journal, tiré à 9 000 exemplaires, fait ainsi la part belle aux luttes d’aujourd’hui et d’hier, désireux de relier les combats sociaux, écologistes, féministes, antiracistes, LGBT et anti-impérialistes. Plusieurs membres du secrétariat fédéral d’Alternative libertaire, mandatés par l’ensemble de l’organisation, ont répondu à nos questions.
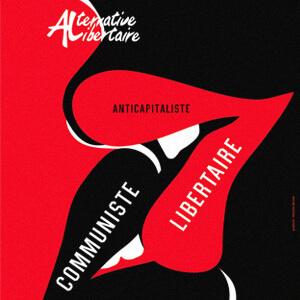 On célèbre cette année les 50 ans de la mort du Che. « Une étoile qui aveugle », avez-vous un jour écrit…
On célèbre cette année les 50 ans de la mort du Che. « Une étoile qui aveugle », avez-vous un jour écrit…
En raison de la plénitude et de la sincérité de son engagement, Che Guevara était une étoile, assurément. Ce qui a quelque peu aveuglé les révolutionnaires des vingt années suivantes, c’est le « guévarisme ». La théorie du foyer de guérilla armée — foco —, appliquée à mauvais escient, s’est soldée par des échecs, voire des catastrophes, pour l’extrême gauche sud-américaine des années 1970-1980. Cependant, le foquisme n’est pas à jeter en bloc à la poubelle. Lorsqu’il s’est exercé dans le cadre d’une lutte de libération nationale, et qu’il a su s’extraire du pur militarisme pour interagir avec une contestation civile, il a pu engendrer des expériences politiques extrêmement riches. Nous pensons bien évidemment à l’EZLN et au PKK en disant cela.
Vos statuts existent en 26 langues, et l’internationalisme compte au nombre de vos piliers. Comment cette exigence se traduit-elle, par-delà les nobles sentiments, dans vos activités d’organisation fédérale et dans votre journal mensuel ?
« C’est dans la lutte que s’éveillent les consciences, les solidarités, que les travailleuses et les travailleurs peuvent apprécier leur force collective. »
Alternative libertaire est membre du réseau communiste libertaire international Anarkismo qui regroupe une vingtaine d’organisations dans quatorze pays, sur quatre continents. C’est un réseau d’entraide, qui facilite une expression commune sur un certain nombre de sujets — contre le Sommet du G8 en 2009, par exemple, ou en faveur de la gauche kurde lors de la bataille de Kobané en 2014. Au sein du réseau, il existe des regroupements en fonction de certaines aires géographiques, principalement l’Amérique du Sud et l’Europe. Ainsi, à la suite de la rencontre d’Anarkismo-Europe en 2010, une campagne commune a-t-elle été menée en faveur de la liberté de circulation des migrantes et des migrants, avec les mêmes affiches déclinées en quatre langues. Le cycle altermondialiste des années 1999-2003 a joué un grand rôle dans le resserrement des liens entre camarades par delà les frontières. Les « contre-sommets » (Prague et Nice en 2000, Göteborg et Gênes en 2001, Séville en 2002, Évian en 2003) en ont constitué des moments privilégiés. Ils ont permis — et c’était plus que jamais nécessaire — de s’extraire de la communication par Internet pour partager des temps forts de confrontation avec les forces de l’ordre, de discussions passionnées jusqu’à 3 heures du matin et, finalement, d’amitié. Dans ces moments-là, il se forge une confiance qui facilite grandement les relations à distance par la suite. Et, bien évidemment, les pages internationales du mensuel Alternative libertaire en bénéficient largement.
La question de la participation aux élections, écrit l’un de vos membres, « divise AL de manière récurrente » : vous n’avez pas souhaité donner de consignes de vote aux dernières présidentielles (« Le Pen ou Macron ? Risque fasciste ou capitalisme ultralibéral ? »). Par quels moyens entendez-vous bâtir la société autogestionnaire et écologiste que vous appelez de vos vœux ?
La stratégie révolutionnaire d’AL repose sur l’action des mouvements sociaux, leur extension et leur radicalisation. Parce que c’est dans la lutte que s’éveillent les consciences, les solidarités, que les travailleuses et les travailleurs peuvent apprécier leur force collective. Dans cette optique, des organisations larges, comme les syndicats, ont un rôle de premier plan à jouer. Elles sont aussi un lieu privilégié pour remettre en cause les inégalités sexistes ou racistes. Autant dire que les révolutionnaires se doivent d’en être, pour apprendre et se former autant que pour y insuffler de la radicalité. Nos camarades des organisations sud-américaines parlent à ce propos de « construction du pouvoir populaire » ; pour notre part, nous parlons plutôt de « construction de contre-pouvoirs », mais l’idée est la même : nous sommes pour l’empowerment des classes populaires. C’est une stratégie qui peut sembler ingrate quand la conflictualité sociale est atone — comme en 2017 —, mais qui s’avère particulièrement payante dans les périodes de remontée de la lutte de classe. Il y a au sein d’AL un large consensus pour considérer qu’il n’y a rien à attendre des institutions républicaines.

Là où il peut y avoir divergence de vues, c’est sur la nécessité ou non d’appeler à « voter contre » une menace réactionnaire. La question s’est posée aux présidentielles de 2002, de 2007 et de 2017. La première fois, AL a appelé à ne pas voter Le Pen ; les deux suivantes, elle n’a donné aucune consigne de vote, préférant affirmer à nouveau sa conviction que la meilleure façon de saper la montée du fascisme sont les luttes sociales et la solidarité de classe qu’elles engendrent. Le schéma révolutionnaire qui est le nôtre se déroule par étapes successives : contre-pouvoirs ; double pouvoir ; pouvoir populaire. La construction de contre-pouvoirs, c’est la tâche à accomplir dans une période non révolutionnaire que nous vivons aujourd’hui ; l’accession à un double pouvoir, avec concurrence entre le mouvement populaire et l’autorité étatique et capitaliste, peut advenir à la faveur de certaines circonstances historiques ; enfin, le renversement de l’autorité étatique et capitaliste pour basculer vers un pouvoir populaire constitue l’étape décisive vers la révolution sociale et la société nouvelle. L’organisation communiste libertaire a un rôle à jouer dans ce schéma. Il y a certes besoin d’un mouvement social fort pour crédibiliser un projet anticapitaliste. Mais une formation communiste libertaire dynamique est également nécessaire pour que ce projet anticapitaliste prenne un tour fédéraliste et autogestionnaire — faute de quoi, on laisse le champ libre à des « solutions » réformistes, étatistes ou nationalistes. Notre courant s’efforce donc de marcher sur ces deux jambes : action au sein du mouvement social, d’une part ; développement d’un courant communiste libertaire audible, de l’autre.
Vous affichez une esthétique fidèle à la tradition communiste libertaire : le rouge et le noir. Un nombre grandissant de militants semble aujourd’hui aspirer à sortir de l’iconographie révolutionnaire, afin de susciter l’adhésion du plus grand nombre. L’entendez-vous ?
« Notre courant s’efforce donc de marcher sur ces deux jambes : action au sein du mouvement social, d’une part ; développement d’un courant communiste libertaire audible, d’autre part. »
Tous les courants politiques ont un code couleur qui permet de les identifier du premier coup d’œil. Les Républicains ont le bleu, les communistes, le rouge, les écologistes, le vert, l’orange est la couleur du Modem et de la CFDT, le violet, du féminisme, le bleu-blanc-rouge convient au FN et à la France insoumise (mais aussi, pour cette dernière, le bleu et l’orange)… on pourrait multiplier les exemples. Pour le communisme libertaire, c’est le rouge et noir. Rien ne justifie qu’on l’abandonne et, à vrai dire, personne ne l’a jamais demandé. Cela ne veut pas dire que notre iconographie doive être intégralement rouge et noir. Les unes du mensuel Alternative libertaire, par exemple, sont de couleurs variées ; le rouge et noir est réservé à l’élément permanent qu’est le logo-titre — comme pour tout périodique, à vrai dire.
Frédéric Lordon propose une sortie de l’euro à des fins anticapitalistes. « Ni franc, ni euro : abolition du salariat ! », objecte, de manière plus générale, l’une de vos sections. Cette abolition n’étant pas pour demain, est-il impensable d’imaginer des paliers ?
La sortie du capitalisme, que nous défendons, est indissociable de l’abolition du salariat, de la structure marchande, de la valeur et de l’argent, dans la mesure où ces catégories sont des catégories spécifiquement capitalistes. Le risque, avec les propositions de Lordon, est que le « palier » devienne une forme fixe, une façon d’aménager le capitalisme au niveau national, et que l’horizon révolutionnaire soit finalement abandonné. En outre, Lordon défend une structure nationale et étatique, et considère que la critique de l’État, ainsi que l’internationalisme, sont peu « réalistes ». Son projet, dans son ouvrage Imperium par exemple, est bien de « dégriser » les libertaires — nous lui avons répondu sur ce point. Nous considérons que le concept lordonien d’« État général » (qui renvoie à une forme de structure « verticale » qui régirait nécessairement toute société humaine) n’est pas viable, car flou et historiquement peu déterminé. Nous insistons de notre côté sur la nécessaire critique de l’État capitaliste. Nous considérons, en outre, que l’idéologie nationale est à déconstruire, et que l’internationalisme n’est pas qu’un « doux rêve », mais bien la seule issue pour abolir effectivement le capitalisme, qui s’est mondialisé. Nous pensons nous aussi, bien sûr, que cette lutte est progressive, et qu’elle suppose des paliers, mais nous préférons poser d’emblée des moyens de lutter et des finalités directement émancipatrices. Lordon, très souvent, critique le néolibéralisme et défend, pour l’instant, davantage le principe d’une économie nationale capitaliste « régulée » que l’abolition du capitalisme. Comme anticapitalistes conséquents, nous ne pouvons nous inscrire dans cette logique « régulationniste ».

Le salaire à vie tel que défendu par Bernard Friot apparaît comme une alternative inédite ; vous estimez pourtant que celle-ci « propose une bien étrange société : des directeurs d’usine, des retraités qui ne s’arrêtent pas de travailler, des gradations de salaire par rapport aux diplômes ». Pouvez-vous développer ?
Tout à fait. Nous faisons plusieurs objections à la proposition de salaire à vie de Bernard Friot. Tout d’abord, comme l’analyse notre camarade Alain Bihr, Bernard Friot a une conception totalement faussée de la valeur, ce qui rend son projet difficilement défendable au niveau économique1. De plus, il propose de changer la répartition du produit du salaire, mais ne remet nullement en question les fondements du capitalisme : hiérarchie au sein du travail, productivisme, usage de la monnaie… Or, il nous semble qu’il n’est pas possible de bâtir une société émancipée en utilisant les catégories du capital… Cette pensée, pour nous, présente d’ailleurs les mêmes limites que les « utopistes » d’avant Marx. Le système est basé sur une idée magique et non sur des expériences concrètes de lutte et sur l’action des exploités — d’où ses failles. C’est le cas du système de « grades » que propose Friot : quatre grades de rémunération liés à la qualification — un peu comme dans la fonction publique —, avec quatre « niveaux » qui correspondraient en gros au bac, à la licence, au master et au doctorat, avec respectivement comme rémunération 1 500, 3 000, 4 500 et 6 000 euros… Il a par la suite nuancé sa position, mais il n’en demeure pas moins que l’idée est de graduer la rémunération, donc de fonder les inégalités non pas sur la possession du capital ou le travail fourni, mais sur le niveau de connaissances ou de qualification, qui deviendrait alors un « capital » justifiant une rente matérialisée par une rémunération plus élevée… Difficile de soutenir une telle vision du monde d’un point de vue égalitaire, communiste et libertaire.
Il y a chez vous un souci constant d’articuler le passé et le présent. Archinov, Guérin, Fontenis, Cafiero : autant d’auteurs que nous partageons avec vous. Mais, nous glisse quelque diablotin, qu’ont encore à dire à notre époque zappeuse, connectée et macronisée toutes ces vieilles barbes ?
« Il nous semble qu’il n’est pas possible de bâtir une société émancipée en utilisant les catégories du capital »
Révolutionnaire italien des années 1870-1880, Carlo Cafiero a fortement pesé dans deux débats qui ont marqué la Première Internationale finissante et ont déterminé la naissance de l’anarchisme en tant que courant révolutionnaire à part entière : le communisme comme but ; l’insurrectionnalisme comme stratégie. Qu’en dire aujourd’hui ? Ses arguments insurrectionnalistes étaient liés à la conjoncture italienne de l’époque, et n’ont pas de caractère d’actualité dans l’Europe contemporaine. Quant à ses arguments en faveur du communisme, ils ont quelque peu vieilli, puisque fondés sur un refus de quantifier la production et la répartition des richesses. Ils ont conduit au mythe de la « prise au tas ». Avec la crise écologique et la nécessité de fixer des limites à la production, on n’envisage plus le communisme dans ces termes. Avec Nestor Makhno, Piotr Archinov a animé dans les années 1920 un groupe d’anarchistes russes en exil, rescapés des persécutions bolchéviques. Plutôt que de confire dans sa rancœur, ce groupe a réfléchi sur les enseignements de la révolution et en a tiré un projet de rénovation théorique et pratique de l’anarchisme, connu sous le nom de « Plateforme communiste libertaire » (ou « Plateforme de Makhno et Archinov ». Ses quatre piliers sont l’« unité théorique », l’« unité tactique », le « fédéralisme » et la « responsabilité collective »). On peut considérer la Plateforme comme une étape historique dans la formation du courant communiste libertaire contemporain. Pour AL, c’est une référence, même si elle n’est pas centrale.
Georges Fontenis, lui, a été, dans les années 1950, un acteur de premier plan du renouveau communiste libertaire au sein de l’anarchisme, au prix de luttes intestines assez violentes qui entacheront durablement son image. Son Manifeste communiste libertaire a été adopté par la Fédération anarchiste en 1953, avant qu’elle ne se transforme en Fédération communiste libertaire, la FCL. Mais le principal écrit qu’il nous a légué, ce sont ses mémoires, où il raconte les combats — des grandes grèves de 1947 à Mai 68, en passant par l’anticolonialisme qui entraîna le démantèlement de la FCL par l’État français. Il explique les positions prises à l’époque : le soutien critique au MNA, puis au FLN algérien ; la ligne « 3e front révolutionnaire : ni Washington ni Moscou ». Autant de thèmes qui rencontrent encore un écho de nos jours ! Daniel Guérin est le principal théoricien du communisme libertaire contemporain, notamment dans les années 1960-1970, lorsqu’il s’attelle à la « recherche » d’une synthèse entre le marxisme et l’anarchisme. Sa vision était celle d’un Marx libéré du léninisme et du jacobinisme dans lesquels l’historiographie communiste l’avait corseté — le marxisme comme outil d’analyse, l’anarchisme comme but, en quelque sorte. Il aura par ailleurs été de tous les combats révolutionnaires du siècle : mouvement ouvrier, antiracisme, anticolonialisme, émancipation homosexuelle… il les aura tous embrassés ! Il aura ainsi réussi le tour de force d’être jusqu’à la fin de sa vie un homme de son temps. Jamais ringardisé. C’est à méditer !

La question animale vous divise, semble-t-il, entre des partisans antispécistes et d’autres visiblement plus proches de la Confédération paysanne (l’élevage perçu comme un « don/contre-don »). On imagine que les dissensions internes doivent être nombreuses, dans une organisation comme la vôtre, sur bien d’autres enjeux : comment parvenez-vous à trouver une voix commune ou à faire état de ces dissensions ?
Alternative libertaire n’est pas une organisation monolithique, et des sensibilités différentes peuvent co-exister sur certains sujets. Cela peut parfois engendrer des tensions, mais l’organisation est toujours parvenue à les surmonter, à s’en enrichir plutôt que d’en souffrir. C’est la seule organisation d’extrême gauche en France qui, en vingt-six ans d’existence, n’a jamais subi de guerre de tendances ni de scission. À quoi cela tient-il ? Trois raisons sont plausibles. La première, c’est qu’AL est fondée sur un socle politique délimité — le communisme libertaire — qui lui épargne le côté auberge espagnole cacophonique qui a pu exister jadis dans le mouvement anarchiste. La seconde, c’est son mode de fonctionnement fédéraliste, avec des procédures démocratiques écrites noir sur blanc qui permettent, au bout d’un temps de débat, de définir une position commune. La troisième ne repose pas sur l’écrit — elle est donc fragile, et il faut la préserver : c’est une culture de tolérance et de bienveillance qui limite l’agressivité et les polémiques, en comparaison avec ce que peuvent subir d’autres organisations. Donnons un exemple avec la façon dont sont rédigés les textes d’orientation dans les congrès d’AL. Si, sur un sujet, se manifestent deux sensibilités divergentes, leurs représentants peuvent tout à fait présenter chacun un texte, le défendre devant le congrès, et chercher à emporter la majorité — schéma classique, qui pousse souvent à accentuer les divergences pour bien se distinguer l’un de l’autre. Pourtant, une autre possibilité existe, à condition d’être dans cette culture de tolérance : les deux sensibilités peuvent commencer par identifier leurs points d’accord — et bien souvent elles sont en réalité d’accord à 80 %. Elles rédigent alors conjointement un texte qui leur servira de tronc commun, et seuls les points de divergence seront mis au vote de façon contradictoire. Sur la question animale, le congrès d’AL de 2017 a entériné un consensus et des différences de sensibilité. Ce qui fait consensus c’est que, pour des raisons écologiques et sociales, il est nécessaire que la société change de modèle alimentaire et réduise drastiquement la consommation de viande. La différence de sensibilités porte sur les choix alimentaires de chacune et de chacun, sur lesquels l’organisation considère qu’elle n’a pas à être prescriptive.
Vous avez affiché vos distances avec le Syndicat du travail sexuel et appelez, dans certains textes, à l’abolition de la prostitution au nom des idéaux libertaires : une position très critiquée dans une partie de la gauche radicale…
« Aucun statut ne combattra le lien d’oppression entre le client et la prostituée. L’interdiction de consommer ne suffit certainement pas à faire disparaître la prostitution. »
Alternative libertaire se classe plutôt dans le courant néo-abolitionniste, un courant qui sait qu’on ne peut pas « décréter » l’abolition de la prostitution, mais qui voit que la prostitution est une violence faite aux femmes et qu’elle doit être combattue en tant que telle — en interdisant donc que cette violence soit commise. Les forces qui défendent la prostitution sont puissantes : c’est un marché énorme, dont le chiffre d’affaires avoisinerait les 3 milliards d’euros annuels, rien qu’en France. Des prostituées indépendantes, membres du Strass, se disent « fières d’être putes » ? Nous ne les contredisons pas. Mais cet arbre ne doit pas cacher la forêt, en l’occurrence le système proxénète, puisqu’en France, 85 % de la prostitution relève des réseaux de traite et de l’asservissement sexuel des migrantes. On ne peut donc, au nom de quelques cas particuliers, accepter l’idée d’un « statut professionnel de travailleuse du sexe ». Comme le statut d’auto-entrepreneur, il ne profiterait qu’au patronat, en masquant le lien de sujétion entre le proxénète et la prostituée. Ainsi, en Allemagne, le statut et sa réglementation ont fait exploser le marché et dopé l’« importation » de femmes par les réseaux de traite. Par ailleurs, aucun statut ne combattra le lien d’oppression entre le client et la prostituée. L’interdiction de consommer ne suffit certainement pas à faire disparaître la prostitution. Cette lutte s’inscrit dans une lutte plus générale contre l’exploitation, contre la précarité, qui touche en premier lieu les femmes. Il faut donc surtout faire reculer la misère engendrée par le capitalisme : par le droit au logement ; par le droit à un revenu pour toutes et tous ; par la liberté de circulation des migrantes et des migrants (la clandestinité en font des proies idéales pour les proxénètes et les réseaux de trafiquants) ; par l’éducation des hommes à des rapports non sexistes et au respect du consentement. Car c’est bien cela, aussi, que nous visons : changer la mentalité des hommes. Tant qu’on leur fera croire qu’ils ont des besoins sexuels irrépressibles et qu’ils peuvent légitimement « se payer » l’usage du corps d’autrui, on alimentera le patriarcat. Il faut aussi se demander qui porte la voix des proxénètes dans ce débat… Et rapprocher le combat néo-abolitionniste de celui contre la gestation pour autrui. Dans les deux cas, on est à l’intersection du racisme, du patriarcat et de l’exploitation économique.
L’essayiste Laurent Lévy vous a accusé de défendre une position « prohibitionniste » sur le voile dans son essai « La gauche », les Noirs et les Arabes. Pouvez-vous rappeler ici la ligne exacte que vous défendez ?
Sur ce point, Laurent Lévy a commis une erreur — qu’il a ensuite reconnue, et il s’en est excusé — parce qu’il n’avait pas pris connaissance de la position d’Alternative libertaire. En 2004, AL a caractérisé la loi d’interdiction du voile dans les lycées comme étant une loi faussement féministe, faussement laïque, et réellement raciste. Et c’est dans les mêmes termes qu’elle a critiqué l’interdiction du voile intégral dans l’espace public en 2011, ou la prohibition du « burkini » par certaines municipalités en 2016. En réalité, tout ce battage n’a qu’un but : l’invisibilisation de l’islam, constamment stigmatisé comme un « ennemi de l’intérieur » incompatible avec la société française, ce qui est insupportable. Bien évidemment, AL n’a fait là que défendre la liberté individuelle, la liberté de choix et la liberté de culte garantie par la laïcité — en aucun cas les institutions religieuses qui prônent « la pudeur de la femme », notion qui relève du plus antique patriarcat, qu’il soit juif, chrétien ou musulman. Dans le climat de réaction xénophobe qui prévaut aujourd’hui en France et en Europe, il nous semble crucial de lutter contre les discriminations. L’antiracisme est en soi un combat nécessaire. Mais, pour des révolutionnaires, il a une valeur supplémentaire : il est vital pour la cohésion du prolétariat. Si on perd ce point de vue de classe, on peut assez rapidement glisser dans l’antiracisme paternaliste ou identitaire.

Nous avons, avec vous — quoique sans concertation aucune —, abondamment traité de la question du Rojava : avec le Chiapas, c’est l’une des seules expériences révolutionnaires contemporaines à large échelle. Qu’a-t-elle à nous apprendre, dans ses apports comme dans ses limites ?
Elle nous apprend que la gauche révolutionnaire peut être à la fois radicale et pragmatique, avec la prise de risque que cela comporte. La gauche kurde est radicale parce qu’au milieu du chaos irako-syrien, dans une guerre civile horrible qui accumule les haines racistes et religieuses, elle propose un projet politique radicalement différent : égalitaire, social et antipatriarcal, et qui se revendique de l’autogestion. Ce qui, déjà, suffit largement à légitimer le soutien qu’on lui apporte, sans tomber dans la mythification. « Oui, le peuple peut changer les choses », comme l’écrivait un observateur au Rojava dès 2013, et c’est crucial de le rappeler. Ce qui interdit la mythification, justement, c’est le pragmatisme dont la gauche kurde fait preuve. Elle a su jouer des rivalités interimpérialistes entre les États-Unis, l’Iran, la Turquie et la Russie pour ne pas être éliminée, mais au risque d’être instrumentalisée. Dans le processus révolutionnaire, ensuite, la gauche kurde est plus incitative que coercitive — ce qu’en tant que communistes libertaires nous ne pouvons qu’applaudir. Elle ne se livre pas à un collectivisme autoritaire, mais cela signifie aussi des accommodements — provisoires ? — avec le féodalisme et le tribalisme locaux. Ensuite, la logique de « paix armée » avec le régime de Bachar el-Assad lui a permis de réserver ses forces pour affronter les djihadistes ; mais, avec la Pax Russia qui se profile en Syrie, ne risque-t-elle pas d’être accusée de connivence avec ce régime fantoche ? Enfin, rappelons la coexistence, au Rojava, d’un système démocratique autogestionnaire et d’un parti hégémonique, le Parti de l’union démocratique, ayant le monopole de la force armée ; le contexte de la guerre explique cela, mais le risque plane toujours d’une dérive dictatoriale — comme on l’a connue avec le FLN algérien il y a 50 ans. Le pragmatisme est une arme à double tranchant. Il rend possible ce qui resterait sinon cantonné à la théorie. Tant que le processus révolutionnaire avance, on se félicite de ce pragmatisme. Quand surviennent les premiers revers, on met le pragmatisme en accusation… Pour résumer, la politique de la gauche kurde au Moyen-Orient est pour nous une source constante de réflexion et d’analyse, d’espoirs enthousiastes… mais aussi d’une certaine intranquillité.
À l’issue de votre 13e Congrès, vous avez reconnu ceci : « Vingt-cinq ans après sa naissance, AL repose toujours sur le modèle du groupe d’extrême gauche actif tous azimuts, avec des débats internes parfois sophistiqués. Ce fonctionnement peut être excluant pour les salarié.e.s n’ayant pas le temps, ou pas le capital culturel adéquat. » Comment sortir de l’écueil groupusculaire ?
C’est une réflexion qui est en cours. Les gens rejoignent une organisation politique d’abord pour ce qu’elle défend ; ils n’y restent durablement que s’ils s’y sentent bien, s’ils s’y sentent utiles. Donc, en plus d’une réflexion constante sur nos propositions et nos pratiques politiques, il est bon, de temps à autre, de faire le point sur Alternative libertaire en tant que telle. Toute organisation vivante génère des codes, un métalangage, des signes de reconnaissance, un habitus, pour employer les grands mots ! C’est inévitable, et pas négatif en soi : cela participe d’une culture commune ; mais il ne faut pas en être dupes, et savoir identifier ce qui peut être excluant ou marginalisant dans cette culture. Nous vivons dans une société capitaliste, patriarcale et inégalitaire. Au sein même du prolétariat, tout le monde n’a pas la même disponibilité et ne se sent pas la même légitimité à l’engagement politique : les travailleuses et travailleurs manuels et intellectuels pour commencer, mais aussi les hommes et les femmes, les Blancs et les minorités arabes, noires, asiatiques ou autres… Soyons clairs : il n’y a aucune formule magique pour renverser ces obstacles ; mais on peut tester des choses. Plusieurs groupes AL proposent des formules d’adhésion plus souples, plus adaptées à des camarades ayant peu de temps libre. Mais comme dans toute organisation autogestionnaire, il ne faut pas que se creuse trop le fossé entre un « noyau » actif et une « périphérie » délégataire ; cela oblige à instaurer des temps forts où l’on se retrouve pour réfléchir et agir tous ensemble. C’est finalement une préoccupation assez similaire à celle de nombreuses équipes syndicales vis-à-vis de leurs syndiqué.e.s. Cela fait 15 ans également qu’AL travaille sur la répartition de la parole, avec quelques règles de débat assez simples et qui aident à endiguer les « ténors ». Les techniques issues de l’éducation populaire inspirent de plus en plus de groupes locaux d’AL et ont fait leur apparition au dernier congrès fédéral. Tout ceci est assez empirique. On fait le point sur les expériences, et on garde ce qui marche. Cela peut-il suffire à dépasser le stade du groupuscule ? En soi, non. Mais c’est une gymnastique très saine, qui peut préparer la fédération à faire face à une croissance des groupes et des effectifs quand la conflictualité sociale repartira à la hausse.
ENGRENAGES — « dispositif de transmission d’un mouvement généralement circulaire formé par plusieurs pièces qui s’engrènent », en mécanique. Cette rubrique donnera, au fil des mois, la parole à ceux que l’usage nomme, dans le camp de l’émancipation, l’édition et les médias « indépendants » ou « alternatifs » : autant de sites, de revues et de maisons d’édition qui nourrissent la pensée-pratique. Si leurs divergences sont à l’évidence nombreuses, reste un même désir d’endiguer les fameuses « eaux glacées du calcul égoïste » : partons de là.
- Alain Bihr, « Friot, ou l’émancipation a minima », Alternative libertaire, septembre 2013.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Piotr Archinov — devenir une force organisée », Winston, octobre 2017
☰ Lire notre article « Shûsui Kôtoku : appel au bonheur », Émile Carme, octobre 2017
☰ Lire notre traduction « Quelle révolution au Rojava ? », avril 2017
☰ Lire notre article « Mohamed Saïl, ni maître ni valet », Émile Carme, octobre 2016
☰ Lire notre entretien avec Frédéric Lordon : « L’internationalisme réel, c’est l’organisation de la contagion », juillet 2016
☰ Lire notre entretien avec Bernard Friot : « Nous n’avons besoin ni d’employeurs, ni d’actionnaires pour produire », septembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Alain Bihr : « Étatistes et libertaires doivent créer un espace de coopération », mai 2015
☰ Lire notre article « Georges Fontenis — pour un communisme libertaire », Winston, janvier 2015


