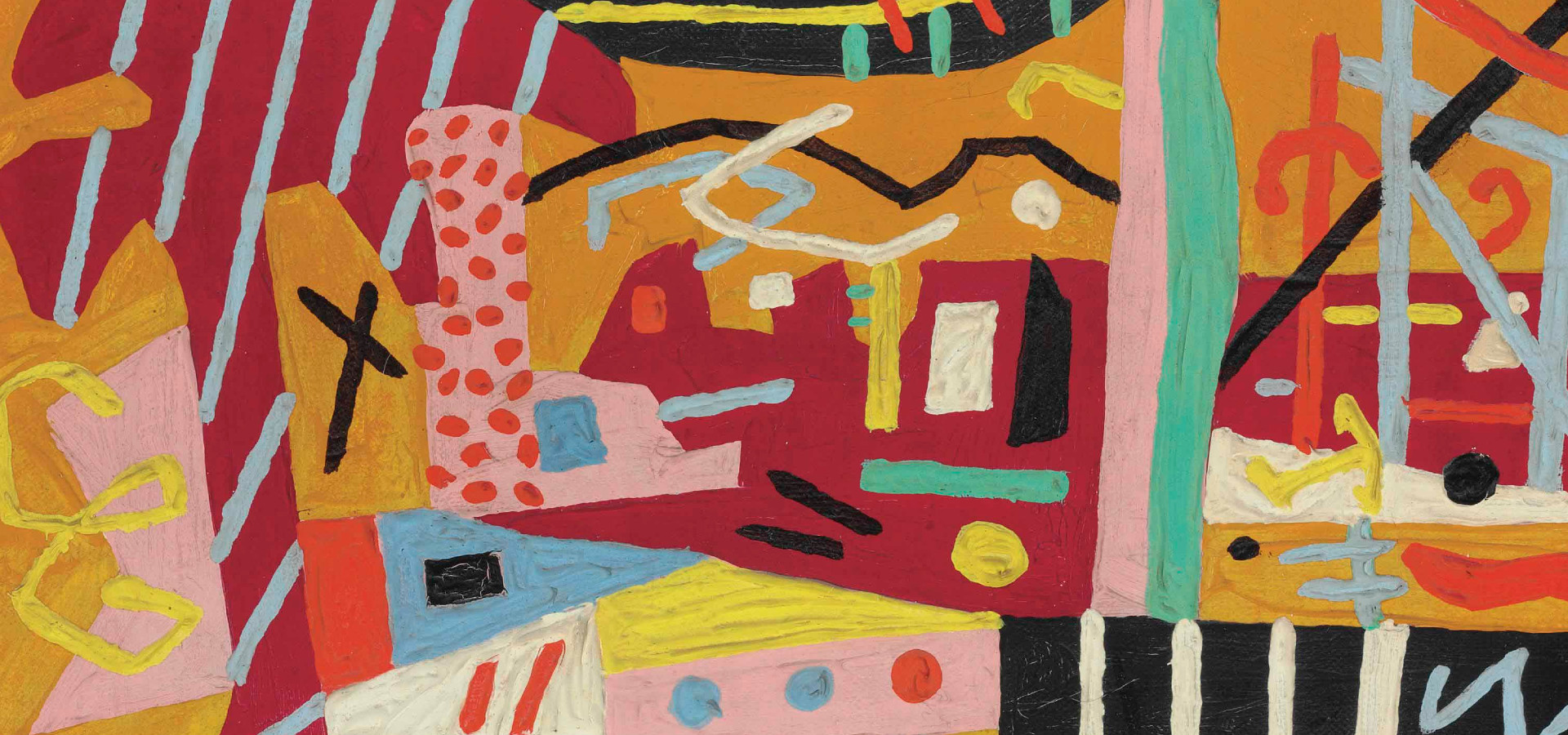Entretien paru dans le n° 4 de la revue papier Ballast (mai 2016)
On l’appelle généralement « revenu universel » ou « revenu de base ». Défendu aussi bien par une partie de la droite que de la gauche, il est, en France, porté avec le plus de visibilité par Benoît Hamon. Il s’agirait, pour l’ancien porte-parole du PS, que chaque citoyen perçoive 750 euros par mois — indépendamment de sa situation familiale et professionnelle, sans contrepartie et à vie. « Cette conquête sociale est plus que jamais d’actualité vu la crise que nous traversons actuellement« , rappelait-il récemment. Parmi les détracteurs les plus résolus de cette proposition, on trouve les partisans du « salaire à la qualification personnelle » — plus connu sous le nom de « salaire à vie ». Rassemblés autour du Réseau salariat et du théoricien Bernard Friot, ils tiennent le revenu de base pour une « roue de secours du capitalisme« . C’est qu’en appelant à lutter contre la « tyrannie du court terme de la pauvreté« , il ne ferait que prolonger l’ordre économique en place : le revenu de base ne touche pas à la propriété privée des moyens de production ni au rapport de force entre travailleurs et employeurs — s’il octroie aux gens de quoi (sur)vivre, le salaire à vie, lui, garantirait à tous le pouvoir économique et décisionnel dans le cadre d’une transformation globale de la société. Ce débat contradictoire, publié dans notre revue papier, donne à lire Philippe Van Parijs, philosophe et défenseur historique du revenu de base, et Christine Jakse, autrice de L’Enjeu de la cotisation sociale et membre dudit réseau. Premier volet, aux côtés de Van Parijs.

Le revenu de base est inconditionnel. À la fois au sens où on y a droit quels que soient ses revenus d’autres sources — c’est l’universalité ou l’absence de contrôle des ressources —, et au sens où on y a droit même si on refuse un emploi ou renonce volontairement à celui qu’on occupe — c’est l’absence de contrepartie. La première inconditionnalité permet d’accepter de travailler pour une rémunération moindre ; la seconde permet d’exiger une rémunération plus élevée. Celui qui prédit une baisse des rémunérations et celui qui en prédit la hausse peuvent donc avoir tous deux raison, mais pas pour les mêmes activités. Des stages, des emplois riches en formation ou en perspectives, des occupations gratifiantes (comme indépendant, en partenariat ou en coopérative) peuvent être rendus viables par le fait que leur faible rémunération pécuniaire est cumulable avec le revenu de base. En revanche, un travail peu formatif effectué dans des conditions physiques ou humaines dégradantes devra être payé davantage pour continuer à trouver des travailleurs susceptibles de l’occuper durablement.
Mais le problème n’est-il pas, avant toute chose, l’existence du droit à la propriété lucrative1 comme réel pourvoyeur des inégalités ?
« Pouvoir compter sans tracas sur 300 ou 400 euros en cas de renoncement volontaire à son emploi, c’est autre chose que de se retrouver, comme chômeur volontaire, sans droit à un seul sou. «
On peut voir dans le droit à la propriété lucrative la source des inégalités, mais à condition de l’entendre dans un sens suffisamment large. Il ne peut s’agir seulement de la propriété du capital matériel et financier. Il doit s’agir aussi de la possession de qualifications valorisées par le marché, ainsi que de l’appropriation d’emplois lucratifs grâce, en partie seulement, à la possession de ces qualifications. Les inégalités que le revenu de base vise à réduire, en augmentant le pouvoir de négociation de celles et ceux qui en ont le moins, sont des inégalités entre travailleurs non moins que des inégalités entre capitalistes et travailleurs.
L’une des erreurs majeures du communisme d’État a été de ne pas démocratiser la maîtrise de la production — en ne la laissant qu’à quelques-uns. C’est aussi le cas du capitalisme : ce sont les propriétaires qui disposent de la souveraineté productive. Le revenu de base ne s’apprête-t-il pas à reproduire la même erreur ?
Le communisme s’est heurté à deux difficultés économiques principales : d’une part, il n’a pas pu développer un mode de coordination efficace des activités innombrables constitutives d’une économie complexe ; d’autre part, il n’a pas pu soutenir une incitation à l’innovation analogue à l’angoisse des capitalistes face à la perspective de se laisser prendre de vitesse par leurs concurrents. Moins de bureaucratie et plus de démocratie ne l’auraient pas aidé à résoudre ces difficultés. Le revenu de base n’est pas, en principe, incompatible avec un régime de propriété collective de moyens de production — démocratique ou non. Certains de ses défenseurs, dont je ne suis pas, pensent même qu’il n’est viable que dans le cadre d’un tel régime. Mais c’est dans le cadre du monde tel qu’il est, donc de sociétés capitalistes, que le revenu de base est proposé aujourd’hui. Dans ce cadre, il vise bien à « démocratiser » l’économie, mais en disséminant le pouvoir économique, pas en remplaçant le régime de propriété. Plus son montant est élevé, plus largement il répartit tant le pouvoir de ne pas vendre sa force de travail2 à un capitaliste que le pouvoir de créer, seul ou avec d’autres, son propre emploi, ou encore le pouvoir de s’adonner à des activités productives non marchandes. Même avec un montant bien inférieur au seuil de pauvreté pour un isolé — et à condition, évidemment, que les autres dispositifs de protection sociale ne soient pas abolis dans la foulée —, l’impact d’un socle inconditionnel n’a pas à être méprisé : pouvoir compter sans tracas sur 300 ou 400 euros en cas de renoncement volontaire à son emploi, c’est autre chose que de se retrouver, comme chômeur volontaire, sans droit à un seul sou.

[Stuart Davis]
Si nous avons d’un côté le marché de l’emploi classique et, de l’autre, le temps libre, la « libre activité », ce dédoublement n’acte-t-il pas la fin d’un « régime de travail réellement humain », tel que le souhaite par exemple le juriste Alain Supiot ?
Il ne peut y avoir de distinction tranchée entre « emploi classique » et « libre activité », ni de définition monolithique du « travail réellement humain ». Il y a quantité de travail à temps partiel ou intermittent bien plus « réellement humain » que bien des emplois à temps plein et à durée indéterminée. Et il y a des doses, certes très inégales, de « libre activité » insérées dans la plupart des emplois classiques. L’information nécessaire pour faire les distinctions pertinentes ne se trouve ni chez les législateurs, ni chez les fonctionnaires, ni chez les experts, mais chez les travailleurs eux-mêmes, qui connaissent les tâches constitutives de l’emploi, les conditions dans lesquelles ils ont à les effectuer, le patron qui prend la peine de les former ou passe son temps à les harceler, les collègues qui les ostracisent ou les protègent. Il s’agit de donner le pouvoir de choisir à celles et à ceux qui disposent de cette information. C’est ce à quoi le revenu de base vise à contribuer.
Le marché de l’emploi soumet les gens à de véritables pressions d’« adaptabilité », d’« insertion » et de « flexibilité » : ils doivent rendre des comptes à des institutions de contrôle culpabilisatrices, où « se vendre » est essentiel, même pour des « bullshit jobs3 ». N’est-ce pas en contradiction avec votre théorie de « real freedom4 » ? Pourquoi ne pas attaquer frontalement le marché de l’emploi dans la constitution du revenu de base ?
« Si je défends le revenu de base, c’est au nom d’une conception égalitaire de la justice sociale qui donne à la liberté une place centrale. »
Tel que je le conçois, le revenu de base — en conjonction avec un enseignement, des soins de santé et un environnement de qualité — doit effectivement permettre de distribuer plus équitablement cette liberté réelle de vivre tel qu’on le souhaiterait, ou pourrait le souhaiter. S’il le fait, c’est notamment en attaquant frontalement le marché de l’emploi, mais pas sur un mode bureaucratique, en multipliant les réglementations pointilleuses. La manière dont le revenu de base est susceptible de transformer profondément le marché du travail était, d’ailleurs, déjà bien décrite par celui qui, le premier, en a proposé l’instauration à l’échelle d’un pays : « Il est indubitable que la constitution d’un revenu garanti, en élevant et améliorant la condition des masses populaires, les rendra plus difficiles dans le choix des professions ; mais, comme ce choix est généralement déterminé par le prix de la main-d’œuvre, il faudra que les industries dont il s’agit offrent à leurs ouvriers un salaire assez élevé pour qu’ils y trouvent une juste compensation aux inconvénients dont elles sont entourées. Ainsi, par exemple, un ramoneur de cheminées qui vit aujourd’hui misérablement, n’ayant le plus souvent qu’un croûton de pain et un méchant grabat pour prix des services qu’il rend à la société par un métier préservatif des incendies, verra, dans le système de la garantie, son gain augmenté de trois quarts au moins, par la raison bien simple que sans cette amélioration équitable il désertera le ramonage comme un état stérile et ingrat. Il préférera s’en tenir à son minimum que de remplir un rôle de dupe, et il aura parfaitement raison. » Il s’agit de Joseph Charlier, dans Solution du problème social, paru en 1848.
Le philosophe Brian Barry commente ainsi votre approche : « Ce que la liberté réelle pour tous requiert, c’est un revenu de base durable le plus élevé. Le capitalisme étant plus productif que le socialisme, il rend plus durable dans le temps ce revenu. Le capitalisme se justifie donc à condition que ses énergies productives s’attellent à la prestation de revenu de base le plus élevé possible. Le choix entre les systèmes économiques joue un rôle secondaire dans l’analyse Van Parijs5. » Peut-on étendre ce commentaire au revenu de base en général — qui serait donc neutre, politiquement ?
Brian Barry a raison. De mon point de vue, le choix du régime de propriété des moyens de production n’est pas fondamental, mais instrumental. Il est parfaitement concevable que la présomption pour le capitalisme en termes de création et d’allocation efficaces des ressources soit plus que contrebalancée par la présomption pour le socialisme en terme de contrôle sur la distribution de ces ressources. Le critère ultime est le niveau du revenu réel qu’il est durablement possible d’allouer inconditionnellement à chacun. Il en découle que, du point de vue exposé dans Real Freedom for All, défendre l’allocation universelle n’implique pas, par nécessité logique, une préférence pour le capitalisme ou pour le socialisme. Une réponse positive à la question de savoir s’il faut préférer une forme de régime capitaliste à toute forme de régime socialiste viable ne peut donc pas découler directement de ma conception de la justice, comme elle le ferait d’une conception libertarienne. Elle ne peut en découler que moyennant certaines hypothèses factuelles, qui demeurent bien entendu réfutables. Cette « neutralité » en termes de régime de propriété des moyens de production n’implique pas la neutralité politique en un sens plus général. Si je défends le revenu de base, c’est au nom d’une conception égalitaire de la justice sociale qui donne à la liberté une place centrale.
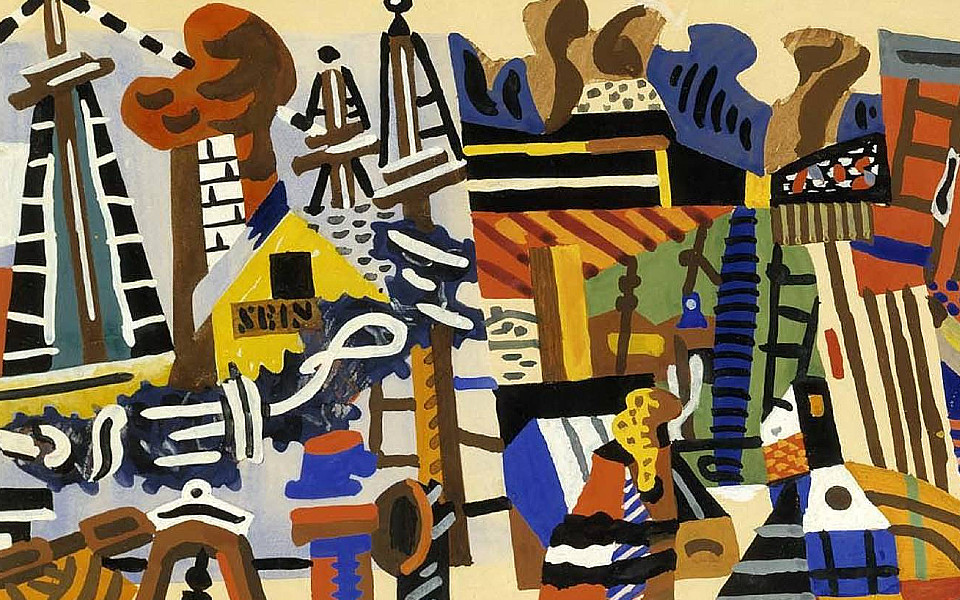
[Stuart Davis]
Ceci a pour conséquence que le revenu de base est défendu par plusieurs politiciens de droite. Quelqu’un comme Bernard Friot explique que ce système ne remet en aucun cas en cause les aspects les plus destructeurs du capitalisme. Et, même, qu’il lui offre une nouvelle légitimité…
… Il y a un des aspects les plus destructeurs du capitalisme auquel le revenu de base, comme tel, n’apporte pas remède — pas plus d’ailleurs que le socialisme : c’est la destruction des conditions de survie de l’espèce humaine sur la planète. Pour l’enrayer, il s’agit d’identifier et d’adopter au plus tôt un mode de vie qui soit durablement généralisable. Qu’on soit en régime capitaliste ou socialiste, il s’agit de modifier les comportements individuels et collectifs en internalisant les externalités négatives6 et en incorporant, dans les prix des ressources naturelles non renouvelables que nous utilisons, le coût d’opportunité pour les générations futures de leur épuisement par la nôtre. Sans suffire à relever ce défi, le revenu de base nous aide cependant à y faire face, en offrant une solution au chômage7 qui ne table pas sur la poursuite d’une croissance indéfinie. En outre, il s’attaque frontalement à bien d’autres aspects destructeurs du capitalisme, notamment en permettant aux travailleurs de lever le pied avant de succomber à un burn-out et de renoncer aux emplois qui n’ont aucun sens pour eux.
Que pensez-vous des propositions visant à installer un salaire maximum lié à une hausse des minima sociaux ? N’est-ce pas une manière de coupler à la lutte contre la pauvreté celle pour l’égalité ?
« Le revenu de base n’est pas principalement un instrument de lutte contre la pauvreté pécuniaire. C’est fondamentalement un instrument d’émancipation de chacun. »
Le revenu de base n’est pas principalement un instrument de lutte contre la pauvreté pécuniaire. C’est fondamentalement un instrument d’émancipation de chacun, qui, même à terme, devra être complété, pour certains, par un complément ciblé leur permettant d’échapper à la pauvreté pécuniaire. Mais c’est certainement un moyen de réduire les inégalités, non seulement de revenu mais de pouvoir, et donc de liberté. Seules sont justes à mes yeux les inégalités qui contribuent à l’augmentation durable de la liberté réelle de celles et ceux qui en ont le moins. Et ce n’est qu’une fraction des inégalités existant aujourd’hui sur la planète qui satisfait à cette condition. Faut-il pour autant imposer un salaire maximal ou un revenu maximal ? L’imposition d’un salaire maximal n’aurait qu’un impact limité, en raison du fait que bon nombre des plus riches perçoivent leurs revenus de plusieurs sources et les perçoivent sous la forme de dividendes, de plus-values, de droits d’auteurs, de brevets, d’honoraires, de rémunérations de services, etc., et non de salaires.
L’imposition d’un revenu maximal, pour autant qu’il soit faisable, ne se heurterait pas à la même objection, puisqu’elle pourrait porter sur un montant agrégeant l’ensemble de ces revenus. J’estime cependant préférable de taxer la tranche de revenu la plus élevée, par exemple à 95 %, et d’utiliser le produit de cette taxe pour contribuer à nourrir le revenu de base de chacun. Imposer un revenu maximum, c‘est-à-dire taxer cette tranche supérieure à 100 % n’aurait rien de scandaleux, mais ne serait pas très intelligent : autant permettre aux pouvoirs publics d’utiliser 95 % de cette tranche plutôt que de n’en utiliser rien du tout, dans l’hypothèse où, étant taxée à 100 %, elle aurait rapidement disparu. J’ajoute que pour maximiser le revenu de base, il ne s’agira pas seulement de taxer davantage les super riches, mais aussi des gens qui, comme moi, professeur d’université de grade et ancienneté maximaux, sont déjà soumis à une imposition totale (cotisations sociales comprises) de plus de 60 %, mais n’en appartiennent pas moins aux 5 % de la population dont le revenu disponible est le plus élevé. L’inégalité que la justice sociale exige de réduire ne se confond pas avec l’écart entre les 0,1 % ou 1 % des plus riches et le reste de la population.

[Stuart Davis]
Un des leviers sur lesquels s’appuient les militants du « salaire à vie » est un déjà là, c’est-à-dire les conquis émancipateurs du mouvement ouvrier : la cotisation sociale — donc la socialisation, pour partie, du salaire. Ils aspirent à les étendre et les radicaliser. Votre moteur semble être une « pensée utopique déniaisée ». Par ce biais, ne rendez-vous pas votre projet plus abstrait, lié à un espoir incertain, plutôt qu’à l’Histoire et aux luttes qui la composent ?
Comme Anthony Atkinson l’explique fort bien dans son dernier livre, Inequality, paru en 2015, il y a trois modèles de protection sociale : l’assistance sociale (qui a pris naissance au début du XVIe siècle), l’assurance sociale (qui a pris son essor à la fin du XIXe) et le revenu de base (qu’il est grand temps d’instaurer). Alors que l’assistance sociale était plongée dans une crise profonde et que Malthus, Ricardo, Hegel et Tocqueville en proclamaient la faillite et réclamaient le retour à la charité privée, la protection sociale a été sauvée par l’invention d’un nouveau modèle : la création de dispositifs d’assurance contre la vieillesse, la maladie et l’invalidité financés par les contributions de travailleurs salariés. C’est cette voie de salut, initialement imaginée par Daniel Defoe, puis Condorcet, qui l’a — heureusement — emporté, plutôt que le rafistolage du modèle ancien recommandé par Bentham, sous la forme d’une généralisation des workhouses8 pour les pauvres. Ce second modèle traverse à son tour une crise profonde, liée à un ensemble de facteurs interconnectés : mondialisation, tertiarisation, robotisation, développement du travail indépendant, intermittent et à temps partiel, affaiblissement des organisations syndicales. Pour faire face à cette crise, on peut essayer, avec l’énergie du désespoir, de sauver le modèle ancien en tentant de faire de toutes et tous des salariés à vie.
« L’instauration d’un revenu de base ne doit pas compter sur la prise de pouvoir par une minorité de révolutionnaires éclairés, mais avant tout sur la force civilisatrice du débat démocratique. »
On peut aussi opter pour l’audace d’imaginer et réaliser un modèle nouveau, un modèle émancipateur qui ne se substitue pas plus intégralement aux deux modèles antérieurs que le modèle de l’assurance sociale ne s’est intégralement substitué à celui de l’assistance sociale. Le revenu de base, ce n’est pas la table rase, la simplification radicale qui permettrait de se défaire de millions de fonctionnaires. C’est l’insertion d’un socle inconditionnel en dessous de l’ensemble de la distribution des revenus. En conséquence, l’assurance sociale et l’assistance sociale devront certes être restructurées et redimensionnées, mais ce sera de manière à les mettre en mesure de mieux jouer leurs rôles respectifs de résorption de la pauvreté et de protection contre une large gamme de risques.
Mais l’émancipation ne suppose-t-elle pas une prise de pouvoir politique, là où la « liberté » n’entend pas, en tant que telle, remettre en cause les termes mêmes des relations de pouvoir ?
L’instauration d’un revenu de base ne doit pas compter sur la prise de pouvoir par une minorité de révolutionnaires éclairés, mais avant tout sur la force civilisatrice du débat démocratique. Dans ce débat, de nombreuses considérations platement pragmatiques auront leur place, à côté des intérêts, de l’indignation et des luttes des victimes principales des dispositifs actuels. Pour qu’il ait des chances de conduire, dans un avenir proche, à l’instauration résolue d’un revenu de base, il faudra cependant que se diffuse, en outre et bien plus largement qu’aujourd’hui, la prise de conscience du fait suivant : que nous soyons capitalistes ou travailleurs, la plus grande partie de notre revenu ne doit pas plus à nos efforts qu’à notre flair ; elle est le fruit d’un héritage dont nous avons le privilège immérité de pouvoir tirer profit et qu’il est grand temps que nous trouvions le moyen de distribuer plus équitablement et plus systématiquement — y compris au-delà de nos frontières.
Illustrations de bannière et de vignette : Stuart Davis
- S’opposant à la propriété d’usage, la propriété lucrative est le droit de faire du profit ou de tirer une rente à partir d’un capital privé, quel qu’il soit (outil de travail, capital pécunier, actions en Bourse, bien immobilier, voiture que l’on loue, etc.). C’est donc, in fine, le fait de gagner de l’argent sans qu’il soit le produit de son travail, mais l’exploitation du travail d’autrui.[↩]
- Destin du travailleur dans la convention capitaliste du travail. La définition capitaliste de la valeur réduit les travailleurs, dans l’acte de production, à démontrer leur capacité de produire de la valeur économique dans une marchandise soumise aux aléas du marché du travail, évaluée au temps nécessaire à sa production. Une des causes majeures de l’aliénation au capital est de considérer la force de travail comme propriété (on « a » une force de travail, c’est un « capital humain ») de la personne capable de produire des valeurs d’usage.[↩]
- Ou « jobs à la con » : concept décrit par David Graeber, anthropologue et économiste étasunien, dans son article « On the phenomenon of bullshit jobs » : il y dénonçait la bureaucratisation de l’économie et la multiplication des emplois inutiles.[↩]
- Se réfère à une notion de liberté qui intègre trois composantes : la sécurité, la propriété de soi et l’opportunité. La « vraie liberté », c’est de pouvoir choisir parmi les différentes vies que l’on pourrait souhaiter mener.[↩]
- Brian Barry, « Real Freedom and Basic Income », dans Andrew Reeve et Andrew Williams, Political Theory after Van Parijs, Real Libertarianism Assessed, Palgrave, Macmillan, 2003, pp. 53-78. Extrait traduit par la rédaction.[↩]
- Caractérise le fait qu’une activité économique (en usine, par exemple) crée un effet externe en procurant à autrui, sans contrepartie monétaire, une désutilité, un dommage sans compensation (pollution de l’eau, appauvrissement des sols alentour, etc.).[↩]
- Situation d’un actif qui se situe hors emploi. Ce qui ne signifie pas qu’il ne travaille pas puisqu’il crée de la valeur d’usage (valeur d’un bien ou d’un service pour un usager en fonction de l’utilité qu’il en retire par rapport à sa personne, ses besoins et ses connaissances dans des circonstances données) via son travail concret (élever ses enfants, entretenir la maison, faire le papier peint de ses voisins, participer à des associations…).[↩]
- Hospices accueillant toute personne incapable de subvenir à ses besoins, sous la forme d’une assistance sociale. Philippe Van Parijs fait ici référence au philosophe Jeremy Bentham. Son nom est associé aux workhouses anglaises de l’époque victorienne, apogée de la révolution industrielle et des romans de Dickens — une part de son œuvre est une des sources de la Nouvelle loi sur les pauvres (1834).[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Bernard Friot : « Je pratique à la fois christianisme et communisme », juin 2019
☰ Lire notre entretien avec Frédéric Lordon : « Rouler sur le capital », novembre 2018
☰ Lire notre article : « Le salaire à vie : qu’est-ce donc ? », par Léonard Perrin, mars 2018
☰ Lire notre entretien avec IWW Belgique : « Renoncer à l’objectif du plein emploi », janvier 2017
☰ Lire notre entretien avec Alternative libertaire : « La sortie du capitalisme est indissociable de l’abolition du salariat », décembre 2017
☰ Voir notre débat filmé : « Salaire à vie et revenu de base en débat », Bernard Friot et Baptiste Mylondo, juillet 2016