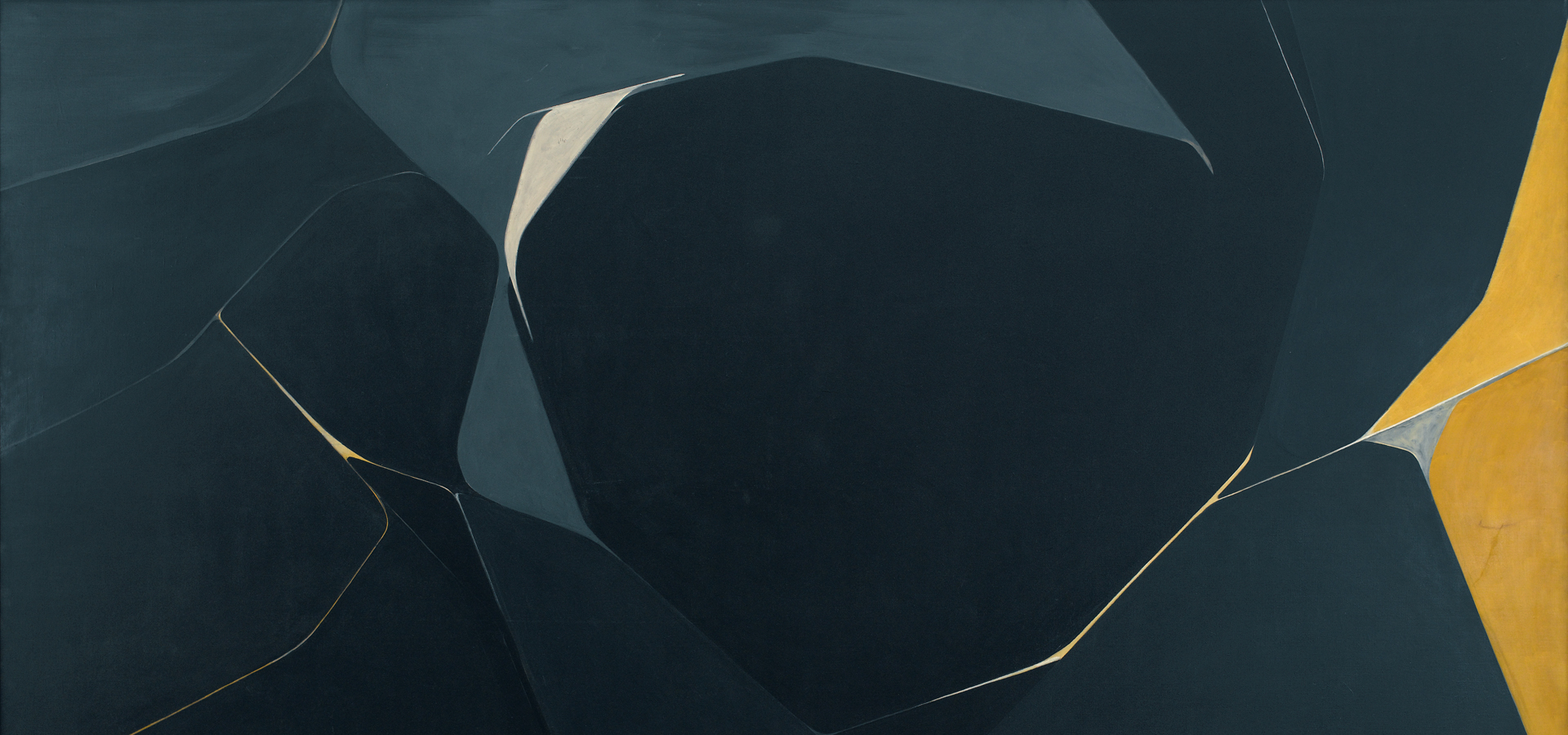Entretien inédit pour Ballast

Formellement, si tant est qu’on puisse parler de formalisme pour un réseau, il est né en mars 2013 à l’occasion d’une première rencontre internationale organisée à Saint-Denis, en France. C’était la suite de contacts et d’un travail commun entre plusieurs organisations, depuis pas mal d’années. À l’échelle européenne, l’Union syndicale Solidaires avait déjà participé à la création et l’animation d’un Réseau européen des syndicats alternatifs et de base. Mais, au début des années 2010, celui-ci s’est un peu essoufflé : les discussions sur des textes de principe prenaient le pas sur les activités syndicales internationales réelles. Dépasser ce Réseau européen, tant pour le champ géographique que pour le spectre des organisations à qui s’adresser, était une opportunité de ne pas perdre les acquis des années précédentes — tout en ne s’enfermant pas dans un cercle qui prendrait le risque de fonctionner sur lui-même. C’est l’option que nous avons retenue au sein de Solidaires et dont nous avons discuté avec notamment les camarades de la Confederación general du trabajo [CGT, État espagnol] et de la Central sindical e popular Conlutas [CSP Conlutas, Brésil]. Il s’agissait aussi de prolonger ce qui existait dans quelques secteurs professionnels. Chez les cheminots et cheminotes, par exemple, nous avions déjà constitué le Réseau Rail sans frontière, avec une rencontre annuelle, un bulletin, des tracts, quelques campagnes communes : un réseau qui comprenait des organisations syndicales du secteur ferroviaire européennes et africaines, en lien avec d’autres en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord.
Fin 2012, avec la CGT et la CSP Conlutas, nous avons lancé les invitations pour une rencontre en mars. La liste a été établie de manière simple : les organisations que nous retrouvions déjà dans des cadres communs à nos organisations (le Réseau européen que nous avons déjà cité, des rencontres internationales à diverses occasions, etc.) et toutes les organisations que CGT, CSP Conlutas ou Solidaires pensaient utile d’inviter. D’emblée, il s’agissait de fonctionner en confiance. Bien sûr, c’était la porte ouverte à de possibles manipulations, à la surreprésentation de certains courants : faire ça aurait peut-être permis à certaines et certains de briller le temps d’une réunion… Mais ça aurait aussi abouti à un échec, d’emblée, du Réseau. La démarche constructive commune à nos trois organisations, dans laquelle se sont retrouvées nombre d’autres, l’a emporté sans problème. Après Saint-Denis, les rencontres suivantes se sont tenues à Sao Paulo en juin 2015 puis Madrid en janvier 2018. Pour cause de pandémie, la IVe n’a cessé d’être reportée depuis 2020… pour finir par se tenir du 21 au 24 avril 2022, à Dijon, donc.
Mais pourquoi ce besoin d’un nouveau réseau ?
« Nous ne voulions pas bâtir un club fermé pour nous rassurer entre nous sur notre niveau de radicalité. Nous voulons disposer d’outils permettant de peser dans les rapports de force. »
Lors de la première rencontre, nous avons eu un débat important à propos des confédérations internationales existantes. Nous étions unanimes pour dire leurs insuffisances — sans doute avec des nuances entre nous, mais il n’y avait pas de différence notable sur ce point. C’est logique puisque nous voulions justement construire une alternative à la seule existence de la Confédération syndicale internationale1 [CSI] et de la Fédération syndicale mondiale2 [FSM]. Ni la ligne qu’on pourrait qualifier de « social-démocrate » de la Confédération syndicale internationale, ni le campisme de la Fédération syndicale mondiale — l’amenant à soutenir des régimes et des États criminels dont l’antisyndicalisme est une des caractéristiques — ne correspondent à notre volonté de construire un mouvement syndical indépendant et travaillant à l’émancipation sociale, totale. Pour autant, bien entendu, on peut se retrouver dans l’anticapitalisme proclamé par la FSM (mais pas du tout, c’est le moins qu’on puisse dire, dans ses soutiens et/ou silences à des régimes liberticides, sous prétexte qu’ils s’opposent à l’impérialisme étasunien). De même, les campagnes de solidarité de la CSI envers des syndicats, voire des peuples, victimes de la répression sont justes, mais la volonté politique de ne pas remettre en cause le capitalisme ne peut nous convenir.
Quelles étaient ces « nuances » ?
La CSP Conlutas et la CGT, par exemple, considéraient que nous ne pouvions accepter au sein du Réseau des organisations par ailleurs membres de la CSI ou de la FSM. Pour Solidaires, nous avons défendu un positionnement contraire : nous définissons de quel type de syndicalisme nous nous réclamons, quelles actions nous voulons mener, etc., et les organisations qui se retrouvent là-dedans peuvent rejoindre le Réseau. C’est à chacune d’entre elles, le cas échéant, de juger ce qui est contradictoire ou pas dans sa démarche, ce qui est transitoire ou non. C’est l’option mise en avant par Solidaires qui a été retenue. C’est une marque du souci de construction, d’ouverture : nous ne voulions pas bâtir un club fermé pour nous rassurer entre nous sur notre niveau de radicalité. Nous voulons disposer d’outils permettant de peser dans les rapports de force, de contribuer réellement à la défense des revendications immédiates et à la rupture avec le système capitaliste. Ça suppose que chaque organisation tienne compte des autres, ne vienne pas seulement défendre ses positions. Dans le cas évoqué, les camarades de la CGT ont dépassé leur position de congrès qui établissait qu’ils et elles devaient rejeter toute alliance avec les syndicats « traîtres », pour permettre au Réseau d’avancer.

[Pablo Palazuelo]
Organisationnellement, que signifie être un réseau ?
Essentiellement, ça signifie qu’il n’y a pas de cotisations à payer pour être membre, pas de vote par mandats dans les congrès et, d’ailleurs, pas de vote et pas de congrès. Nos échéances biennales sont des rencontres internationales où les diverses motions, les textes à propos de l’autogestion, du féminisme, du colonialisme, des droits des personnes migrantes et de la résistance à la répression sont validées au consensus. De même pour l’actualisation du manifeste. Il y a une petite centaine d’organisations, mais avec un nombre d’adhérents et adhérentes, une place dans les luttes, un poids dans les rapports de force différents : des organisations syndicales nationales interprofessionnelles, des fédérations nationales professionnelles, des unions locales interprofessionnelles, des syndicats locaux et, parce qu’il faut tenir compte des réalités qui varient selon les organisations et les pays, quelques courants ou tendances syndicales. Europe, Afrique, Amériques et, plus faiblement, l’Asie sont représentées. Pour ce qui est des secteurs professionnels, c’est à l’image de bien des organisations syndicales : éducation, ferroviaire, santé, centres d’appel, industrie, administration publique, social, commerce et services, poste, etc. Trois organisations assument la coordination du Réseau avec Solidaires : CGT [État espagnol], CSP Conlutas [Brésil], Confederazione Unitaria di Base [CUB, Italie]. Grossièrement, on peut dire qu’elles représentent dans leur pays à peu près la même chose que Solidaires en France : des organisations minoritaires mais implantées nationalement et pesant de manière indéniable dans certains secteurs. Si on se réfère à la totalité des organisations membres, vu la diversité que nous avons évoquée auparavant, c’est plus difficile à évaluer — mais je pense qu’on peut toutefois dire à peu près la même chose.
Les organisations à l’origine de la création du RéSISoL ont des fonctionnements et des positionnements différents. Il n’y a par exemple pas d’équivalents de la Charte d’Amiens, socle historique du syndicalisme en France, dans beaucoup de pays. Sur quelles bases communes avez-vous réussi à fonder ce réseau ?
La Charte d’Amiens est une référence française, c’est exact. Mais l’indépendance de classe, l’autonomie de la classe ouvrière, sa capacité à s’organiser et décider elle-même sans être dirigée par des éléments extérieurs à elle, ça, c’est une orientation politique syndicale qui traverse le monde. La base commune, on la trouve dans le manifeste qui fonde « l’adhésion » au Réseau. Ensemble, nous voulons construire « l’outil commun international nécessaire à toutes les forces syndicales qui se revendiquent et pratiquent un syndicalisme de luttes, anticapitaliste, autogestionnaire, démocratique, écologiste, indépendant des patrons et des gouvernements, internationaliste, et luttant contre toutes formes d’oppression (patriarcat, racisme, homophobie, xénophobie). La démocratie ouvrière, l’auto-organisation des travailleurs et travailleuses sont aussi parmi nos références communes ». La CGT de l’État espagnol se réfère à l’anarchosyndicalisme, la CSP Conlutas est animée par des militantes et militantes trotskystes morénistes, Solidaires parle d’un syndicalisme de transformation sociale… Alors ? On en reste là, chaque organisation se félicite de son purisme évalué à l’aune de ses seuls propres critères et on se désintéresse de la construction d’un outil commun pour peser sur le rapport de forces, pour le changement social radical ? Ou alors c’est bien le but commun qui est privilégié, et on voit ensemble comment tenir compte des positions, discussions, cultures, références propres à chacune de nos organisations — ce qui suppose de savoir les assouplir parfois ? Ce qui est déterminant est que chaque organisation rende compte à ses militant·es de ce qui est fait au sein du réseau afin que chaque collectif syndical puisse comprendre et contrôler celui-ci !
Après la création d’un réseau comme le vôtre, comment faire pour que l’internationalisme ne soit pas qu’une simple invocation au sein des structures syndicales ?
« Dans les faits, quelle part de nos activités syndicales consacrons-nous à bâtir et faire vivre des solidarités internationales actives ? »
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », « La classe ouvrière n’a pas de frontière » : mais, dans les faits, quelle part de nos activités syndicales (temps, énergie, finances, etc.) consacrons-nous à bâtir et faire vivre des solidarités internationales actives ? Avec les populations matraquées par les institutions financières capitalistes ? Avec les peuples dont l’existence même est niée par les colonialistes de tous bords ? Avec les travailleuses et les travailleurs pour qui l’esclavage demeure une réalité contemporaine ? Avec les femmes considérées comme des objets dans tant de pays ? Avec nos collègues d’autres pays, d’autres continents ? Avec les travailleuses et travailleurs de filiales à l’étranger de multinationales « françaises » ? La tâche est immense, oui. Pas plus que de vouloir « changer le monde », en limitant son action militante à « chez nous » !
Une fois ce dur constat dressé, il faut dire aussi ce que nous faisons, car ce n’est pas rien. Ainsi, plusieurs des structures professionnelles de Solidaires, notamment parmi les historiques, ont une affiliation et une activité internationale de longue date, à travers des fédérations internationales sectorielles. Souvent, des camarades de nos syndicats y jouent un rôle prépondérant : c’est le cas, par exemple, du Syndicat national des journalistes [SNJ] ou de Solidaires Finances publiques. D’autres ont fait le choix de construire des réseaux syndicaux internationaux dans leur champ d’activité : SUD-Rail est à l’origine du Réseau Rail sans frontière, Sud Santé sociaux coanime le Réseau européen pour le droit à la santé et à la protection sociale, Sud PTT a mis en place un réseau international dans les centres d’appel. Solidaires est aussi très présent, depuis l’origine, dans le mouvement altermondialiste (Forums sociaux, Contre-sommets, Alter-summit, Attac, etc.). Nous le sommes aussi dans les mouvances telles que Transnational social strike, la coordination des salarié·es d’Amazon ou la Fédération transnationale des coursiers. Le travail que nous menons en France sur certains sujets trouve aussi un prolongement international : autour de l’autogestion avec le Réseau international de l’économie des travailleurs et des travailleuses, sur le climat avec des coordinations comme Global climate strike, à travers les liens avec diverses organisations de travailleurs et travailleuses immigré.es ou de soutien à ceux-ci et celles-ci. La commission internationale de Solidaires assure aussi des liens étroits avec des peuples en lutte : Palestine, Syrie, Kurdistan, Chiapas, Hong Kong…

[Pablo Palazuelo]
Le Réseau syndical international de solidarité et de luttes est un lieu permettant la mise en commun d’histoires et de réalités différentes. Son efficacité réelle passe par la dynamisation du travail international dans les secteurs professionnels. Comme pour tout le reste de notre activité syndicale, il faut que nos informations, nos réflexions, nos actions, soient en phase avec ce qui se fait sur le terrain. Lors d’un congrès Solidaires, en 2017, nous avions défini un mandat de travail. Plutôt que de le paraphraser, citons-le : « Il faut par exemple proposer à nos équipes syndicales locales, aux sections syndicales, des tracts internationaux axés sur la réalité du travail quotidien dans l’entreprise ou le service, il faut organiser des tournées syndicales internationales, des réunions entre structures syndicales transfrontalières. […] Solidaires doit s’engager plus avant dans la prise en charge du travail au sein du Réseau des quatre thèmes retenus lors de la rencontre de 2015 : Autogestion et contrôle ouvrier, criminalisation des mouvements sociaux, droits des femmes, migrations. […] La question de l’élargissement du Réseau est une de nos priorités ; nous devons mettre à profit le travail international déjà réalisé par plusieurs de nos organisations, suivre plus efficacement les contacts pris à travers l’activité de la commission internationale. […] Pour franchir un cap dans cette construction, nous devons mieux faire connaître le Réseau, renforcer sa visibilité ». Il reste de quoi faire, mais ça avance.
Comment parvenez-vous à trouver un langage commun pour faire dialoguer les revendications des différentes structures syndicales, en dépassant les différences des modes d’organisation nationaux, voire régionaux ? Rien que l’idée d’autogestion, ou l’expression « contrôle ouvrier », ont des significations différentes selon les endroits.
C’est une des difficultés du syndicalisme international. Mais en réalité cette difficulté existe aussi au plan national, voire local : « grève générale ! », « convergences des luttes », oui, bien sûr, mais comment construire des organisations et des mouvements qui permettent à celles et ceux du secteur ferroviaire de faire grève en même temps que le personnel des EHPAD, les aides à domicile ou les sans-papiers du sous-traitant de la poste ? Ce n’est ni plus facile ni vraiment plus compliqué à l’échelle internationale. Il faut juste mettre en œuvre les moyens nécessaires aux objectifs qu’on se fixe. Si c’est la solidarité internationale et l’action internationale qui sont des priorités parce « les patrons, eux, sont organisés par-delà les frontières », alors il faut y consacrer du temps et des moyens. Mais pas seulement dans les réunions nationales ou fédérales ! Surtout dans les syndicats et les sections syndicales — c’est bien de là que nous voulons construire notre syndicalisme. Entretenir des liens avec des collectifs syndicaux similaires d’autres pays dans le monde n’est pas très compliqué. Diffuser à tous les syndiqué∙es des informations syndicales internationales est aussi à la portée de tous et toutes. Voilà deux exemples d’internationalisme aussi peu grandiloquents que réellement concret !
« L’essentiel est le travail dans la durée, à partir et en relation avec ce qui se passe dans les entreprises, services et collectifs syndicaux de base. »
Au sein du Réseau il y a tout de même les questions de traduction qu’on ne peut gommer. Pour les rencontres internationales, c’est un poste financier important car l’interprétariat est indispensable. Pour le travail quotidien, pour les activités sectorielles, on fait avec les moyens du bord : des camarades traduisent bénévolement, on se débrouille parfois sans traduction. Mais pour en revenir à la nécessité d’avoir du matériel diffusable aux travailleurs et aux travailleuses, il est évident qu’un tract international n’a d’intérêt que traduit en plusieurs langues. Autogestion, contrôle ouvrier, entreprises récupérées, économie des travailleurs et travailleuses : autant de termes qui traitent de la même problématique. Mais tout l’enjeu est là : comprendre qu’à la fois ça recouvre une même préoccupation mais aussi des divergences politiques, tactiques, culturelles… Là encore, il faut se rappeler ce qu’on veut privilégier : imposer et « gagner » l’utilisation de nos termes de référence ou faire en sorte qu’ensemble on discute et on agisse à propos du confédéralisme kurde, des entreprises récupérées d’Amérique du Sud, des expériences autogestionnaires européennes, du contrôle ouvrier qui n’a rien à voir avec la cogestion capitaliste, etc.
Parvenez-vous à mener des actions communes transnationales ?
Oui. Il y en a même que nous n’avons pas inventé et dans lesquelles nous nous inscrivons : les manifestations du 1er mai dans tous les continents, la campagne de Boycott, désinvestissement et sanctions contre l’apartheid de l’État israélien à l’encontre du peuple palestinien, la Journée internationale pour les droits des femmes du 8 mars… Au-delà, le Réseau est un outil pour mener des actions au sein de groupes internationaux (Amazon, La Poste, des centres d’appel, Renault, etc.) et de secteurs professionnels dont les caractéristiques sont proches quel que soit le pays (ferroviaire, éducation, personnel hospitalier, etc.). La réponse à la question des secteurs les plus dynamiques n’est pas évidente : ça peut varier selon les moments. L’essentiel, là encore, comme pour l’ensemble des activités syndicales, est le travail dans la durée, à partir et en relation avec ce qui se passe dans les entreprises, services et collectifs syndicaux de base. De ce point de vue, ne le cachons pas, il y a du pain sur la planche et des retards à combler si nous voulons nous doter d’outils syndicaux permettant de renverser la vapeur vis-à-vis des exploiteurs.

[Pablo Palazuelo]
Quelles ont été les conclusions des rencontres de Dijon ? Quelles problématiques communes et générales se dégagent des discussions qui y ont eu lieu ?
Reprendre ici l’ensemble du manifeste (même s’il n’est pas excessivement long) n’est sans doute pas possible. Mais en citer des extraits est sans doute le meilleur moyen de répondre à vos questions. « La bourgeoisie et les gouvernements mènent une guerre sociale contre les travailleuses et les travailleurs. Les crises économiques, financières, écologiques et sociales s’entremêlent et s’autoalimentent. Cette crise globale propre au capitalisme montre l’impasse d’un développement basé sur un partage de plus en plus inégal de la richesse produite par l’exploitation des travailleuses et des travailleurs, la déréglementation financière, le libre-échange généralisé et le mépris des impératifs écologiques. […] Le syndicalisme a la responsabilité d’organiser la résistance à l’échelle internationale, pour construire à travers les luttes, la nécessaire transformation sociale anticapitaliste. Nous voulons construire un système, d’où soit banni l’exploitation, fondé sur les biens communs, sur une redistribution égalitaire des richesses entres toutes celles et tous ceux qui la créent (c’est-à-dire les travailleuses et les travailleurs), sur les droits de ces dernier·es et sur un développement écologiquement soutenable. […] Notre syndicalisme allie la défense des intérêts immédiats des travailleuses et travailleurs, et la volonté de changement social profond. Il ne se limite pas au champ revendicatif économique, il englobe des sujets comme le droit au logement, à la terre, l’égalité entre hommes et femmes, l’antiracisme, la lutte contre l’homophobie et la xénophobie, l’écologie, l’anticolonialisme, etc. Les intérêts que nous défendons sont ceux de la classe ouvrière (travailleuses et travailleurs en activité formelle ou informelle, en retraite, chômeuses et chômeurs, jeunes en formation). Ils s’articulent avec ceux des peuples de toutes les régions du monde. En cela, nous nous opposons frontalement au patronat, aux gouvernements et institutions qui sont à son service, et nous revendiquons notre autonomie vis-à-vis de toute organisation politique. […] Nous décidons de renforcer, élargir, rendre plus efficace, un réseau du syndicalisme combatif, de luttes et démocratique, autonome, indépendant des patrons et des gouvernements, anticapitaliste, féministe, écologiste, internationaliste, construisant le changement par les luttes collectives, combattant toutes les formes d’oppression (machisme, racisme, homophobie, xénophobie, etc…). »
Les objectifs du réseau sont d’agir « dans la durée, pour la solidarité internationale, et notamment contre toute répression antisyndicale », tout en menant un combat « contre toutes les oppressions » — classistes, sexistes, racistes. Ces engagements ont vocation à se traduire par un appui aux « luttes et des campagnes internationales, en réaffirmant le droit à l’autodétermination de tous les peuples ». Ces actions peuvent se mener à la fois dans les différentes secteurs professionnels, ou de manière transversale. Le site Internet du RéSISoL constitue sa vitrine, qui permet de réunir les communiqués — ça peut sembler dérisoire mais la visibilité internationale a un véritable impact auprès de certains gouvernements — et les productions des membres.
Quelque chose de particulier a‑t-il retenu votre attention, durant cette quatrième et dernière rencontre ?
Deux faits. Tout d’abord : cinquante-deux syndicalistes ont été interdits et interdites de réunion internationale pour cause de visas non délivrés. Ils et elles devaient venir du Soudan, du Maroc, du Pakistan, d’Inde, du Mali, du Sahara occidental. Et puis on ne peut passer sous le silence le fait que cette rencontre a eu lieu en Europe, dans un moment où la guerre touchait une partie de ce continent. Dès l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le Réseau syndical international de solidarité et de luttes avait publié un texte explicitant notre positionnement et nos actions en tant que syndicalistes — donc internationalistes, anti-impérialistes, etc. Une militante syndicale ukrainienne était présente à Dijon pour nos rencontres. Par ailleurs, depuis février, nous avions organisé des réunions en visio avec des syndicalistes d’Ukraine, collecté de l’argent et du matériel, publié régulièrement des informations, participé à des cadres unitaires français et internationaux, lancé l’idée d’un convoi intersyndical français, organisé un premier convoi syndical du Réseau syndical international de solidarité et de luttes. Au sein du Réseau : aucun souci à condamner le régime de Poutine — contrairement aux positions développées par la FSM. Mais la manière d’aborder les choses varie selon les histoires politiques des pays : le poids des coups d’États étasuniens pèse dans toute l’Amérique latine, la présence dans le pays de bases militaires de l’alliance nord-atlantique influe sur la force anti-OTAN au sein du mouvement ouvrier italien, etc. Face à la guerre, aux massacres, aux remises en cause des droits des travailleurs et des travailleuses, il nous fallait impérativement éviter la division tout en demeurant ferme sur le fait que notre priorité est de répondre aux demandes de nos camarades syndicalistes sur place : soutenir la résistance du peuple d’Ukraine. D’où l’adoption, parmi de nombreuses autres, de deux motions sur ce sujet3, qui illustrent la possibilité de prendre des positions de fond tout en respectant les différences dans l’appréhension d’un sujet.
Illustration de bannière : Pablo Palazuelo
- Fondée en 2006 suite à la fusion de deux organisations préexistantes, sous l’impulsion notamment de la CGT française, la CSI est la plus grosse organisation syndicale internationale. Elle est jugée trop réformiste par ses détracteurs.[↩]
- Fondée à paris en 1945, longtemps hégémonique mais en perte de vitesse après la chute du bloc de l’Est, la FSM se définit comme anticapitaliste et anti-impérialiste. Ses détracteurs lui reprochent d’être restée une organisation marquée par le stalinisme. Elle s’oppose fortement à la CSI.[↩]
- Ici et là.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre traduction « Un syndicat chez Amazon : comment la gauche doit s’ancrer dans le monde du travail », Costas Lapavitsas, Madhav Ramachandran et Yannis Bougiatiotis, avril 2022
☰ Lire notre traduction « Femmes en grève : vers un nouveau féminisme de classe ? », Josefina L. Martinez, mars 2022
☰ Lire les bonnes feuilles « Une histoire du syndicat Industrial Workers of the World », Peter Cole, David M. Struthers et Kenyon Zimmer, avril 2021
☰ Lire notre entretien avec Charles Piaget : « La lutte des Lip », septembre 2020
☰ Lire notre article « Argentine un syndicalisme de masse », Arthur Brault Moreau, mars 2019
☰ Lire notre entretien avec Annick Coupé : « Le syndicalisme est un outil irremplaçable », juillet 2018