Texte inédit pour le site de Ballast
À l’origine, une interview de Lilian Thuram parue début septembre dans un journal italien : questionné sur les « cris de singe » racistes que subissent certains joueurs dans les stades, l’ancien footballeur a estimé qu’« il est nécessaire d’avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu’ils croient l’être ». S’en est suivie une polémique médiatique sur le « racisme anti-Blancs » et la validité, ou non, du concept même. Dans un article publié sur Mediapart, l’historien Nicolas Lebourg avance pour sa part que « le discours tenu par les obsédés du racisme anti-Blancs
est factuellement faux », mais qu’il n’est pas pour autant « rationnel de faire de la formule le racisme anti-Blancs n’existe pas
un mantra de gauche ». Mélusine, militante féministe et antiraciste, a tenu à réagir : le racisme est avant tout un rapport social systémique, et ne peut être réduit à un simple système idéologique.
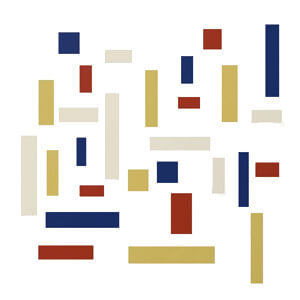
« En prétendant que l’islamophobie ne serait qu’une critique de la religion ou le racisme une idéologie de haine, on réduit la focale et le champ de lutte possible. »
Cette éclipse de l’événement raciste à l’origine de la polémique résume à elle seule l’enjeu de ces débats. On ne saurait les réduire à de simples différends lexicaux, puisque contester le sens des mots, celui d’islamophobie et celui de racisme, c’est aussi désarmer ceux qui s’en servent et, en l’occurrence, priver ceux qui étudient et qui combattent le racisme des outils qui leur sont nécessaires pour le dire, le décrire, l’analyser et, finalement, comprendre comment le détruire. Il s’agit bien d’une bataille de mots, mais elle n’est pas que cela, elle est tout cela : c’est une bataille à propos de ce qu’il est possible de dire et de montrer de la réalité sociale dans laquelle nous vivons, et donc à propos de ce qu’il est possible d’y changer. En prétendant que l’islamophobie ne serait qu’une critique de la religion ou le racisme une idéologie de haine, on réduit la focale et le champ de lutte possible.
Que la droite réactionnaire s’emploie à diluer la signification du mot « racisme » en inventant des concepts de toutes pièces sans se soucier de leur rapport à la réalité n’est pas surprenant : elle y a des intérêts politiques et matériels évidents. Mais que la gauche s’obstine à entretenir une obscurité conceptuelle et lexicale sur les questions de racisme, qu’elle refuse de tenir compte des travaux de recherche produits depuis des décennies sur ce sujet, qu’elle ne discerne plus les enjeux politiques qu’il y a à bien définir le racisme et son fonctionnement pour le combattre, voilà qui met en rage. Pour cette raison, il est nécessaire de faire à nouveau ce qu’on n’imaginait plus devoir faire : revenir sur les définitions fondamentales et les démonstrations élémentaires, en s’appuyant sur les travaux des chercheurs spécialistes des questions de racisme. La chronique de Lebourg est un matériau adéquat pour se livrer à ce travail, dans la mesure où elle s’articule à plusieurs falsifications conceptuelles, distordant les positions exprimées par les mondes académique comme militant.
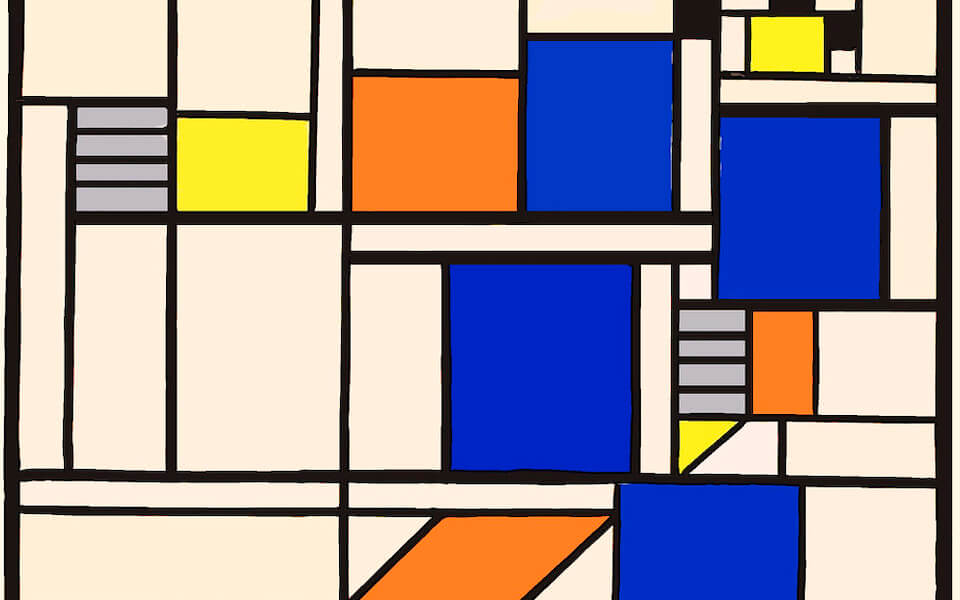
Theo Van Doesburg, Design for Leaded Light Window (1921)
Le racisme, un système social de domination
La tentative de Lebourg de donner sa chance au concept de racisme anti-blancs repose en effet sur un unique coup argumentatif : il substitue une définition partielle et minoritaire du racisme à celle qu’utilisent réellement les chercheurs et les militants auxquels il s’attaque : le racisme serait non pas un « système structurel de discriminations sociales » mais un « système idéologique », voire un simple « projet politique », qui pourrait selon lui être comparé au communisme ou à l’écologie. Il écrit ainsi : « les intellectuels qui défendent l’idée que le racisme anti-Blancs n’existe pas inscrivent plus leur analyse dans le cadre des structures sociales que dans celui des projets politiques et des représentations culturelles au long cours ». Outre le refus d’obstacle que ce glissement de définition représente, il est largement contestable : d’abord, parce qu’il choisit arbitrairement d’ignorer la réalité matérielle de la société pour s’intéresser exclusivement aux idées. Ensuite, parce qu’il écarte, sans le justifier, la définition qui prévaut aujourd’hui et depuis des décennies dans les travaux de recherche en sciences sociales et parmi les militants antiracistes, en France et à l’étranger.
« Le racisme [est] un principe d’organisation de la société, un système de domination, finalement un rapport social »
Appliquée au sexisme, cette redéfinition aurait par exemple des conséquences drastiques : le terme ne désignerait alors que les idéologies politiques qui revendiquent explicitement l’essentialisation de la féminité, l’infériorité des femmes ou leur relégation dans l’espace domestique. Autrement dit, il ne concernerait que des mouvements religieux conservateurs, certains partis de droite ou d’extrême droite et quelques groupes masculinistes confidentiels. Le sexisme ainsi entendu ne recouvrirait ni les représentations collectives, ni les normes sociales relatives aux rôles sexués. Il ne parlerait ni des habitus, ni des pratiques attachées à la féminité ou à la masculinité. Il ignorerait les inégalités institutionnelles, les violences, l’exploitation domestique, et finalement toute la matérialité quotidienne et réalisée du sexisme. Il ne dirait, finalement, rien du patriarcat, de l’organisation de la société, de la domination vécue et entretenue.
C’est pour éviter cette impasse idéaliste que la plupart des chercheurs en sciences sociales préfèrent à la définition de Lebourg une définition forte, qui considère le racisme comme un principe d’organisation de la société, un système de domination, finalement un rapport social, celui qu’entretiennent des groupes distingués et hiérarchisés par un principe racial3. Cette définition permet de lier la structure et la superstructure, de dire la réalité matérielle et l’hégémonie culturelle qui vient la justifier et l’entretenir. Elle prend au sérieux le processus d’altérisation et d’hostilité — de racisation4 — qui, au-delà des idéologies politiques et scientifiques racistes, a façonné les imaginaires, les corps, le langage et l’organisation sociale, au fil de plusieurs siècles d’esclavage, d’exploitation économique, d’occupation militaire, de gestion administrative, de discriminations en droit et en fait, de dépréciation esthétique, morale, culturelle et symbolique.
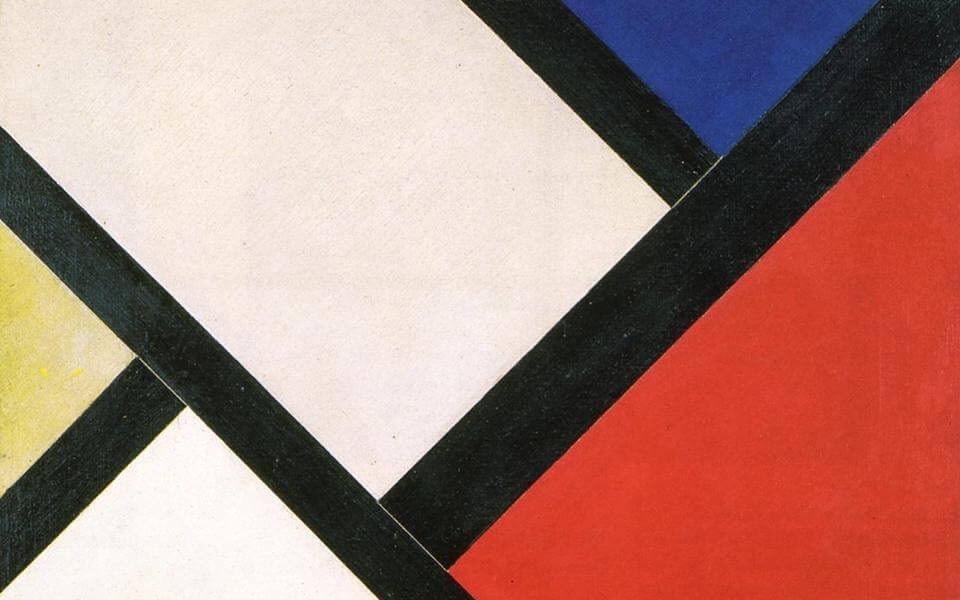
Theo Van Doesburg, Counter Composition XIV (1925)
Les blancs, un groupe social dominant
C’est donc sur une définition réductrice du racisme que s’appuie Lebourg lorsqu’il dénonce l’essentialisation raciste consistant à prétendre qu’un « groupe biologique » (sic) pourrait avoir le monopole d’une idéologie politique. Ce faisant, il conteste un argument que personne n’avance, sans doute parce qu’il méconnaît profondément les nombreux travaux de sciences sociales sur le groupe blanc. « L’un des problèmes majeurs des polémiques actuelles est qu’elles tiennent la subdivision raciale entre Blancs et Noirs comme un fait acquis, naturel et multiséculaire », affirme Lebourg. De fait, l’ensemble de la littérature sur le sujet démontre le contraire. L’organisation raciale du monde social est toujours envisagée non comme une réalité intemporelle ou nécessaire, mais comme le produit d’une histoire longue, dont la forme actuelle est l’héritière de l’Empire, de l’esclavage et de la colonisation européens5. Les chercheurs français ont d’ailleurs particulièrement étudié la constitution sociohistorique du groupe blanc, notamment en colonies, à travers la création administrative des catégories raciales ou l’évolution des sciences racialistes6.
« Les blancs sont en réalité appréhendés comme un groupe social produit par le racisme lui-même : ils sont blancs parce qu’ils entretiennent un rapport de domination particulier avec les groupes racisés. »
Aux États-Unis, la construction du groupe blanc comme position socioéconomique dont les frontières varient dans le temps et l’espace a également donné lieu à une littérature importante7. Ainsi, contrairement à ce que croit Lebourg, lorsque les chercheurs parlent des blancs, ils ne parlent ni d’une race supérieure décrite par les idéologues du XIXe siècle, ni d’un groupe partageant des critères biologiques — dont celui de la peau blanche. Les blancs sont en réalité appréhendés comme un groupe social produit par le racisme lui-même : ils sont blancs parce qu’ils entretiennent un rapport de domination particulier avec les groupes racisés, parce qu’ils sont distingués des non-blancs, parce qu’ils occupent, toutes choses égales par ailleurs, une position sociale et symbolique qui leur est supérieure. Le qualificatif « blanc » ne désigne pas une qualité de l’être, mais bien une propriété sociale : il ne dit pas l’identité des individus, mais leur position dans la société, dans le rapport de domination raciste.
On peut donc déjà comprendre pourquoi le refus du concept de racisme anti-blancs n’a rien d’un dogme, mais est la conséquence nécessaire du fonctionnement du système raciste, compris comme la domination des blancs sur les non-blancs. Non pas parce que les blancs seraient par nature dominateurs et racistes, mais parce que les blancs, qui n’ont aucune existence de nature, n’existent comme groupe qu’à travers la domination qu’ils exercent effectivement sur les autres groupes sociaux, et qui se traduit à la fois par une hégémonie culturelle et par une organisation sociale inégalitaire, chacune facilement constatable. Finalement, il s’agit presque d’un problème de logique : les définitions posées, l’impasse conceptuelle est claire.

Theo Van Doesburg, Simultaneous Counter Composition (1929)
Les non-blancs et l’idéologie raciste
Dans ces conditions, qu’en est-il du rapport des non-blancs à l’idéologie raciste ? Lebourg écrit en effet — et c’est une phrase qui mérite d’être relue à plusieurs reprises pour en goûter l’insulte : « Penser qu’un Noir ne pourrait être raciste devrait éveiller chez les antiracistes l’écho de la phrase justement décriée de Nicolas Sarkozy sur “l’homme africain” qui ne serait “pas entré dans l’Histoire” ». À nouveau, Lebourg n’entend le racisme que comme une idéologie politique et s’étonne qu’on puisse croire que les non-blancs ne seraient pas capables d’adhérer à toutes les idéologies imaginables. Et à nouveau, en distordant le sens des mots, il fausse les idées qu’il prête à ceux dont il se fait le contradicteur.
« Les blancs comme les non-blancs sont pris dans la toile de la domination raciste, et s’extraire de l’hégémonie culturelle est, pour les non-blancs, une condition nécessaire de leur émancipation. »
Parce qu’évidemment, les personnes non blanches peuvent être racistes. Elles peuvent l’être parce que, comme l’ensemble de la société, elles sont perméables à l’hégémonie culturelle qui façonne depuis l’enfance leur vision du monde et d’elles-mêmes. Elles peuvent l’être en tant qu’elles partagent malgré elles l’échelle de valeurs et la grammaire symbolique du groupe dominant : elles peuvent, elles aussi, accepter la naturalité de la division raciale, la supériorité esthétique et morale des blancs, la valorisation des traits physiques ou culturels qui les rapprochent du modèle hégémonique et donc le rejet de ceux qui en paraissent plus éloignés. Ainsi, elles peuvent pleinement participer à la reproduction du système raciste et, conformément aux catégories dominantes de la société dans laquelle elles vivent et aux représentations qui leur sont associées, exercer discrimination, violence et exclusion à l’égard d’autres groupes racisés. Les expressions ponctuelles de haine envers le groupe dominant elles-mêmes doivent être considérées dans le cadre général de l’hégémonie blanche et des catégorisations raciales qu’elle impose, comme une violence de réaction — condamnable évidemment à titre individuel, mais révélatrice d’aucune structure politique et sociale à renverser. Comme l’écrit Frantz Fanon, les blancs comme les non-blancs sont pris dans la toile de la domination raciste, et s’extraire de l’hégémonie culturelle est, pour les non-blancs, une condition nécessaire de leur émancipation8.
Cette asymétrie conceptuelle fondamentale n’est pas une injustice faite aux blancs, elle dérive de l’inégalité sociale effectivement réalisée. Le racisme n’avait en effet pas à être, nécessairement, une hégémonie blanche. Mais il se trouve qu’il l’est, parce que l’histoire contingente l’a fait ainsi, avec la construction scientifique et idéologique des races humaines qui a remodelé profondément les modalités d’expression de la domination sur l’ensemble de la planète ; avec la conquête européenne du monde, la mise en esclavage industrielle et la colonisation ; les génocides et les massacres perpétrés sur les cinq continents ; la mondialisation impérialiste, extractiviste et inégalitaire ; l’organisation raciste actuelle des sociétés dites occidentales et l’hégémonie culturelle qui s’étend bien au-delà de leurs frontières9. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas d’autres rapports sociaux racistes, aujourd’hui, dans d’autres pays du monde, ni qu’il n’aurait pas pu exister dans une réalité parallèle, un système raciste opprimant les blancs. Seulement que, dans le monde dans lequel nous vivons, l’hégémonie blanche est incontestable, matérielle, pluricentenaire et vivace.
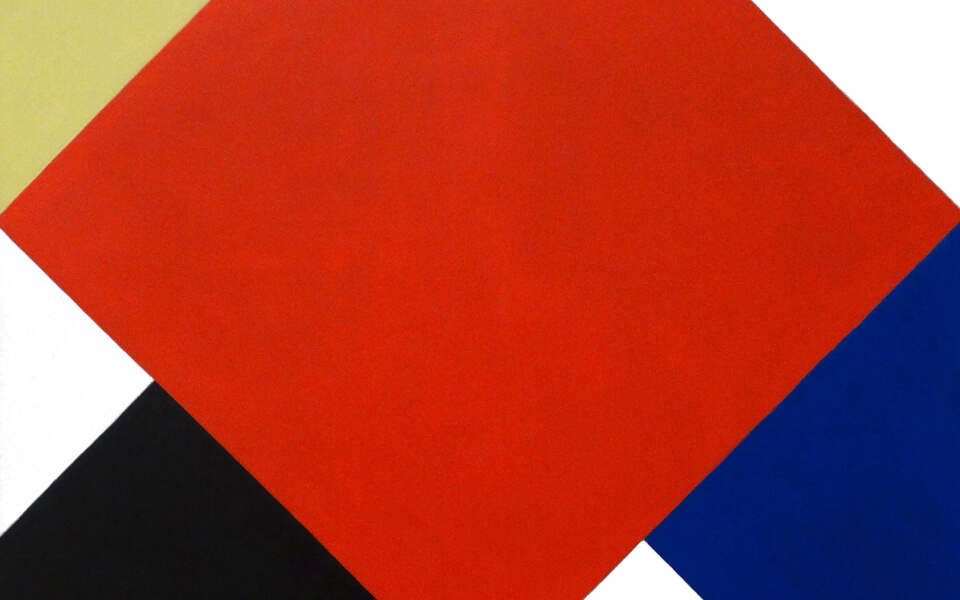
Theo Van Doesburg, Counter Composition V (1924)
Malgré ces erreurs factuelles, ces redéfinitions arbitraires et la méconnaissance des travaux scientifiques sur le racisme qu’elle révèle, la chronique de Lebourg a eu un grand succès dans les courants réactionnaires de la gauche républicaine10 : en effet, elle participe au travail général de sape des mots utilisés pour dire le racisme — le racisme structurel, matériel, institutionnel, indéboulonnable — en relativisant l’importance des structures sociales au profit d’une analyse idéaliste libérée de tout impératif de relations avec le réel. Il est temps de se demander pourquoi autant d’intellectuels de gauche sont si peu effarouchés de se caler sur le tempo des obsessions de l’extrême droite, à une époque où l’ensemble de l’espace politique se droitise et où les politiques inégalitaires et répressives se durcissent. Pourquoi ces intellectuels, la presse progressiste et les partis politiques de gauche ne prennent pas au sérieux les travaux scientifiques sur le racisme et alimentent activement les efforts transpartisans de discrédit qui visent les mouvements militants antiracistes. Pourquoi, enfin, ils font si peu de cas de la violence raciste subie par des millions de personnes dans leur pays, cette violence économique, physique, sociale et symbolique qui n’est ni théorique, ni potentielle, mais qu’ils n’hésitent pas à relativiser — peut-être au nom de la défense des intérêts de leur propre groupe social.
Image de miniature : Theo Van Doesburg, Composition VIII
Image de bannière : Theo Van Doesburg, Simultaneous Counter-Composition (1929–30)
- Note de la rédaction : Nous avons respecté la volonté de l’autrice d’écrire « blanc » et « non-blanc » sans majuscule. Celle-ci s’en explique dans d’autres articles : elle n’applique pas la règle typographique de la majuscule aux peuples ou aux groupes ethniques puisqu’elle entend désigner, dans ce cadre de réflexion, un groupe social.[↩]
- Élise Vincent, « Racisme anti-Blancs : la formule qui fâche », Le Monde, 25 octobre 2012, republié le 9 septembre 2019.[↩]
- Lila Belkacem [et al.], « Prendre au sérieux les recherches sur les rapports sociaux de race », Mouvements, février 2019.[↩]
- Colette Guillaumin, L’Idéologie raciste. Genèse et langage actuel, Mouton, 1972.[↩]
- Nell Irvin Painter, The History of White People, W. W. Norton & Company, 2010.[↩]
- Sylvie Laurent et Thierry Leclère (dir.), De quelle couleur sont les Blancs ?, La Découverte, 2013.[↩]
- Noel Ignatiev, How the Irish Became White : Irish-Americans and African-Americans in the 19th Century, Routledge, 1995 ; Karen Brodkin, How Jews Became White Folks and What That Says About Race in America, Rutgers University Press, 1998.[↩]
- Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Seuil, 1952.[↩]
- Amélie Le Renard, Le Privilège occidental. Travail, intimité et hiérarchies postcoloniales à Dubaï, Presses de Sciences Po, 2019 ; recension de Mehdi Derfoufi dans Orient XXI, publiée le 6 septembre 2019.[↩]
- Note de l’autrice : notamment au sein du Printemps Républicain, à commencer par Gilles Clavreul qui en est l’un des cofondateurs, ou encore un certain nombre de militants du Parti socialiste.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Audre Lorde : le savoir des opprimées », de Hourya Benthouami, mai 2019
☰ Lire notre entretien avec Françoise Vergès : « La lutte décoloniale élargit les analyses », avril 2019
☰ Lire notre entretien avec Angela Davis : « S’engager dans une démarche d’intersectionnalité », décembre 2017
☰ Lire notre traduction « Femmes noires et communistes contre Wall Street », Claudia Jones, décembre 2017
☰ Lire notre entretien avec Amandine Gay : « À qui réussit-on à parler ? », janvier 2017



