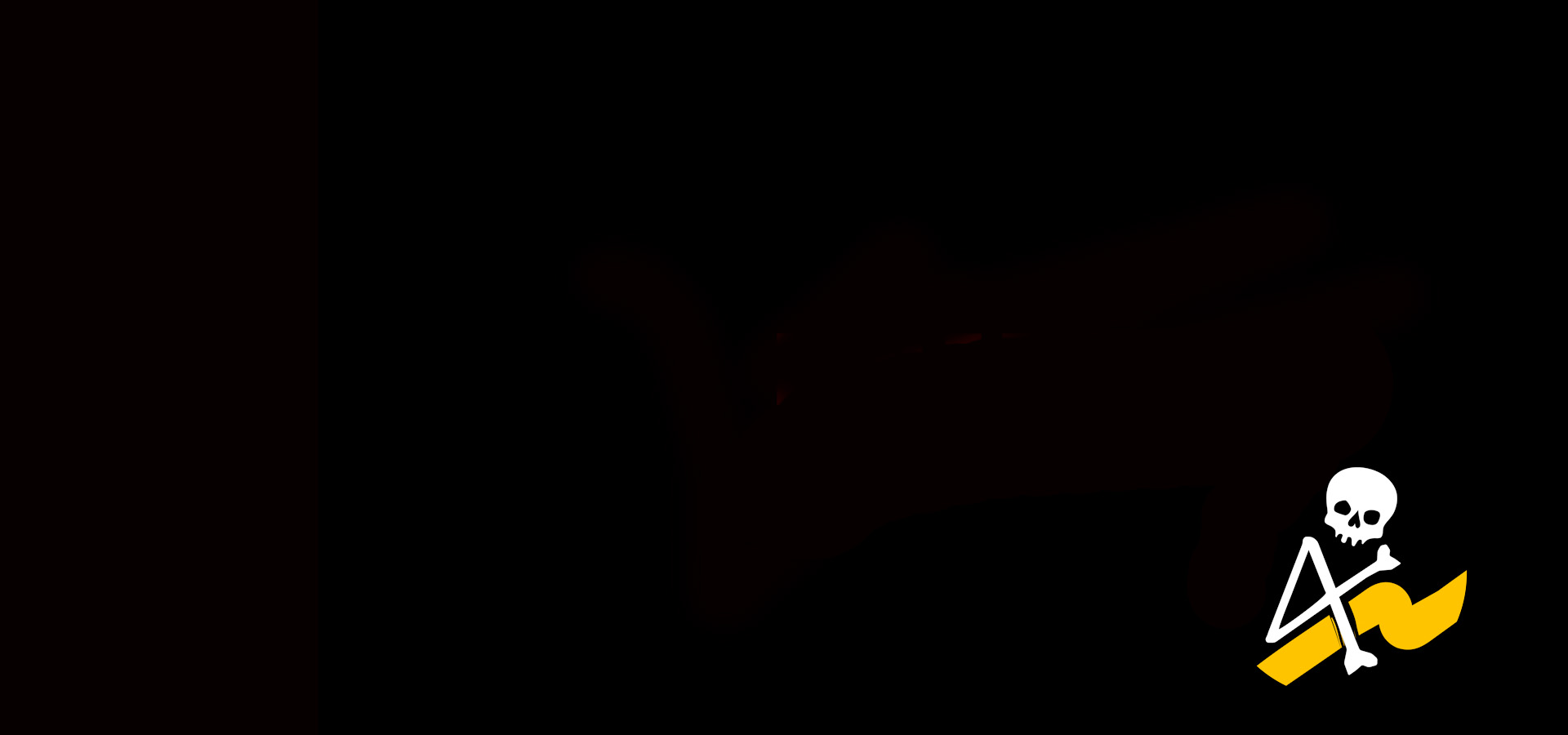Entretien inédit pour le site de Ballast | rubrique Relier
Le blues et la Commune, la pédagogie et la révolution russe, les droits civiques et la prison, Jack London et Simone Weil : le lien ? Une petite douzaine d’années et une grosse centaine de livres au compteur des éditions Libertalia, également libraires à Montreuil. Si leur ancrage libertaire est revendiqué — jusque dans leur nom, bien sûr, en écho à l’utopie pirate dont la légende dit qu’elle fut fondée à Madagascar, au XVIIe siècle, afin que « le peuple lui-même [soit] l’artisan et le juge de ses propres lois » —, leur catalogue fait la part belle à l’ensemble des courants anticapitalistes : « Toutes celles et ceux qui se battent pour des lendemains moins sombres appartiennent à la même famille que nous. » Nous les croisons régulièrement au détour d’une manifestation et il n’est pas rare que leurs livres s’empilent sur nos bureaux ou remplissent nos poches ; nous avons donc pris le temps de nous arrêter, histoire de discuter d’espoir, de sous et de bouquins.

Nous avons créé Libertalia il y a une douzaine d’années sans avoir la moindre idée de ce que deviendrait ce projet, sans vision claire de la ligne éditoriale, sans « budget prévisionnel » ou autre « plan de financement ». Nous souhaitions simplement rééditer quelques vieux textes, proposer un peu d’inédit rock’n’roll et enragé, et diffuser tout ceci prioritairement sur nos tables de presse en concerts et en manifs. On avait déjà l’expérience de la vente à la criée, puisqu’on autodiffusait notre fanzine Barricata à quelque 2 000 exemplaires. En quelques années, on a progressivement appris le métier mais on a conservé notre côté forain. Aujourd’hui, Libertalia reste une petite maison, mais nous avons acquis une certaine légitimité et une honorable visibilité. Pour autant, nous sommes toujours en proie au doute.
Que redoutez-vous ?
« La défaite du mouvement social de l’automne 2010 nous a amenés à reconsidérer notre mode opératoire. »
De ne pas réussir à saisir l’or du temps, de faire fausse route, de « prêcher » dans le vide. De façon récurrente, on se pose la question de la poursuite de l’aventure Libertalia. Est-ce que ça a vraiment un sens ? Est-ce que nous sommes plus utiles ici qu’ailleurs ? Et comment préserve-t-on notre propre équilibre au sein du tumulte quotidien ? Nous sommes las des misérables querelles intestines, des mesquineries quotidiennes ; on a parfois la tentation de disparaître pour vivre autrement.
Vous venez de la CNT et d’une vision stricte, sinon sectaire, de l’anarchisme. Pourtant, « nous n’avons pas d’ennemis à gauche », nous avez-vous dit un jour. Vous concevez de plus en plus Libertalia comme une passerelle : entre quelles rives ?
On aime bien l’image du pont, ou de la passerelle, qui s’oppose à celle des murs que tous les gouvernants s’échinent à bâtir dans les esprits et aux frontières des mondes physiques et sociaux. Il est clair, en effet, que nous avons changé de façon d’agir. Après des années de militantisme effréné, on a levé le pied. Pour deux raisons : la défaite du mouvement social de l’automne 2010 nous a amenés à reconsidérer notre mode opératoire — nous avons lâché nos mandats pour nous concentrer davantage sur la vie de la maison d’édition ; peu après, avec Charlotte [Dugrand], nous avons eu deux enfants, et on a tenu compte des conseils des vieux camarades : « Ne négligez pas le quotidien, vous le regretteriez. » Quelques années et quelques cheveux blancs plus tard, nous sommes toujours présents, mais moins dans l’animation, plutôt dans l’accompagnement des luttes et des moments d’intensité politique. Par conséquent, sans rupture, nous avons délaissé une forme de patriotisme organisationnel pour tenter d’établir des liens entre les mondes qui résistent. Aujourd’hui, nous sommes une maison d’expression libertaire avec une identité forte et sans œillères.
Relier toute la « gauche radicale » ? Le « camp anticapitaliste » ? Comment on appelle ça ?
Nous sommes solidaires de toutes celles et de tous ceux qui font avancer les choses dans la voie de l’émancipation, que ce soit d’un point de vue social ou sociétal. Ça regroupe toute la gauche radicale et au-delà. Donc les collectifs autonomes, féministes, antifascistes, les syndicats, les organisations politiques, mais également les troupes de théâtre, les groupes de musique, les cinéastes, les maisons d’édition, les libraires, les animatrices et animateurs de revues…
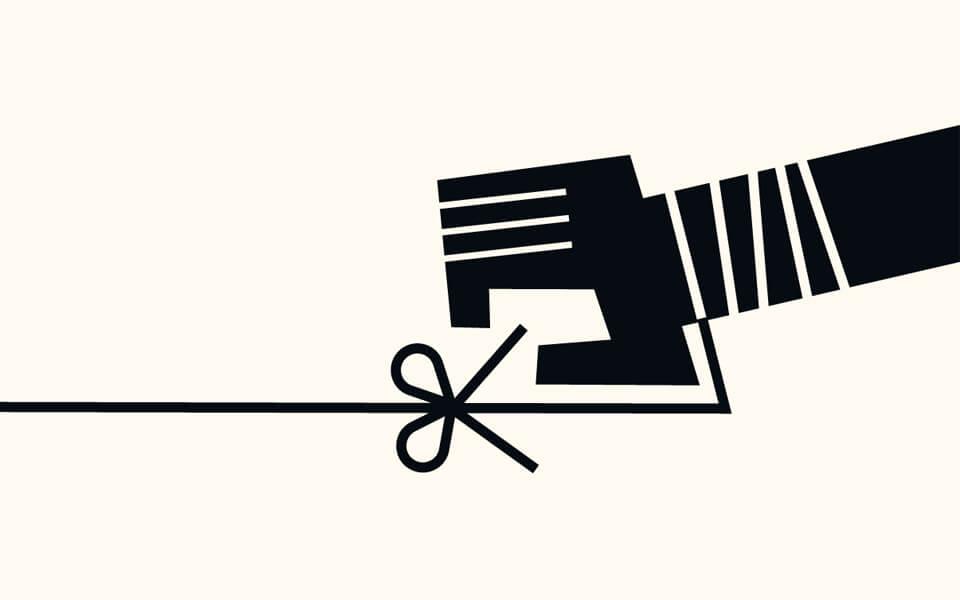
[L’Apostat (2018) | visuel : Bruno Bartkowiak]
Jack London, un auteur qui vous est cher, disait : « Nous autres socialistes, anarchistes, vagabonds, dévaliseurs de poulaillers, hors-la-loi, citoyens indésirables. » Ce serait une bonne ligne éditoriale, ça ?
Il écrivait ceci en 1911 et ajoutait qu’il souhaitait qu’il y ait davantage de dévaliseurs de poulaillers et de hors-la-loi. Mais, dans le même temps, il faisait bâtir le plus grand des poulaillers : la Wolf House, sa maison gigantesque de Glen Ellen, comprenant une entrée de service pour les domestiques et une piscine au dernier étage pour le maître des lieux ! Jack London, le fils de rien, celui qu’on aime tant, était alors devenu un opulent propriétaire foncier pétri de contradictions. Que lui restait-il du souffle romantique et vengeur du Frisco Kid ? Celui qui pillait 20 ans plus tôt les parcs à huîtres, buvait vite et frappait fort…
Il y a chez vous une affection pour ce que Raoul Vaneigem appelle « le parti pris de la vie », dans son Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations. Ce positionnement relativement peu universitaire, et finalement assez marginal au sein de l’édition « critique », est d’abord affaire de dispositions personnelles ou de ligne idéologique ?
« Toutes celles et ceux qui se battent pour des lendemains moins sombres appartiennent à la même famille que nous. »
Vaneigem est un penseur qui nous est cher, et c’est un auteur maison, puisque nous avions naguère réédité l’Histoire désinvolte du surréalisme, et que nous venons de publier un inédit, Appel à la vie contre la tyrannie étatique et marchande, dans lequel le vieux combattant n’en finit pas de régler son compte au spectacle. Le Traité, on l’a lu à 20 ans, et ça fait partie des livres qui ont changé notre existence. Oui, il faut changer la vie en commençant par changer la nôtre et profiter du quotidien sans céder au repli égotiste. Toutes celles et ceux qui se battent pour des lendemains moins sombres appartiennent à la même famille que nous. Cela peut sembler un peu naïf ainsi, mais ça répond à des prédispositions personnelles. Parmi les trois animateurs de Libertalia, il n’y a pas d’héritiers et, à l’échelle de deux générations, on vient du peuple d’en bas. Si nul d’entre nous n’a connu la faim, je me souviens encore de certaines fins de mois de mon enfance : dans le frigo, il n’y avait que du lait, des pâtes et des œufs. Ça contribue à forger une conscience, voire une haine de classe. Et tout ceci, très vite, entra en résonance avec Camus, Vallès ou Jules Renard. Ce positionnement éditorial est donc à la fois personnel et idéologique. L’idéologie est venue consolider plus tard ce qui était déjà en germe. Par ailleurs, et il ne faut pas le minorer, nous venons de familles au fort héritage militant, que celui-ci soit chrétien de gauche, communiste, anarchiste, ou à la limite du banditisme social. Dans ces familles, le livre était l’objet sacré, celui de l’émancipation.
L’éditeur de La Fabrique, Éric Hazan, avance dans Pour aboutir à un livre que son principal critère en matière de choix d’un texte est son caractère « offensif ». Entendre qu’il ne doit pas décrire le monde, ni même le critiquer, mais « propose[r] des pistes pour sa subversion ». Ça vous parle ?
Complètement. Éric a raison. On va employer toutes nos forces au cours des prochaines décennies à contribuer à la guerre en cours contre le capital. Sans toutefois délaisser la littérature et le rock’n’roll, qui permettent d’ouvrir vers des moments de joie et de quiétude. Mais serons-nous seulement audibles ? Est-ce que ce qu’on l’on raconte fait encore sens à l’heure du repli individualiste béat et de la conflictualité en berne ?
Mais ne vivons-nous pas une sorte de sursaut ? Ici, les gilets jaunes contre l’oligarchie néolibérale ; en Algérie, le mouvement contre l’oligarchie militaire…
C’est vrai, il y a encore des mobilisations, mais de là à parler de « sursaut » ! De quand date le dernier grand mouvement de masse victorieux ici ? De 1995 ? Ça commence à dater tout de même ! Le monde qui portait ces mobilisations, la vieille gauche syndicale, n’en finit plus de vieillir et de se déliter. Tout est à reconstruire et à réinventer, là est l’espoir. Et pour ça, il faut fédérer : Ballast le fait très bien, à son échelle.

[Tout est possible ! (2018) | visuel : Bruno Bartkowiak]
Vous assumez un côté « famille » : vous ne publiez que les auteurs que vous connaissez ou qu’on vous recommande. Pourquoi ne pas laisser leur chance aux inconnus ?
Parmi nos principales contradictions, il y a celle-ci : on défend l’idée d’une vie au juste rythme, en profitant de l’instant présent, mais dans les faits, on bosse tout le temps, jamais moins de 60 heures par semaine. Libertalia publie plus de 20 livres par an : c’est beaucoup, c’est peut-être trop pour une si petite structure, mais on a envie de publier de l’histoire, de la pédagogie, de la littérature, de la pensée critique, et les publications s’enchaînent. Nous n’avons donc pas le temps d’étudier les manuscrits qu’on nous envoie. Nous avons même le plus grand mal à boucler les livres à paraître. Donc on se protège comme on peut, notamment en ne répondant pas. Il ne faut pas y voir du mépris, juste du surmenage. Et puis ceci ne nous empêche pas de réfléchir à des thèmes qui nous semblent essentiels, et alors on se met alors en quête d’autrices ou d’auteurs.
D’ailleurs : est-il possible d’anticiper le succès ou l’insuccès, même à la louche, d’un livre ?
« Il y a des sujets peu vendeurs, on le sait d’expérience : tout ce qui a trait aux migrants et au Proche-Orient. »
Il y a des sujets peu vendeurs, on le sait d’expérience : tout ce qui a trait aux migrants et au Proche-Orient. Cela ne nous empêche pas de publier ce type d’ouvrages. Mais on sait qu’il faudra les contrebalancer par d’autres titres plus faciles. On a du mal à anticiper le succès d’un livre. D’ailleurs, celui-ci reste toujours très relatif chez nous : quelques milliers d’exemplaires. Il y a un seuil que nous n’arrivons pas à franchir, celui des 10 000 exemplaires vendus. Ou alors il nous faut huit ans ! À l’instar des éditions Maspero, et en toute transparence, on mentionne les tirages à la fin de nos ouvrages. Rien n’est plus réjouissant que procéder au troisième ou au quatrième tirage d’un livre qui semblait originellement à « faible potentiel ».
En 2010, vous disiez même que vous ne vouliez pas gagner d’argent avec Libertalia. Aujourd’hui, vous dégagez des salaires. Comme tout bienfait a son revers : que gagne et que perd-on à se « professionnaliser » ?
À ce jour, au terme de 12 années d’existence, Libertalia est en mesure de rémunérer l’équivalent de trois SMIC. Par conséquent, on ne vit pas des activités de la maison d’édition, ça relève davantage du défraiement. Bruno [Bartkowiak], le graphiste et webmaster, pige ici ou là pour compléter ses menus émoluments ; Charlotte est correctrice pigiste au Parisien pour arrondir les fins de mois ; on provisionne l’équivalent d’un SMIC pour une libraire qui nous rejoindra dans quelques semaines ; on essaie aussi d’inventer de l’argent pour embaucher une éditrice-libraire en septembre 2019. Quant à moi [Nicolas Norrito], après quelques années à temps partiel et même deux trimestres en disponibilité, je suis temporairement de retour à temps plein dans l’Éducation nationale. Parce qu’on a des mômes, un lourd crédit, et que le compte n’y est pas encore. Ça c’est la réalité prosaïque d’une maison d’édition qui vend près de 50 000 livres par an, mais qui fait en sorte de maintenir les prix à un niveau décent, et tente de rémunérer les auteurs et les traducteurs avec le moins de retard possible. Alors peut-on parler de « bienfait » et de « revers » ? Disons plutôt que ceci explique pourquoi les éditrices et éditeurs sont si souvent des enfants de la bourgeoisie intellectuelle : mieux vaut bénéficier d’un solide capital quand on se lance dans pareille aventure ! Mais pour répondre franchement, nous sommes davantage attentifs à l’équilibre financier de nos publications désormais. Il y a donc des livres que nous aurions pu éditer il y a quelques années mais que nous ne ferions plus aujourd’hui — notamment de grosses traductions d’ouvrages anciens.

[Mon histoire (2018) | visuel : Bruno Bartkowiak]
« Le véritable engagement requiert une action plus directement concrète que le seul fait d’éditer des livres, sinon c’est vraiment s’en tirer à bon compte », estimait l’éditeur François Maspero. S’il est l’une de vos sources d’inspiration, pourriez-vous toutefois signer ce propos ?
François Maspero a incarné l’édition critique durant plus de 20 ans, de 1959 à 1982. Ce qu’il publiait s’ancrait dans une époque et a accompagné de façon extrêmement concrète la réalité quotidienne des luttes. Par conséquent, le fonds de la Petite Collection Maspero — 282 titres numérotés, un peu plus en réalité — a énormément vieilli tant les ouvrages étaient en phase avec les revendications des lycéens, étudiants, travailleurs, détenus, militants anti-impérialistes de l’époque. Après avoir cédé son catalogue à François Gèze en 1982, Maspero n’a pas disparu : il a traduit de magnifiques auteurs, comme Luis Sepúlveda et Álvaro Mutis, et rédigé de grands livres empreints de poésie et de combativité. Lisez son ouvrage sur Gerda Taro, et Les Abeilles et la guêpe ! Maspero, dans cette implacable sentence, semble être dans le vrai : il ne faut nullement idéaliser ou surestimer notre petite action d’éditeurs. On publie des livres qui peuvent avoir un certain écho à un moment, mais ceci participe d’un mouvement global. Il n’y a pas là matière à se prendre pour un voyant. Dans les faits et en pratique, nous ne sommes (presque) rien.
Avoir, depuis peu, une librairie à Montreuil, ça appelle à quoi ?
À notre désir de contribuer, en armant les esprits, à ce que demain ne soit pas aujourd’hui en pire. Et si on échoue, tant pis, au moins nous aurons essayé. Notre petite librairie se veut un lieu de partage, de quête, elle s’inscrit dans un écosystème : Montreuil, une ancienne cité de la banlieue rouge en cours de gentrification, mais encore populaire et épicée. Dans les faits, on rêve d’un lieu quatre fois plus grand, où l’on pourrait organiser des rencontres avec 200 personnes, des projections, des spectacles… Affaire à suivre !
Photographie de vignette : Maya Mihindou | Ballast
Cette rubrique donnera, au fil des mois, la parole à ceux que l’usage nomme, dans le camp de l’émancipation, l’édition et les médias « indépendants » ou « alternatifs » : autant de sites, de revues et de maisons d’édition qui nourrissent la pensée-pratique. Si leurs divergences sont à l’évidence nombreuses, reste un même désir d’endiguer les fameuses « eaux glacées du calcul égoïste » : partons de là.
REBONDS
☰ Lire « Fonder des territoires — par Raoul Vaneigem », avril 2019
☰ Lire notre entretien « Michèle Audin raconte Eugène Varlin », avril 2019
☰ Lire notre entretien avec Véronique Decker : « Aux côtés des élèves, jamais face à eux », septembre 2018
☰ Lire notre article « B. Traven : ombre et révolte », Thomas Misiaszek, février 2018
☰ Lire notre entretien « Des hommes et des bagnes », octobre 2015
☰ Lire notre entretien « Que deviennent les zapatistes, loin des grands médias ? », novembre 2014