Entretien inédit pour le site de Ballast
Les écoles de Seine-Saint-Denis apparaissent trop souvent comme des prisons pour enseignants débutants, des territoires où l’on a remisé l’espoir d’un monde meilleur pour les enfants qui y passent. Pourtant, Véronique Decker l’affirme : elle a « toujours beaucoup aimé [y] enseigner ». À quelques années d’une retraite qu’elle admet tout de même attendre impatiemment, cette directrice d’école primaire poursuit son combat pour une école émancipatrice au sein d’un établissement (public, bien sûr) « Freinet », à Bobigny — mais également en dehors. Invitée à Marseille dans le cadre d’un stage syndical pédagogique organisé par la CGT, la CNT et Sud, c’est là que nous l’avons entendue la première fois ; faisant part de son expérience, elle n’en démordait pas : « Enseigner, c’est d’abord un geste politique. » La lecture de ses ouvrages, aux éditions Libertalia, tour à tour tendres, militants et pleins d’humour, a achevé de nous convaincre : un entretien s’imposait.

Enseigner, c’est un ensemble de techniques, mais qui ne sont pas indépendantes des contenus. On enseigne quoi à la génération qui nous suivra ? On l’enseigne comment ? Souhaitons-nous qu’ils soient plus individualistes, plus coopératifs, plus empathiques ou plus indifférents au sort d’autrui ? La politique, c’est la vie de la Cité. L’enseignement, c’est la construction de la Cité de demain. On nous fait croire que les objectifs sont dans le champ de la « performance » mesurée au centième de point, alors que l’objectif de l’école, c’est de rendre le monde meilleur en formant des adultes plus courageux, plus déterminés, plus humanistes1.
Il est courant que des enseignants qui se considèrent comme « engagés » cloisonnent leurs engagements : d’un côté, ce qui concerne leur pratique professionnelle (c’est-à-dire essentiellement d’ordre pédagogique) ; de l’autre, les engagements politiques. Cela ne semble pas être votre cas.
« L’enseignement est rempli d’enseignants prédicateurs qui professent la bonne parole révolutionnaire le soir, après le travail, mais qui recherchent en classe une autorité dictatoriale. »
L’enseignement est rempli d’enseignants prédicateurs qui professent la bonne parole révolutionnaire le soir, après le travail, mais qui, dans leur pratique, ne sont ni féministes, ni écologistes, ni coopératifs, et recherchent en classe une autorité dictatoriale. Les militants du mouvement Freinet tentent d’accorder leurs engagements personnels, associatifs, syndicaux et politiques avec leurs pratiques réelles — ce qui permet d’être bien assis sur des chaises à quatre pieds. Nous nous réunissons avec les élèves car nous faisons la promotion d’une démocratie citoyenne. Nous cultivons un jardin et nous recyclons nos déchets car nous sommes écologistes. Nous avons des délégués qui se réunissent pour chercher des solutions aux problèmes car nous sommes coopératifs. Nous travaillons avec les filles et les garçons à l’égalité des droits dans toutes les circonstances, car nous sommes féministes. Enseigner, c’est élever les adultes de demain. Il faut relier l’école à la société, pour réfléchir ensemble au monde que nous voulons et donc à ce que nous voulons transmettre d’important.
Comment expliquez-vous la popularité, y compris au sein d’une partie de la gauche, de la vision dite « transmissive » de l’éducation2, portée par exemple par l’éditorialiste médiatique Natacha Polony ?
Les salons parisiens adorent les beaux parleurs, et Natacha Polony est une belle parleuse. Elle tient un discours qui flatte tous ceux qui pensent que c’était mieux avant. Et elle a partiellement raison. Évidemment, à l’époque où il y avait moins de 10 % des enfants qui intégraient les établissements du secondaire, c’était les meilleurs élèves, et le niveau des établissements était plus élevé. L’entourloupe, c’est qu’il s’agissait du niveau d’établissements sélectifs où 90 % des élèves n’allaient pas… La « massification » ne permet pas à elle seule de faire « monter le niveau » : il faut pour cela de l’engagement, de la formation, de la détermination, de l’accompagnement social. Il faut effectivement « transmettre », mais chaque « transmission » est une reconstruction par les élèves des savoirs qui sont apportés. Chaque enfant doit s’approprier par son propre chemin le dessin, la danse, l’équilibre, le calcul, le langage, la lecture, la natation, la géométrie, la musique… Tous les parents le savent : il n’y a pas deux petits qui marchent le même jour, pas deux qui deviennent propres au même âge. Il faudrait parler moins et observer davantage, mais cela ne permet pas de briller sous les feux de la rampe. Natacha Polony a enseigné un an dans le public, dans le 93, ce qui est léger — léger pour se prétendre « spécialiste » du monde éducatif : elle flotte sur une vision superficielle, mais tellement à la mode…
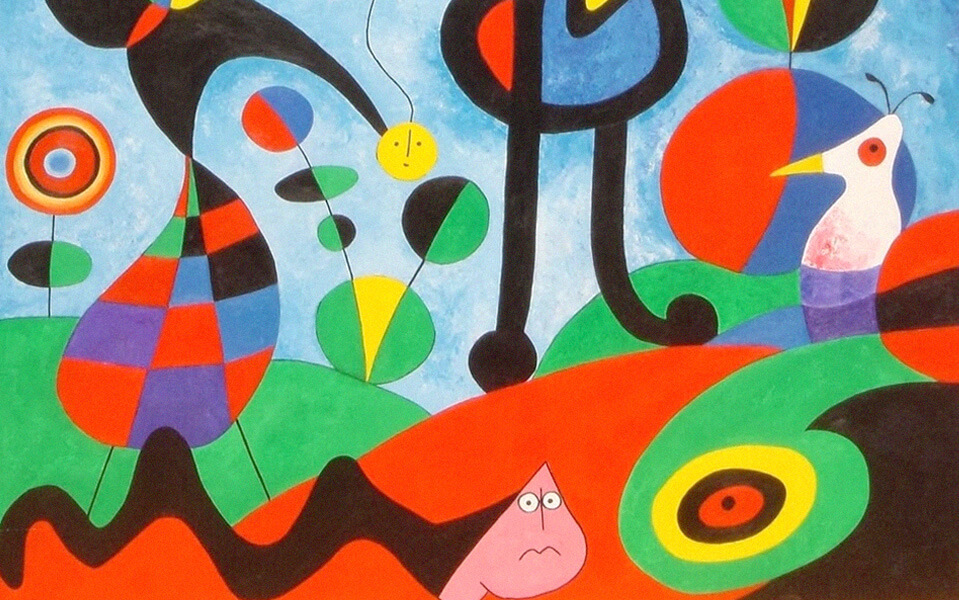
Extrait d’une toile de Joan Miró
Le fameux « mérite » doit-il être un moteur de l’école ?
Quel mérite ? Qu’est-ce qui fonde le « mérite » ? Les résultats ? La démarche ? L’effort de l’enfant ? Il y a des enfants dyspraxiques extrêmement méritants, qui se battent pour parvenir à faire difficilement ce que d’autres parviennent à faire sans y penser. Il y a des élèves logés au 115 qui font une heure de transport seuls pour venir à l’école. La notion même de « mérite » est une notion de droite, réactionnaire, religieuse, qui associe la souffrance au résultat. Cela s’oppose au droit de tous d’accéder à leur propre destin, au-delà de ce que leur naissance leur offre, c’est-à-dire à l’émancipation.
Vous vous réclamez des principes fondamentaux de la pédagogie Freinet. Pouvez-vous expliquer, pour qui la découvrirait, ce que cela signifie pour vous ?
« La notion même de
mériteest une notion de droite, réactionnaire, religieuse, qui associe la souffrance au résultat. »
La pédagogie Freinet, ce n’est pas simple… Il y a des principes de fonctionnement comme le tâtonnement expérimental, le conseil de coopération, l’entraînement individualisé, le texte libre et le dessin libre, les sorties scolaires, les classes transplantées, les projets coopératifs3, des pratiques toujours aux côtés des élèves et de leurs parents, et jamais face à eux. Il y a un engagement dans l’école publique, un engagement syndical, politique, associatif qui place les militants Freinet en première ligne. Car notre pédagogie forme aussi de jeunes militants, des enfants capables de se réunir, de s’organiser, de réfléchir collectivement, de travailler ensemble pour aboutir à quelque chose.
La sociologue Monique Pinçon-Charlot expliquait récemment aux Cahiers Pédagogiquesque « Montessori et Freinet ont été d’emblée totalement adoptés par la grande bourgeoisie ». Vous enseignez dans une école REP+4 de Bobigny, où la grande bourgeoisie n’est pas la classe sociale la plus représentée !
Montessori a créé une entreprise qui vend de la pédagogie ; Freinet a fondé un mouvement militant qui était en lien avec le syndicat, qui était proche du Parti communiste jusqu’à ce que Freinet en soit exclu. Le mouvement Freinet s’est toujours gardé d’être le sous-fifre d’un parti. On y trouve des militants de toutes sortes d’associations et de partis, de toutes sortes de syndicats et des non-syndiqués. Néanmoins, si des écoles privées se réclament de Freinet, c’est juste parce que nous ne sommes pas une marque déposée. Aucun militant du mouvement Freinet ne travaille dans une école privée pour bourgeois. Freinet a été obligé de faire une école privée car il a été exclu de l’Éducation nationale à la demande d’autorités académiques, en lien avec l’extrême droite de l’époque — il y a immédiatement accueilli des enfants réfugiés de la guerre d’Espagne et d’autres des bidonvilles de Gennevilliers, avec un accord de la municipalité PC de l’époque. La pédagogie est un exercice difficile quel que soit le milieu où on la pratique. Tous les enfants de la bourgeoisie ne sont pas bien élevés ; tous les enfants du peuple ne sont pas des voyous ; toutes les classes sociales ont leur lot d’enfants handicapés ou malades. Le mouvement Freinet a fait le choix clair de l’école publique, celle qui peut accueillir tout le monde. Ce qui rend les choses difficiles dans les quartiers populaires, c’est l’effondrement de l’entourage social de l’école et non la question pédagogique.

Extrait d’une toile de Joan Miró
Que pensez-vous des écoles privées qui cherchent à promouvoir des pédagogies progressistes ou émancipatrices ?
Elles ont raison. Cela se vend bien, et comme leur projet est un projet commercial, elles doivent vendre du rêve aux parents. Maintenant, si on est complaisant avec les parents pour avoir un bon salaire, si on fait ce qui leur fait plaisir et non ce qui est bon pour leurs enfants, c’est plus difficile de travailler à une éducation émancipatrice : par nature, l’émancipation, pour un enfant, c’est la possibilité de rencontrer des gens que ses parents ne lui auraient pas fait connaître, de visiter des lieux dans lesquels ses parents ne l’auraient pas emmené, de lire des livres que ses parents ne lui auraient pas achetés. Les écoles privées sont un peu obligées de devenir les « larbins » des parents.
Vous semblez avoir aimé enseigner en Seine-Saint-Denis. L’académie de Créteil peine pourtant à recruter et les dépressions y sont nombreuses parmi les enseignants. Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui y débutent ou y éprouvent des difficultés ?
« La majorité des jeunes enseignants qui arrivent en responsabilité n’ont aucune sécurité orthographique ni grammaticale. »
Il faut travailler en équipe, se former rigoureusement, ne pas avoir peur des autres, des étrangers, des cultures qui ne sont pas celles auxquelles nous sommes habitués, ne pas céder sur l’émancipation, sur les contenus, sur la démocratie. Il ne faut pas chercher à « dresser » les enfants des banlieues. Les bibles du débutant, c’est le livre de Martine Boncourt, L’Autorité à l’école, mode d’emploi, et celui de Catherine Chabrun, Démarrer en pédagogie Freinet. Il faut aller à des stages, participer à un groupe pédagogique, visiter d’autres classes. On apprend souvent davantage entre enseignants qu’avec des formateurs, surtout quand on débute.
En 2016, le Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO) publiait un rapport indiquant que l’école française accentuait les inégalités sociales. Quelles en sont les causes ?
Je ne sais pas. Je ne suis pas une chercheuse, je n’ai pas les éléments scientifiques pour répondre à ce genre de questions. Ce qui est certain et que je peux voir de là où je suis, c’est que le niveau social des classes populaires est en baisse avec une explosion de la précarité, des horaires décalés, des logements surpeuplés, des difficultés d’accès aux droits sociaux (santé, école, protection) et que cette précarité sociale pèse lourdement sur les résultats des élèves.
Sur quels leviers l’Éducation nationale devrait-elle alors jouer en priorité pour inverser cette tendance ?
La formation. Le niveau de formation des enseignants s’est effondré. Les cours des ESPE5 sont trop universitaires, trop rapides. La formation au métier est trop faible. Il ne suffit pas de dire aux gens qu’il existe des « ressources en ligne » pour qu’ils les intègrent. Je plaide pour cinq années de formation rémunérée, avec deux années sans classe en responsabilité, et une prise de poste progressive sous forme de stages en responsabilité accompagnée, puis d’une journée par semaine ou deux après quatre années de formation (non seulement sur les disciplines, mais sur les contenus des programmes). Aujourd’hui, la majorité des jeunes enseignants qui arrivent en responsabilité n’ont aucune sécurité orthographique ni grammaticale ; ils peinent à corriger les cahiers et préfèrent alors faire des photocopies que laisser leurs élèves écrire et faire des erreurs qu’ils ne sauraient pas corriger. Leur connaissance de l’expérimentation scientifique en classe est très faible, ils ne savent pas utiliser le matériel de manipulation en maths, ne savent pas diriger une séance de sport… Cela rend les débuts dans le métier trop difficiles : parfois, dans la même école, il y a huit débutants sur douze postes.
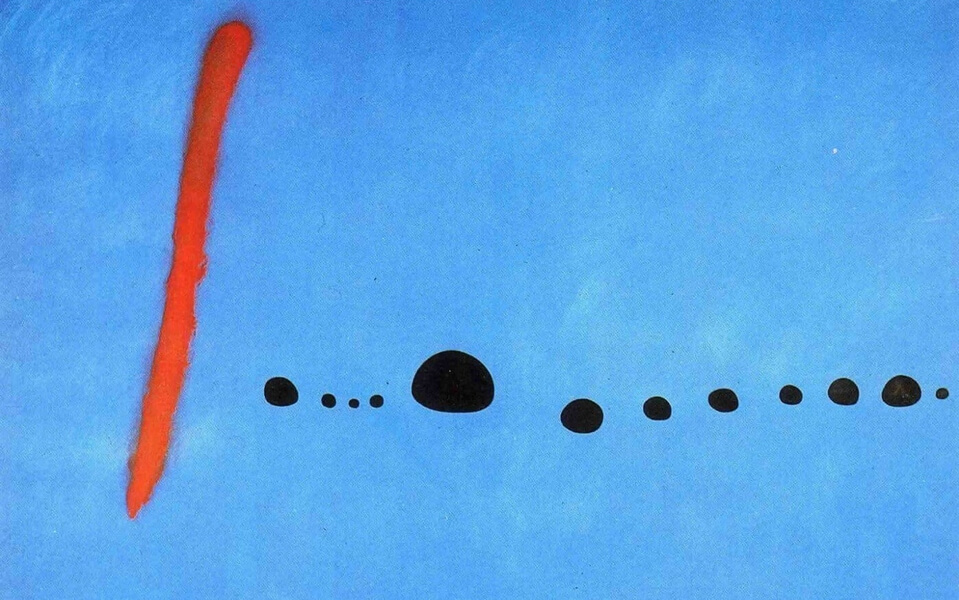
Extrait d’une toile de Joan Miró
En 2015, Franck Lepage nous expliquait que l’école avait intégré les méthodes du management de l’entreprise, avec notamment la « pédagogie par projet » et l’évaluation par « compétences ». Partagez-vous ce constat ?
Pas du tout. La pédagogie de projet, c’est super. Et l’évaluation par compétences est une excellente idée. Par contre, les libéraux n’ont pris que le mot et pas le contenu, ce qui donne une merveilleuse entourloupe. Ils appellent Ferrari une 2 CV, et paquebot un bateau gonflable ! Lorsque mon inspectrice me demande mon « projet d’école », elle ne demande pas du tout comment on (tous les enseignants de l’école) se projette pour emmener les élèves dans des apprentissages l’année suivante. Elle veut un document à trous qu’il faut remplir par des mots prévus à l’avance, dans le cadre d’un contrat d’objectifs tout à fait ressemblant à un contrat d’objectifs managérial d’un commercial. Pour l’évaluation par compétence, c’est pire encore. Les ultras libéraux souhaitent plus que tout éliminer les diplômes et éradiquer les dernières conventions collectives qui reposent sur cette assise. Donc ils veulent que chaque personne ait un « portfolio de compétences », qui permettra de payer chacun selon un rapport de force strictement individuel, dans lequel individuellement nous serons chacun mangés tout cru. Alors que dans la pédagogie Freinet, il s’agit de rendre l’enfant acteur de ses apprentissages en le positionnant comme sujet de sa propre évaluation, compétence par compétence, afin de ne pas être l’objet d’une tractation entre l’école et ses parents qui finit par des baffes si on a 0 en dictée. Et puis 0 en dictée, cela ne me dit rien sur ce qu’il ne sait pas faire : tenir un stylo ? écrire des mots bien orthographiés ? accorder des pluriels ? mettre de la ponctuation ?
Les parents d’élèves — et plus généralement, les familles — font partie des acteurs majeurs de l’école, pourtant parfois oubliés ou caricaturés. Pensez-vous que l’école leur laisse une place suffisante, ou au contraire, trop anecdotique ?
« Ce qui rend les choses difficiles dans les quartiers populaires, c’est l’effondrement de l’entourage social de l’école, et non la question pédagogique. »
On parle des « parents » dans les quartiers riches, des « familles » dans les quartiers populaires et des « grands frères » dans les cités désespérées. La place des parents, des familles et des frères n’est pas celle de l’école. Les parents doivent transmettre ce qu’ils savent, leur culture, leur manière de cuisiner, leur religion, leur façon d’être au monde. L’école doit transmettre autre chose : souvent, l’émancipation ne fait pas réellement plaisir aux parents. Car l’école doit être l’endroit où les croyants fréquentent des incroyants, où les juifs donnent la main aux musulmans, où les chrétiens étudient les procès en sorcellerie du Moyen Âge, où les Noirs apprennent les poèmes d’Aimé Césaire, même lorsque leur mère s’enduit chaque soir de crème blanchissante, où les pères autoritaires doivent faire face aux projets sur l’égalité filles-garçons de la classe de leur fille, où les mères abusives doivent abandonner leur garçon pour un départ en classe verte, où les parents racistes doivent faire lire le soir des romans antiracistes à leur enfant, où les homophobes doivent avaler que leur enfant va regarder Tomboy ou Billy Elliott en classe… Il faut donc être ouvert à tous et toutes et poser les limites qui sont celles d’une école émancipatrice et solidaire.
On parle souvent de la mixité sociale comme l’un des moyens de réduire les inégalités à l’école…
C’est en partie vrai, car une part de l’enseignement est assurée par les autres élèves, par les animateurs, par les agents de service. Lorsque l’école est ghettoïsée, que les agents crient dans la cantine « C’est qui qui reveut des frites ? », que les animateurs disent aux enfants « Wesh, on tape un foot ? », que leurs parents disent « Va-z-y, t’fais pas chier la maîtresse, hein ? » comme encouragement le matin, trop de responsabilité sur la transmission de la langue française repose sur les épaules des enseignants — insuffisamment formés à l’enseignement actif du langage, en plus. Dans les quartiers disposant d’une certaine mixité sociale, les parents les plus impliqués fondent des associations de parents, font « vivre » le quartier, et cela aide aussi l’école qui, disposant de parents combatifs, est mieux reconnue par la municipalité, l’Inspection et les autorités en général.
Illustration de bannière : Joan Miró
Portrait en vignette : Yann Levy
- On peut lire sur ce sujet l’excellent entretien du Café pédagogique avec la chercheuse Irène Pereira.[↩]
- L’approche transmissive de l’apprentissage consiste en un savoir exclusivement connu de l’enseignant et transmis par lui seul à des élèves à l’écoute, attentifs et passifs. Dans ce cadre, les erreurs sont à éviter : non seulement elles désignent un manque mais provoquent une perte de temps dans le déroulé de la transmission.[↩]
- Nous pouvons ajouter à la liste de Véronique Decker ce que l’on nomme les « invariants pédagogiques », qui fondent une bonne partie des pratiques de la pédagogie Freinet. Ceux-ci se trouvent résumés ici.[↩]
- Réseau d’éducation prioritaire renforcé.[↩]
- Écoles supérieures du professorat et de l’éducation, qui remplacent les IUFM.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Freire, hooks, Freinet : les pédagogues révolutionnaires », Rachid Zerrouki, mai 2017
☰ Lire notre article « L’université populaire doit l’être vraiment », Thomas Moreau, avril 2016
☰ Lire notre entretien avec Manuel Cervera-Marzal : « Travail manuel et réflexion vont de pair », mars 2016
☰ Lire notre entretien avec Emmanuel Daniel : « L’émancipation ne doit pas être réservée à ceux qui lisent », janvier 2016
☰ Lire notre entretien avec Franck Lepage : « L’école fabrique des travailleurs adaptables et non des esprits critiques », juin 2015


