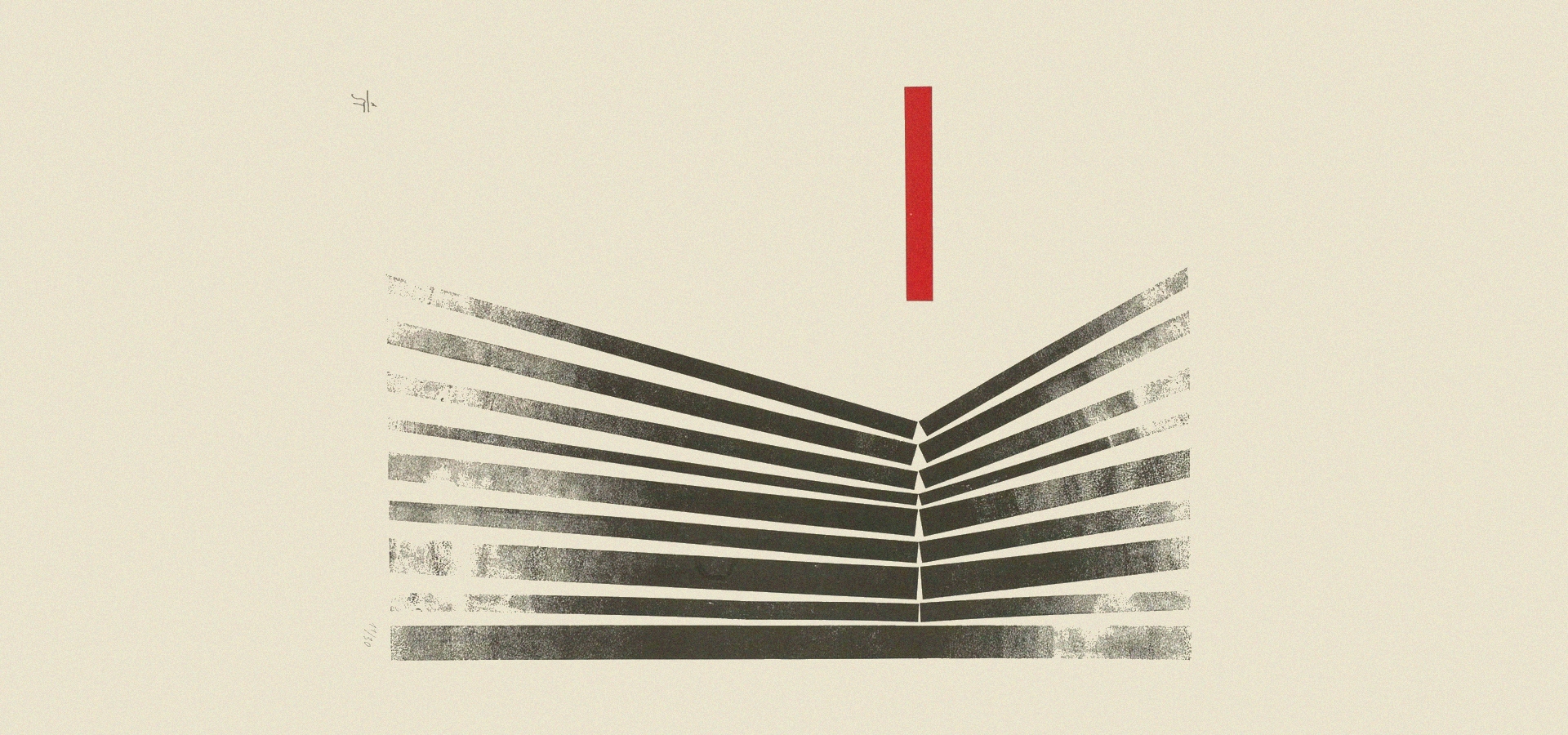Entretien inédit | Ballast
Un mouvement social historique contre la réforme des retraites, une intersyndicale unie, et pourtant : la défaite. De quoi questionner les pratiques militantes, le syndicalisme d’aujourd’hui et de demain. Guillaume Goutte est correcteur, secrétaire délégué des correcteurs au Syndicat du Livre CGT et auteur, chez Libertalia, de Correcteurs et correctrices, entre prestige et précarité et Dix questions sur le syndicalisme. Il se réclame également du syndicalisme révolutionnaire, fidèle à l’esprit de la charte d’Amiens et à sa « double besogne » : soit « l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d’améliorations immédiates » et « l’émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste« . En cette journée de mobilisation syndicale pour les salaires, l’égalité femmes-hommes et l’opposition aux politiques d’austérité macronistes, nous en discutons avec lui.

Un syndicalisme qui revient à ses sources pour mieux affronter les enjeux posés aujourd’hui par l’évolution du monde du travail, mais aussi pour renouer concrètement avec ses ambitions révolutionnaires. Il n’y a pas toujours besoin d’élaborer de nouvelles théories ou de penser de nouvelles pratiques pour être « du XXIe siècle ». Il suffit parfois de regarder le passé pour s’adapter au présent. C’est en tout cas vrai, à mon sens, pour le syndicalisme de classe : on avait tous les outils entre les mains, mais on les a cassés ou perdus, et nous nous sommes égarés… Quel syndicalisme, alors ? Un syndicalisme de classe, confédéré, sur des bases industrielles, avec un vrai ancrage interprofessionnel, donc local. C’est ce syndicalisme, longtemps en vigueur dans la CGT, qui est en mesure de répondre efficacement aux problématiques posées, par exemple, par le développement de la sous-traitance, l’« ubérisation », l’éclatement des communautés de travail. Un syndicalisme qui rompt avec les corporatismes de boîtes — et, donc, le modèle du syndicat d’entreprise — pour renouer avec une dimension industrielle et de proximité — le syndicat local professionnel.
Qu’entendez-vous par « industrie » ?
J’entends « branche professionnelle ». Il n’y a pas un syndicat par entreprise mais un syndicat par branche et par département. Autrement dit on organise les travailleurs et les travailleuses non pas dans leur entreprise, mais dans leur profession, au sein de leur territoire, quel que soit leur « statut » (CDI, CDD, intérimaire, pigiste, apprenti, autoentrepreneur…). C’est la forme de structuration qui avait été choisie par la CGTU, notamment. Elle permet la construction de solidarités concrètes entre travailleurs d’une même branche professionnelle/industrie, de casser la mise en concurrence patronale des travailleurs, de développer des politiques salariales ambitieuses, de mutualiser les moyens militants (financiers comme humains), de sortir du cadre institutionnel du syndicalisme d’entreprise, d’obliger les camarades à s’intéresser à ce qui se passe ailleurs que dans leur boîte, de déserter le terrain où l’employeur est roi pour l’obliger à se confronter avec la solidarité de classe. C’est le meilleur moyen, aussi, de connaître les réalités locales de son industrie, ce qui est indispensable quand le syndicat a pour ambition d’être la base de la réorganisation économique et sociale.
« Ce syndicalisme du XXIe siècle est un syndicalisme qui ne s’interdit aucune lutte, qui n’a pas peur de dire que rien ne lui est étranger. »
Et puis, enfin, je dirais que ce syndicalisme du XXIe siècle est un syndicalisme qui ne s’interdit aucune lutte, qui n’a pas peur de dire que rien ne lui est étranger, qui cesse enfin de déléguer à des partis politiques certains combats essentiels — notamment l’antifascisme, le féminisme et l’antiracisme. Un syndicalisme qui aspire à transformer en profondeur la société, qui ne s’enferme pas dans l’entreprise et qui se sait légitime à se trouver sur tous les champs de bataille de l’émancipation.
En France, de nombreux syndicats se revendiquent toujours de la charte d’Amiens. Le militant de l’Union syndicale Solidaires Thierry Renard a écrit à ce sujet : « Cette question [de l’indépendance] est malheureusement traitée souvent sous l’angle quasi exclusif des rapports entre le syndicalisme et les partis politiques. La charte d’Amiens pose pourtant comme principe une indépendance de classe, une capacité de la classe des opprimé∙es à avoir son propre projet émancipateur. L’indépendance n’a en effet aucun sens, si l’organisation prétendument indépendante n’a pas sa propre vision, ses orientations stratégiques propres. » Êtes-vous d’accord ?
Bien sûr. D’ailleurs, certaines confédérations se revendiquent de la charte d’Amiens pour justifier un syndicalisme réformiste, voire d’accompagnement, se contentant de l’affirmation de l’indépendance syndicale, oubliant toute la partie sur le projet révolutionnaire. La nécessité pour une confédération syndicale de penser son propre projet de société est, d’ailleurs, ce qui motive, en partie, l’exigence d’indépendance syndicale. La charte d’Amiens ne dit finalement rien d’autre que ceci : nous n’avons besoin de personne d’autre que nous-mêmes pour penser la société de demain et les moyens d’y parvenir. Pourquoi faire sans les partis politiques ? Parce qu’ils divisent plus qu’ils ne rassemblent. Une confédération qui s’acoquinerait avec l’un d’eux fermerait de fait sa porte à ceux qui ne s’en réclament pas, provoquant exclusion, scission, départs… En la matière, l’histoire du syndicalisme est riche. Or la force de l’organisation syndicale est d’être une organisation de classe : on n’y adhère pas en fonction de son obédience politique mais de sa place dans les rapports de production capitalistes. Ce qui n’empêche pas, bien sûr, les débats d’idées en son sein, dans lesquels ne manquent jamais de s’affirmer les appartenances politiques et les accointances philosophiques des uns et des autres. Et c’est de la richesse de ce pluralisme, garanti par l’indépendance syndicale, que jaillissent des orientations stratégiques et un projet de société propres à la confédération syndicale.
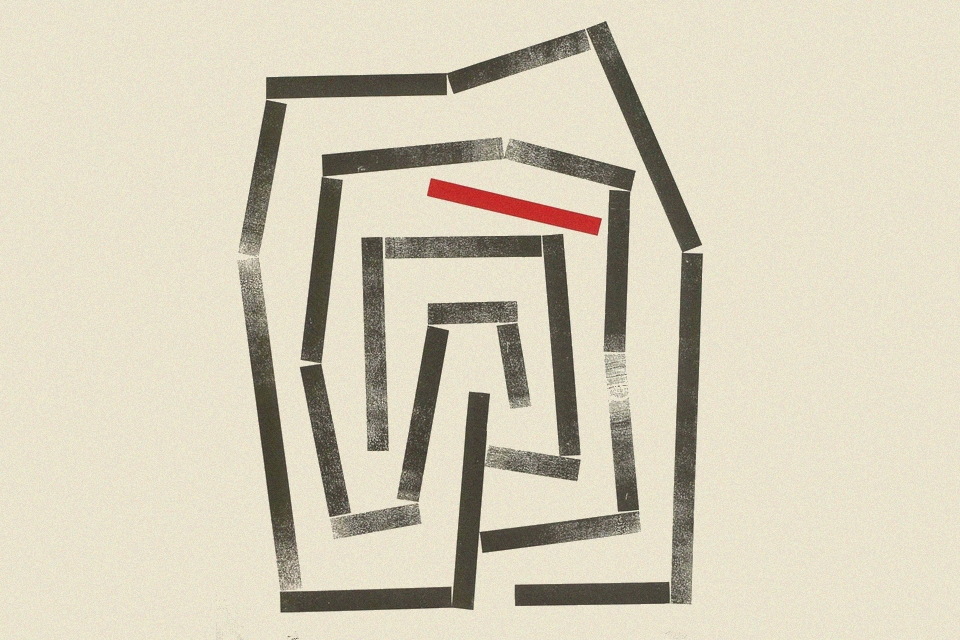
[Anton Stankowski]
Ne pas s’acoquiner avec les partis, dites-vous. Quel serait leur rôle dans le cadre d’un syndicalisme révolutionnaire ?
Le courant syndicaliste révolutionnaire ne dit pas que les partis politiques n’ont aucun rôle à jouer mais que le syndicalisme peut et doit faire sans eux. Le syndicalisme, c’est la pratique autonome de la lutte des classes. Et, pour qu’il le reste, il lui faut tenir les partis loin de lui. Ce qui n’empêche pas les militants syndicalistes d’être, à titre individuel, membres d’un parti ou d’une organisation politiques. Tant qu’ils ne cherchent pas à transformer le syndicat en chambre d’écho de leur parti ou à lui faire épouser son calendrier et ses orientations… Les organisations politiques sont des laboratoires d’idées plus ou moins pertinents, des espaces de formation et d’échange qui ont leur intérêt dans la construction politique des militants, mais elles ne sauraient être les locomotives de la révolution. Ce sont des think tanks, des clubs de pensée… Personnellement, je préfère les clubs de montagne !
Ces dernières années, on a vu des mouvements de protestation en lien avec la question du travail, mais qui se sont organisés en dehors des syndicats et parfois même en rupture : les gilets jaunes, la grève des contrôleurs SNCF de décembre 2022… Quels enseignements en tirer ?
Les gilets jaunes et les contrôleurs grévistes de 2022, ce n’est pas vraiment la même histoire, quand bien même ces deux épisodes se sont déroulés sans la présence des syndicats… On parle d’un mouvement populaire tenté par l’insurrection et d’une grève strictement corporatiste dans une entreprise. En ce qui concerne les gilets jaunes, mouvement que je ne me risquerai pas à essayer de résumer ici tant il a eu d’aspects différents — certains enthousiasmants, d’autres beaucoup moins… —, disons qu’au-delà de la question du travail ils ont su poser celle de la sociabilité. Avant que le rituel « insurrectionnel » du samedi ne s’installe dans le mouvement, les gilets jaunes ont investi et occupé des ronds-points un peu partout sur le territoire. Ils ont réussi à faire de ces endroits insignifiants de vrais lieux de vie, de rencontre, de convivialité et d’échanges. Le mouvement des gilets jaunes a ainsi traduit une crise de la sociabilité dans une société libérale qui ne propose que des quotidiens formatés, écrasés par le travail et où l’isolement gangrène la vie.
« Le mouvement des gilets jaunes a traduit une crise de la sociabilité dans une société libérale qui ne propose que des quotidiens formatés, écrasés par le travail. »
Les questions qui se posent aux syndicalistes, c’est : pourquoi ces salariés ont-ils dû aller sur des ronds-points pour trouver des espaces de sociabilité en rupture avec le libéralisme ? Pourquoi ne sont-ils pas allés dans les Bourses du travail ou les unions locales de syndicats, qui, à l’origine, ont été pensées comme autant de lieux de contre-culture ouvrière, où pouvaient s’épanouir les sociabilités de classe ? La réponse est simple : parce que le syndicalisme, même de classe, a depuis longtemps abandonné ce rôle, qu’il avait pourtant à l’origine. En se repliant dans les entreprises ou sur le terrain juridique, en désertant les Bourses du travail pour aller siéger dans les bureaux du paritarisme, les syndicats se sont coupés d’une partie de celles et ceux qu’ils représentent.
Et pour la grève des contrôleurs de la SNCF ?
J’insiste sur son caractère strictement corporatiste. Quelque part, c’est ce que le syndicalisme peut faire de moins intéressant… Certes, les grévistes ont été radicaux dans leur façon de conduire ce mouvement, mais cette radicalité était vide de tout contenu de classe — notamment parce qu’elle s’est organisée sans les syndicats. D’un point de vue révolutionnaire, et même réformiste — le réformisme est un anticapitalisme, à ne pas confondre avec le syndicalisme d’accompagnement type CFDT ou jaune —, cette grève n’a aucun intérêt, sinon de montrer ce qu’est le syndicalisme radicalement corporatiste, et en quoi il s’oppose — et s’attaque — au syndicalisme de classe. De manière plus générale, oui, on voit des travailleurs et des travailleuses s’organiser en dehors des syndicats pour porter des revendications concernant leurs conditions de travail et de rémunération. On peut se féliciter de voir des gens relever la tête et se battre, mais il ne faut pas non plus faire de ces mouvements ce qu’ils ne sont pas.
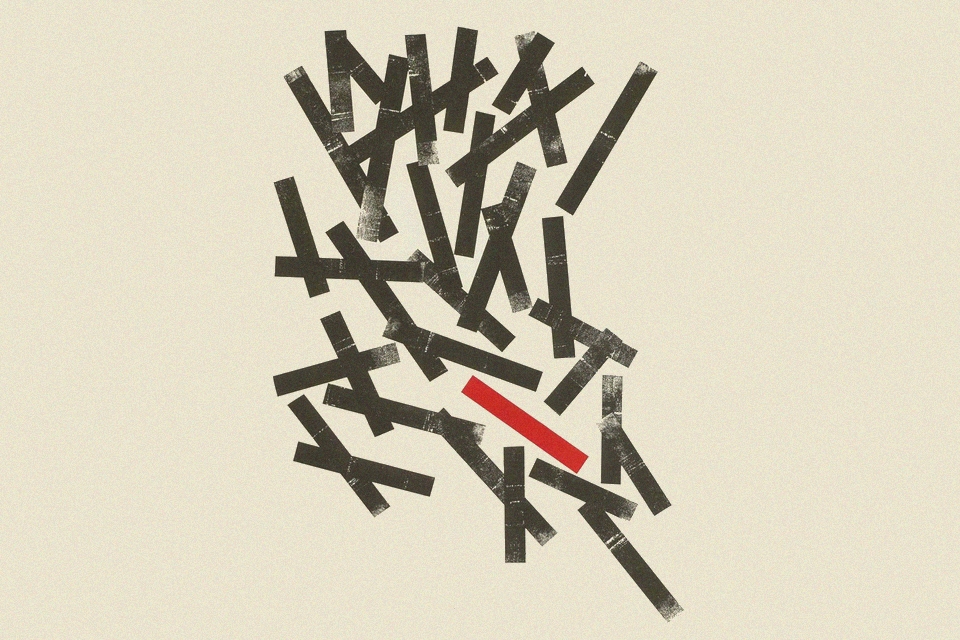
[Anton Stankowski]
C’est-à-dire ?
Généralement, ils séduisent beaucoup les milieux révolutionnaires, en particulier l’extrême gauche, les libertaires et les autonomes. Ce qui est assez curieux car ces mouvements expriment un corporatisme pur et dur. Ces collectifs n’étant pas rattachés à des fédérations d’industrie et à des structures interprofessionnelles, ils peinent ne serait-ce qu’à parler avec les salariés de l’ensemble de la chaîne industrielle dans laquelle ils s’inscrivent. Rien d’étonnant, et on ne peut pas le leur reprocher, mais il faut en avoir conscience avant de vouloir en faire l’avenir de la lutte des classes. On ne pourra pas faire la révolution avec des collectifs corporatistes qui s’épuisent souvent aussi vite qu’ils ont émergé malgré leur dynamisme initial. Le développement — qui reste toutefois restreint — de ce corporatisme traduit à sa façon l’affaiblissement du syndicalisme de classe, c’est-à-dire le recul d’un syndicalisme de combat qui permet, par sa structuration et ses pratiques, de dépasser les corporatismes — de métier comme de boîte —, en faisant émerger la conscience de classe, pensée comme le ciment d’une lutte globale contre le capitalisme. C’est ce syndicalisme-là, celui que nous portons en tant que militants anticapitalistes, qui est la première victime de ces mouvements corporatistes. Et c’est la raison pour laquelle les médias bourgeois aiment tant les mettre en avant.
Il n’y a donc rien de positif dans l’émergence de ces collectifs ?
Ces collectifs et mouvements ont le mérite de bousculer les syndicats, notamment dans les boîtes, en leur rappelant qu’il y a un terrain de lutte en dehors des institutions représentatives du personnel, et que ce terrain les attend. Ce que leur émergence traduit, c’est notamment cette absence de lien entre les salariés et les élus syndicaux, parfois trop coupés du terrain, absorbés par le paritarisme et ses innombrables réunions. Une perte de confiance, aussi, alimentée par le travail de sape de nombre de politiciens — même à gauche — qui n’en finissent pas de ternir l’image des syndicats, et par les querelles internes qui minent la vie démocratique de la plupart des organisations syndicales. Mais, souvent, ces collectifs finissent par se rapprocher des syndicats et par travailler main dans la main avec eux. Et quand ces collectifs meurent, beaucoup de celles et ceux qui les animaient rejoignent un syndicat. On a vu ça dans le Livre, par exemple, avec le collectif Correcteurs précaires en 2018 : beaucoup des personnes qui étaient aux manettes ont rejoint la CGT et militent aujourd’hui en son sein — y compris dans l’interpro ! Les animatrices du collectif y ont trouvé une organisation solide, avec des militants, des moyens et une puissante culture de la lutte pour construire leurs revendications. Le syndicat y a gagné des forces vives et a renforcé sa légitimité dans la profession. C’est l’aboutissement d’une relation saine entre le collectif et le Syndicat du Livre CGT tout au long du mouvement des correctrices et correcteurs d’édition.
Face à la pluralité des mouvements sociaux — pensons par exemple au Comité Adama, aux Soulèvements de la Terre —, on entend régulièrement des appels à la « convergence des luttes ». Au-delà de la tonalité incantatoire, quels liens concrets tisser entre les syndicats et ces mouvements ?
« On ne pourra pas faire la révolution avec des collectifs corporatistes, qui s’épuisent souvent aussi vite qu’ils ont émergé
malgré leur dynamisme initial. »
Des liens existent déjà entre ces mouvements et certaines confédérations ou unions syndicales. La CGT et Solidaires, par exemple, ont appelé et participé à la Marche unitaire contre les violences policières, contre le racisme systémique et pour les libertés publiques du 23 septembre 2023, aux côtés de nombreuses associations et collectifs de victimes. Un travail de longue haleine et particulièrement constructif a également été mené par la CGT, Solidaires et la FSU au sein de l’AES, l’Alliance écologique et sociale [auparavant nommé Plus jamais ça !, ndlr] — que la CGT a hélas quittée il y a quelques semaines, après une décision de son 53e congrès.
Après, les organisations syndicales, du moins celles que nous citons ici, ne sont pas des monolithes où tout se décide en haut. Les liens entre les organisations syndicales et les associations et collectifs écologistes, féministes, antiracistes, doivent se construire localement : c’est tout le rôle du réseau syndical interprofessionnel. La « convergence » existe déjà sur le terrain, elle n’a souvent pas à attendre le feu vert du « national ». Et c’est heureux. Par exemple, dans les Deux-Sèvres, l’union départementale CGT 79 est partie prenante de la lutte contre le projet de mégabassines, aux côtés du collectif Bassines, non merci — et ce bien avant l’émergence des Soulèvements de la Terre. Ce qui se joue dans les territoires peut aussi se jouer dans les professions à l’image de ce qui s’est construit, en Seine-Maritime, pour sauver la papeterie de la Chapelle Darblay : cette usine de papier journal recyclé, promise à la fermeture, a été sauvée à la faveur d’un combat commun mené par la CGT et le collectif AES, qui ont réussi à faire converger les revendications sociales et écologiques.

[Anton Stankowski]
Sur le front antifasciste, des liens se construisent aussi entre les organisations syndicales, des groupes antifascistes spécifiques et des organisations antiracistes. En décembre 2021, ça a donné, à Paris, une importante manifestation unitaire contre un meeting d’Éric Zemmour, appelée par la CGT, Solidaires et la Jeune Garde Paris, rejoints par plus de 60 organisations, associations et collectifs. Ces initiatives ont donné un élan salutaire à la CGT sur la question de l’antifascisme, trop souvent déléguée aux partis politiques, et a permis de bâtir des passerelles entre la CGT et certains collectifs et associations antiracistes. Et tout l’enjeu de ces dynamiques est là : il ne suffit pas de cosigner un appel et de laisser les autres se mobiliser ensuite : les organisations syndicales doivent s’emparer à bras-le-corps de ces combats, qui sont aussi les leurs, et les faire vivre en leur sein.
Toutes ces démarches sont intéressantes, et souvent efficaces. Elles permettent aux uns et aux autres d’apprendre à se parler, à s’écouter, à se connaître, pour construire ensemble des luttes unitaires. Tout ça ne se fait pas du jour au lendemain et les appels incantatoires n’apportent généralement pas grand-chose à l’édifice complexe de l’unité. Mais l’essentiel se joue au-delà de l’alignement des sigles et des logos sur une affiche ou un appel : l’important, c’est de créer de la vie sociale. C’est pourquoi cette « convergence » doit être pensée dans le réel, ancrée dans les territoires et non élaborée artificiellement dans les « états-majors » — pas seulement syndicaux : la bureaucratie existe aussi chez les autonomes — ou pour surfer sur des campagnes militantes médiatiques qui viennent souvent s’imposer et se substituer à ce qui s’est construit localement.
Nous sortons d’un mouvement social historique contre la réforme des retraites. Pourquoi a-t-on encore perdu ?
« Les Bourses du travail ne sont plus ces hôtels de ville de la classe ouvrière qu’elles étaient jadis, des lieux de vie sociale et d’organisation qui unifiaient le prolétariat. »
Parce que nous n’avons plus les outils nécessaires à la construction d’une grève générale. L’implantation syndicale est trop faible et souvent mal structurée, la plupart du temps incapable d’organiser de vraies luttes ambitieuses, excepté dans quelques secteurs qui ont préservé la culture et le savoir-faire de la mobilisation professionnelle. On n’organise pas une grève générale avec une agglomération de tout petits syndicats d’entreprise, où l’essentiel de la vie syndicale est tournée vers le paritarisme…
Que faut-il ?
Un réseau de syndicats locaux professionnels susceptibles de coordonner les mobilisations dans les entreprises dans un même élan, en lien avec des unions interprofessionnelles. Or les syndicats locaux d’industrie, pourtant historiques, ont été peu à peu délaissés dans la CGT au profit des syndicats d’entreprise, en une curieuse évolution qui a épousé les désirs du patronat — lequel a toujours préféré négocier à l’échelle d’une boîte que d’une branche. Nous n’avons plus, aussi, de bases arrière pour le mouvement social… Les Bourses du travail ne sont plus ces hôtels de ville de la classe ouvrière qu’elles étaient jadis, des lieux de vie sociale et d’organisation qui unifiaient le prolétariat dans une ville. Elles se contentent bien souvent d’héberger les syndicats et d’accueillir des permanences juridiques — ce qui est nécessaire, mais tellement insuffisant. Or la grève générale a besoin de bases arrière pour s’organiser et durer, elle a besoin de lieux de vie ouverts et conviviaux, de coopératives alimentaires, de crèches collectives… Toute cette vie sociale, cette contre-société que nous avons aujourd’hui perdues.

[Anton Stankowski]
Nous avons abandonné l’idée de grève générale, quand bien même certains l’agitent encore à coups d’appels incantatoires ou la réclament comme s’il suffisait de la vouloir pour la construire ! On a tellement abandonné la grève générale qu’on a fait de la manifestation de rue l’alpha et l’oméga de la mobilisation sociale, à tel point qu’on se préoccupe plus du nombre de gens dans la rue que du taux de grévistes… On a renversé le paradigme : autrefois on manifestait parce qu’on était en grève, aujourd’hui on fait grève pour aller manifester. On fait tout à l’envers ! On a tellement perdu la tradition gréviste dans les entreprises que certains ne font même pas grève les jours de manifestation : ils posent une RTT, un jour de congés payés ou, pour ceux qui en ont, une vacation syndicale. On marche sur la tête ! La manifestation doit visibiliser ce qui se passe dans les branches professionnelles et les entreprises, autrement, c’est juste un défilé de gauche sans intérêt, qui ne fait trembler personne… La manifestation est importante mais elle est secondaire dans la construction d’un rapport de force. J’aurais tendance à dire qu’il faut parfois déserter la rue pour occuper les entreprises.
Au début du mouvement, les cheminots avaient fait sentir qu’ils ne voulaient pas être la « locomotive » du mouvement social. L’idée qu’il y a des « secteurs stratégiques » sur lesquels il faut s’appuyer semble assez largement partagée : est-ce aussi une notion qu’il faut revoir ?
C’est une notion qu’il faut enterrer, surtout. Elle vit sur le mythe de 1995 et de la grande grève dans les transports… On appelle ça la « grève par procuration », c’est-à-dire qu’on laisse à d’autres le soin de faire grève à notre place au prétexte qu’ils auraient un « rôle stratégique » ou une implantation syndicale suffisamment importante pour le permettre. Ça ne mène à rien. On l’a bien vu lors des dernières mobilisations. Laisser des secteurs aller au front tout seuls, c’est s’assurer d’une défaite : on épuise les secteurs en question, on les jette en pâture à la vindicte politique et médiatique et, à la fin, on les engage dans plusieurs années de défaitisme et de démobilisation. C’est ce qui s’est passé en 2019 avec les camarades de la RATP, qui n’ont pas rejoué en 2023 la partition qu’ils avaient jouée à l’époque, à savoir une grève dure et exemplaire mais isolée au niveau interprofessionnel et national. L’autre risque, c’est d’enterrer la revendication interprofessionnelle — l’abrogation d’une réforme, par exemple — au profit de revendications corporatistes, arrachées par la puissance de la grève. Et quand on est tout seul engagé dans la bataille, c’est assez facile, au bout d’un moment, de céder aux sirènes du corporatisme.
« Laisser des secteurs aller au front tout seuls, c’est s’assurer d’une défaite : on épuise les secteurs en question. »
Ce n’est donc pas en cultivant le mythe de la grève par procuration qu’on renforcera l’implantation syndicale. En fait, cette notion sert surtout à justifier le refus de s’engager dans la grève et de construire l’organisation syndicale, en se reposant sur les autres. Et elle a trouvé dans le phénomène de la « caisse de grève en ligne » un puissant relai : on va bosser les jours de grève mais on se donne bonne conscience en versant quelques euros à la caisse de solidarité sur Internet… C’est la culture de la résignation et de la défaite. D’un point de vue révolutionnaire, cette notion a encore moins de sens. Une grève générale révolutionnaire a pour objectif l’expropriation capitaliste et la réorganisation économique et sociale, par le biais de la socialisation de l’ensemble des moyens de production et des services. Si un mouvement social se construit seulement autour de la grève de deux ou trois secteurs économiques « stratégiques », on peut d’ores et déjà oublier cette finalité-là. La grève générale cesserait alors d’être révolutionnaire pour n’être plus que réformiste — au mieux. D’ailleurs, il ne s’agirait même pas de grève générale…
La question de la police divise le camp de l’émancipation. Il existe aujourd’hui une CGT-Police et un très petit SUD-Intérieur. Un syndicat révolutionnaire doit-il syndiquer des policiers, gendarmes ?
Rassurez-vous, les deux sont modestes… La CGT-Police n’a quasiment aucun adhérent. La CGT-Préfecture de police en a davantage, mais il ne s’agit pas des types armés qui nous éborgnent dans les manifestations et nous flinguent dans les quartiers, mais des employés de préfecture. La question de la syndicalisation des forces de répression est aussi vieille que le syndicalisme et, sincèrement, je n’ai pas trop d’avis là-dessus. J’aurais tendance à dire que, avant de savoir si on doit syndiquer les flics, on devrait se préoccuper de savoir comment syndiquer les 92 % de salariés du privé qui ne le sont pas… Ce qui est sûr, en revanche, c’est que la CGT et Solidaires n’ont rien à faire dans les rassemblements organisés par les syndicats de policiers d’extrême droite, type Alliance ou le SGP. Ce serait se compromettre avec les fascistes et les voyous, ce qu’ils ont toujours refusé de faire, et c’est heureux.
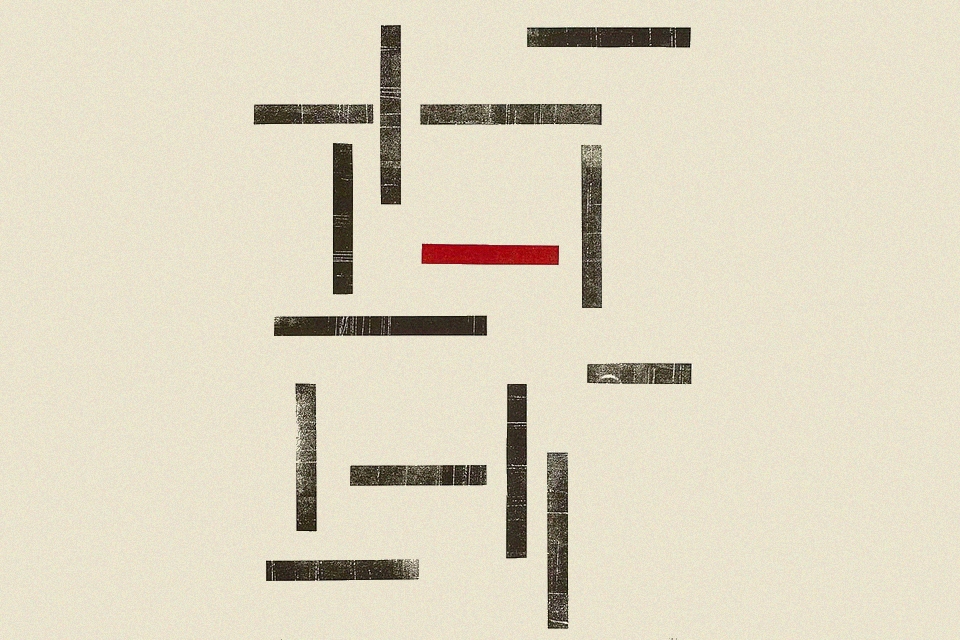
[Anton Stankowski]
En 2023, la CGT a vécu un 53e congrès mouvementé. Vous êtes d’ailleurs intervenu pour le Syndicat général du Livre et de la communication écrite CGT. Comment voyez-vous maintenant les choses pour la CGT, et son avenir ?
Un congrès mouvementé, oui ! Nous avons assisté à une guerre interne à la bureaucratie, où l’appétit des uns et des autres pour les galons était beaucoup plus fort que les divergences… Il y avait néanmoins de vrais antagonismes, notamment autour de la sempiternelle question des affiliations internationales de la CGT, avec, d’un côté, les partisans d’un retour à la Fédération syndicale mondiale — la FSM, organisation aux relents staliniens qui, derrière un discours de lutte des classes, n’a pas de problème à s’acoquiner avec certains régimes autoritaires —, et, de l’autre, ceux qui souhaitent rester au sein de la Confédération syndicale internationale [CSI] et de la Confédération européenne des syndicats [CES], tout en dénonçant les tendances pro-syndicalisme d’accompagnement qui y sévissent. Les premiers ont été vaincus, de manière assez nette — 72 % —, mais ont pu jouer d’autres cartes (notamment la sortie de l’AES), pour ne pas sortir totalement défaits de ce congrès.
Je ne sais pas si nous sommes passés près de la scission mais l’atmosphère était très tendue. Deux candidates au secrétariat général ont échoué devant le Comité confédéral national [CCN] — Marie Buisson, adoubée par Philippe Martinez et Céline Verzeletti — et, finalement, c’est Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT des cadres et techniciens, qui a été choisie. L’avenir dira si ce fut ou non une bonne décision, mais cette camarade est une bosseuse et elle a montré, ces derniers mois, qu’elle aimait le terrain. Elle est dans une position compliquée, avec un bureau confédéral et une Commission exécutive confédérale [CEC] assez divisés, au sein desquels elle va devoir maintenir les équilibres pour tenter de préserver le rassemblement…
Pour le reste, ce sont les syndicats qui font la CGT, pas sa secrétaire générale. Le fédéralisme sur lequel est construit la CGT donne une large autonomie aux organisations qui la composent : c’est à elles que revient le rôle de l’engager sur la bonne voie. À chacun et à chacune d’y œuvrer, dans son syndicat et dans son union locale. Le tournant pris ces dernières années pour construire une CGT résolument ouverte aux questions écologiques, féministes et antiracistes doit être préservé, pour permettre à l’organisation de renouer avec ses ambitions de transformation sociale globale. Mais des questions vont devoir être abordées pour de bon : parmi elles, celle de la structuration de la CGT, du renforcement des unions interprofessionnelles et de la vie démocratique dans les fédérations.
Illustration de bannière : Anton Stankowski
REBONDS
☰ Lire notre article « Réforme des retraites et mouvement social : la fin des AG ? », Rémi Azemar et Rémi Segonds, octobre 2023
☰ Lire notre entretien avec Grégory, ouvrier-cordiste : « S’organiser, se défendre, se bagarrer », juin 2023
☰ Lire notre entretien avec Olivier Mateu : « Il faut partir au combat, l’organiser », mai 2023
☰ Lire notre rencontre avec le Planning Familial : « Les grévistes nous racontent », avril 2023
☰ Lire notre entretien avec Simon Duteil (Solidaires) : « Ce qui déstabilisera, c’est la massification », mars 2023
☰ Lire notre entretien avec Annick Coupé : « Le syndicalisme est un outil irremplaçable », juillet 2018