Entretien inédit pour le site de Ballast
Mettre sur la table une question cruciale mais souvent négligée : la stratégie. Telle est l’ambition d’Aurore Koechlin dans son livre La Révolution féministe. S’il est évident, pour l’autrice, que le féminisme réformiste (dialoguer avec les institutions de l’État, intégrer ses administrations, bénéficier de ses financements associatifs) ne permet pas l’affranchissement plein et entier des femmes et la construction d’une société plus juste, Koechlin n’en fait pas moins état des impasses d’une autre tendance, incontournable dans le camp de l’émancipation : la « stratégie intersectionnelle ». Tout en soulignant la nécessité d’appréhender l’enchevêtrement des différentes dominations, elle conteste les effets politiques concrets produits par ce qu’elle tient pour une déformation de ce que propose, initialement et justement, l’intersectionnalité comme outil sociologique. Effets qu’elle résume ainsi : dénonciation des « privilèges » des individus plutôt que des structures du pouvoir ; désintérêt pour la construction d’un grand mouvement collectif ; focalisation élitiste et puriste sur les codes admis, le langage requis. L’ouvrage entend dès lors proposer une stratégie de nature « révolutionnaire », héritière d’un marxisme critique : la constitution d’un mouvement féministe de masse en lien avec les mouvements ouvrier et antiraciste, permettant, ensuite, la formation d’une force populaire à même de tourner la page du capitalisme, c’est-à-dire de prendre le pouvoir. Nous en discutons.

Oui, énormément. Je partage avec ses autrices l’essentiel des analyses, tant théoriques que stratégiques, sur le féminisme. Elles se réclament toutes de la théorie de la reproduction sociale, elles font l’analyse qu’une nouvelle vague du féminisme est en cours et elles défendent stratégiquement que le féminisme doit à la fois se démarquer du féminisme libéral et être pensé en lien avec la lutte des classes et les luttes antiracistes. La principale différence entre nous repose sur le fait qu’elles ont choisi de mettre davantage en avant un féminisme anticapitaliste plutôt que révolutionnaire — c’est-à-dire qui souligne surtout contre quoi elles se battent. À l’inverse, il m’a semblé important de mettre en évidence que pour en finir avec la domination des femmes et des minorités de genre, une révolution est nécessaire.
Qu’entendez-vous exactement par « révolution » ?
« Pour en finir avec la domination des femmes et des minorités de genre, une révolution est nécessaire. »
Ce terme a connu un double mouvement dans les dernières années, qui l’a beaucoup galvaudé. D’un côté, il a été diabolisé : source de peur, présenté comme un moment unilatéralement violent, à l’opposé de la démocratie. De l’autre côté, il a pu être vidé de sa substance, notamment sous l’effet du marketing néolibéral (pour vendre un produit, il le présente comme « révolutionnaire »). Tout est révolution : rien n’est révolution ; le mot n’a plus de sens. Ces deux mouvements ont un même but, enterrer collectivement l’idée d’une alternative à la société actuelle. C’est pourquoi il me paraît important de se réapproprier le terme et de lui donner une autre connotation — en soulignant, par exemple, que si on a une analyse structurelle conséquente des rapports sociaux de domination, on ne peut qu’être révolutionnaire. Si, vraiment, il y a des dominations parce qu’il existe des structures qui les portent (l’État, la Justice, la police, la famille, l’école, le travail…), alors il faut les renverser et en penser de nouvelles pour mettre fin aux dominations.
L’histoire des féminismes est souvent présentée par différentes « vagues ». Mais cette historiographie a pu être contestée. En quoi cette métaphore vous paraît-elle pertinente ?
Je comprends parfaitement que cette historiographie, simplificatrice, soit contestée par des historien·nes qui montrent que l’histoire du féminisme est plus complexe qu’une question de séquençage en vagues. Ou par des militant·es, qui rappellent que cette histoire est centrée sur les pays occidentaux et fait fi de l’histoire des luttes féministes hors de ce contexte. Je partage ces critiques. Néanmoins, la notion de vagues me semble apporter deux choses. D’une part, sa simplification même permet une facile appropriation. L’histoire des féminismes est peu connue, en grande partie parce qu’elle a été volontairement invisibilisée et oubliée. Je fais partie d’une génération qui a dû grandir en redécouvrant ce qu’avaient accompli les générations féministes antérieures, au prix d’un long apprentissage parfois difficile. Les choses sont en train d’évoluer avec un dynamisme certain du côté de l’histoire du féminisme, comme en témoigne par exemple la publication du récent ouvrage Ne nous libérez pas, on s’en charge — Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, de Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michelle Zancarini-Fournel.

[Rachel Levit Ruiz | rachellevit.com]
Il me semblait utile de livrer un premier repère historique en trois vagues, qui permet de fixer simplement de grandes périodes. L’autre apport de cette notion, c’est qu’il s’agit d’une caractérisation militante. Bibia Pavard a montré dans son article « Faire naître et mourir les vagues : comment s’écrit l’histoire des féminismes » que ce sont les nouvelles générations féministes qui se sont à chaque fois qualifiées de nouvelles vagues, ce qui a un effet performatif : proclamer qu’on entre dans une nouvelle vague contribue ainsi à la faire advenir. À ce titre, il me semblait intéressant de souligner qu’on assiste actuellement à une quatrième vague du féminisme, afin de prendre la mesure de la situation et de réfléchir collectivement aux tâches politiques que cela implique. La particularité de cette quatrième vague est qu’elle ne naît pas dans les pays occidentaux, mais en Amérique latine — ce qui permet justement de sortir du reproche qu’on a pu faire. Il serait d’ailleurs intéressant de relire ce séquençage avec les apports des recherches historiques sur les féminismes non occidentaux.
Franck Gaudichaud nous disait justement toute l’importance du féminisme pour comprendre les mouvements sociaux en Amérique latine1. Les féminismes latino-américains sont-ils aujourd’hui les plus à même de faire la jonction avec le mouvement ouvrier ?
« Les femmes de chambre de l’hôtel Ibis-Batignolles lient indissociablement le féminisme, la lutte antiraciste et celle pour l’amélioration de leurs conditions de travail. »
Cette question du lien est très compliquée. Historiquement, le mouvement féministe en tant que tel est né au sein des révoltes sociales. Mais sa particularité a toujours été d’être transclasse. Il a ainsi pu être réduit par des fractions du mouvement ouvrier, parfois par ses dirigeants staliniens, à un mouvement bourgeois ou petit-bourgeois. Cela a entraîné une crise durable entre mouvement féministe et mouvement ouvrier depuis les années 1970, avec l’émergence d’un mouvement féministe autonome du mouvement ouvrier — au moins partiellement. Même si cette autonomie est à relativiser : les féministes du courant « lutte de classes » faisaient, dès cette époque, le lien entre les deux mouvements. Aujourd’hui, une partie de l’extrême gauche continue de nier la centralité politique du féminisme et ne se souvient de sa force que lorsqu’il parvient à mobiliser massivement des milliers, voire des millions de personnes. Cette fraction de l’extrême gauche conteste surtout sa centralité à un niveau stratégique : elle peut reconnaître qu’il existe des formes d’oppression spécifiques qui pèsent sur les femmes et les minorités de genre, mais elle ne pense pas que l’oppression de genre est consubstantielle au capitalisme et nie qu’elle est aussi une forme d’exploitation, c’est-à-dire d’appropriation de la force de travail. On pourrait faire exactement les mêmes remarques sur la centralité politique de l’antiracisme.
Mais, bien sûr, on ne saurait réduire le mouvement ouvrier à cette fraction de l’extrême gauche. Je crois qu’à la base des mouvements, au contraire, il y a une forte conscience de la nécessité de la convergence des luttes. Et concernant le féminisme, elle est en partie réalisée dans les faits : de nombreuses travailleuses en lutte font le lien entre ces différents combats, car le sexisme et/ou le racisme structurent leur exploitation au travail, et cela n’a pas de sens de les séparer. Un bon exemple est la lutte des femmes de chambre toujours en cours de l’hôtel Ibis-Batignolles. Elles lient indissociablement le féminisme, la lutte antiraciste et celle pour l’amélioration de leurs conditions de travail. Mais pour revenir à l’Amérique latine, je crois que sa particularité repose sur le fait que, justement, le mouvement féministe y est très puissant. C’est peut-être actuellement le mouvement le plus puissant. Dès lors, les féministes peuvent faire en acte la convergence des luttes. En France, je pense que cette convergence adviendra lorsque nous aurons réussi à construire un mouvement féministe fort et populaire, qui pèsera sur le mouvement ouvrier et donnera de l’écho aux femmes et aux minorités de genre du mouvement ouvrier.
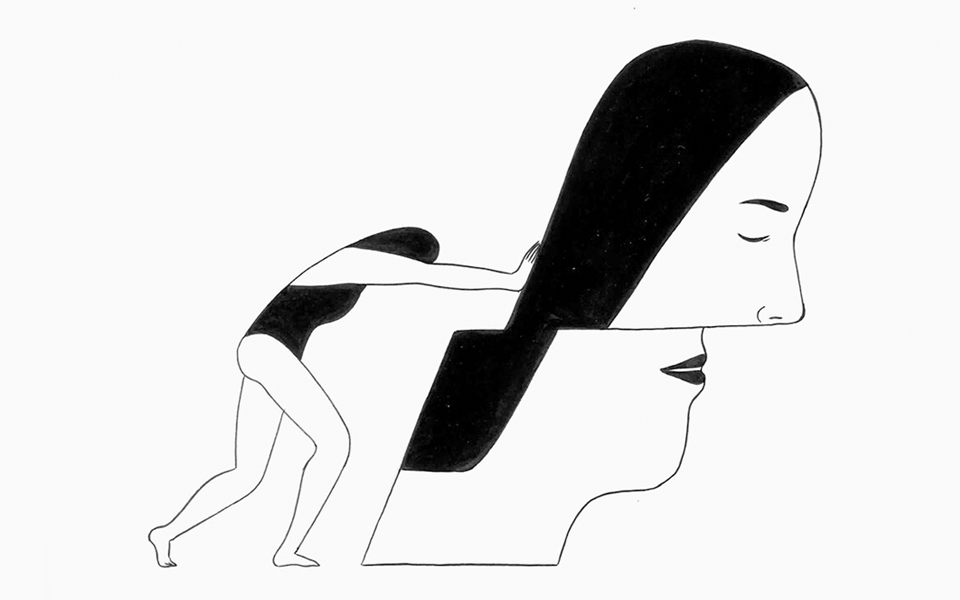
[Rachel Levit Ruiz | rachellevit.com]
Dans une perspective d’articulation du marxisme et du féminisme, vous mettez en avant une théorie de la reproduction sociale afin de penser les rapports de production, de reproduction et les rapports sociaux. Pourquoi est-elle essentielle à vos yeux ?
Cette théorie a émergé au croisement de la théorie marxiste et de la théorie féministe dès les débats des années 1960–1970, autour du travail domestique. Puis elle s’est cristallisée dans les années 1980 autour d’un ouvrage majeur, Marxism and the oppression of women de Lise Vogel, pour connaître un renouveau ces dernières années dans un contexte politique et universitaire spécifique. D’un côté, le marxisme a en effet connu un regain d’intérêt dans le contexte de la crise économique de 2007–2008. De l’autre, la théorie féministe, à la faveur de la nouvelle vague, est particulièrement dynamique ces dernières années. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’importance qu’a prise la théorie de la reproduction sociale. Elle essaie de livrer une analyse de l’oppression des femmes et des minorités de genre dans le cadre théorique du marxisme — ce qui implique bien évidemment d’avoir un rapport souple à ce dernier. La théorie de la reproduction sociale montre que si les femmes et les minorités de genre sont dominé·es, ce n’est pas dû à une simple oppression idéologique qui aurait perduré (comme une réminiscence d’un ancien temps). Elle montre également que ce n’est pas accessoire au capitalisme, et que le capitalisme n’aurait pas pu être indifférent au genre. Si cette domination existe, c’est qu’elle a une base matérielle et que cette dernière est nécessaire au capitalisme. Cette base matérielle, c’est l’assignation des femmes et des minorités de genre dans le cadre d’une division genrée du travail, à un type de travail spécifique : le travail reproductif. Celui-ci consiste à produire et à reproduire la vie, c’est-à-dire les travailleurs et les travailleuses dans le cadre de l’économie capitaliste. Dit à un plus haut niveau d’abstraction, et en utilisant les catégories marxistes, le travail reproductif est le travail qui produit et reproduit la force de travail. Il faut donc bien voir qu’il ne s’agit pas d’un travail centré sur le biologique. Au contraire : l’essentiel des tâches qui y sont liées ne sont pas d’ordre biologique. Même quand le travail reproductif inclut des processus biologiques, ils sont marqués du sceau du social. D’où le terme de « reproduction sociale ».
Comment ce travail reproductif se traduit-il concrètement ?
« Il est impossible de penser un capitalisme qui soit indifférent au genre (de même qu’à la race).
Il s’effectue à un double niveau. D’abord à un niveau quotidien, il consiste à accomplir l’ensemble des tâches nécessaires pour que les travailleurs et travailleuses soient fraiches et disposes pour retourner travailler le lendemain : préparation des repas, lessives, entretien de la maison, etc. Ensuite, à un niveau intergénérationnel, il consiste à reproduire la force de travail dans le temps : par la production et l’éducation des enfants, notamment. L’un des lieux centraux dans lequel se déploie le travail reproductif est la famille — il correspond alors au travail domestique théorisé par les féministes des années 1970. Mais l’intérêt de la théorie de la reproduction sociale est de montrer qu’il peut aussi être effectué dans d’autres espaces.
Lesquels, par exemple ?
Il peut être en partie collectivisé via les services publics, notamment en matière d’éducation et de santé. Dans ce cadre, il demeure extrêmement genré : ce sont majoritairement les femmes et les minorités de genre qui le prennent en charge. De la même façon que le travail reproductif est invisibilisé et méconnu comme travail dans le cadre de la famille, mais présenté comme le résultat d’une aspiration « naturelle », il est dévalorisé socialement et faiblement rémunéré dans le cadre des services publics — et considéré comme à la limite d’un travail. Mais il peut aussi être intégré à la sphère du marché, cette fois-ci principalement via les services à la personne. Dans ce cadre, on constate qu’il n’est pas seulement genré mais également extrêmement racisé : ce sont en grande partie les femmes des classes populaires et racisées qui l’effectuent. Cela permet de montrer que des actrices centrales de la lutte féministe sont les femmes racisées, qui prennent aujourd’hui de plus en plus en charge le travail reproductif. Dans le cadre capitaliste, la domination des femmes et des minorités de genre est ce qui permet indirectement la production des profits. Il est donc impossible de penser un capitalisme qui soit indifférent au genre (de même qu’à la race) : tout son fonctionnement repose sur l’existence et la perpétuation de ces rapports sociaux de domination.

[Rachel Levit Ruiz | rachellevit.com]
Selon vous, le point faible du féminisme dit « matérialiste » « réside […] dans son manque d’élaboration stratégique ». Vous esquissez la voie d’une stratégie révolutionnaire et marxiste : pourquoi serait-elle plus à même de réussir ?
Pour être précise, je fais l’hypothèse qu’une des causes de la rapide institutionnalisation du mouvement féministe repose sur le manque d’élaboration stratégique du féminisme matérialiste hors mouvement. De façon significative, Christine Delphy pouvait dire dans les années 1970, revenant sur son article « L’ennemi principal », que parler de lutte révolutionnaire « ne veut pas dire qu’on sait comment s’y prendre, ni ce qu’il faut détruire pour détruire [le patriarcat]. Le découvrir fait partie intégrante de la lutte ». Je pense que c’est en partie symptomatique du fait que la lutte féministe se suffisait en quelque sorte à elle-même, et qu’il y avait ici une forme de refus d’élaborer une stratégie concrète de renversement du patriarcat. Mais je ne l’écrirais probablement plus exactement sous cette forme aujourd’hui…
Pourquoi ?
« Nous ne devons pas avoir peur de tirer les bilans de nos erreurs passées pour pouvoir construire un mouvement féministe qui soit le plus victorieux possible. »
J’ai l’impression que c’est un mouvement indépassable du capitalisme que de coopter les différents mouvements contestataires. Par contre, sur la question du débat entre féministes matérialistes et féministes marxistes, il me semble important, d’abord, de souligner combien nous sommes toutes et tous débitrices, en tant que féministes, des élaborations extrêmement riches théoriquement du féminisme matérialiste. Le désaccord se place davantage à un niveau politique. Christine Delphy en particulier a défendu l’idée d’un mode de production patriarcal autonome et parallèle au mode de production capitaliste, alors que je trouve que l’articulation entre production et reproduction que propose la théorie de la reproduction sociale est une analyse plus convaincante. À un niveau stratégique, cela l’a menée à défendre une totale autonomie du mouvement féministe par rapport aux autres mouvements. Or cela me semble faux, théoriquement, tant le genre, la classe et la race sont entrelacés : ils se produisent et se reproduisent mutuellement. Faux et grave, stratégiquement. Je doute qu’aucun mouvement n’ait le pouvoir de renverser le capitalisme ou le patriarcat à lui tout seul et de mettre en place une autre organisation sociale sans poser centralement la question de la production et de la reproduction, la question du genre comme de la classe et de la race.
Vous faites une lecture critique de ce que vous nommez « la stratégie intersectionnelle », c’est-à-dire de certaines appropriations du concept d’intersectionnalité par des milieux militants : notion de « privilèges » qui efface la question du pouvoir, individualisation de la domination au détriment d’une approche structurelle, « safe spaces » [« espaces sûrs »] peu démocratiques, recherche de pureté individuelle… C’est là un constat amer de militante ?
Cela part effectivement d’une expérience militante. Le bilan me semblait nécessaire. Non pas que j’en garde une amertume particulière, mais plutôt parce que nous assistons à une renaissance du féminisme. Nous ne devons pas avoir peur de tirer les bilans de nos erreurs passées pour pouvoir construire un mouvement féministe qui soit le plus victorieux possible. Je suis moi-même entrée dans ces logiques, à une époque : il ne s’agit pas tant d’une critique que d’une forme d’autocritique. J’ai d’ailleurs l’impression que je ne suis pas la seule à dresser ce bilan : en réalité, nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à le faire. Le nombre de collectifs féministes qui ont explosé — c’est par exemple le cas de mon ancien collectif — et de personnes qui ont arrêté de militer suite à ces phénomènes a poussé à une réflexion collective d’importance et à une profonde remise en question de ces pratiques.

[Rachel Levit Ruiz | rachellevit.com]
D’aucuns estiment que l’intersectionnalité est un cadre théorique, et non une stratégie. L’objet de votre critique semble parfois osciller entre ce cadre théorique et son appropriation stratégique…
Dans la lignée des élaborations du Black feminism, l’intersectionnalité est conceptualisée par la juriste américaine noire Kimberlé Crenshaw dans deux articles fondateurs de 1989 et 1991. Si elle développe tout un ensemble de réflexions, on peut dire que le noyau central de son propos est de montrer qu’il est impossible d’isoler un rapport social de domination des autres (notamment ceux de genre, classe, race) : ils sont articulés entre eux et se reconfigurent mutuellement. Le terme connaît un tel succès, tant théorique que militant, qu’il est en partie approprié par la sociologie du genre, notamment, et sert alors à désigner avant tout une méthode — celle du croisement des dominations sociales. Je suis donc d’accord sur le fait que l’intersectionnalité est d’abord et avant tout une théorie. Cela n’a pas empêché certaines appropriations militantes, qu’il faut distinguer de l’intersectionnalité originelle — ce que j’essaie de faire dans mon ouvrage, peut-être avec plus ou moins de succès. Je montre qu’il s’agit d’une déformation à une échelle individuelle ou interindividuelle de l’analyse matérialiste, et parfois marxiste, du Black feminism originel. Je précise systématiquement quand j’en ai l’occasion que j’ai nommée cette stratégie « intersectionnelle » faute de meilleurs mots pour la caractériser… Dans un contexte où le gouvernement vise à diaboliser l’intersectionnalité et à censurer la production théorique et militante sur le sujet, je suis bien sûr pour revendiquer le terme ! Mais cela ne doit pas empêcher pour autant d’avoir un regard critique sur certaines de ses appropriations militantes.
« Donner la parole aux concerné·es » est un mot d’ordre désormais répandu. Vous regrettez qu’un glissement puisse parfois s’opérer : quand on passe « d’une théorie des points de vue situés […] à une théorie du privilège épistémologique absolu des dominé·es sur leur domination », c’est-à-dire quand « toute personne, si elle est opprimée, détient la vérité incontestable de son oppression, donc la clé de sa libération. » Mais quel serait le « bon » équilibre, alors ?
« Il faut mettre l’accent sur le fait que seule une infime partie de la population n’est dominée d’aucune façon — c’est elle qui possède le pouvoir politique et économique de déterminer les vies de toutes et tous les autres. »
Là aussi, il s’agit d’une déformation de la théorisation originelle. On passe de l’idée tout à fait marxiste que la position sociale détermine notre façon d’appréhender le monde (et qu’il est donc intéressant, pour analyser la domination, de repartir de l’expérience de celles et ceux qui la vivent — et que cela peut, politiquement, nécessiter des moments et des organisations en non-mixité) à l’idée que seul·es celles et ceux qui vivent la domination ont le droit d’en parler. Et qu’ils doivent s’organiser politiquement de façon absolument autonome de celles et ceux qui ne la vivent pas. Lorsqu’on adopte une perspective intersectionnelle, justement, on voit que c’est difficile à tenir : cela a pour effet d’atomiser les luttes et d’empêcher toute convergence. A contrario, je pense qu’il faut mettre l’accent sur le fait que seule une infime partie de la population n’est dominée d’aucune façon — c’est elle qui possède le pouvoir politique et économique de déterminer les vies de toutes et tous les autres. Même si, actuellement, nous ne vivons pas les mêmes types de domination, même si, ponctuellement, nos intérêts peuvent diverger, nous avons un intérêt matériel supérieur à nous unir pour renverser les structures de la société et mettre en place une autre façon de vivre, de produire, de reproduire et de faire de la politique.
Au vu de l’héritage théorique et politique dans lequel vous vous inscrivez, de quel œil voyez-vous le phénomène de réhabilitation des sorcières dans le féminisme occidental — avec la part « ésotérique » qu’il charrie parfois ?
La spécificité de la figure de la sorcière, c’est qu’elle est particulièrement plastique. Elle peut être revendiquée comme un symbole féministe large : la chasse aux sorcières est un exemple historique de féminicide de masse. Ou être appropriée par différents courants au sein même du féminisme, qui en feront à chaque fois une lecture différente. C’est le propre des symboles. La sorcière a pu être convoquée par des black blocs féministes, nommés « Witch Blocs », pendant la mobilisation contre la loi Travail. C’est le noir qui y est associé, et sa connotation féministe, qui ont rendu possible cette appropriation. Théoriquement, c’est une figure que convoque aussi bien Silvia Federici dans une lecture matérialiste de l’avènement du capitalisme comme accumulation primitive du corps des femmes dans Caliban et la sorcière, que Starhawk, qui revendique sa part d’ésotérisme. Je pense donc que les significations de la sorcière ne sont pas figées et que c’est un symbole puissant et mobilisateur qu’il ne faut pas hésiter à convoquer.

[Rachel Levit Ruiz | rachellevit.com]
Vous faites partie du Collectif féministes révolutionnaires, créé, justement, dans l’élan de la mobilisation contre la loi Travail…
On a voulu faire un espace qui soit à la fois féministe et marxiste. Un lieu de formations, de débats, de luttes. Un espace bienveillant où chacun·e puisse à la fois se former collectivement, exprimer des désaccords et militer. Bien sûr, le fait de se définir comme « révolutionnaires » crée de fait une délimitation avec l’ensemble du mouvement féministe. L’idée n’était pas forcément de faire le collectif le plus large possible mais plutôt de défendre au sein du mouvement féministe une certaine politique et une certaine stratégie. Pour mobiliser, il nous semble plus approprié de développer l’auto-organisation à une échelle locale et nationale : via des comités de quartiers et sur les lieux de travail, par exemple, comme au moment du MLAC dans les années 1970. Notre but est d’intervenir conjointement dans le mouvement féministe et dans le mouvement social au sens large, c’est-à-dire aussi bien dans les mobilisations nationales qu’auprès du mouvement antiraciste ou du mouvement ouvrier — en défendant à chaque fois la convergence des luttes. Nous militons activement au sein de la nouvelle vague du féminisme : nous avons par exemple participé à des assemblées générales MeToo en 2017 et nous poussons à la création de comités locaux pour la préparation de la grève féministe pour le 8 mars. Nous soutenons également les différents mouvements sociaux et y mettons en avant les mots d’ordre et les revendications féministes. Lors de la mobilisation des cheminot·es contre la casse de leur statut, par exemple, nous sommes intervenu·es en soutien au technicentre du Landy à Saint-Denis ; en retour, ils et elles sont venu·es manifester avec nous à la Marche des fiertés qui a suivi. Plus récemment, nous soutenons la grève des femmes de chambre de l’hôtel Ibis-Batignolles, dont nous parlions, en lutte depuis plus d’un an.
Mais, au fait : si le féminisme n’est pas un bloc unifié, comme vous l’avez montré, pourquoi avoir intitulé votre ouvrage… La Révolution féministe ?
J’utilise le terme de « révolution féministe » de la même façon que je parle de « mouvement féministe » au singulier — tout en sachant très bien qu’il est traversé par des courants opposés, qu’il existe une diversité de féminismes et que l’étiquette « féministe » peut être appropriée pour défendre des choses qui n’ont pas beaucoup à voir avec le féminisme ! Parfois, il est bon d’avoir des termes plus abstraits, donc au singulier, qui permettent d’englober un ensemble d’espaces différents. Le mouvement féministe est, à l’image du mouvement ouvrier, un terme qui permet de ressaisir l’ensemble de l’espace social féministe, en étant momentanément aveugle à sa diversité consubstantielle. La révolution féministe, c’est à la fois une période, celle qu’on est en train de vivre : la montée d’un mouvement féministe depuis plus d’un siècle, à l’échelle planétaire, qui, comme une lame de fond, une vague, menace de tout renverser sur son passage. Et c’est aussi une promesse. Celle qu’à un moment, une révolution féministe adviendra. Mais j’espère avoir été suffisamment claire sur le fait que, dans ma conception, si aucune révolution ne peut advenir si elle n’est pas féministe, inversement, aucune révolution ne sera féministe si elle ne renverse pas le capitalisme, le système des classes sociales et l’organisation raciste de la société. Si elle ne met pas en place, également, une réorganisation de la production et de la reproduction.
Illustration de bannière : Rachel Levit Ruiz | rachellevit.com
Photographie de vignette : Louise Rocabert
- « [Q]ui est à l’offensive aujourd’hui [en Amérique latine] ? Le mouvement féministe tout d’abord, un des acteurs centraux de la lutte des classes au Chili, en Argentine, au Mexique. Qui a été capable de mettre deux millions de personnes dans la rue dans la dernière période en Amérique latine ? Le mouvement féministe chilien, argentin, pas la gauche révolutionnaire ! Ceux qui ont une vision strictement ouvriériste du changement social ne peuvent pas comprendre l’Amérique latine ! »[↩]
REBONDS
☰ Lire notre abécédaire de Clara Zetkin, septembre 2020
☰ Lire notre article « Checker les privilèges
ou renverser l’ordre ? », Kaoutar Harchi, juin 2020
☰ Lire notre entretien avec Silvia Frederici : « Le féminisme d’État est au service du développement capitaliste », avril 2020
☰ Lire notre entretien avec Maud Simonet : « Travail gratuit ou exploitation ? », février 2019
☰ Lire notre entretien avec Emma : « Faire péter le patriarcat en même temps que le capitalisme », avril 2018
☰ Lire notre entretien avec Angela Davis : « S’engager dans une démarche d’intersectionnalité », décembre 2017


