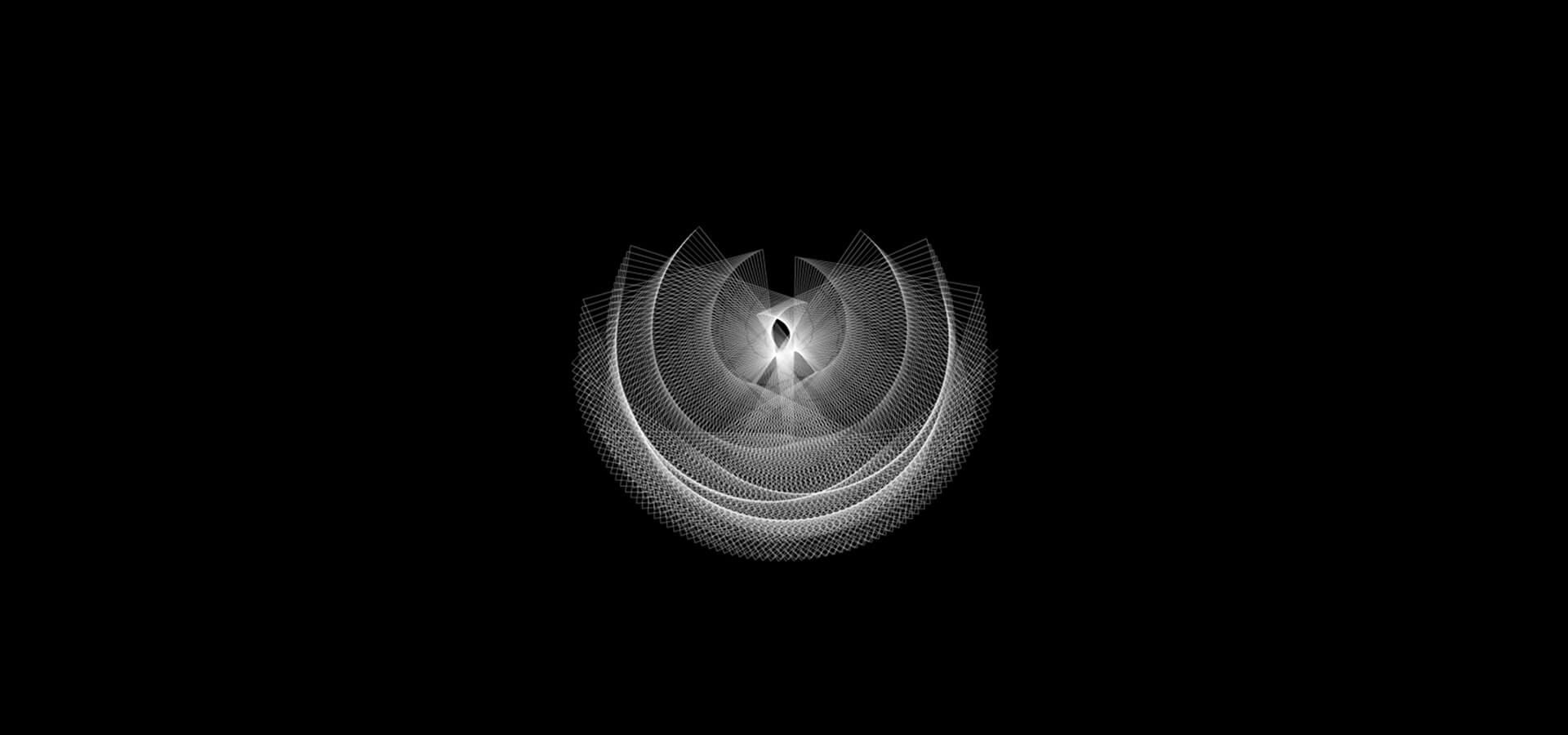Entretien inédit pour le site de Ballast
Alain Damasio est l’un des auteurs incontournables de la science-fiction française : une poétique toute personnelle, un appel à la résistance politique irrigué de vitalisme. Dès La Zone du Dehors, premier roman publié en 1999, ses personnages incarnent une existence orientée vers le « dehors » : des figures de ré-voltés tentant d’échapper à une société futuriste sclérosée par l’hyper-contrôle de ses citoyens. Chez Damasio, qui se dit lui-même « philosophe raté », les figures tutélaires de Foucault, Nietzsche et Deleuze ne sont jamais loin — ces deux derniers inspireront son second ouvrage, La Horde du Contrevent. Romans, nouvelles, mais aussi jeux vidéo, productions sonores et scénarios ; il multiplie les supports, quitte à agacer son éditeur et à « s’éparpiller1 », comme il l’avoue. Nous l’avons rencontré à Marseille, autour d’un café, attelé à son troisième roman, Les Furtifs. Un entretien que nous vous proposons, tout au long de cette semaine que nous lui consacrons, en quatre volets.

Comment lier art et engagement sans verser dans la propagande ?
Il y a une chose essentielle qui différencie l’art de la propagande. La propagande, comme disait Foucault, c’est l’art de « conduire des conduites », de créer quelque chose dans un registre argumentatif afin d’amener les gens à adopter certains comportements. Il y a une vraie volonté de manipuler la liberté des personnes, de la canaliser vers des points considérés comme relevant de la vérité. La grande différence et la grande chance, pour nous, artistes, c’est que nous sommes des « ouvreurs » : on ouvre le crâne des gens. Ce qui m’intéresse, c’est d’arriver à ce point où un déclic se fait, où les gens, simplement, ouvrent les yeux, les oreilles et parviennent à quelque chose d’autre. L’art doit permettre le décollement de la norme subie au quotidien. Il t’ouvre sur l’émotion, sur la perception, mais ne les ferme pas. La différence vient aussi du registre. Entre un registre poétique et un registre argumentatif, il y a une énorme différence. Toute la propagande relève de l’argumentatif : tu accumules des arguments qui te conduisent à une « vérité », tu réduis le cône jusqu’à toucher ce que tu veux faire croire aux gens. L’art opère en sens inverse : c’est un cône d’ouverture. Ce n’est pas si évident que ça, à l’écrit : des amis extrêmement littéraires me reprochent de trop fermer certaines de mes productions écrites. Je n’en ai pas l’impression, mais c’est possible.
Engagé, militant… Que choisir ?
« Nous, artistes, nous sommes des
ouvreurs: on ouvre le crâne des gens. »
Engagé, de façon certaine, mais « engagé », c’est très large. Je considère qu’un artiste, à partir du moment où il dispose d’une parole publique, même minimale, engage à une responsabilité vis-à-vis de ceux qui vont le découvrir, le lire, le suivre ; il a dès lors un impact et ne peut plus faire les choses de façon neutre. Ceci étant, j’ai toujours dit que je ne me considérais pas comme un militant. J’aimerais en être un, au concret, au quotidien. La vérité, s’il y en a une, c’est que ma militance consiste à créer tout le temps. Je travaille énormément, dans beaucoup de domaines, et c’est comme cela que j’ai l’impression d’agir sur le monde. Parfois, j’aimerais être sur des actions toutes simples, concrètes, sobres, qui dépassent la manifestation et les tracts ; en même temps, la chance que j’ai, c’est ce don pour créer — autant que je l’utilise au maximum pour aider les mouvements et y contribuer avec ma création.
Dans La Zone du dehors, les personnages principaux veulent « insuffler de l’air dans les interstices » d’une société contrôlée et cherchent des moyens de le faire. Il y a par exemple cette idée des « clameurs », appareils cachés qui déclament automatiquement un message unique à ceux qui passent à proximité…
Les clameurs, c’est un excellent point. Dans ce livre, je voulais vraiment créer un chapitre de réflexion sur la publicité. Quelle est la différence entre un groupe d’extrême gauche qui balance des slogans et une pub qui va te demander d’acheter tel ou tel parfum ? Ma réponse a été très claire : si je crée des clameurs (il y en a qui ont déjà été créées, et j’espère un jour avoir suffisamment de financements pour en générer un maximum), le point fondamental serait qu’aucune ne se répète, ne dise le même slogan, que chaque clameur soit artisanalement créée, propre à une personne. La clameur, pour moi, ne doit pas fermer le sens mais garder une certaine polysémie poétique. Si tu es sur ce mode-là, alors, oui, tu peux prétendre amener les gens vers une forme de liberté. Dans le groupe Zanzibar2, on a le projet de faire de l’affichage avec des blocs de nouvelles assez courtes. Elles se situeront dans le registre émotionnel et non argumentatif. La diversité est extrêmement importante ; pour moi, tu ne peux pas porter un mouvement d’extrême gauche si tu ne fais que répéter des slogans redondants. Je suis par exemple toujours gêné par le slogan « ACAB » [acronyme pour « All Cops Are Bastards » ; en français, « Tous les policiers sont des bâtards », ndlr] : c’est cool, « ACAB », mais en quoi amènes-tu les gens vers plus de liberté en disant cela ? Ce n’est pas suffisant.
Les théoriciens Ernesto Laclau et Chantal Mouffe assurent que le langage est un terrain permettant à la fois de résister et de fédérer, en utilisant parfois les mots comme des « signifiants vides » derrière lesquels chacun peut mettre ce qu’il veut y trouver. Comment entendez-vous cette bataille politique des mots ?
C’est complexe. Les mots sont des vecteurs de catalyse et de convergence. Mais il est difficile de créer des mots qui soient denses, habités, et qui permettent en même temps à des gens de se réunir. Je me méfie donc beaucoup du côté « mot-sac » dans lequel on met ce que l’on veut. Il est également facile de faire croire à un concept nouveau en mettant un mot nouveau dessus. Je vous donne un exemple : j’ai commencé à en avoir marre d’entendre le mot « transhumain », j’ai cherché une façon d’y réagir, je me suis dit que « très-humain » était intéressant. Ça me permettait d’éviter « surhumain », « surhomme », qui restent encore connotés, associés au nazisme. Quand tu crées un néologisme comme celui-ci, tu permets à des gens d’acter leurs positions sans être piégés par la réaction des transhumanistes, qui ont un discours du genre : « Vous êtes des réacs, vous allez vous éclairer à la bougie, vous êtes dans le bioconservatisme… » « Très-humain » est un mot qui permet de s’opposer en disant : « Si ! On a une vitalité, on a un mouvement : on va au bout des capacités humaines, de ce que l’humain peut. » Malgré tout, il ne faut pas être dupe : « Très-humain », c’est surtout Spinoza, Nietzsche, Deleuze, Jacques Ellul, Ivan Illich — j’ai simplement créé un nouveau syncrétisme. Et on en a parfois besoin : souvent, les gens ne connaissent pas Ellul, n’ont jamais lu Spinoza ni Nietzsche… On a un rôle en tant qu’écrivains : essayer d’amener un peu de nouveauté dans les logiciels, de trouver de nouvelles façons de s’opposer, qui permettent de dire : « Enfin quelque chose de nouveau se passe ! » C’est en cela que je trouve le travail sur les mots intéressant.
Il y a également le mot « volte » — construit en enlevant le préfixe de « révolte » —, que vous utilisez et qui a donné son nom à votre maison d’édition…
« La volte redonne la dimension de ce que c’est qu’être actif, c’est-à-dire de générer un mouvement par soi-même. »
Oui. « Volte », pour moi, ce n’est pas un jeu de mot : c’est vraiment important. J’ai eu le sentiment que nous étions passés d’un régime disciplinaire à un régime de contrôle. Quand tu dis « révolte », tu es encore dans le régime disciplinaire ; tu n’as pas encore compris que le problème, ce n’est pas seulement les médias, les multinationales et l’État — même si ces forces continuent à être importantes —, mais l’existence de types de pouvoirs bien plus virulents, extrêmement disséminés, diffus, dont tu es esclave. Ce n’est pas juste Google, Apple ou Facebook : tout le monde y participe, en est acteur. N’importe qui, en créant un site, fait du design de la dépendance, participe à l’économie de la captation de l’attention. Par rapport à cela, la volte est importante puisqu’elle n’indique pas uniquement « Je me révolte sur un truc » : encore faut-il échapper au truc ! Il ne faut pas dire « J’éteins tous les sites et je ne me connecte plus à Internet. » Cela se passe davantage dans tes pratiques, dans ta prise de conscience. La volte redonne la dimension de ce que c’est qu’être actif, c’est-à-dire de générer un mouvement par soi-même. Par exemple, la ZAD s’avance en réaction contre Vinci ; elle tient de l’ordre de la révolte. Mais, en réalité, ce qu’ils vivent au quotidien, c’est de la volte, profondément : les gens, d’eux-mêmes, génèrent un ensemble de modes de vie qui sont du domaine de l’action, du « On fait ensemble quelque chose ». Et c’est précieux : ce sont eux qui vont montrer que du désir est possible.
Dans La Horde du Contrevent, les personnages tentent de trouver l’origine d’un vent qui souffle toujours dans la même direction. Doit-on y voir une métaphore d’ordre politique ?
Non, il n’y avait pas d’idée de métaphore. La vraie dimension politique de La Horde, c’est comment un groupe de 23 personnes peut fonctionner ensemble et aller au bout de ce qu’elles peuvent. J’essaie de travailler sur le lien, en 600 pages. C’est tellement dur d’être lié, ne serait-ce qu’à 5, à 10, donc à plus forte raison à 20… Ce roman montre un groupe en actes, qui va au bout de ce qu’il peut, qui va jusqu’au bout de son conatus, qui persévère dans son être de horde. Nous sommes dans une logique nietzschéenne : le but était dans le chemin mais n’avait pas de sens — c’était uniquement le « Tu dois » qu’on leur avait donné. Ils ont été formés pour aller au bout et, dès lors, vont au bout. Après, il y aura le tome 2, qui sera le « Je veux » et « Je crée ». C’est pour cela qu’il y a quantité de gens qui ne comprennent pas la fin, qui se disent qu’« en fait, c’est triste » ; non, ça ne l’est pas : c’est une étape du cheminement. Ils étaient chameaux et deviendront lions, puis enfants3.
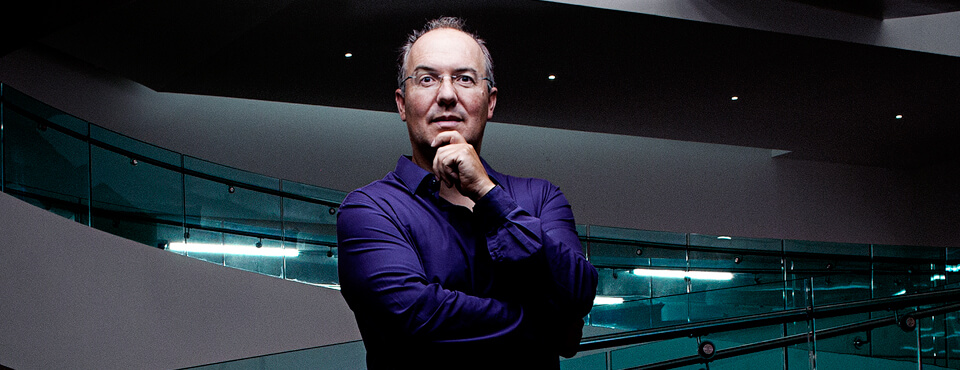
Par Cyrille Choupas, pour Ballast
Où en êtes-vous de ce tome 2, d’ailleurs ?
C’est en cours, il est dans ma tête ; j’ai beaucoup de choses dessus…
Vous aimez expérimenter d’autres langages que celui de l’écrit : le jeu vidéo, la création sonore… À quand Alain Damasio scénariste pour la série dystopique Black Mirror ?
J’adorerais ! J’ai trouvé la saison 2 excellente ! Quand je l’ai vue, je me suis dit que ce n’était pas la peine que je fasse des séries TV, que je n’étais pas au niveau. Ce que je trouve absolument génial, c’est la faculté qu’ils ont de te mettre dans un malaise prodigieux par rapport à la technologie, sans être moralisateur ni technophobe. On les sent traversés par la fascination de la technologie ; ils nous font traverser cette technologie dans tout son mal-être. Le chef d’œuvre de Black Mirror, c’est l’épisode de Noël [« White Christmas », ndlr]. C’est un chef d’œuvre absolu, je le place au zénith ! Il y a une mise en abîme, une narration en poupées russes… Par exemple, le fait que tu ne puisses plus voir ta copine parce qu’elle t’a « bloqué » et qu’elle est toute brouillée à ton regard, ça te tord l’estomac. Tu sors de l’épisode et ça reste en toi, ça ancre une mémoire. Ça devrait être un long-métrage, dans le haut du panier des grands films de SF. Mais c’est dur de faire ça. Dans la saison 2, toujours, ils traitent de la mémorisation permanente [l’épisode « The Entire History of You », ndlr] : tu peux traiter ce problème de 500 façons différentes. Je peux le dire parce que j’ai travaillé dessus durant trois ans, pour le jeu vidéo Remember Me. Eux, ils choisissent un axe, c’est la jalousie, et c’est extrêmement puissant parce que tu es touché émotionnellement sur plein d’aspects de ta propre vie, de ton propre rapport à la jalousie. Ça t’ouvre à énormément de questions. On est dans la poésie, l’émotion et la perception. Dans la saison 3, ils sont victimes de leur succès et on voit à quel point il est compliqué de créer. Par exemple, l’épisode où ils se co-évaluent tous : l’idée est très chouette, mais c’est trop linéaire : le scénario est trop moralisateur, démonstratif — ils sortent du registre dérangeant pour entrer dans un registre argumentatif. C’est la différence entre l’art et la propagande : on en a là un très bon exemple. Mais j’aurais du mal à faire un scénario qui ne soit pas trop explicite ; j’aurais le même problème. Tu veux pousser, tu veux aller plus loin, taper plus fort, mais en faisant cela tu perds toute la magie de ce que tu fais et tu sors de l’art pour faire de la propagande. Si ça se trouve, mon tome 2 de La Horde va être de la merde. Je vous dis ça et, en même temps, je suis conscient de pourquoi ça peut merder, donc peut-être pas…
Visuel de couverture : http://www.phonophore.fr
Toutes les photographies d’Alain Damasio sont de Cyrille Choupas, pour Ballast.
- Il participe à la création de Dontnod et travaille sur le scénario de leur première production, Remember me. Il s’intéresse également au travail sonore : sa maison d’édition, La Volte, lui permet d’accompagner la réédition de son second roman d’une bande originale. Il prolonge ses écrits par des expérimentations sonores, participe à la création d’une série radiophonique dystopique, propose des ballades sonores et déclame de la poésie sur la scène de la philharmonie de Paris, le temps d’un concert électronique avec son ami Rone en chef d’orchestre. Récemment, il a également participé à une exposition sur le thème du travail. [↩]
- Collectif d’auteurs de science-fiction dont fait partie Alain Damasio. Dans son « minifeste », Zanzibar revendique « rêver ses textes comme des endroits où se rencontrer, où penser et commencer à désincarcérer le futur. »[↩]
- Voir « Les trois métamorphoses », telles qu’énoncées Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Vincent Message : « Accomplir le projet inachevé des Lumières », juin 2016
☰ Lire notre article « Lire Foucault », Isabelle Garo, février 2016
☰ Lire notre entretien avec Jean-Pierre Siméon : « La poésie comme force d’objection radicale », décembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Olivier Rolin : « La littérature m’a permis de voir les multiples facettes de la réalité », février 2015
☰ Lire notre entretien avec Kaoutar Harchi : « Mes personnages viennent du désaccord », janvier 2015
☰ Lire notre entretien avec Édouard Louis : « Mon livre a été écrit pour rendre justice aux dominés », janvier 2015
☰ Lire notre entretien avec Daniel Zamora : « Peut-on critiquer Foucault ? », décembre 2014