Texte inédit pour le site de Ballast
Au début des années 1990, l’universitaire étasunien Allan Bloom compare sa situation à celle des réfugiés du Cambodge : les explosions de bombes, ce sont cette fois les féministes qui auraient pris le contrôle du monde universitaire… À l’époque, les femmes occupent pourtant 10 % seulement des chaires du pays — et, dans la discipline de l’intéressé, la philosophie, ne sont à l’origine que de 2,5 % des publications. Comment comprendre pareille réaction ? C’est à cette tâche que s’attelle Susan Faludi dans son ouvrage phare Backlash, paru en 1991. Celui-ci décrit et analyse les mobilisations hostiles qui, aux États-Unis, ont alors suivi l’affirmation du mouvement féministe. Alors même que la situation du début des années 1990 reste profondément inégalitaire, l’émancipation des femmes qui se profile est en elle-même une possibilité insupportable pour les partisans de l’ordre social en place. S’ensuit une réaction violente : un « backlash ». ☰ Par R. R. Cèdre

En français, on traduit « backlash » par « contrecoup », soit la répercussion d’un choc : une conséquence naturelle, inéluctable, un écho plus léger que le coup originel, une petite résistance. L’ouvrage Backlash de Susan Faludi est l’histoire d’un contrecoup, celui de la réaction à l’avancée du féminisme des années 1970 aux États-Unis1. Un contrecoup redoutable pour un petit coup bien modéré. Un contrecoup qui a écrasé le féminisme, en a fait une insulte pour longtemps — qui l’a fait résonner, aussi, dans des invectives haineuses et des plaisanteries crasses.
« Toute l’entreprise de Backlash peut être lue comme la déconstruction des idées reçues antiféministes qui nous imprègnent. »
Le propos de Susan Faludi est de montrer que si le mouvement féministe a progressé par « vagues » depuis les suffragettes — on parle ainsi aujourd’hui d’un féminisme de troisième ou de quatrième « vague » —, ce qu’on oublie, c’est le ressac. Celui-ci n’est pas le résultat d’un épuisement du féminisme, lequel aurait atteint ses objectifs, mais plutôt d’une réaction active : cette dernière s’évertue à décrédibiliser et diffamer le féminisme comme mouvement politique, par le biais de discours ayant trait aux valeurs ; à affaiblir les droits des femmes et leurs possibilités de lutte par l’intermédiaire de mesures économiques ; à saper la volonté et retourner l’opinion des femmes via des représentations médiatiques. Faludi expose les ressorts de la revanche et met en évidence deux causes premières : la structuration de l’économie et la construction de la masculinité. Si les réactions antiféministes ont vu le jour, ce n’est ainsi « pas seulement à cause de la persistance du vieux fond de misogynie, mais avant tout parce que les femmes s’efforcent d’améliorer leur condition et que les hommes, surtout lorsqu’ils sont menacés dans leur bien-être économique et social, interprètent toujours cet effort comme une atteinte à leurs prérogatives » . L’actualité française, hélas, l’illustre — de Polanski récompensé aux Césars à la répression violente de la manifestation féministe du 7 mars 2020. Si l’ouvrage n’a pas perdu de son mordant, il s’agira ici de le relire à la lumière des critiques afroféministes, à commencer par Ne suis-je pas une femme ? de bell hooks, publié en 1980.
La faute des femmes
Toute l’entreprise de Backlash peut être lue comme la déconstruction des idées reçues antiféministes qui nous imprègnent. Parmi elles : prétendues pénuries d’hommes, dénatalité, épidémie d’infécondité, déprime des femmes célibataires, maltraitance dans les crèches — à l’opposé d’un rôle maternel sacralisé —, mais aussi crises du mariage, de la masculinité ou encore de la féminité… Autant de fantasmes sur les impacts terribles du mouvement féministe. Or, contrairement à ce que clament les antiféministes, ce n’est pas l’arrivée des femmes sur le marché du travail qui menace « le bien-être économique et social » des hommes : il n’est, au contraire, pas difficile de constater que dans un ménage hétérosexuel marié (cellule de base de la société dans le contexte de Faludi, et aujourd’hui encore), le fait que le mari et l’épouse travaillent tous les deux ne peut mathématiquement qu’augmenter les revenus — du fait de la double journée féminine, le travail domestique continuant à être assuré gratuitement2. Alors pourquoi, lorsqu’un contexte particulier menace économiquement les hommes — changements politiques, guerre, krach boursiers —, interprètent-ils leurs difficultés comme étant liées à la montée des droits des femmes (et particulièrement leur droit de travailler) ?

[Giorgia Siriaco |www.gioeucalyptus.com]
À l’origine de ces phénomènes, on retrouve pourtant majoritairement d’autres hommes en situation de pouvoir. Ces derniers tirent parti à la fois de la précarité des femmes et du sentiment antiféministe, qu’ils investissent eux aussi. Tout en exploitant malgré tout le travail féminin dont ils déplorent le développement, ils maintiennent ces femmes dans un état de fragilité sociale, les empêchant de se constituer en force d’opposition. Ils gagnent une main d’œuvre moins chère et moins syndiquée en déviant les revendications : le patron (souvent un homme) qui a licencié des employés, ou le représentant politique (souvent un homme) qui a fait voter des lois réduisant les droits des salariés, ne sont plus dans le viseur des contestations quand les travailleurs interprètent leurs difficultés comme une conséquence de l’arrivée des femmes sur le marché du travail. Elles font figure de bouc-émissaires — en tant que masse sans visage, mais parfois individuellement. Les femmes « qui ont réussi », implicitement coupables d’avoir rogné leur plafond de verre et d’être entrées dans un milieu d’hommes, sont les premières accusées en cas de crise : lors de la crise économique des années 1980, Karen Valenstein (vice-présidente de EF Hutton, groupe financier) est ainsi prise pour cible par les médias dominants comme incarnation de Wall Street, alors même qu’elle ne fait pas partie des personnes les plus influentes.
Des cuisines aux usines, l’exploitation du travail féminin
« La précarité féminine est liée tant à la structuration de l’économie qu’à la construction de la masculinité. »
Faludi le montre bien : les femmes arrivant sur le marché du travail ne prennent pas la place des hommes. Elles occupent au contraire les postes dont ils ne veulent pas, à des conditions qu’ils refusent (Faludi n’en parle pas explicitement mais il faudrait ajouter : tout comme les femmes noires occupent les postes dont les femmes blanches ne veulent pas, à des conditions qu’elles refusent). En découle une accusation — faite aussi aux immigrés — de « casser » le marché du travail, de faire baisser les salaires. Il s’agit alors de faire pression sur les femmes afin qu’elles abandonnent : par des mesures économiques comme la suppression des crèches et l’inégalité d’accès aux postes ; par des représentations médiatiques promouvant l’image de mère au foyer comme aspiration ultime ; par la tolérance envers le harcèlement au travail. Pourtant, les femmes sont une main-d’œuvre docile et peu coûteuse au service des capitalistes… Sur le court terme au moins, et non sans cynisme, leur travail sous-payé permet une hausse des profits. Mais il faut croire que la mise sous contrôle des femmes est dans ce contexte encore plus sacrée que la croissance.
C’est d’autant plus surprenant que les femmes les plus pauvres ont toujours travaillé : dans les champs, dans les usines, en tant que domestiques… Aux États-Unis, le travail des femmes noires esclaves puis descendantes d’esclaves n’a jamais été un sujet de débat. Mais ce travail, en plus d’être sous-payé et considéré comme dégradant, est perçu comme une « extension du rôle naturel
de la femme [noire]3 » — Susan Faludi n’évoque d’ailleurs pas substantiellement les différences entre les femmes blanches et noires dans son ouvrage : un défaut récurrent dans la littérature scientifique féministe étasunienne4. Une contre-offensive nécessaire, dont la logique semble avoir échappé aux employeurs comme aux syndicats5, est de lutter à la fois pour des droits égaux sur le plan salarial (avec une harmonisation vers le haut) et pour l’émancipation des femmes — puisque c’est leur situation personnelle précaire qui les pousse à accepter ces postes et ces conditions. Pour le dire autrement : de lutter à la fois contre un système patriarcal et contre un ordre économique fondé sur l’exploitation. La précarité féminine est liée tant à la structuration de l’économie qu’à la construction de la masculinité.

[Giorgia Siriaco | www.gioeucalyptus.com]
Puissance économique, puissance virile
C’est que la masculinité se construit également à travers un rôle économique. D’après le rapport Yankelovich6, cité par l’autrice, une grande majorité d’Étasuniens considèrent que le premier principe de la masculinité est la fonction de chef de foyer et de père nourricier7. Notons toutefois que cette éthique valorisante du travail n’est pas universelle, ni le lien entre masculinité et emploi. Pour les Noirs-Américains pauvres qui n’ont souvent accès qu’à des emplois exténuants et déconsidérés qui ne procurent ni richesse, ni sentiment d’accomplissement, le travail ne peut être une source de fierté, et donc de masculinité. Au contraire, accepter des emplois considérés comme dégradants est vu comme démasculinisant8 : l’homme décide, précisément parce qu’il ramène le pain. En bref, ses qualités de supériorité et d’autorité découlent directement de son rôle économique. De ce fait, l’accès des femmes au travail est ressenti comme autant de virilité retirée aux hommes. Si, de nos jours, en France, il semble que peu d’hommes soient troublés par le fait que leur épouse travaille et participe à l’économie du ménage (ce qui n’était pas le cas 30 ans auparavant), on peut toujours observer des survivances tenaces. Il est encore mal vécu que l’épouse gagne beaucoup plus que le mari et le « domine » économiquement9, alors même que cette situation reste rare : en 2011, selon l’Insee, trois femmes sur quatre gagnent moins que leur conjoint. En outre, les femmes assument toujours beaucoup plus que la moitié des tâches domestiques10 : elles sont à la fois soutiens de famille et femmes au foyer, tandis que la contribution masculine à la construction du foyer reste principalement liée, dans les esprits, à l’argent qu’il y apporte. La situation est paradoxale : les femmes, ayant historiquement toujours été plus précaires (car moins considérées, moins éduquées, chargées des devoirs familiaux et des métiers à temps partiel, du care…), sont les premières victimes des crises économiques — et se voient pourtant accuser d’alimenter la précarité.
Les vases communicants de la masculinité
« Cette image de la femme noire puissante permet également d’éloigner les femmes noires du mouvement féministe majoritairement blanc. »
Cette primauté du pouvoir économique, fondateur de la masculinité aux yeux de Faludi, a pu être remise en question. Les hommes qui collent à cette étiquette en retirent du pouvoir, mais ceux qui ne le peuvent pas ou choisissent de ne pas le faire sont-ils pour autant dévirilisés ? L’irresponsabilité tournée en dérision attachante, la fuite vue comme une prise de liberté, l’indulgence envers les pères absents : notre société parvient très efficacement à proposer des narrations efficaces qui présentent la défaillance masculine comme acceptable (« boys will be boys ») ou même positive. Cela va de l’homme qui « ne veut pas se prendre la tête » sur les applications de séduction à « l’esprit libre retenu dans les chaînes du mariage », en passant par le père divorcé qu’on plaint car il ne voit ses enfants qu’un week-end sur deux… alors que, dans 80 % des cas, il n’a jamais demandé à avoir leur garde exclusive11. Pourquoi les épouses divorcées auraient-elles tant de mal à obtenir le versement de leurs pensions alimentaires si ce rôle de pourvoyeur fondait le privilège masculin12 ? Parce que ce rôle est avant tout ancré dans les représentations, et celles-ci n’ont pas forcément à être validées systématiquement… Dans les faits, il y a des femmes pourvoyeuses et des hommes qui refusent de l’être sans perte de statut social. Mais elles et ils sont effacés des représentations.
Le lien entre sexisme et capitalisme pourrait donc moins être lié à la conception de la masculinité qu’à l’utilisation par le capitalisme du sexisme comme miroir aux alouettes. Le sexisme fait des femmes les ennemies castratrices ; il détourne l’attention des véritables forces déshumanisantes à l’œuvre : les institutions racistes-sexistes du capitalisme impérialiste — leur laissant ainsi toute latitude pour prospérer. Ce curieux système de vases communicants de la virilité est aussi utilisé dans le mythe suprémaciste blanc de la femme noire matriarche. Ce stéréotype de la femme noire « trop » puissante, qui écraserait son mari, a été donné comme explication au faible taux d’emploi des hommes noirs : leur difficulté à s’insérer dans le système économique serait due à leur émasculation par des femmes trop fortes. Ainsi, on masque le fait que c’est le racisme institutionnel et le racisme des employeurs qui rend plus difficile aux hommes noirs l’accès à l’emploi. Cette image de la femme noire puissante permet également d’éloigner les femmes noires du mouvement féministe majoritairement blanc : leur supposée puissance (en réalité acceptation stoïque de conditions d’existence sur lesquelles elles n’ont aucune prise) semble rendre inutile un quelconque mouvement politique libérateur.
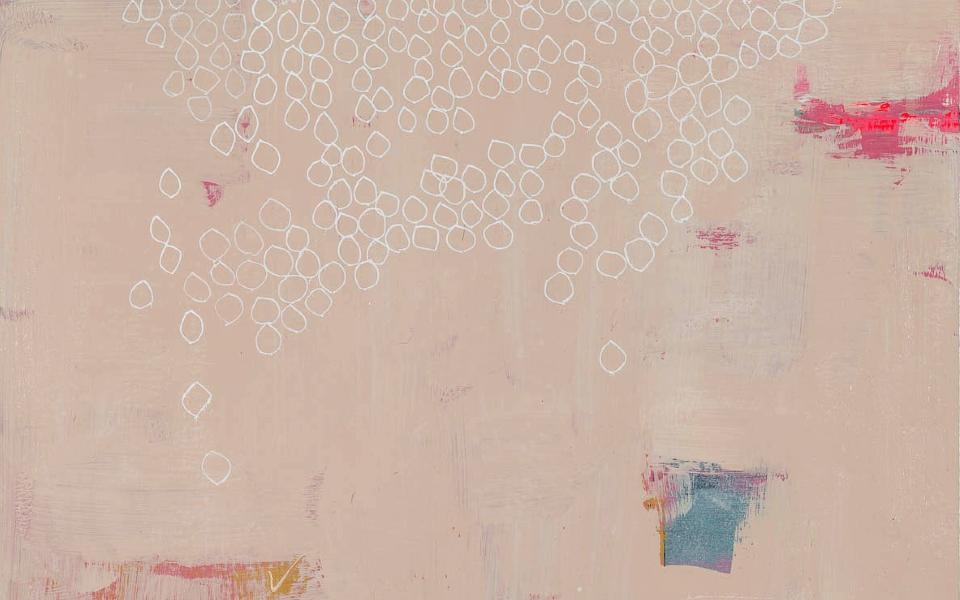
[Giorgia Siriaco | www.gioeucalyptus.com]
Les femmes contre les femmes
Plus subtilement que les attaques frontales des pasteurs évangéliques ou des militants anti-avortement, le contrecoup consiste également à isoler les femmes pour les empêcher de lutter efficacement — monter les femmes les unes contre les autres, en opposant différents modèles tout aussi contradictoires qu’inatteignables de ce que doit être « la femme ». Les autres femmes deviennent des concurrentes tandis que les hommes, hors de cette compétition, peuvent prendre confortablement la place de l’arbitre. bell hooks s’attarde sur cette dynamique dans le contexte de l’esclavage : l’arrivée des femmes noires esclaves a provoqué un changement dans la considération des femmes blanches. Si les femmes blanches étaient les servantes des hommes blancs, elles pouvaient devenir maîtresses à leur tour, particulièrement des femmes noires. Et la peur de perdre ce statut a largement empêché toute solidarité féminine interraciale de se construire. Ce défaut de solidarité a continué après l’esclavage. Il est inhérent au combat qui consiste à lutter pour les droits de la partie de la population dans laquelle on s’inscrit (par exemple, le droit de vote pour les femmes blanches de classe moyenne) sans remettre en question les racines des discriminations, de lutter pour pouvoir s’intégrer dans un système oppressif.
« Certaines femmes conservatrices ont été les porte-étendards de ces mouvements antiféministes. Faludi explique cette position a priori paradoxale. »
Une autre facette de cette stratégie d’isolement et de dépolitisation consiste à dépeindre les difficultés des femmes comme relevant de problématiques strictement personnelles, voire psychologiques, et non sociales : « Dans [les années 1980], les guides pratiques et les divans analytiques sont les deux seules formes d’aide qui s’offrent aux femmes démoralisées ; à l’heure où l’espoir d’un véritable changement social ou politique s’amenuise, changer soi-même devient la seule issue13. » Les vendeurs de guides de développement personnel font leur beurre des anxiétés féminines et entretiennent le filon en remettant au goût du jour les vieilles théories de l’hystérie et du masochisme féminin. Le célibat (des femmes uniquement) est présenté comme une névrose, voire une « androphobie » — le remède miracle contre la dépression étant le mariage. Pour la très médiatique psychologue étasunienne Toni Grant, « le masochisme [est] un désir naturellement féminin » qui pousse les femmes à « choisir » des hommes destructeurs. Quant au féminisme, il engendrerait des psychoses. L’autrice Robin Norwood vend ainsi des thérapies de groupe pour « les femmes qui aiment trop », qui seraient des « droguées des relations ». Elle ne propose pas pour autant d’éduquer les petites filles à ne pas tout attendre d’un prince charmant, afin qu’elles deviennent des adultes émancipées. Enfin, l’édition 1985 du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux comporte de nouveaux troubles qui font des femmes des êtres souffrant naturellement de maladie mentale, notamment les « troubles dysphoriques prémenstruels » et le « trouble masochiste de la personnalité« , dont voici les symptômes : syndrome de l’imposteur, souci des autres, souci de ne pas être un fardeau, propension au sacrifice…
Certaines femmes conservatrices ont été les porte-étendards de ces mouvements antiféministes. Faludi explique cette position a priori paradoxale : en revendiquant en public leur volonté de soumission et en obtenant par là l’approbation masculine, elles acquéraient en privé la liberté effective de mener leur vie. Ainsi Susan Price, thérapeute et autrice elle aussi de guides de développement personnel, défend-elle la soumission naturelle de la femme et avertit contre le piège du féminisme, tout en menant une carrière professionnelle éclatante — ses enfants étant confiés à des baby-sitters. Dans le couple Levin, auteurs du livre Feminism and Freedom, où le féminisme est décrit comme une idéologie totalitaire et comparé au fascisme mussolinien, Margarita a une meilleure carrière que son mari en tant que spécialiste de philosophie des mathématiques — alors même que leur ouvrage affirme que les filles sont nulles en maths ! Ces femmes gagnent en fait leur émancipation en la refusant aux autres.

[Giorgia Siriaco | www.gioeucalyptus.com]
The Self-Unmade Woman
Les femmes antiféministes justifient leur mode de vie en se présentant comme des « exceptions » et se dissocient de la masse « geignarde » des femmes, qui ne mériteraient que ce qu’elles ont. Après tout, si elles ont réussi, c’est que c’est possible, et l’échec de toutes les autres serait dû à une faiblesse de caractère, une défaillance personnelle. Au paradoxe de la femme antiféministe s’ajoute celui de la défense d’une méritocratie absolue qui n’en essentialise pas moins les autres femmes, décrites comme passives et impuissantes, afin de servir leur discours et vendre leurs produits. Le sentiment de culpabilité s’allie alors à l’isolement pour convaincre les femmes que le mouvement féministe est inutile, voire nocif. Cette dynamique est activement entretenue par ceux qui ont tout intérêt à maintenir les femmes dans l’inégalité : outre les patrons, combien de publicitaires, de chirurgiens esthétiques, de couturiers ou de coachs de bien-être tirent profit de ce mal-être social réduit à un mal-être individuel ?
« Outre les patrons, combien de publicitaires, de chirurgiens esthétiques, de couturiers ou de coachs de bien-être tirent profit de ce mal-être social réduit à un mal-être individuel ? »
« Les femmes ne savent pas tirer avantage du pouvoir dont elles disposent », déclare en 1988 Kate Rand Lloyd, rédactrice en chef du magazine Working Woman, citée par Faludi. « Ce que je regrette, c’est que nous ne comprenions toujours pas ce que nous avons accompli, à quel point nous sommes indispensables, et que nous avons tous les outils nécessaires pour changer notre avenir. » Mais comment se penser forte et importante dans un système où chaque malheur est imputé à un manquement personnel ? Aux travailleuses harcelées des années 1980, on répondait « mariez-vous ! » plutôt que de punir les harceleurs. De nos jours, c’est encore aux femmes que l’on recommande de « faire attention » et non aux hommes de se contrôler. L’appareil judiciaire, les politiques publiques et entrepreneuriales ne sont pas neutres. Faludi analyse à cet égard nombre de films et de séries télévisées à succès14 : en imprégnant l’imaginaire collectif, ces œuvres de fiction ont naturalisé certains comportements violents et ont même servi d’arguments dans des procès et des débats politiques, alors que la réalité du terrain les contredisait.
Une porte peut être ouverte ou fermée
Faludi décrit, en creux, une stratégie de lutte contre le reflux antiféministe : s’attaquer à la masculinité hégémonique15. Car tant qu’il y aura des maîtres, il y aura des esclaves. Au gré des diverses vagues du féminisme, les femmes ont peu à peu tenté de déconstruire la conception de la féminité — il reste encore du chemin. Mais cette démarche est encore balbutiante du côté des hommes. Ces derniers gagneraient pourtant à être libérés de nombreuses injonctions à prouver sa virilité par des comportements destructeurs, à réprimer les émotions perçues comme féminines, à la performance économique et physique — qui sont autant de contraintes. « En régime patriarcal […] la norme culturelle de l’identité humaine est, par définition, l’identité masculine — la masculinité. [Elle] rime avec pouvoir, prestige, privilège, et des droits sur et contre la classe des femmes. Voilà ce qu’est la masculinité. Ça n’est rien d’autre », écrit John Stoltenberg dans « Toward Gender Justice16 ».
Les cercles non-mixtes existent depuis longtemps. Ceux des femmes leur ont historiquement appris une position conservatrice (rester à sa « place de femme », l’accepter et y prendre plaisir) ; ceux des hommes ont créé des conceptions de la masculinité toujours plus excluantes, nourries d’aigreurs misogynes (le climat « potache » des Boys’ Club dont on a pu voir encore récemment l’impact délétère sexiste, raciste et homophobe17. Pour Stoltenberg, la solidarité masculine est la base de la perpétuation du patriarcat et « constitue le fond et la forme de toutes les rencontres possibles entre deux hommes18 ». Pour en faire des espaces de déconstruction, il faut d’abord qu’ils puissent être choisis et non subis. La déconstruction des féminités et des masculinités nécessite à la fois des espaces non-mixtes sûrs et des espaces mixtes de façon, pour les premiers, à développer une expression longue dans un contexte solidaire, et, pour les seconds, à sortir de son quant-à-soi et confronter les points de vue.

[Giorgia Siriaco | www.gioeucalyptus.com]
Détricoter l’antiféminisme
Représentativité politique, égalité professionnelle, accès à la contraception : ces dernières décennies, des mesures féministes ont été inscrites dans la loi19. Mais leur application pose toujours problème, et les résistances sont toujours présentes. Outre la réaction antiféministe, les mouvements féministes font face à plusieurs difficultés, ainsi qu’à des clivages internes. D’une part, les logiques capitalistes fondamentalement antiféministes (puisque fondées sur l’exploitation) ont donné naissance à un marketing féministe pernicieux : le « pink washing » ou « feminist washing« . D’autre part, les luttes afroféministes, décoloniales, intersectionnelles et anticapitalistes sont encore trop souvent invisibilisées, car en porte-à-faux avec un féminisme dit « universaliste », blanc, lequel sert de prétexte à des politiques racistes, notamment islamophobes20.
« S’inscrire dans la structure oppressive en place est un non-sens pour lutter contre les oppressions. »
Ces dernières années, un grand mouvement de mise à jour des violences faites aux femmes s’est fait entendre : #MeToo et #BalanceTonPorc. Il s’est heurté à des résistances qui, en 2050, paraîtront aussi absurdes et mesquines que les récriminations d’Allan Bloom aujourd’hui. Le corset des injonctions patriarcales opère un peu moins autour de nos corps, de nos maisons — pas beaucoup moins autour de nos esprits. Dans quel sens travailler pour abolir le traitement social différencié entre hommes et femmes ? À cet égard, les pistes proposées par Faludi n’ont (hélas) pas pris une ride : déjouer les logiques d’un système économique fondé sur l’exploitation et l’inégalité ; déconstruire la masculinité hégémonique et la naturalisation du féminin social ; combattre la désinformation et proposer une représentativité médiatique réelle ; créer des dynamiques de sororité et de bienveillance. Backlash se conclut d’ailleurs sur un rappel de l’importance de la sororité, dont le manque criant est, selon Faludi, la raison de l’échec des mouvements féministes à résister aux ressacs de la revanche. La sororité se voit en effet détricotée en permanence par le patriarcat afin d’assurer sa propre préservation (par la compétition des femmes entre elles, la misogynie intériorisée et la dévalorisation de la classe des femmes par les femmes, le masochisme entretenu, etc.). En détricotant d’un côté la sororité, il tricote de l’autre la solidarité masculine qui maintient un contrôle social des hommes entre eux (attention aux « traîtres » à leur classe) en même temps que l’exclusion des femmes de la société des hommes, légitimant ainsi le patriarcat.
Et tout, tout de suite
S’inscrire dans la structure oppressive en place est un non-sens pour lutter contre les oppressions. Vouloir accéder à la place des hommes, c’est « accorder une plus grande crédibilité à la mythologie sexiste du pouvoir masculin qui proclame que tout ce qui est masculin est fondamentalement supérieur à tout ce qui est féminin21 ». Virginia Woolf, dans Trois Guinées, prévenait déjà — tout en faisant de l’accès au travail salarié/payé et l’indépendance économique la clé de la libération des femmes — que cette libération ne devait pas se fonder sur un mimétisme de la société masculine, faite de prestiges creux et menant à la guerre. D’autres penseuses, notamment dans le courant féministe matérialiste lesbien, théorisent qu’on ne peut faire l’économie d’une abolition des classes de genre pour sortir de cette dynamique d’oppression. Un article de presse affirmait récemment que le « féminisme de 4e génération », apparemment caractérisé par sa puérilité tout autant que son inconscience des réalités, voulait « tout, tout de suite ». Mais tous les mécanismes de domination sont imbriqués, comme le démontraient déjà brillamment les penseuses du Black Feminism dès les années 1970. Considérer une oppression — de race, de classe, de genre — indépendamment des autres est une impasse, et fait courir le risque d’en renforcer certaines. Le souligner n’est pas l’apanage d’un « féminisme de 4e génération » ; c’était le message de Susan Faludi en 1991. C’était déjà ce qu’écrivaient Barbara Smith, Hazel Carby, bell hooks et les afro-féministes étasuniennes. C’était en 1986, en 1982, en 1979. Aujourd’hui, leurs travaux nourrissent un féminisme qui se doit d’être anticapitaliste et intersectionnel — en bref, révolutionnaire.
Tout, tout de suite et pour toutes.
Photographie de bannière : Giorgia Siriaco | www.gioeucalyptus.com
- L’édition utilisée pour les citations du présent article est celle de Susan Faludi, Backlash, la guerre froide contre les femmes, trad. L. Éliane Pomier, É. Chatelain, T. Reveillé, Éditions des femmes, 1991. Les références sont ici françaises et états-uniennes. Une comparaison avec d’autres pays reste à faire.[↩]
- Les familles aisées peuvent certes se payer des « femmes de ménages ». Ce sont toujours des femmes, souvent racisées, qui fournissent alors un travail qui n’est plus « gratuit » mais dont la délégation participe à leur précarisation, et qui subissent ces double journées de travail domestique.[↩]
- bell hooks, Ne suis-je pas une femme ?, Cambourakis, p. 157.[↩]
- « La force qui autorise les auteures féministes blanches à ne faire aucune référence à l’identité raciale dans leurs livres sur
les femmes
, qui sont en réalité des livres sur les femmes blanches, est la même force que celle qui pousserait tout·e auteur·e qui écrirait uniquement sur les femmes noires à se référer explicitement à leur identité raciale. Cette force, c’est le racisme. […] C’est la race dominante qui a le pouvoir de faire comme si son expérience était une expérience type. »[↩] - Concernant l’évolution des syndicats entre 1990 et 2020 aux États-Unis et en France, bien que les taux de syndication tendent à se rejoindre, les femmes continuent à être moins souvent syndiquées que les hommes. Cela s’explique aussi par le fait que les secteurs historiquement masculins (bâtiment, transport, énergie) aient une forte tradition syndicale, contrairement au secteur très féminin du care par exemple. Entre soutien de certaines luttes féministes et accusations de harcèlement sexiste, le syndicalisme français ne semble pas encore un clair allié. Voir Economic News Release et La syndicalisation en France.[↩]
- The Yankelovitch Monitor, édition 1989 — entretien personnel de Susan Faludi avec Susan Hayward, directrice générale de Yankelovitch Clancy Shulman, en septembre 1989.[↩]
- C’est toujours le cas en 2017 : « Americans see men as the financial providers, even as women’s contributions grow », Pew Research Center, Kim Parker and Renee Stepler[↩]
- « L’homme étatsunien attend de son rôle de soutien de famille qu’il le valide dans sa masculinité, mais le travail en lui-même est déshumanisant — c’est-à-dire castrateur », écrit Myron Brenton dans The American Male — A Penetrating Look at the Masculinity Crisis. La crise de la masculinité, déjà décrite en 1966… Le travail n’est donc virilisant que lorsqu’il est socialement valorisant. La dignité des femmes, elle, passe après la survie économique de la famille.[↩]
- Voir à ce sujet « Gender identity and relative income within households », Marianne Bertrand, Emir Kamenica, Jessica Pan.[↩]
- En 2016, les femmes passaient deux fois plus de temps que les hommes à faire le ménage et à s’occuper des enfants à la maison selon l’Observatoire des inégalités.[↩]
- Voir la vidéo de Marine Périn sur le sujet.[↩]
- En 2019, en France, près d’une pension sur deux est non payée.[↩]
- Backlash, la guerre froide contre les femmes, Éditions des femmes, 1991, p. 480.[↩]
- L’ouvrage ayant été publié en 1991, il s’agit de productions des années 1980. Parmi les films cités : Liaison fatale d’Adrian Lyne (1987), Le prix de la passion de Leonard Nimoy (1988), ou encore Working girl de Mike Nichols (1989). Du côté des séries télévisées, Faludi analyse à la fois des séries qui valorisent le rôle de ménagère comme Just the Ten of Us ou Raising Miranda, et des séries mettant en scène des héroïnes fortes dont les actrices ont subi des campagnes haineuses, comme Roseanne ou Cagney and Lacey.[↩]
- Le concept de masculinité hégémonique a été développé par Raewyn Connell, sociologue australienne. Pour une présentation du concept, on pourra se reporter à l’article du blog Ça fait genre, « Masculinité hégémonique ».[↩]
- For Men Against Sexism, 1977.[↩]
- On pense à l’affaire de la Ligue du LOL, mais le Boys’ Club est bien plus étendu que cela.[↩]
- Ibid.[↩]
- Ces lois sont aujourd’hui remises en question dans plusieurs pays (Pologne, États-Unis…), nous prouvant une fois de plus que rien n’est gagné pour toujours et que la force de la revanche est vivante et active.[↩]
- Voir Christine Delphy, Classer, dominer, La fabrique, 2008, et l’article « Lichen, violence et sarabande capitaliste », Réfractions n° 43.[↩]
- bell hooks, ibid., p. 290.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Melissa Blais : « Le masculinisme est un contre-mouvement social », décembre 2019
☰ Lire notre notre article « Audre Lorde : le savoir des opprimées », Hourya Bentouhami, mai 2019
☰ Lire notre entretien avec Françoise Vergès : « Dénoncer ce qui n’est qu’une fausse universalité », avril 2019
☰ Lire notre entretien avec Christine Delphy : « La honte doit changer de bord », décembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Bérengère Kolly : « La fraternité exclut les femmes », octobre 2015
☰ Lire notre traduction « Quand les élites mondiales récupèrent le féminisme », Hester Eisenstein, septembre 2015


