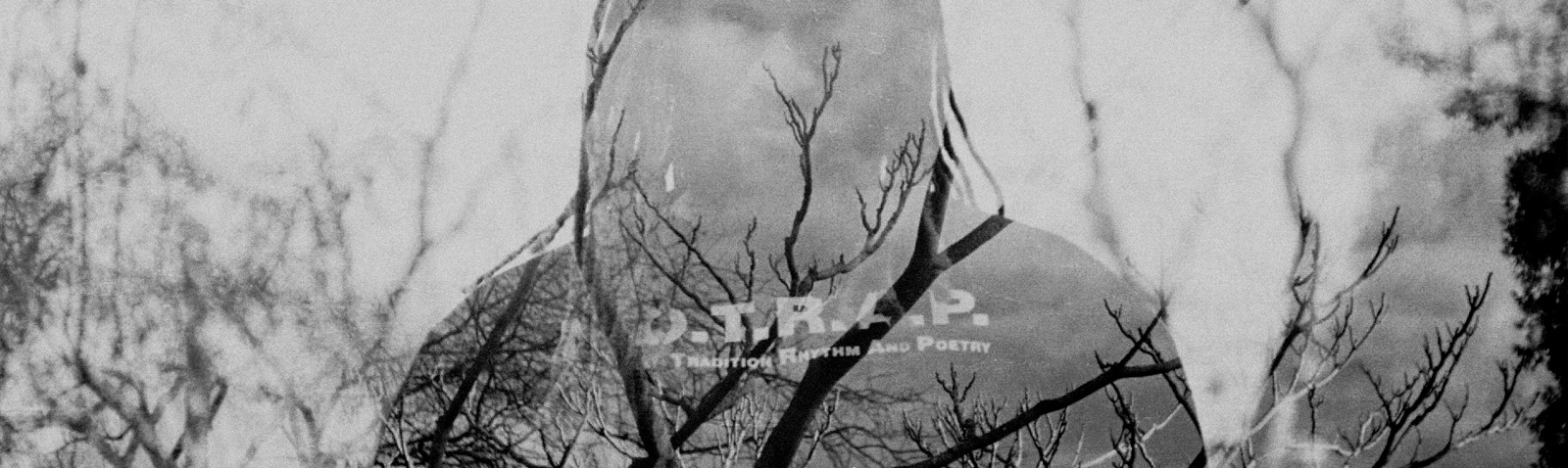Entretien inédit pour le site de Ballast
D’ de Kabal, c’est une voix et une gueule. Une voix caverneuse, métallique. Ce touche-à-tout, qui nous confiait il y a quelques semaines de cela ne pas éprouver le besoin de dénoncer, une fois de plus, certaines méthodes policières, vient pourtant, en écho à la relaxe du policier qui tua Amine Bentounsi, de sortir le morceau « État d’urgence ». Rappeur, slammeur, homme de théâtre, le poète — puisque, de tous ces mots, c’est celui qu’il revendique le plus volontiers — est à l’initiative de nombreux collectifs inter-disciplinaires. Nous le retrouvons à Pantin, en banlieue parisienne. Café, chocolat chaud ; la voix est posée, mais dense — les idées fusent. Nous le savions habitué, depuis le groupe qui l’a vu naître dans les années 1990, Kabal, à mettre à plat les poings levés de l’Histoire, à viser droit dans le présent ; nous le retrouvons, l’été dernier, dans le off du festival d’Avignon, clamant seul sur scène : « L’intégrisme masculin autorise la prise de pouvoir, il autorise la domination, l’écrasement de l’autre ; homme ou femme, indifféremment peut-être, même s’il préfère broyer des os de femme. » Premier spectacle d’un cycle en préparation. Il nous a semblé urgent de le rencontrer.

Il y a une phrase qui dit : « Il faut tout un village pour élever un enfant. » Et je pense qu’il faut tout un tas de gens pour faire société, pour faire monde — en termes de « mondialité », comme l’aurait dit Édouard Glissant. Chacun a sa pierre à apporter à l’édifice global. Il faut des gens qui soient indépendants ; j’entends : indépendants par la pensée. On peut être assujettis à différentes pressions — économiques, culturelles, sociales — mais garder un espace d’indépendance afin de créer, réfléchir, fabriquer, faire du lien. Tu peux être travailleur social ou poète. Faire du beat box et aller dans les écoles pour travailler. Être architecte et construire à ton échelle. L’indépendance, c’est ce qui permet la créativité et l’imaginaire. « Virulents »… Dans le monde actuel, c’est très bien qu’il y ait des gens qui soient caressés dans le sens du poil — ils en ont besoin. Je ne dis jamais non pour un bon massage qui me détendrait les muscles ! Mais il faut qu’on puisse aussi être piqués et rappelés à l’ordre un peu durement ; c’est ce que j’entends par ce terme. Appuyer un peu là où ça fait mal — j’essaie d’apporter ma pierre. « Fiers »… Mes enfants ont inventé un mot entre eux, pour se dire quelque chose qui est plus fort que « je t’aime », qu’ils trouvent trop petit — mot que je ne vais pas dire ici car il leur appartient : je pense qu’il devrait y avoir un terme plus fort que « fier » pour signifier ça. Un mot qui induise la fierté de ce que l’on est sans avoir besoin de le porter comme un étendard. Venant des barreaux inférieurs de l’échelle, c’est important de savoir ce qu’on véhicule et d’où on vient. Le monde actuel nous force, implicitement, à être fier de ce qu’on est. Ça me pose question d’être « fier d’être noir », mais je trouverais plus fort que ça ne soit même pas une question : c’est un état. Un état qui devrait être induit dans la vie qu’on mène, au point qu’il n’y ait même pas besoin de le nommer. Ces mots-là me chahutent régulièrement… Je suis quelqu’un qui effectue souvent un « état des lieux » de ce que je veux faire, de ce que je deviens. Continuer à travailler dans le sens de ces mots-là ? J’ai l’impression d’être un handicapé qui ne peut pas faire autrement.
Vous avez évoqué Glissant. Glissant qui écrivait : « Nous sommes collectivement parlés par nos mots bien plus que nous ne les pratiquons. » Comment entendez-vous ça, vous qui écriviez, dans Autopsie d’une Sous-France : « En nous dépossédant du sens / de nos mots, ils nous enlèvent la / Parole, la riposte et la réflexion. »
« Le théâtre doit faire l’effort d’être plus ouvert. Et de travailler à rendre les œuvres accessibles. »
C’est une phrase qui prend de la hauteur sur moi. C’est comme l’air ; on est dedans. Il faut imaginer trois sphères. Une grosse comme le cœur, une encore plus grande (qui prend juste notre contour) et une plus grande encore, qui inclut les deux autres, et soi. Je me rends compte, étant descendant d’esclaves, que la parole et les mots sont une des forces les plus redoutables de notre monde. L’utilisation des mots, cadrés à bon escient, permet des choses inouïes. Il y a une lutte pour ne pas laisser le terrain aux autres. Ces « autres », comme dans Bernie de Dupontel.
Descendant d’esclave, originaire des Antilles. Quelle place cela prend-il, d’ailleurs, dans votre travail ?
Mon premier spectacle de théâtre parlait de ce que c’est d’être antillais en France, dans les années 2000. C’était instinctif de parler d’où je venais, de son histoire, puis de la banlieue. Ça m’a accompagné pendant longtemps. Mais c’est important pour moi d’en sortir, aussi, et d’assumer d’être plus complexe que cette identité-là. De rappeler que le combat est ailleurs, aussi. Au fur et à mesure des années, j’ai déroulé le fil.

D' de Kabal, par Dwam Ipomée (pour Ballast)
Le dramaturge franco-libanais Wajdi Mouawad estime que « faire du théâtre, c’est se jeter dans la bataille ». Ça vous parle ?
Je fais souvent le parallèle entre le théâtre et le rap. Le théâtre a également la réputation d’être un lieu d’entre-soi. À qui cela s’adresse t‑il ? À qui le théâtre est-il ouvert ? Le rap paraît être, pareillement, un lieu d’entre-soi — alors que ce n’est pas le cas. Si je vais voir Booba à Bercy, je serai au contact d’une faune — parisienne et de banlieue — qui ressemble à la mienne et au monde dans lequel je vis ; quand je vais au théâtre, le public ne ressemble pas du tout à ce monde ! Mouawad est un de mes héros. Le théâtre se jette bien dans la bataille, mais trop de gens se sentent encore exclus de ce champ d’expérimentation et d’action. Le théâtre doit faire l’effort d’être plus ouvert. Et de travailler à rendre les œuvres accessibles. Je participe à beaucoup de concertations à ce sujet, actuellement. Ce n’est vraiment pas rien, le théâtre ! Tu es chez toi, tu allumes ton ordi, tu écris un texte et, quelque temps plus tard, il y a une salle, des gens y viennent, on éteint la lumière et ces gens écoutent ce que tu as à dire…
L’exposition/spectacle Exhibit B de Brett Bailey mettant en scène, sous forme de tableaux vivants, une galerie de personnages supposés incarner la violence de la colonisation et de l’esclavage, a défrayé la chronique l’an passé lors de son arrivée dans la région parisienne. De nombreuses associations « racisées » ont perçu ce spectacle comme raciste et humiliant…
Je déteste ce mot, « racisé » ! C’est un mot importé des États-Unis. Les États-Unis et la France n’ont pas la même histoire : il faut qu’on fabrique nous-mêmes nos concepts.
… La Brigade antinégrophobie, le PIR et d’autres associations militantes se sont unies pour interdire sa diffusion. Vous avez pourtant tenu à dire qu’il s’agissait avant tout d’une performance et que toute interdiction était une « prise d’otage ». « Le spectacle vivant est vivant, il vibre, transporte, bouscule, interroge, abasourdit », écriviez-vous. Interdire le spectacle, « c’est cantonner les acteurs à une couleur de peau et les réduire, c’est refuser d’admettre qu’ils sont des acteurs, c’est les enfermer dans le rôle que vous avez décidé / C’est affirmer à voix haute qu’ils sont victimes de l’Histoire et non pas acteurs de la mémoire de celle-ci ». Pouvez-vous revenir là-dessus ?
Mon texte a beaucoup circulé, mais je crois que mon propos a été mal reçu. Ça a blessé des gens qui ne me connaissaient pas, qui n’étaient pas habitués à cette lutte — les militants de terrain, eux, sont rodés au débat avec des personnes en désaccord. J’ai pris la parole contre ceux qui s’opposaient à la tenue de l’exposition — n’étant pas d’accord avec le fait d’interdire un objet artistique et théâtral, j’ai pris la plume pour dire autre chose. Ça fait longtemps que je travaille sur les questions de la mémoire de l’esclavage et de la colonisation — notamment avec le Comité de marche 98. Pour écrire ce texte, j’ai pris tout l’amour que j’avais pour mes frères et sœurs de lutte, qui se battent pour ça. Je trouve ce qu’il s’est passé vraiment très grave — grave, cette incapacité que nous avons eue à discuter entre nous d’un sujet aussi douloureux. Je ne lâcherai pas l’affaire — et je voudrais ouvrir un groupe de travail pour en parler. Des gens historiquement solides sur la question de l’esclavage doivent être capables de dialoguer : qu’est-ce que cette exposition a réveillé chez les uns, chez les autres ? Je ne me serais pas permis de dire à quelqu’un à qui l’idée d’Exhibit faisait mal que son malaise n’existait pas ; je n’étais pas insensible au fait que beaucoup de gens de mon entourage se sont sentis attaqués. C’est à nous, qui militons sur ces questions, d’être capables d’écoute — et pas seulement entre Noirs. Surtout pas qu’entre Noirs.

D' de Kabal, par Dwam Ipomée (pour Ballast)
Mais il y a deux ratés sur la question Exhibit : faire s’engouffrer tout un tas de gens pour tenter de faire annuler un spectacle, ça allait forcément dans le mur (c’est une mauvaise énergie de bataille). Je n’étais d’ailleurs pas seul à trouver que la performance était extraordinaire : c’est très dangereux, et alarmant, que des personnes soient allées voir la performance « en secret », se soient pris une gifle, pour ensuite participer à la mascarade de l’interdiction ! C’est devenu une mascarade à partir du moment où ceux-là mêmes qui avaient été bouleversés par la proposition en off la condamnaient en public. Ces personnes se sont elles-mêmes censurées ! On n’avance pas ! Ça me rend triste.
« Faire s’engouffrer tout un tas de gens pour tenter de faire annuler un spectacle, ça allait forcément dans le mur. »
La pression exercée sur ce type de militantisme est tellement forte que certains n’osaient même pas dire qu’ils avaient apprécié, que cela les avait fait bouger — et ceux qui militaient contre sans l’avoir vu ?… Comment discuter d’une œuvre avec des gens qui ne l’ont pas vue ? Le soir de la dernière, au théâtre Gérard-Philippe, à Saint-Denis, je suis allé devant pour discuter avec les gens en direct — j’en avais marre des réseaux sociaux. C’était houleux, et presque risible tellement on ne parlait pas la même langue. Le dialogue était cassé à un endroit. Il y avait beaucoup de personnes des quartiers populaires issues de la mouvance hip-hop. D’un point de vue sociologique, c’était intéressant de voir cette génération se saisir d’un sujet de société. Certains avaient, dans leurs jeunes années, répondu aux détracteurs du rap : « Le rap a le droit d’être une fiction, ce sont des auteurs, c’est une culture que vous comprenez pas. » Avec tout ce second degré, qu’on voulait assumer. Devant le théâtre, ces mêmes personnes tenaient le même discours que les détracteurs du rap : « Ce spectacle, ce n’est pas du spectacle. Il faut l’annuler. » Un retour de bâton.
Mais cette pensée homogène qui mène à l’autocensure, n’est-ce pas le propre de tout milieu militant ?
Le souci venait surtout des gens pour qui c’était le premier acte militant de leur vie. Je n’ai pas envie d’être cassant en disant ça, mais certains ont eu un espèce de « réveil » et se sont trouvés confrontés à d’autres, qui travaillent et réfléchissent de longue date aux débats soulevés. Ces derniers avaient les ressources pour entrer en dialogue et ont permis des échanges pas inintéressants. Les autres, ceux qui crachaient (physiquement !) sur ceux qui allaient voir le spectacle n’ont rien compris. Tout mouvement a sa gauche et sa droite, certes… C’est pour ça que je ne me considère pas vraiment comme un militant, d’ailleurs. Je trouve que c’est un boulot qui nécessite beaucoup de ressources et pas de vie de famille. Certains y arrivent très bien — et je leur dis « Big up ! ».
Kabal était un groupe novateur dans le rap. En dehors de l’aspect politique et social, vous avez abordé dans vos albums solo — et semblez prolonger cette démarche dans vos spectacles — des thèmes assez peu populaires dans le hip-hop : homophobie, masculinisme, dépression, maladie… Pourquoi cette familiarité avec ce qui va contre ?
Déja, à l’époque de Kabal — et encore aujourd’hui —, on était créoles. Créoles, car traversés par des gens très différents. Il n’y avait pas une volonté de choisir des sujets qui n’étaient pas abordés dans le rap. Je suis entouré de gens de tout un tas de corps de métiers et je suis obligé, dans ma musique, de rendre compte de cette complexité. Dès mon premier disque, je savais que, parmi les gens qui allaient l’écouter, ne serait-ce que dans mes proches, il y aurait des homosexuels, des handicapés, des gens atteints de maladies rares, des gens dépressifs… Pas seulement des personnes « des quartiers ». On s’adresse forcément au monde que l’on connaît. Et je défends de plus en plus le rap des quartiers ou des « cailleras » : ces mecs font simplement état de leur monde. Ce n’est pas moins intéressant que Wajdi Mouawad, c’est juste différent. À nos débuts — et je n’ai jamais parlé, jusqu’ici, de la jeunesse de Kabal —, on était un noyau dur de cinquante personnes ; au milieu des années 1990, on a rencontré ceux qui ont produit Kabal durant des années. En accédant au studio, on était conscients qu’un monde pluriel existait ; on ne pouvait pas faire comme si on avait passé toute notre vie en bas du bâtiment, à Bobigny — puisque ce n’était pas vrai. Kabal, c’était raconter notre univers, qui était large, nourri des discussions avec les uns et les autres. On n’était pas plus malins que les autres, mais on circulait dans différents mondes.
Le slam a été un gros déclencheur. Quand ce mouvement s’est lancé, à Paris, on a assisté à la rencontre de gens complètement différents, voire opposés. La Cour des miracles ! Profs de lettres qui se lâchaient dans des textes complètement fous, le soir tombé, assistantes maternelles, rappeurs… tout était mélangé. S’il y a toujours eu, dans tous mes albums de rap, au moins un titre qui dénonçait l’homophobie, je n’ai, en revanche, lorsque j’arpentais les scènes slam, jamais éprouvé la nécessité d’aborder ce sujet — tant c’était évident que la population présente, à l’écoute, n’était pas atteinte d’homophobie. Le slam m’a énormément fait bouger dans mon approche de l’écriture : j’y ai rencontré des auteurs basés sur l’oralité, comme moi, mais qui venaient d’autres univers. Des auteurs balaises ! C’est ce qui m’a fait écrire en prose, abandonner la rime (sans ces personnes, je n’en serais pas là). Et puis il y a eu le théâtre : c’est comme ça que ton monde s’élargit — et les thématiques abordées avec.
« Quand le slam s’est lancé, à Paris, on a assisté à la rencontre de gens complètement différents, voire opposés. La Cour des miracles ! »
J’aurais énormément de mal à faire un morceau « anti-flics », par exemple. Il faut en faire, mais il y en a plein ; je n’aurais rien à dire de nouveau. J’essaie d’être plus complexe ; et c’est la complexité de ton univers qui produit le son. On peut aussi se créer une fiction et fabriquer son objet artistique à partir de ça ; je ne pense pas que Booba passe trois cent cinquante jours par an en bas du bloc, mais il fait une musique qui ressemble à ça. Il y a maintenant une offre qui est énorme ; plusieurs scènes se côtoient. Mon fils pourra aller voir Kaaris au Zénith une semaine, et la suivante j’irai avec ma femme au New Morning pour voir Specta, Casey, Lino ou Kohndo. J’attendais depuis longtemps que plusieurs scènes coexistent. Évidemment, ce n’est pas la même chose en terme d’affluence, mais il faut défendre les différents types de rap, ne pas être dans le rejet.
Pouvez-vous revenir sur ce « tournant » qu’a été pour vous l’écriture en prose ?
À chaque fois que je commence un texte, je me pose la question de la ligne et des contraintes que je vais me donner. Dans le rap que je pratiquais, je privilégiais le son avant le sens. La concession du flow, de la musicalité. Ce sont des concessions infimes, mais quand tu choisis de mettre un mot à la place d’un autre parce que ça rime, tu es déjà dans une concession par rapport au sens premier. Tu fais rentrer ton texte dans le son pour qu’il fonctionne musicalement. La rime permet une musicalité plus immédiate ; la prose a cassé ça. J’ai eu envie d’être plus « jazz » que « chanson ». Plus libre. D’être dans le sens pur et de ne « musicaliser » que dans un second temps. Et même si je continue de faire des albums avec des rimes, je travaille différemment — c’est plus difficile d’accès à l’écoute, peut-être, mais plus abrupt, plus cru, plus direct.
Auteur, rappeur, slammeur, metteur en scène, comédien, danseur, travailleur socio-culturel et, avant tout, poète. Et toujours l’urgence de « mutualiser nos points de suture », comme vous dites. Vous êtes combien, dans cette carcasse, D’ ?
Cinq ou six. Sans compter la ou les femmes qui font partie de ce petit monde ! Mais c’est harmonieux. C’est un système de chaises musicales, de tournantes. C’est dense ; on dort peu. Ce n’est pas simplement une boulimie, mais un besoin de nourrir tout le monde. (rires) Aujourd’hui, on nous définit énormément par nos fonctions — ce qui n’est pas un mal en soi ; ça fait seulement partie des règles. Mais je ne dirais pas que je suis danseur, ni que je fais du human beat box, parce que je connais des mecs qui sont à un niveau technique vraiment fou : je préfère dire que je fais de la musique vocale, que je pratique un peu. Pour la danse, c’est pareil : j’ai un amour profond pour le mouvement, qui est — et j’ai peur de le dire — presque plus fort que les mots. De plus en plus, dans mes créations, j’essaie d’en inclure et de mettre en scène mon corps.

D'de Kabal, par M. Mihindou (pour Ballast)
Quelle est la source première de toutes ces créations, de tous ces projets collectifs ?
La prise de parole. Le reste n’est qu’organisation de cette parole. Que ce soit un support écrit ou scénique, mis en musique ou sans elle… Le point de départ, c’est la verbalisation de quelque chose. Suivra, je l’espère, le mouvement. Et que ça remplace la parole petit à petit. J’espère avoir été suffisamment clair dans ce que j’étais pour raconter avec le moins de mots possibles.
Vous fondez R.I.P.O.S.T.E en 2005. Ce n’est pas rien de passer d’une scène de rap à une scène de théâtre, du travail des mots à celui des gestes. Comment passe-t-on d’un langage à l’autre ?
C’est une manière d’épurer. Il y a toujours un moment, quand on parle avec quelqu’un, où s’installe du silence. Alors autre chose naît, sans la parole. Avec du geste. Je me considère comme quelqu’un d’assez bavard, mais je suis conscient qu’il faut retirer les mots. En 2013, on a été invités dans un dispositif de création à Avignon, le « in ». Il m’a fallu travailler avec quelqu’un que je ne connaissais pas pour faire une pièce d’une demi-heure — une danseuse contemporaine, Émeline Pubert. On a beaucoup parlé au téléphone sans se rencontrer, puis on s’est donné rendez-vous dans une salle de répétition, histoire de voir ce qui en sortirait. J’avais ma loop station ; elle est arrivée ; on a bu un café ensemble puis j’ai commencé à jouer, et elle à danser. Et j’ai fait quelque chose que je n’avais jamais fait de ma vie : je suis allé danser avec elle. La rencontre était extraordinaire. De ça est né Créatures, projet sur lequel on a travaillé ensemble, sous l’œil de l’excellent Farid Berki. Au fur et à mesure, j’ai épuré le texte, pour aboutir à un format de trois à quatre minutes — tout le reste, ce sont des gestes et du son. Cette étape de travail a été très importante pour moi, et c’est ce que j’ai envie de pousser.
Cette année, dans le off du festival d’Avignon, vous avez présenté un nouveau spectacle, étonnant : L’homme/femme, les mécanismes invisibles. Étonnant, car il est rare de voir un homme s’emparer de manière aussi frontale de réflexions souvent cantonnées aux espaces féminins-féministes. Vous êtes seul sur scène, torse nu. Et vous vous faites tour à tour conteur, confident, objecteur de conscience ; votre voix se multiplie pour aborder la question des blessures intimes (de femmes et d’hommes), le tatouage comme lieu d’expression, pour révéler les mécanismes de ce que vous nommez l’« intégrisme masculin ». Tout ceci dans un texte en prose fortement poétique. Pouvez-vous revenir sur cet ambitieux projet ?
Il y a deux choses : on ne choisit pas sa couleur de peau avant de naître et on ne choisit pas son sexe. Je dresse souvent des parallèles entre les différentes luttes (racisme, sexisme, etc.) pour être concret. Des proches — blancs — se trouvaient mal à l’aise face à des situations de policiers maltraitant des Maghrébins ou des Noirs ; ça les foutait mal à l’aise en tant que Blancs, alors qu’ils n’avaient rien à voir avec ces flics. Je pense à cet ami ingénieur-lumière, au Sénégal : on était à une soirée, là-bas, et c’était très beau, très classe. Jusqu’à ce que des fils de bonne famille européens arrivent, montent au milieu de la scène et commencent à faire les cons, à faire des gestes vraiment obscènes et vulgaires. Mon pote me dit : « J’ai jamais eu autant honte d’être blanc. » Ça m’avait frappé, car il n’avait rien à voir avec eux ! Au moment de l’affaire DSK, toutes les infos étaient un peu plus focus sur les affaires de viol ; des histoires sordides, des viols collectifs en Inde… Et je ressentais cette honte, mais en tant qu’homme.
« Comment nous, hommes, pouvons-nous être acteurs de la fin de la fabrication des violeurs ? »
M’est revenue, plus tard, l’injonction du « Not In My Name ». Je me suis demandé pourquoi on exigeait des musulmans d’afficher ce slogan, alors qu’on n’avait jamais eu cette exigence des hommes face à d’autres atrocités. J’ai fait le parallèle entre ces deux formes d’intégrisme et j’ai trouvé que le mot exprimait bien cette idée. Ce terme n’inclut pas forcément la violence physique mais il habite potentiellement chacun d’entre nous. Voilà quelques années maintenant que je travaille sur le viol ; la question du violeur est pour moi le bout de la chaîne du travail : l’horreur du passage à l’acte. Je me suis demandé : « Comment nous, hommes, pouvons-nous être acteurs de la fin de la fabrication des violeurs ? » Je me suis rendu compte de l’importance de parler du quotidien, de l’éducation des hommes. De la rééducation à faire. Je tenais à m’attaquer en premier lieu au processus plus insidieux, plus intégré : il me fallait un terme qui raconte ça, qui me parle et qui fasse le rapprochement avec quelque chose de préexistant au viol. L’intégrisme, c’est ça : enfermer l’autre. Ne pas accepter autre chose que sa propre réalité. Un circuit fermé. Ça fait vraiment des années que je travaille sur la question, que je tourne autour, que je cherche par quel bout la prendre ; c’est seulement récemment que j’ai décidé d’en faire une série de spectacles, dont L’homme/femme, les mécanismes invisibles est la première impulsion. Mais il y en aura d’autres, par étapes, qui prendront des années.
Dans votre spectacle, vous interrogez justement : « Par quels bouts prendre la question des violences faites aux femmes quand on est un homme ? » Au terme de cette année de travail, de représentations et d’échanges, où en êtes-vous dans la réponse ?
Ce que j’ai le plus entendu, de la bouche d’autres hommes, suite à cette première année de travail autour de ce spectacle, se résume ainsi : « Tu as réussi à parler du silence des hommes sur certaines questions. » Certaines femmes n’avaient pas de problèmes à venir me parler de leur ressenti, mais les hommes restaient silencieux — et ils n’allaient pas se mettre à parler du jour au lendemain. Ça m’a bousculé. Les femmes étaient plus à l’aise pour parler de ces violences, et même pour parler de sexualité. J’ai, en même temps, rencontré beaucoup de féministes et de proféministes avec qui j’ai discuté : ça m’a nourri énormément. Les hommes sont davantage vierges sur ces questions. En tant qu’hommes, pour avancer, on doit définir notre fil rouge, nos lignes pour ce combat, nos urgences. Qui ne peuvent pas être les mêmes que les femmes, puisque nous sommes à un autre endroit de la société et du système. Et, plus encore, ce qui m’intéresse, c’est de pointer les endroits où, dans cette lutte commune, on ne sera pas d’accord. C’est un pas important. De reconnaître que toi, féministe, tu pointes un ensemble d’urgences, qu’il faut savoir entendre, car il y a en effet péril en la demeure, mais admettre, dans le même temps, qu’en tant qu’homme proféministe, je vais pointer des choses différemment car j’entame un travail de terrain sur les individus de mon genre. Les termes que les féministes utiliseront leur conviendront pour exprimer une réalité ; mais le terme à choisir pour parler à d’autres hommes, nous devons l’inventer, car il doit nous correspondre. Il faut inventer nos propres termes pour cette même lutte. Le texte de L’homme/femme est plein d’évidences, au final, mais il y a une volonté de rééducation, de reprendre les bases à zéro, et d’admettre qu’on s’est trompés.
Je me nourris de discussions — théoriques — avec des féministes pour comprendre à quel endroit on n’est pas raccord sur certaines postures, et sur les mouvements intellectuels et sensibles. Car il faut une approche sensible. Je vais prendre l’exemple d’une vidéo qui tourne sur Internet, « Dear daddy », avec laquelle je ne suis pas complètement d’accord. Cette vidéo (une jeune fille s’adresse à son père pour lui parler des différentes agressions que des hommes lui feront subir dans sa vie), très bien réalisée, me posait un problème sans que je ne comprenne bien lequel ; je me suis demandé si je montrerai cette vidéo à mes filles, notamment à celle de 15 ans. Et j’ai réalisé que non. Pourquoi ? Je trouve que le fil rouge de cette vidéo, la manière dont c’est écrit, est sans nuances. Il n’y a pas de « si », il n’y a pas de « peut-être ». Je suis conscient des chiffres des violences faites aux femmes mais, pour autant, en tant que père je ne peux pas montrer cette vidéo, car elle ne fonctionne que sur la peur. « Papa, si tu les laisses me traiter de salope, je vais être violée et battue. » Quand tu es parent, tu es très vigilant sur la peur ; j’angoisse qu’il arrive des choses horribles à mes enfants. Mais mon travail de père, et celui de leur mère, ce sera de ne pas injecter cette peur. Celle de la fatalité, qui est le propos de cette vidéo. Les insultes, le viol, les coups : ça va arriver, donc ayons peur… Ça sert la soupe à des mecs de ma génération, qui ont une idée de la femme plus à l’ancienne, qui montreront cette vidéo à leurs filles et leur diront : « Tu vois, j’avais raison. Ton frère peut sortir dehors après 21 heures, et toi non. » Bien sûr, il n y a pas d’outil parfait. Mes filles ont peur, de fait, de sortir tard le soir et de marcher dans des rues peu éclairées — mais je ne peux pas en rajouter. C’est aussi une question de poésie.

D'de Kabal, par Dwam Ipomée (pour Ballast)
De poésie ?
Le propos de cette vidéo, qui voudrait être une étape pour prendre conscience, est juste, mais il y a un mouvement à trouver dans le texte qui aurait permis d’être moins excluant. Il manque un détail qui transforme le propos en autre chose que de la peur. J’ai beaucoup d’amis qui sont allés en Palestine ou au Congo, par exemple, et qui reviennent en rappelant combien la poésie y est présente et quotidienne. C’est encore abstrait ici, pour nous. Avec la musique, je travaille beaucoup en prison — notamment avec des longues peines que je vois depuis trois ans, à côté de Mulhouse. J’ignore pourquoi ils sont là. La première année où j’ai travaillé avec eux, je suis sorti de la centrale et j’ai compris que toutes les phrases un peu clichées qu’on pouvait entendre sur la poésie, du genre « La poésie libère », étaient loin d’être du vent. Se rendre compte de ça à 38 ans, ça met une tarte. Et ce n’est pas une vue de l’esprit, encore moins de la masturbation intellectuelle. Je le vois tous les ans avec ces mecs, et tout au long de l’année avec d’autres détenus avec qui je travaille et échange. On vit des moments d’évasion pure avec eux (c’est eux qui le disent). La poésie est quelque chose de terriblement précieux qu’il faut défendre, et appliquer.
« Reprendre les bases à zéro », dites-vous. Sans même parler des plus religieux, d’autres hommes, intellectuels « de renom », estiment l’exact contraire et accusent notre pays d’être « dévirilisé », « féminisé ».
Si tu t’inquiètes de la bonne santé et de la bonne forme de ta vérité, c’est qu’elle n’est pas l’apanage de ton genre. C’est un peu ce que je disais sur la fierté et son aspect inaliénable. Ces gens admettent que c’est une vérité toute construite, puisque leur monde et leur vision de la virilité s’écroulent. Mon travail de poète est justement de déconstruire. Déconstruisons et voyons ce qu’il y a derrière ! Il y a bien autre chose derrière, à proposer. C’est le même mécanisme que l’esprit d’un colon. Certaines personnes peuvent s’inquiéter du fait qu’il y a de plus en plus de « nègres » qui vont à la fac : je pense à ce formidable face-à-face entre Léonora Miano et Élisabeth Levy sur le plateau de Taddei. Miano disait, en substance : « Ce monde-là est déjà terminé ; le reste est déjà en mouvement, vous ne pourrez rien y faire. » Je répondrais la même chose à un Zemmour. On va continuer à gommer cette vérité d’une ascendance d’un sexe sur l’autre, car cela a fait énormément de ravages. Et c’est inéluctable. Il peut se faire le chantre de vieilleries nostalgiques et vendre des livres, mais même lui sait très bien que c’est en train de mourir, qu’il ne pourra plus transmettre ce vieux monde à ses enfants. C’est l’échec de leur consanguinité intellectuelle. Il faudrait vraiment leur mettre certains chiffres de violence dans le nez et leur demander les analyses qu’ils en tirent. Ce n’est pas contre eux qu’il faut écrire : il faut écrire sur ce qui pose problème dans notre positionnement d’hommes vis-à-vis des femmes et des filles. Et tant pis pour eux. Moi je suis ailleurs, et je suis pas tout seul. Je nourris un autre monde qui existe en dessous, et qui bouge aussi.
« Ce n’est pas contre eux qu’il faut écrire : il faut écrire sur ce qui pose problème dans notre positionnement d’hommes vis-à-vis des femmes et des filles. »
Le chantre de cette pensée-là reste sans doute le polémiste Alain Soral, qui rassemble beaucoup d’autres « masculinistes » autour de lui.
Soral est à la croisée des chemins entre le racisme et le sexisme. Il est extraordinaire ! Il est au sommet de la pyramide de l’intégrisme masculin. Il cristallise une théorie que je compte bien développer dans mes futurs écrits — il a ce que j’appelle l’érection méprisante. C’est un adolescent en souffrance.
Le militant proféministe John Stoltenberg a des positions assez radicales : il soutient que l’identité sexuelle masculine est une construction sociale et politique, liée de façon inextricable à la suprématie masculine. Il ajoute que le sexe masculin a besoin de l’injustice pour exister. Dans votre spectacle, vous dites que l’homme est mû par une force aveugle, par des mécanismes invisibles, qu’il faut désapprendre le sexe comme enjeu de pouvoir…
Ce qui me gêne dans ce genre de formulation, c’est qu’il n’y a, de nouveau, rien de sensible dans ce que j’entends. Il y a des schémas. Mais si on veut être audible, il ne faut pas n’être qu’intellectuel. Il faut être sensitif ! Mon propos est à l’endroit du sensible. Or, là, je n’entends que l’affirmation de grands mécanismes ; je ne peux pas réunir des hommes de bonne volonté, leur parler du viol, leur lire du Stoltenberg et et leur demander : « Ok, on commence par quoi, les mecs ? » Il faut partir de ce que les hommes ont dans le ventre, dans leur vécu. Et dans le pantalon, puisque c’est aussi ce dont on parle. Qu’est-ce qui se passe dans la tête d’un mec quand il bande ? Je suis pas un grand lecteur, mais je n’ai pas trouvé énormément de choses là-dessus. Le premier commentaire qui revient sur mon spectacle, c’est : « Je n’ai jamais entendu ça. » C’est fort, sur une question aussi prégnante. Donc, ce qui me manque, pour travailler collectivement à un changement de ces mécanismes masculins, c’est, j’insiste, la dimension sensible. Si, avec d’autres hommes, il faut parler d’un mec qui a violé une femme, on ne peut pas commencer par dire, immédiatement, que c’est la société qui en est responsable : ainsi, le terme de « culture du viol » sera parlant et utile pour les féministes — c’est une belle trouvaille sémantique. Mais c’est un terme que les hommes ne comprendront pas. Alors comment avancer ? Il y a des Blancs qui me disaient qu’en m’opposant à l’interdiction d’Exhibit, je ne luttais pas contre le racisme. J’avais envie de leur demander : toutes les luttes sur le racisme ont-elles réussi quelque part ? Ne faut-il pas continuer à inventer ? Sur le sexisme, c’est pareil. Ça veut dire qu’il faut expérimenter d’autres manières de travailler à ce problème. Comment le faire, au quotidien et en dehors du cercle des amis ? Comment agir sur cette construction de nos sexualités, sur le sens qu’on y met ? Quelle place occupe la femme ? Est-elle un faire-valoir, une partenaire, un miroir ? Si on n’aborde pas ça, le propos d’un Stoltenberg ne parlera pas. L’imaginaire que tu te fabriques, certes nourri par des choses que le système autorise, c’est ce qu’il faut interroger. D’où l’immensité du chantier.

D' de Kabal, par M. Mihindou (pour Ballast)
Une partie du spectacle s’attarde sur le tatouage, sur lequel vous posez une parole peu commune. Nos sociétés occidentales voient naître de plus en plus de personnes tatouées pour des raisons personnelles et non plus traditionnelles. De votre côté, vous en dites : « C’est notre peau qui se recommence, une envie que cette peau n’oublie jamais ce par quoi elle est passée. » Pouvez-vous évoquer ce rapport à l’encre ?
Les tatouages sont l’expression graphique et artistique d’une certaine intériorité, qui déstabilise ou dérange. Sont rendus visibles les mouvements intérieurs, ce qui nous remue, ou nous obsède, même. De l’encre comme facteur d’éclosion de nos aspirations, nos rêves, nos imaginaires, nos blessures. Bien évidemment, tout le monde ne se tatoue pas pour les mêmes raisons, mais ce qui est certain, c’est qu’il y a là une volonté de laisser parler ce qui normalement est en sommeil. Il me semble que, le plus souvent, ceux qui ont recours à l’encre le font pour se réapproprier leur peau, leur corps, une partie de leur existence. J’ai une peau qui porte des cicatrices, vestiges de principes éducatifs d’un autre temps. D’un autre temps, mais qui a laissé sa marque. À un moment, j’ai décidé que les prochaines marques qui allaient me recouvrir seraient choisies par mes soins, et j’ai commencé mon projet de recouvrement de cette peau qui en avait trop vu. J’ai choisi le motif de l’écorce. Je voulais une nouvelle enveloppe qui pourrait vieillir avec l’ancienne, alors j’ai fait dessiner des arbres afin qu’ils me prêtent leur cuirasse pour pouvoir avancer plus sereinement. Et comme rien n’est jamais acquis, elle n’est pas hermétique ; et si de face je peux avoir l’air entouré de remparts et protégé par mon aspect extérieur, dans le dos je porte une faille, une ouverture, à vif. À l’intérieur on distingue un entrelacs de chair et de végétal. C’est en moi que s’effectue le mix organique entre l’humain et le végétal. Je pourrais en parler pendant des jours, mais j’arrête là, on risque de se perdre ! Mon prochain spectacle s’appelle Cris sourds : je vous laisse le soin de deviner de quoi il sera question.
Dans le spectacle, vous abordez également ce que vous nommez les « blessures intimes », notamment celles de l’enfance. Et vous estimez que pour avancer, « il faut trouver le lieu où la blessure commune est non genrée ».
« Il y a un endroit où les blessures intimes ne font de nous que des victimes, indépendamment du genre. »
Comment rendre compte d’une pensée complexe par des mots simples et accessibles ? Dans un protocole expérimental d’échanges, jouer, interchanger les rôles de chacun est extrêmement parlant pour tous, en général. Par exemple, je suis allé au Gabon : j’arrive à la douane, à Libreville, et — chose extraordinaire quand t’es un Renoi vivant à Paris — les douaniers laissent passer tous les Noirs et bloquent tous les babtous (dont moi). Avec empreintes digitales, photos. J’avais la banane ! Parce que c’était beau de voir des hommes en costard-cravate et attaché-case traités à leur tour comme… des étrangers ! Dans un cadre de paroles et d’échanges sur la masculinité, il faut chercher l’endroit où il y a un vécu commun, femme ou homme. Il peut y avoir les mêmes blessures dans chaque vécu. Il faut passer par cette étape pour comprendre que c’est après qu’on aura, pour chaque sexe, un certain type de réponse conditionnée par la société et la pression culturelle. Et un certain type de réaction attendu de chaque sexe. Mais il y a un endroit où les blessures intimes ne font de nous que des victimes, indépendamment du genre. L’homme, lui, ne doit pas être une victime. Et je suis bien placé pour le savoir — on lui apprend qu’il n’a pas d’espace pour ça. À terme, on aura deux blessures originellement similaires modifiées par les injonctions du système, et des trajectoires totalement divergentes à l’arrivée. La femme pourra se retrouver possiblement en solidarité avec d’autres femmes, elles feront corps, alors que l’homme pourra parfois devenir quelqu’un de dangereux.
C’est ce qui m’intéressait dans mon spectacle : revenir à ce moment où la blessure n’est pas genrée, et rappeler que ce sont des codes, des systèmes de pensée, des mécanismes invisibles qui fabriquent aussi la réponse que chacun y apporte. Il y a des hommes victimes de violences ou d’abus, petits. Je voudrais, grâce à des exercices pédagogiques simples, permettre de s’affranchir de tout ce qu’on a construit depuis lors. Et d’ interroger : que signifient pour toi ces blessures ? Et pourquoi est-ce différent d’être un petit garçon, au nom de quoi ? Qui te l’a dit ? Je mets en scène des situations parallèles entre les hommes et les femmes, et j’interroge : pourquoi un comportement est socialement accepté dans un sexe et pas dans l’autre ? Il faut des débats publics, mais il faut aussi que ces compréhensions s’incrustent dans l’intimité et dans les expériences de chacun. Les slogans règlent un certain type de choses. Mais sur des questions comme celles-ci, la théorie ne marche pas. Il faut remuer en profondeur quand on parle de comportements quotidiens, d’intimité, de sexualité — avec tout ce que ça comporte de non-dits, de retenues, de débordements. Les hommes ne parlent jamais de ça. Ils ne parlent pas des mécanismes qu’ils activent, à l’intérieur. Alors, y penser de manière collective ? Pourquoi pas. Les gars, on fonctionne tous pareil, à quelques exceptions près. Qui commence ?
Photographie de couverture : Dwam Ipomée
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Marc Nammour : « S’ériger contre la division », janvier 2016
☰ Lire notre entretien avec Médine : « Faire cause commune », septembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Almamy Kanouté : « Il faut fédérer tout le monde », juillet 2015
☰ Lire notre entretien avec Angela Davis : « Nos luttes mûrissent, grandissent », mars 2015
☰ Lire notre entretien avec Clémentine Autain : « Rendre au féminisme son tranchant », février 2015