Entretien inédit pour le site de Ballast
D’abord la question de l’origine, depuis longtemps ressassée : d’où vient la violence ? quand commence la guerre ? quelle source commune aux inégalités sociales, économiques, sexuelles ? Puis l’apparente nécessité de s’appuyer sur un basculement, et la discussion de celui-ci : les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient-elles pacifistes ou belliqueuses ? la révolution néolithique et la généralisation de l’agriculture, des formes urbaines et de l’État auraient-elles été synonymes d’un accroissement de la violence ou plutôt les moyens de sa canalisation ? Enfin, une interrogation légitime sur les méthodes employées pour trancher. Depuis une dizaine d’années, l’économiste marxiste et paléoanthropologue Christophe Darmangeat s’empare de ces questionnements sur son blog La Hutte des Classes, ainsi que dans quatre ouvrages. Le plus récent s’attache à la guerre et à la justice dans les sociétés aborigènes australiennes. Tandis que les militants s’écharpent sur les fins stratégiques de la violence ou de son contraire, les chercheurs s’opposent sur la manière dont s’affrontaient les sociétés préhistoriques. Christophe Darmangeat reprend pour nous les termes de cette passionnante discussion.
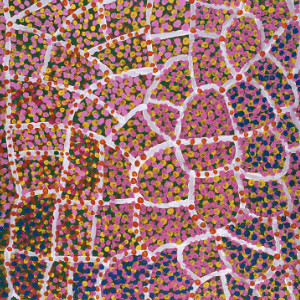
Depuis les débuts de la science de la préhistoire et de l’anthropologie sociale, au XIXe siècle, le monde savant a longtemps été relativement unanime sur le fait qu’une bonne partie des chasseurs-cueilleurs, économiquement égalitaires, sinon tous, étaient tout à fait belliqueux. Dans les premières décennies du XXe siècle, toutes les bases de données qui ont été construites continuaient à s’accorder sur ce point. Ce n’est que récemment, dans les années 1950, qu’une partie des chercheurs, en particulier ceux classés politiquement à gauche, s’est mise à défendre l’idée que la guerre était née seulement avec la révolution néolithique, voire plus tard encore. Il est difficile de cerner les raisons précises de cette évolution, mais elle s’inscrit manifestement dans un mouvement général d’idéalisation du lointain passé qui a marqué le dernier demi-siècle. Pour parler du cas plus précis du marxisme, courant dont je me réclame, la situation ne manque pas d’ironie : tout « bon » marxiste croit aujourd’hui savoir que la guerre est née avec l’agriculture et l’exploitation de l’Homme par l’Homme. Pourtant, il suffit de relire Engels ou Plekhanov pour réaliser qu’à leurs yeux, si les inégalités de richesse avaient donné de nouveaux motifs à la guerre, celle-ci existait bien avant elles : elle était alors menée « avec la cruauté qui distingue les hommes des autres animaux et qui fut seulement tempérée plus tard par l’intérêt2 ».
Vous venez de consacrer une recherche extrêmement fouillée sur la place de la violence armée et de la guerre chez les Aborigènes australiens. Quels matériaux vous permettent aujourd’hui d’affirmer que les conflits violents étaient monnaie courante chez les peuples de l’Australie précoloniale ?
« Ce n’est que récemment qu’une partie des chercheurs, en particulier ceux de gauche, s’est mise à défendre l’idée que la guerre était née seulement avec la révolution néolithique. »
L’idée de cette recherche m’est venue car, au cours de mes lectures sur ce continent, je suis tombé sur plusieurs récits très circonstanciés de conflits armés. Je me suis alors fait la remarque que cela ne correspondait guère à l’image traditionnelle des chasseurs-cueilleurs. Soupçonnant qu’il y avait là un filon qui n’avait jamais été véritablement creusé, j’ai entrepris de rassembler systématiquement tous les récits d’affrontements collectifs disponibles. Cela m’a pris quatre ans de travail et, bien sûr, je suis sans doute loin de les avoir tous repérés ! Toujours est-il que j’ai ainsi constitué une base de données, que j’ai d’ailleurs mise en ligne dans son intégralité afin que chacun puisse vérifier sur quelles sources je m’appuie et si les codifications que j’ai employées sont légitimes. En m’attelant à ce travail, je m’attendais à une récolte abondante car l’Australie est le plus grand ensemble de chasseurs-cueilleurs mobiles observés à l’époque moderne. En fait, les résultats ont dépassé mes espérances : j’ai réuni — aidé, entretemps, par quelques contributeurs qui m’ont prêté main-forte —, de la documentation sur plus de 200 événements. Parmi les récits, très peu proviennent d’anthropologues professionnels. L’immense majorité ont été rapportés par des Occidentaux, fonctionnaires coloniaux, explorateurs, agriculteurs, aventuriers, bagnards évadés ou naufragés, qui ont passé quelques mois ou plusieurs années au contact de groupes aborigènes, dont certains vivaient encore de manière traditionnelle. Quelques-uns proviennent d’Aborigènes eux-mêmes, qui ont raconté leurs souvenirs d’enfance.
Cette matière première, il m’a ensuite fallu la traiter. Pour commencer, j’ai dû évaluer la qualité des sources, en particulier pour celles qui rapportaient des événements particulièrement sanglants : quelques-unes m’ont paru invraisemblables ou d’une fiabilité vraiment douteuse. Cependant, la plupart résistent bien à la critique et, à l’arrivée, le faisceau de preuves est suffisamment solide. À partir de là, j’ai commencé à bâtir une typologie de ces conflits, selon leurs motivations, la physionomie militaire des confrontations et, très rapidement, j’ai compris que je devais intégrer tout cela dans un ensemble plus vaste et aussi foisonnant qu’inattendu : celui des procédures judiciaires des Aborigènes — car sur ce plan, ces sociétés étaient extrêmement imaginatives !

[Emily Kame Kngwarreye]
Mais ces conflits n’obéissaient-ils pas à une forme ritualisée d’hostilité ? Peut-on, dans ce cas, parler de « guerre », d’autant plus qu’ils n’opposaient parfois que de faibles quantités d’individus ?
Lorsqu’on étudie la documentation, une chose saute aux yeux, d’ailleurs très tôt remarquée en Australie : il a existé deux grands types de conflits collectifs. Dans les premiers, qu’on a souvent appelés « rituels » (même s’il n’y avait pas un gramme de religion là-dedans), les camps en présence limitaient leur violence. Les combats cessaient dès que quelqu’un était sérieusement blessé. Étant donné les effectifs qui montaient parfois à plusieurs centaines de combattants de part et d’autre, il arrivait qu’il y ait deux ou trois morts. Mais il est clair qu’on n’est pas là face à des batailles qui s’inscriraient dans une guerre authentique. Il s’agit plutôt de duels où des règles proscrivent les coups trop dangereux, un peu comme dans nos sports de combat modernes, sauf qu’ils étaient menés collectivement. Ces affrontements, publics, hautement spectaculaires et dont l’Australie est d’ailleurs loin d’avoir le monopole, ont contribué à accréditer l’idée que les peuples sans inégalités de richesses, voire l’ensemble des peuples sans États, ignoraient la guerre réelle — ce qui, en tout cas pour l’Australie, est une erreur profonde. Car à côté de ces affrontements régulés, il en était d’autres, soit sous forme de batailles rangées soit, plus souvent, d’attaques surprises, où l’on cherchait à infliger des pertes maximales à l’adversaire. Ainsi, dans ma base de données, on compte une cinquantaine d’affrontements ayant fait au moins 10 morts et pour certains plusieurs dizaines. Rapportés aux populations concernées, c’était considérable ! De tels combats s’inscrivent clairement dans des situations d’hostilité sans frein, où l’on s’efforce d’écraser l’ennemi, voire de l’exterminer — ce que confirment d’ailleurs plusieurs témoignages directs. Cette différence entre les combats modérés ou ritualisés et ceux qui s’inscrivaient dans une authentique volonté d’infliger le maximum de pertes était évidemment parfaitement conçue et exprimée par les Aborigènes eux-mêmes.
Sur le plan matériel, cette différence de nature dans les combats se traduisait-elle, par exemple, par une différence dans les armes employées ?
« L’idée que les peuples sans inégalités de richesses, voire l’ensemble des peuples sans États, ignoraient la guerre réelle est, en tout cas pour l’Australie, une erreur profonde. »
Absolument. Pour commencer, il existait des armes spécifiquement destinées au combat, distinctes de celles employées pour la pêche ou pour la chasse. C’est une évidence s’agissant des boucliers, un instrument qui dans presque toute l’Australie faisait partie de l’équipement de chaque homme adulte. Mais c’est aussi vrai concernant les trois grands types d’armes australiennes, à savoir la lance, la massue et dans une moindre mesure le boomerang. Ainsi, les lances destinées à la guerre étaient toujours les plus lourdes et celles sur lesquelles on investissait du temps de travail ou des matières premières rares afin de les rendre plus dangereuses. En particulier, ce sont ces lances qui étaient barbelées — avec parfois quelques barbelures sculptées à contresens afin de rendre l’extraction encore plus difficile ! Mais la plus terrifiante est sans doute celle surnommée la « lance de mort », où des éléments tranchants étaient fixés avec de la gomme tout au long de la tête. Non seulement cette lance possédait une très forte capacité de pénétration — elle pouvait traverser un corps humain de part en part — mais lorsqu’on l’extrayait, certains des corps tranchants se détachaient, et restaient au plus profond de la plaie en y provoquant des infections. Parmi les armes utilisées au combat, il y avait aussi une distinction entre les modèles les moins dangereux, les seuls autorisés lors des combats modérés et ceux qu’on destinait aux luttes à outrance. L’Australie démontre très clairement qu’une société de chasseurs-cueilleurs mobile, à la production matérielle et aux techniques limitées, est déjà tout à fait capable de fabriquer des armes spécifiquement destinées à affronter des humains en recherchant une efficacité militaire maximale. Après tout, cela n’a rien d’étonnant : au risque d’enfoncer une hutte ouverte, la guerre est une activité dangereuse et la gagner est une question de vie et de mort…
Vos conclusions vous placeraient donc plutôt dans le camp des « faucons » belliqueux que dans celui des « colombes » pacifistes ?
Ce n’est pas si simple ! Ce que l’Australie aborigène démontre clairement, c’est que la guerre est très probablement apparue bien avant l’agriculture ou l’exploitation des humains entre eux. C’est une objection majeure à la position défendue par les « colombes », pour qui des chasseurs-cueilleurs mobiles n’ont aucune raison valable de se faire la guerre — laquelle aurait donc été inconnue jusqu’au Néolithique, voire jusqu’à l’Âge du bronze. Pour autant, cette même Australie aborigène ne légitime pas réellement la position classique des « faucons ». Pour commencer, si la guerre existe en Australie, elle n’y existe pas partout. Cela montre que, si la guerre n’est pas incompatible avec l’économie de chasse-cueillette, elle n’en est pas non plus le fruit nécessaire : il faut faire entrer d’autres variables dans l’équation (qui ne sont d’ailleurs pas si faciles à cerner). Si l’on projette ces éléments pour raisonner sur le passé — avec toutes les difficultés que cela comporte —, cela signifie que la guerre a pu exister avant l’agriculture et la sédentarité, et qu’elle l’a probablement fait. Mais cela ne dit rien ni de sa fréquence, ni de son ancienneté. On peut imaginer, à partir de là, que le scénario proposé par les « faucons », qui fait remonter la guerre aux primates, est le bon. Mais on peut tout aussi bien penser que la guerre est une innovation plus tardive, liée par exemple à l’apparition de sapiens, ou plus tard encore, de telle ou telle forme d’organisation sociale. En réalité, sur ce point, il est sage de ne jamais oublier qu’on en est réduit à avancer des hypothèses invérifiables, et qu’on ne sait à peu près rien.
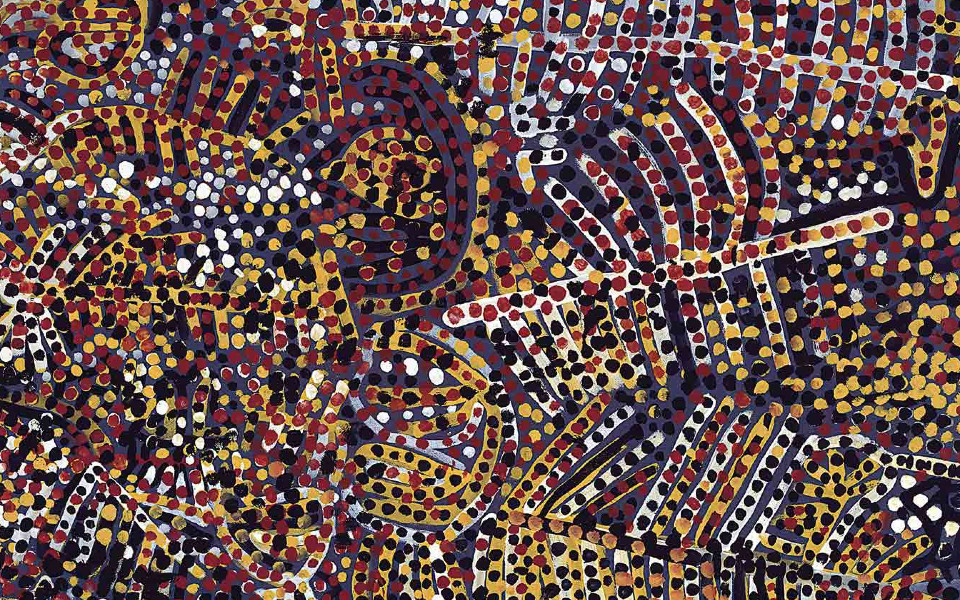
[Emily Kame Kngwarreye]
Mais il y a d’autres aspects sur lesquels je ne me reconnais pas vraiment dans les raisonnements des « faucons ». Par exemple, ceux-ci sont assez peu intéressés à définir la guerre — ce qui est tout de même un problème aussi essentiel que difficile. Leur approche disons « élastique » du phénomène les aide à le retrouver un peu partout, jusque chez les chimpanzés, mais c’est une victoire bien mal acquise… Cette indifférence aux dimensions sociales (pourtant cruciales) ne concerne pas uniquement la définition, mais aussi les motivations des guerres. Ils affirment ainsi que la guerre, partout et toujours, porte sur les ressources utiles à la reproduction. Ce n’est certes pas faux, mais le problème est que c’est tellement général que ça ne peut pas vraiment l’être — d’une manière ou d’une autre, tout peut être vu comme nécessaire à la reproduction ! Ce qui est intéressant, c’est au contraire d’observer que les guerres, là où elles existent, ne poursuivent pas du tout les mêmes buts. Il nous faut donc comprendre comment ces buts s’articulent au type de société concerné.
À la différence d’autres sociétés de chasseurs-cueilleurs — celles de la côte Nord-Ouest des États-Unis, par exemple —, les Aborigènes australiens ne connaissaient pas d’inégalités « économiques » ou « politiques ». Pas de distinction entre riches et pauvres, ni entre libres et esclaves. Et quand il y avait des « leaders », ils ne jouissaient pas d’une position statutaire ni d’un pouvoir coercitif sur les autres membres du groupe. Quelle pouvait bien être la finalité de la violence dans des sociétés où il n’y avait nulle richesse à s’approprier, nul territoire à conquérir, nul pouvoir dont s’emparer ?
« Il y a une forme d’ethnocentrisme insidieux à penser que la guerre est nécessairement née avec la richesse et avec l’exploitation de l’Homme par l’Homme. »
Au premier abord, la guerre aborigène a pour nous quelque chose d’incompréhensible. On n’y pille jamais de biens, on n’y prend jamais de prisonniers ou d’esclaves. Si l’on capture parfois des femmes, c’est semble-t-il un sous-produit de la victoire, non son objectif initial. Quant aux conquêtes territoriales, s’il est difficile d’affirmer qu’elles étaient totalement inconnues, elles semblent néanmoins avoir été très rares. En fait, la guerre aborigène est d’abord et avant tout une guerre de nature judiciaire. Elle est la manière dont on règle les différends collectifs lorsqu’on entretient avec le groupe concerné des relations hostiles. Ces différends ont deux grandes causes : soit ils concernent les droits sur les femmes, soit ils relèvent d’accusations de meurtre par arme ou par sorcellerie — en Australie, on pensait les morts naturelles impossibles : tout décès était attribué à la sorcellerie, et donc susceptible d’être légitimement vengé ! Lorsqu’une querelle impliquait des groupes socialement proches, elle donnait lieu à des procédures de réparation qui atténuaient la rigueur du vieux principe « œil pour œil, dent pour dent ». Au lieu de compenser un meurtre par un autre meurtre, on se contentait par exemple de faire couler le sang du coupable par un simple châtiment corporel non létal. En revanche, lorsque le meurtrier appartenait à un groupe vis-à-vis duquel existait déjà une certaine inimitié, la vengeance égalait l’offense, voire l’excédait. En pareil cas, on voulait donner aux ennemis une leçon dont ils se souviendraient. C’est ainsi que l’on pratiquait, selon les cas, une compensation moins que stricte, une compensation stricte, ou une escalade sans limites — c’est-à-dire la guerre.
Au passage, il y a une forme d’ethnocentrisme insidieux à penser que la guerre est nécessairement née avec la richesse et avec l’exploitation de l’Homme par l’Homme. Et, qu’avant, les groupes humains n’avaient aucune raison d’en venir aux armes. C’est une forme de myopie qui revient à penser que si les gens n’avaient pas nos propres raisons — celles des sociétés de classes — de se faire la guerre, alors ils n’en avaient aucune, et, par conséquent, qu’ils ne se la faisaient pas. C’est justement là où l’ethnologie est indispensable. Elle nous montre en chair et en os, si l’on peut dire, des sociétés dans lesquelles les êtres humains s’organisaient méthodiquement dans le but de se tuer avec d’autres objectifs que confisquer des biens, de la main‑d’œuvre ou des territoires.

[Emily Kame Kngwarreye]
Face à ces positions, les « colombes » affirment souvent que la violence en question est en réalité un effet, fût-il indirect, de la colonisation ou de la pression exercée par des sociétés agricoles ou étatiques voisines. Que répondez-vous à ces critiques ?
Cette hypothèse mérite d’être soigneusement examinée. Il est en effet tout à fait possible que l’influence, même indirecte, des sociétés de classes et de leurs États ait pu, dans certaines circonstances, nourrir la violence chez les petits cultivateurs ou les chasseurs-cueilleurs qui la subissaient. Ce mécanisme est bien attesté, par exemple, pour l’expansion au XVIIe siècle de la machine de guerre iroquoise en Amérique du Nord, dans laquelle la traite des fourrures par les Occidentaux a joué un rôle de premier plan. En revanche, tout indique que cette explication n’a aucune pertinence pour le cas australien. Une partie des témoignages de guerres aborigènes émanent de sociétés qui n’avaient pour ainsi dire aucune forme de contact avec les Blancs. Nulle part la présence occidentale ne transparaît dans les raisons alléguées par les protagonistes pour se battre : encore une fois, on ne se massacre ni pour des biens, ni pour des captifs, ni pour des routes commerciales, et très rarement pour des territoires. Cette présence occidentale en Australie n’était pas ancienne. Quand ils ne la précédaient pas, les combats qui ont été rapportés la suivaient de très peu : l’État colonial, comme partout, a obligé les locaux (du moins ceux qui n’avaient pas été fauchés par les maladies infectieuses) à déposer les armes. Or aucun Aborigène, nulle part, n’a jamais présenté la guerre comme un phénomène récent, qui aurait par exemple été inconnu du temps de ses parents ou grands-parents. Tout au contraire, les inimitiés sont toujours décrites comme ancestrales et la guerre entre groupes est évoquée tant dans certains mythes sur l’origine du monde que dans les discours tenus lors de l’initiation des jeunes hommes. On est donc en présence d’un ensemble d’éléments très solides qui pointent tous dans le même sens : celui de guerres endémiques, inscrites dans la logique des sociétés aborigènes elles-mêmes.
Certes. Mais quand bien même ces données seraient justes en ce qui concerne les sociétés de chasseurs-cueilleurs observées au cours des derniers siècles, elles ne permettent en rien d’extrapoler sur la nature des rapports sociaux des temps préhistoriques, par définition inconnaissables en raison de la trop grande rareté des données archéologiques.
« Dans l’hypothèse où il y aurait eu des guerres au Paléolithique, quelles traces auraient-elles pu laisser ? »
Cette idée fausse part d’un fait incontestable : toutes les sociétés évoluent et les Aborigènes australiens du XIXe siècle ne peuvent évidemment pas être considérés comme la copie conforme de ceux d’il y a 10 000 ans, et sans doute encore moins de ceux de l’époque de Lascaux. Le problème, c’est de savoir jusqu’où ce constat reste vrai et à partir de quel moment il devient faux et stérilisant. En fait, on pourrait faire le même raisonnement en paléontologie et dire ainsi que l’étude des animaux actuels ne nous éclaire en rien pour celle des animaux préhistoriques, étant donné que les espèces ne sont plus les mêmes ! Mais une telle position serait intenable, car chacun sait que c’est en comprenant, à partir des animaux existants, quelles sont les relations entre le squelette et le reste du corps, qu’on peut tenter de reconstituer les formes de vie dont on retrouve les fossiles. Même si la tâche est sans doute plus ardue, la démarche est la même avec les sociétés humaines qu’avec les animaux. Et même si, bien sûr, le mode de subsistance et le niveau technique ne déterminent pas tous les aspects des sociétés, il serait absurde d’affirmer qu’ils n’en déterminent aucun et que les chasseurs-cueilleurs observés récemment n’auraient aucune espèce de point commun avec ceux du passé. Et puis, qu’il soit permis de remarquer que dans la bouche de ceux qui l’utilisent, cet argument est volontiers à géométrie variable. Personne, par exemple, ne remet en cause l’égalitarisme matériel des sociétés du Paléolithique. Pourtant, sur quoi cette conviction se fonde-t-elle, sinon sur l’observation des peuples de chasseurs-cueilleurs effectuée en ethnologie ? Et les « colombes » n’ont pas été les dernières à invoquer certains peuples contemporains, en particulier les San (« Bushmen ») du sud de l’Afrique, pour appuyer l’idée que des chasseurs-cueilleurs mobiles ne sauraient se faire la guerre.
Il n’empêche : il n’existe aucune trace archéologique qui témoignerait de guerres au Paléolithique. N’est-ce pas un argument fort en faveur de ceux qui en contestent l’existence ?
C’est incontestable : pour toute cette immense période, rien en effet ne s’interprète comme un vestige clair de massacres collectifs. On n’a retrouvé ni représentations artistiques de scènes de combats, ni ensembles de cadavres victimes de violences létales, ni armes spécifiquement destinées au combat. Il semble donc assez naturel d’en conclure que la guerre n’est apparue que bien plus tard, lorsqu’elle a commencé à laisser des vestiges palpables. Le problème avec ce raisonnement, c’est qu’il oublie de poser une question : dans l’hypothèse où il y aurait eu des guerres au Paléolithique, quelles traces auraient-elles pu laisser ? L’art des grottes ne représente pour ainsi dire jamais d’humains. Les cadavres, s’agissant de populations peu nombreuses et nomades, n’étaient pas forcément enterrés — ils pouvaient fort bien être démembrés et cannibalisés, comme cela se faisait dans bien des régions australiennes. Quant aux armes, tout ce qui était en bois (par exemple, les boucliers) a forcément disparu, sauf circonstances extraordinaires. Restent les pointes en pierre ou en os, éventuellement barbelées, dont nous ne pouvons pas savoir si elles étaient conçues pour la chasse ou pour la guerre. Mais ce n’est pas parce que nous ne pouvons pas le savoir que ce n’était pas le cas !

[Emily Kame Kngwarreye]
L’Australie illustre de manière saisissante cette divergence entre réalité sociale et empreinte archéologique. Alors que l’on a observé des dizaines d’affrontements suffisamment violents pour causer parfois plusieurs dizaines de morts, l’archéologie n’en garde pour ainsi dire aucune trace. Tout au plus peut-on citer, dans une zone du nord du pays, des peintures pariétales — mais on peut aussi très bien penser qu’elles figurent des batailles régulées. Le seul cadavre ayant été assassiné à la lance a été retrouvé il y a seulement douze ans, et il s’agit d’un individu isolé. Quant aux armes, toutes faites de bois, on n’en a découvert presque aucune. Alors qu’elle était endémique dans les sociétés aborigènes, la guerre est archéologiquement invisible. C’est pourquoi affirmer que la guerre paléolithique n’existait pas au simple motif qu’on n’en a pas de traces — en tout cas, pas de traces évidentes —, c’est se comporter comme un policier paresseux qui, suite à une disparition et en l’absence de cadavre, refuserait d’ouvrir une enquête pour meurtre. Mais évidemment, dans ces cas-là, il faut commencer par se demander si la victime présumée avait reçu des menaces de mort et si, vu les circonstances, son corps avait une forte probabilité d’être retrouvé ou non.
Cette propension à la violence guerrière chez les Aborigènes se retrouve-t-elle dans d’autres sociétés de chasseurs-cueilleurs ou bien est-elle « l’exception qui confirme la règle » ? Inversement : y a‑t-il parmi les chasseurs-cueilleurs connus des cas de peuples véritablement pacifiques ?
« Je ne vois pas ce qui autoriserait à considérer l’explication de Clastres comme pertinente. »
Comme je vous le disais, tous les travaux qui ont essayé de recenser les différentes sociétés de chasseurs-cueilleurs mobiles ont conclu que beaucoup d’entre elles possédaient un niveau de violence tout à fait significatif. Après, il faut être prudent parce que la violence, même collective, ce n’est pas forcément la guerre. Il y a en particulier dans toutes ces sociétés un phénomène qu’on appelle le feud (ou la vendetta, en Méditerranée), qui découle du fait qu’on peut (et qu’on doit !) aller venger un mort en tuant celui qui l’a tué ou un membre de son groupe. Mais sans entrer ici dans une discussion technique qui a fait couler beaucoup d’encre, il est très difficile de trouver un bon critère pour distinguer le feud de la guerre. Les scientifiques se sont divisés sur ce que pouvait être ce critère ; ils sont unanimes, en revanche, pour dire que le feud n’est pas la guerre. Donc, avant de parler de guerres dans de telles sociétés, il faut être prudent et ne pas se contenter d’impressions générales de violences collectives. Pour ma part, je suis assez enclin à penser que la guerre existait en-dehors de l’Australie (et qu’elle a existé dans le passé dans différents endroits du monde). Mais c’est davantage un sentiment qu’une véritable certitude. C’est d’ailleurs sur ce sujet que je suis en train de travailler à présent. Pour ce qui est de sociétés de chasseurs-cueilleurs pacifiques, tout dépend de ce qu’on entend par là. Les fameux San dont je parlais auparavant, prétendument si inoffensifs, avaient tout de même un taux d’homicides plus élevé que nos sociétés modernes. Mais surtout, ce qu’on dit des San en 1950 n’a rien à voir avec ce qu’on disait d’eux un siècle plus tôt, où ils étaient décrits comme pratiquant le feud, et même la guerre ! Les San de 1950, comme bien d’autres chasseurs-cueilleurs dits pacifiques, étaient en réalité beaucoup moins pacifiques que pacifiés, que ce soit par des voisins trop puissants ou par l’ordre colonial.
L’ethnologue Pierre Clastres a soutenu, dans Archéologie de la violence, que les sociétés « primitives » étaient des « sociétés pour la guerre », ce qui n’entre pas fondamentalement en contradiction avec votre travail. Mais cette violence était à ses yeux, au même titre que la régulation démographique, une stratégie déployée pour préserver la fragmentation de la société, une pratique « libertaire » en quelque sorte, destinée à prévenir l’unification coercitive et mortifère qu’aurait entraîné l’émergence de l’État. Que pensez-vous de cette explication ?
Elle ne me convainc absolument pas. Sur un plan général, je ne crois pas que les sociétés « décident » de grand-chose, et je pense qu’on les comprend beaucoup mieux en recherchant les contraintes qui pèsent sur elles et qui façonnent leurs idéologies à leur insu, qu’en postulant qu’elles font des choix libres. Il y a en plus un vrai problème de logique à leur prêter des choix censés les prémunir contre un danger lointain, tel que celui incarné par l’État, dans une société dépourvue de toute structure politique. Concernant le cas précis de l’Australie, on ne trouve pas la moindre trace, dans toute l’ethnographie (et elle est fichtrement volumineuse !), d’une telle motivation. À ma connaissance, aucun Aborigène n’a jamais expliqué à quiconque qu’il allait se battre pour préserver sa liberté ou empêcher une quelconque autorité politique de se constituer. Dans ces conditions, je ne vois pas ce qui autoriserait à considérer l’explication de Clastres comme pertinente.

[Emily Kame Kngwarreye]
Les recherches sur l’origine de la violence et de la guerre, comme celles qui portent sur l’origine de la domination masculine, n’en finissent pas de susciter des débats passionnés. Dans la gauche anticapitaliste, et plus encore dans certains milieux libertaires, on aimerait parfois se convaincre que la violence et le patriarcat sont des constructions socio-historiques tardives — donc plus aisément réversibles. On peut rechigner à admettre qu’elles puissent s’enraciner dans un passé bien plus lointain, de peur que cela ne contribue à leur naturalisation et, in fine, à leur légitimation…
Disons, pour commencer, que le mécanisme intellectuel que vous décrivez, qui associe de manière simple et directe un constat sur le passé avec une perspective d’avenir, ne se rencontre pas uniquement chez les libertaires : il concerne tout autant, par exemple, les milieux marxistes. En réalité, c’est un trompe‑l’œil (ou, si vous préférez, un trompe-cerveau). On prend trop souvent pour un raisonnement ce qui n’est en fait qu’une association d’idées. Je le disais tout à l’heure : quelque chose peut être très récent et néanmoins très solide, ou très ancien et néanmoins condamné à périr rapidement. Il faut donc absolument apprendre à se défaire de ces impressions superficielles, et se poser une série de questions : quels sont les facteurs qui ont amené la naissance de tel phénomène ? Ces facteurs continuent-ils d’agir aujourd’hui ? Sont-ils relayés ou contrecarrés par d’autres ? Quelle est la dynamique de ces facteurs et quel avenir préparent-ils ? C’est la seule manière de raisonner sérieusement, même si elle demande davantage d’efforts. Et c’est celle que j’avais par exemple tenté d’appliquer dans un précédent livre, à propos de la division sexuée du travail. Nous vivons justement une époque où cette division sexuée du travail, qui est au fondement de la domination masculine et dont l’origine se perd dans la nuit des temps, est sapée par certaines évolutions modernes qui permettent, sans doute pour la première fois dans l’histoire des sociétés humaines, d’envisager sa disparition prochaine.
Mais que pensez-vous du discours de certains chantres de la modernité industrielle et capitaliste, dont le cas le plus emblématique est sans doute celui du linguiste Steven Pinker3, qui utilisent la violence supposée des sociétés de chasseurs-cueilleurs pour exalter le présent et les supposés « progrès » de la « civilisation » quant au respect de la vie humaine ?
« Il serait tout aussi faux d’idéaliser le progrès qu’a représenté l’État que d’idéaliser le passé qui le précédait. »
Il serait tout aussi faux d’idéaliser le progrès qu’a représenté l’État que d’idéaliser le passé qui le précédait. Il est très compliqué de produire des statistiques fiables pour comparer en termes chiffrés le niveau de violence physique chez des chasseurs-cueilleurs mobiles et dans les États modernes. Mais s’il y a d’excellents motifs d’être révolté par l’organisation sociale actuelle, ce n’est pas une raison pour regretter les organisations sociales du passé, en les repeignant en rose au passage. Les Aborigènes le disaient eux-mêmes : avant que les Blancs arrivent, on ne quittait jamais son arme, même la nuit, et l’on vivait en permanence sur ses gardes. Dans toutes les sociétés sans État, se faire justice soi-même est non seulement légitime, mais c’est le seul moyen de faire respecter ses droits. Est-ce cela l’avenir auquel il faudrait aspirer ? Alors, je le sais, bien des gens affirment que l’on pourrait fort bien se débarrasser, en même temps que du capitalisme, de l’industrie, de la science et de la techniques modernes — quand ce n’est pas de l’agriculture —, tout en instaurant des rapports sociaux égalitaires et pacifiques. Mais c’est une double illusion. D’abord, parce qu’on ne voit guère comment l’humanité pourrait renoncer à un certain nombre d’acquis, hormis au travers d’un cataclysme que personne de censé ne peut souhaiter. Ensuite, parce qu’à supposer que ce renoncement soit possible, ressusciter les économies disparues ne pourrait que ressusciter les rapports sociaux d’antan. Si aujourd’hui on peut aller sans armes et sans craindre pour sa vie rencontrer des inconnus y compris à l’autre bout du monde c’est parce que l’humanité a été unifiée par une économie mondialisée. On peut imaginer et souhaiter une science, une technique et une industrie libérées du capitalisme et de la course aveugle au profit. Mais renoncer à la science, à la technique et à l’industrie, détricoter le tissu économique mondial, ce serait également renoncer, par la force des choses, à un certain nombre d’acquis qui se sont construits sur cette base, à commencer par la conscience générale d’appartenir à une commune humanité. Avec une économie pré-industrielle, voire pré-agricole, resurgiraient fatalement les rapports sociaux qui leur sont nécessairement liés et toutes les oppressions dont ils étaient porteurs.
Un monde débarrassé de la violence et de la guerre ne pourra être qu’un monde débarrassé de l’exploitation économique et de toutes les frontières politiques, nationales ou non. À l’heure où, plus que jamais, les problèmes environnementaux constituent pour les sociétés humaines une menace directe, une régression vers davantage de fragmentation serait une impasse tragique pour celles-ci. Tout au contraire, leur seule perspective passe par une unification encore plus poussée, c’est-à-dire par une économie moderne et interdépendante à l’échelle de la planète, gérée non plus dans l’anarchie aveugle de la course au profit mais comme une immense coopérative, dans l’intérêt de tous et des générations futures.
Photographie de bannière : Emily Kame Kngwarreye
- On peut penser en France à la préhistorienne Marylène Patou-Mathis.[↩]
- Voir L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, 1886.[↩]
- On peut noter que ce dernier s’inspire directement de l’archéologue Lawrence Keeley, pionnier des études sur la guerre dans les sociétés archaïques.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Yuk Hui : « Produire des technologies alternatives », juillet 2020
☰ Lire notre entretien avec Pierre Déléage : « Si l’anthropologie a une vertu, c’est sa méfiance vis-à-vis de l’universalité des lois », juin 2020
☰ Lire notre entretien avec Pierre Vallombreuse : « Il y a des photographes qui ont un discours néocolonialiste », janvier 2020
☰ Lire notre entretien avec Jean Malaurie : « Nous vivons la crise mondiale du Progrès », juin 2016
☰ Lire notre entretien avec David Graeber : « Nos institutions sont antidémocratiques », juin 2015


