« L’éternelle revendication ouvrière, c’est qu’on ait enfin un jour plus d’égard aux hommes qu’aux choses », écrivait Simone Weil en octobre 1936. La joie ressentie lors des grèves de mai et de juin — « ce sursaut de dignité » — commençait alors à vaciller dans le pays. Un demi-siècle plus tard, l’ouvrier, syndicaliste et auteur Jean Pierre Levaray publiait Putain d’usine. « Personne ne parle de ce malaise qui touche les ouvriers qui ont dépassé la quarantaine et qui ne sont plus motivés par un travail trop longtemps subi. Qu’il a fallu garder parce qu’il y avait la crise, le chômage. » Le livre est, depuis, un classique de la littérature ouvrière. Dans l’un des chapitres, « Dire non », Levaray faisait le récit d’une grève à l’usine dans laquelle il travaillait. « Des grèves, on sait qu’il y en aura d’autres, c’est inéluctable. Parce qu’on ne se laissera pas faire », écrivait-il. Les syndicats viennent d’appeler à des grèves de masse le 7 mars prochain, pour contrer la réforme des retraites ; nous publions en ligne ce texte rêvant, encore et encore, de « jours meilleurs ».
« Une vie de con. » C’est ça qu’on pense lorsqu’on retire nos vêtements de travail, dans le vestiaire, assis devant une des rangées d’armoires métalliques, avant de prendre la douche et partir. Enfin, quitter ce lieu d’infamie.
La douche. Ce n’est pas tellement qu’on ait plus travaillé que les autres jours ou qu’on ait particulièrement transpiré (on a de la chance, le boulot ici est propre ; dans d’autres secteurs de l’usine, c’est Cayenne ou Germinal). La douche, comme pour se débarrasser du travail qui nous a collé à la peau pendant huit heures. Se débarrasser des scories du salariat avant de revenir à la vie (la vraie vie ?). La douche est le rituel quotidien pour chacun d’entre nous, et malheur les jours où il est impossible de l’utiliser à la suite d’un quelconque problème technique.
Le passage des consignes au collègue de la relève, la douche et basta.
Pour recommencer le lendemain, jusqu’à la retraite.
Parfois, des moments forts, une réappropriation de sa vie, lorsqu’on sait dire non.
⁂
Un genre d’étincelle. Pas celle qui met le feu à la plaine. Non. Plutôt l’étincelle qu’il y a dans les yeux de ceux qui disent : « Ça suffit. »
Arrêter l’atelier. Appuyer sur les boutons, fermer les vannes, courir pour faire les manœuvres. Cette fois, c’est nous qui décidons. L’arrêt des machines, c’est déjà une première victoire. C’est la grève !
Tout est à l’arrêt : les machines, les turbines, les pompes ne tournent plus ; les fluides ne circulent pas dans les tuyauteries ; les cheminées ne déversent plus leurs poisons ; et, plus que tout le silence, le calme.
Imposant, ce calme.
Le symbole de notre force, pour dire non à la hiérarchie, au petit chef, au patron.
Je ne parle pas des « journées d’action », des grèves de vingt-quatre heures décidées en haut lieu par nos stratèges syndicaux. Pas ces grèves qui ne durent pas, qui servent juste à montrer un certain rapport de forces mais qui impliquent de retourner au turbin le lendemain. Non, je parle de ces grèves qui arrivent dans les ateliers, comme ça, sans (presque) crier gare. On me dira que c’est catégoriel, certes. Pire même, ces grèves ne touchent souvent qu’un secteur de l’usine. C’est vrai que ce serait mieux si on faisait « tous ensemble », mais les prolos ne sont pas tous les jours des révolutionnaires… On s’en serait rendu compte depuis longtemps. Parfois, ces grèves sporadiques, qui éclatent dans un secteur, un seul atelier de l’usine, font boule de neige et entraînent les autres secteurs. Par solidarité ou sur la base de leurs propres revendications.
Dire non, c’est jubilatoire. C’est une façon de retrouver un peu de soi-même, un peu de la fierté qu’on a perdue en acceptant le salariat. Comme si, pour quelques jours, on prenait nos vies vraiment en main.
Ces grèves éclatent souvent au bout d’un long cheminement : une demande accrue de travail, des heures supplémentaires en pagaille, des congés qu’on ne peut pas prendre, un chef de service qui vous prend pour des cons, ou même un mélange de tout ça.
On sent que ça monte. La tension qui s’installe dans les équipes, on en parle à la relève avec les autres. Au fil des jours, des semaines, voire des mois, sans stratégie véritable, on sait qu’on va vers le conflit. On sait qu’on ne fera pas l’économie d’une grève.
Le patron et l’encadrement le sentent aussi. Ils savent qu’il va se passer « quelque chose », mais une fois que la machine s’est emballée, ils ne peuvent rien faire pour l’arrêter. Essayer d’acheter les plus mous ? On fera sans eux.
Un jour donc, on se met d’accord et c’est la grève. L’arrêt total. On arrive le matin, à cinq heures, grévistes mais présents, pour parler avec ceux de nuit qui sont restés. Tous contents du coup qu’on vient de faire au patron, d’avoir osé.
Parfois, les revendications ne sont pas claires. En AG, un cahier de revendications s’élabore. Ça chauffe, ça discute. D’autres fois, charge est donnée aux syndicats de mettre des mots sur ce qui n’est qu’un gigantesque ras-le-bol. Les revendications ne sont pas toujours le plus important. L’essentiel, c’est surtout de montrer qu’on n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds.

[Ryan Tippery]
Demande est faite d’être reçus par la direction. Au début, c’est toujours non, mais on ne se laisse pas faire. On y va directement, on sait qu’ils tiennent réunion, sans nous, sur notre dos. On s’invite. Vêtus de nos tenues de travail, on se rend dans leurs bureaux. Ils n’aiment pas nous voir en bleus. La secrétaire de direction — « l’assistante », comme on dit désormais — nous annonce et nous entrons. Ils sont là : directeur, responsable technique, responsable des ressources humaines.
On s’installe, à notre rythme, dans ce bureau trop grand, au mobilier chic. Les copains sont contents d’être là pour se faire entendre. Je m’adresse au patron, annonçant la couleur, et le pourquoi de notre intrusion dans leurs locaux. Le DRH aurait une mitraillette à la place des yeux, je serais mort. Mais c’est bête pour lui, il arbore une fleur de lys à la boutonnière, et ça, je ne supporte pas. J’énonce nos revendications et les collègues ensuite prennent la parole. Là, c’est fort : quand, malgré le vernis qui les recouvre, nos patrons doivent écouter leurs salariés. Ceux qu’ils ne veulent pas connaître ; ceux qui ne représentent à leurs yeux qu’une masse salariale, un coût fixe qu’il faut réduire ; ceux dont ils se passeraient bien. Des robots, ce serait tellement plus simple…
La direction donne rarement de réponse lorsqu’on vient la voir comme ça. Elle explique qu’elle veut traiter avec les organisations syndicales.
Que dire des syndicats ? Il y a ceux qui se présentent comme des « outils » pour les salariés, qui accompagnent dans la lutte, qui prennent fait et cause pour les grévistes, et il y a les autres, les « responsables », toujours le stylo sorti prêt à signer n’importe quel protocole ou accord de fin de conflit.
Entre nous, au fur et à mesure que le conflit se poursuit, on se retrouve en AG. C’est bien simple, on est plus souvent à l’usine quand il y a grève que lorsqu’on travaille normalement. Il n’y a que les grosses « journées d’action » qui permettent de s’offrir un jour de repos supplémentaire. Pour nos conflits à nous, nous sommes présents.
Les AG sont parfois houleuses, parce que rien n’est simple. Alors que les jours passent, on sait qu’on perd du fric, et pour certains c’est dur. On vient de rencontrer à nouveau le patron, en délégation, on parle des propositions entre nous et la discussion repart.
La fin d’un conflit de ce type n’est jamais facile. Il a fallu négocier, parfois il a fallu s’asseoir sur un coefficient ou sur une prime. Parfois on n’arrive pas à obtenir exactement l’augmentation qu’on voulait, ou encore un syndicat dit qu’il faut reprendre sinon c’est le lock-out… Les raisons ne manquent pas.
Alors on vote. Quand on arrive à un tiers pour la continuation de la grève et deux tiers pour reprendre le travail, il faut s’y faire. On avait beau être un certain nombre à vouloir continuer pour obtenir davantage, c’est fini.
Il y a quelques jours durs, après ces conflits. La reprise est toujours pénible. Comme un coup de bâton, parce que ce n’était pas la révolution (même si l’effervescence du conflit a pu le faire croire). La réalité du salariat reprend forme. On redémarre les machines… En route pour le quotidien !
Quelques semaines après, pourtant, parce qu’on a tout de même obtenu des choses, ça va mieux. On en reparle, on refait des stratégies, on en entend même parler du temps où ils se frottaient aux CRS, alors qu’on les connaît et qu’ils n’ont jamais fait que suivre les mouvements de loin. Au moins ils assument l’histoire ouvrière.
On a repris ce fichu turbin et on est un certain nombre à attendre cette nouvelle étincelle qu’on verra briller dans le regard des collègues lorsqu’ils oseront à nouveau dire non.
⁂
« La Défense, tout le monde descend. » On arrive à deux cars pour aller manifester devant le siège de l’usine. Deux cars : près de cent gars de Rouen, c’est plutôt bien. Une énième journée de protestation contre les licenciements dans le groupe. Près de cent cinquante emplois supprimés dans notre boîte, quelques sites vont fermer. Les bénéfices affichés sont au plus haut, les actions continuent à monter, or les plans « sociaux » se multiplient. Sur certains sites, comme le nôtre, il s’agit surtout de départs en retraite non remplacés et de mutations vers d’autres sites, il y a très peu de licenciements secs.
Dans nos cars, pas mal de prolos de base. En fait, ce sont particulièrement leurs postes que la direction veut supprimer : il y aura encore plus de sous-traitance.
Pour un grand nombre, c’est la virée à Paris.
La Défense, architecture laide pour nos décideurs. Le point de rassemblement, c’est la Grande Arche. C’est énorme, mais nous sommes nombreux et nous faisons impression. Impression sur tous ces commerciaux pressés qui avancent d’un pas rapide, portable dans une main, attaché-case dans l’autre.
Au bout d’une heure d’attente, quand toutes les boîtes sont représentées (ou presque), la manif s’ébranle. De nombreux cadres (ou habillés comme tels) nous regardent d’un sale air. On s’en fout, on a le nombre, on les emmerde.
La manifestation est bruyante. Certains ont amené des bidons d’huile vides et tapent dessus à la manière des Tambours du Bronx. Il y a des pétards, des sifflets, des mégaphones et des slogans à propos des stock-options du patron.
Arrivée devant le siège. Un immeuble tout en verre dépoli qui renvoie les reflets du soleil. Tout en haut, le sigle qui veut s’imposer. C’est une des plus hautes tours de la Défense. C’est un peu comme ces villages toscans où, au Moyen Âge, chaque habitant fortuné voulait construire la tour la plus haute du village.
On est au pied de l’immeuble, plus d’un millier, très bruyants mais un peu frustrés : les portes sont fermées et il n’y a même pas de flics pour qu’on se défoule.
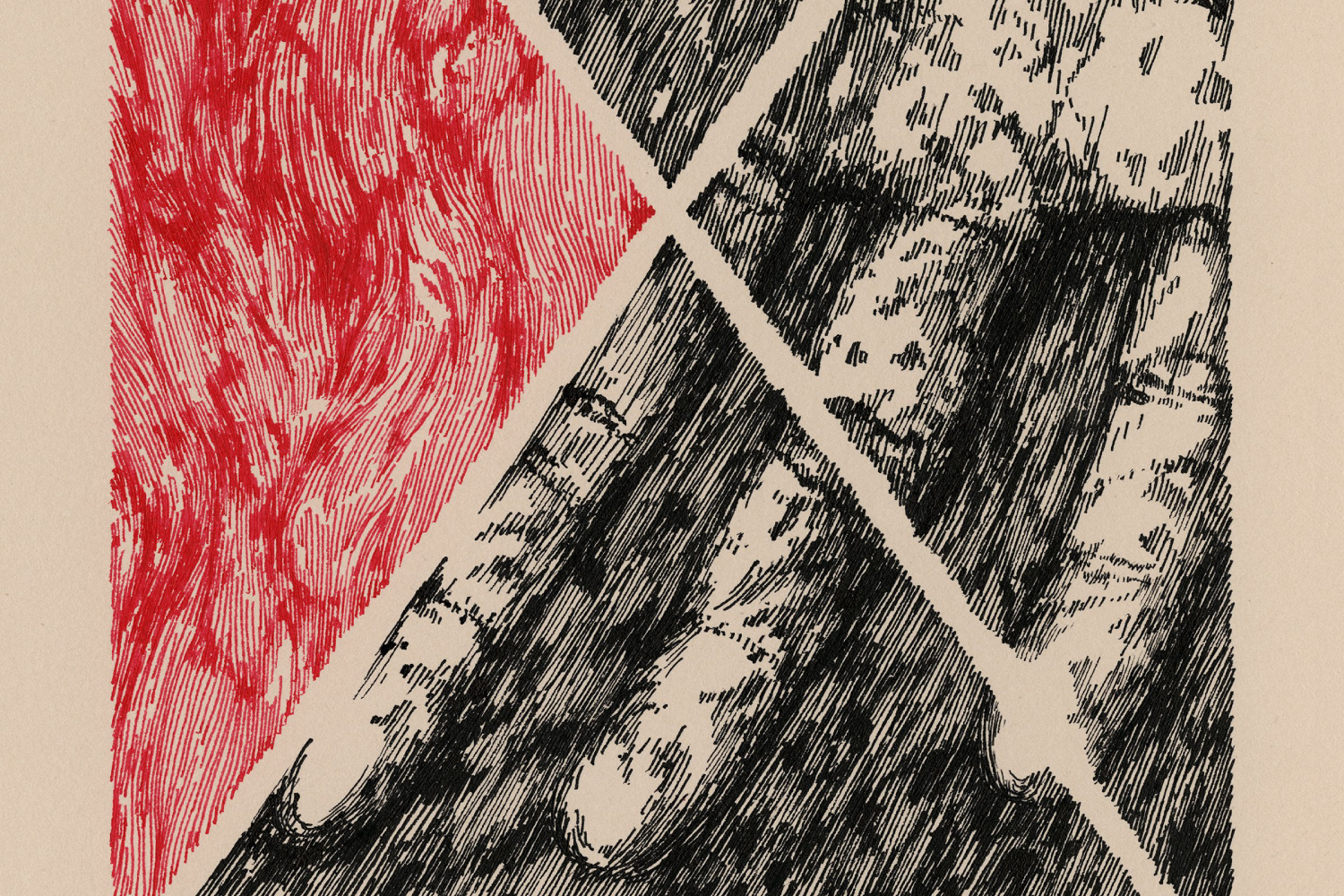
[Ryan Tippery]
Nous rejoignons des retardataires, et non des moindres : ils viennent du Sud-Ouest, où le site va entièrement fermer. Ils sont en grève depuis trois semaines et ils sont très remontés. On les acclame.
La tension monte, je me faufile vers les premiers rangs. Les portes vont céder, c’est clair. Quelques costauds s’y attellent. Les portes s’ouvrent. Derrière, les vigiles ne font pas le poids. On entre tous, dans un genre de patio-salle d’attente. Des secrétaires, des hôtesses d’accueil n’en mènent pas large, leur sourire est forcé. Dans les étages qui donnent sur ce patio, les cadres nous regardent, protégés par de grandes verrières. Des œufs s’envolent et s’étalent à hauteur de leurs tronches. C’est l’hallali. On investit les lieux. Les pétards rendent l’endroit assourdissant. Des copains qui ont amené des sacs de produit, les renversent dans les escaliers. C’est casse-gueule mais ça fait de l’effet. Les cameramen de TF1 qui ont raté la scène demandent qu’ils la rejouent. Les copains se plient de bonne grâce, transpercent un nouveau sac et répandent les granulés avec des gestes assez gracieux. Les cameramen ont l’image, ils peuvent se tirer.
Un collègue pique un téléphone. Les revues publicitaires valsent. Des manifestants, en nombre, se rendent vers la cafétéria au sous-sol et se font servir des repas gratuitement, « aux frais du patron », pendant que d’autres s’approprient les quelques bouteilles de vin disponibles.
Dans un couloir, à force de pétards et de fumigènes, on ne voit plus rien et ça pue. La moquette commence à brûler et les plantes (de prix) sont allées valser.
Une délégation est reçue, on était en partie là pour ça, mais on s’en fiche. En fait, on est là pour se défouler de tout ce qu’on vit à l’usine.
Dehors, les bouteilles qui viennent d’être piquées tournent comme des joints dans un concert.
Le hall est plutôt dévasté, pourtant le patron se refuse à faire intervenir les flics. Les saccages, tout jouissifs qu’ils soient, se font avec l’énergie du désespoir. Au fil des années, et des divers « plans sociaux », on y a laissé beaucoup de plumes et on sait qu’on va en laisser encore. Nos actions vont sans doute réduire l’hémorragie, mais celle-ci va encore continuer. Des copains vont nous quitter, changer de région, et on va se retrouver à beaucoup moins pour faire le même travail, voire pire. On n’arrive plus à gagner, même si on est encore nombreux à se déplacer pour manifester.
Le climat s’apaise (il n’y a plus de pétards) et on attend la délégation.
Plus tard — on s’en doutait —, cette dernière annonce que sur les huit cents suppressions d’emplois prévues il n’y en aura que six cents. Toujours le jeu des enchères où tout le monde prétend avoir gagné.
On repart. Saluts à quelques collègues d’autres sites et retour vers nos cars respectifs. Sur le trajet, l’ambiance est moins chaude, moins gaie qu’à l’aller.
Un copain du syndicat aura beau dire qu’on a fait reculer la direction, on y croit à peine. Un collègue, au fond du car, sort de sous son manteau une bouteille de whisky qu’il a dégotée et qu’il s’est autorisé à prendre lors de son incursion dans un bureau. Il affiche un air de victoire sur son visage et on se met tous à rire. Il est content de son coup.
C’est la route du retour, le soleil se couche. Demain il faudra retrouver le travail.
⁂
D’autres souvenirs qui remontent.
Quand les ateliers de toute l’usine faisaient grève à tour de rôle ; les gueules de nos chefs qui dans ces moments-là n’arrivaient pas à se faire entendre ; « Non, moi je suis en grève à partir de maintenant » ; les assemblées générales devant les portes de l’usine et l’enthousiasme des grévistes ; une manif dans l’usine, pas très efficace mais plutôt réjouissante quand on a fini par pénétrer dans les bureaux de la direction ; les piquets de grève à l’entrée, au petit matin, lorsqu’on fait brûler des palettes pour avoir de la chaleur mais surtout pour le sentiment de puissance qui s’élève du brasier (maintenant, on fait rarement des piquets de grève, mais j’en vois encore quand je me rends dans d’autres usines en lutte).
Et puis… malgré nos combats, même si on a limité la casse, on n’a pas pu tout empêcher. Il y a quinze ans, nous étions deux mille, aujourd’hui on se retrouve à six cent cinquante, tout en produisant plus. Et on sait que l’hémorragie n’est pas terminée.
Des grèves, on sait qu’il y en aura d’autres, c’est inéluctable. Parce qu’on ne se laissera pas faire, même si l’usine c’est loin d’être la lutte tous les jours et qu’il y a des jours où on avale des couleuvres.
Mais c’est dans ces moments-là, lorsque l’étincelle brille dans les yeux des ouvriers en grève, lorsqu’ils se réapproprient leur vie, que j’ai encore un peu d’espoir en des jours meilleurs.
Texte extrait de Jean Pierre Levaray, Putain d’usine, Agone, 2005
Illustrations : Ryan Tappery
REBONDS
☰ Lire notre récit « Le triangle — une marche dans Aubervilliers », Loez, juin 2022
☰ Lire notre récit « Tout ce qui vit », Élie Marek et Elias Boisjean, mai 2022
☰ Lire le texte « 99 », Marc Nammour, avril 2022
☰ Lire notre récit « Drôle de temps, ami », Maryam Madjidi, janvier 2022
☰ Lire les textes « Combien de fois », Claro, décembre 2021
☰ Lire notre nouvelle « L’usine », Marc Graciano, novembre 2021


