Texte inédit pour le site de Ballast
La monnaie exprime un pouvoir disciplinaire de classe qu’il convient de dévoiler afin de concevoir des formes de résistance adaptées. Élucider cette question est décisif pour comprendre d’autres « objets économiques » qui y sont associés — tels que le crédit, la finance ou le système bancaire. La monnaie joue un rôle absolument crucial dans la légitimation, la dépolitisation et la mystification des rapports sociaux capitalistes. Dès lors, la « repolitiser » doit faire partie intégrante de tout projet émancipateur. Explications. ☰ Par Ilias Alami, Vincent Guermond et Caroline Metz
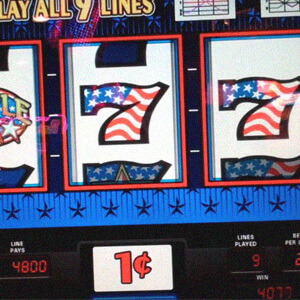
Comment expliquer ce paradoxe ? Pourquoi et comment le contenu politique de la monnaie est-il systématiquement « mystifié² », rendu invisible par les représentations que nous en avons ? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de se pencher sur le rôle de la monnaie, sa nature et les différentes formes qu’elle prend au sein du système capitaliste.
Le fétichisme de la monnaie comme catégorie ‘technique’ dans le capitalisme
La monnaie est la représentation matérielle de la richesse sous sa forme la plus abstraite, c’est-à-dire sans lien avec aucune marchandise ou processus de production : elle joue le rôle de « l’équivalent général », le seul « objet » qui a la propriété de pouvoir être échangé contre toutes les marchandises³. Ainsi, nous dit Karl Marx, la monnaie est « la forme absolue et toujours disponible de la richesse sociale4 ». Elle confère le pouvoir de « commander » le travail : de façon directe, car la monnaie permet l’achat de la force de travail (c’est-à-dire le paiement d’un salaire en échange du travail) ; de façon indirecte, car l’achat de marchandises revient en fait à « commander » le produit du travail des autres.
« La monnaie joue un rôle crucial dans la légitimation, la dépolitisation, et la mystification des rapports sociaux capitalistes. »
La monnaie est aussi une « entité » qui peut être appropriée et accumulée par des individus ou des groupes sociaux particuliers : « Le pouvoir que tout individu exerce sur les activités des autres existe en tant que possesseur de… monnaie. Son pouvoir social, tout comme sa connexion avec la société, il les porte sur lui, dans sa poche.5 » Cet aspect souligne l’une des contradictions au cœur de la monnaie capitaliste : elle est à la fois l’incarnation absolue de la richesse sociale (c’est-à-dire le pouvoir de commander l’activité des autres) et l’objet d’une appropriation privée. La monnaie capitaliste n’est pas neutre ; elle représente et exprime un pouvoir fondamentalement inégalitaire. Ce pouvoir inégalitaire est, plus spécifiquement, un pouvoir social de classe. On le sait : dans les sociétés capitalistes, l’immense majorité de la population n’a pas accès aux moyens de production ; pour (sur)vivre et se reproduire, le commun des mortels doit se procurer des marchandises (nourriture, vêtement, logement, électricité, etc.) produites par d’autres. Or ces marchandises ont un prix. L’accès à la monnaie est dès lors la condition sine qua non de subsistance — et cet impératif force à vendre sa force de travail contre salaire. La monnaie exprime un pouvoir disciplinaire crucial au cœur du rapport social entre capital et travail : c’est la capacité qu’a le capital d’imposer le travail salarié. Comme l’explique Toni Negri, la monnaie est avant tout l’équivalence d’une inégalité sociale. Elle représente, reproduit et masque tout à la fois l’inégalité des rapports de production capitaliste, c’est-à-dire l’inégalité fondamentale entre ceux qui n’ont que leur force de travail à vendre (et n’ont pas d’autre choix pour survivre que de la vendre) et ceux qui, par la possession de monnaie, commandent l’activité des autres⁶.

(DR)
Les possesseur(e)s de monnaie imposent leur volonté en avançant la monnaie ou en la retirant de la circulation⁷. En d’autres termes, dans les sociétés capitalistes, le pouvoir de la monnaie exprime la subordination de la reproduction matérielle et sociale aux disciplines et à la logique de l’accumulation du capital⁸. Loin d’être un moyen rationnel pour satisfaire les besoins humains, la monnaie est en fait un pouvoir social par lequel la satisfaction de ces besoins est soumise au capital. Ce pouvoir social est abstrait mais bien réel, précise David Harvey⁹ : les abstractions monétaires — telles que salaires, prix, taux d’intérêt, taux de change, notes de crédit, etc. — ont une emprise tangible sur la vie sociale et leurs fluctuations ont un impact direct sur notre existence. La monnaie capitaliste représente un pouvoir foncièrement inégalitaire, un pouvoir social de classe10 ; comme l’explique Toni Negri, elle « représente, sanctionne et organise » les rapports sociaux capitalistes.
« Les rapports d’exploitation et de domination — qui sont l’essence même du capitalisme — sont masqués par l’apparence d’égalité et de liberté de la monnaie. »
Il est cependant crucial pour la reproduction des rapports sociaux capitalistes que ce pouvoir social de la monnaie soit le moins évident possible. L’apparente égalité abstraite selon laquelle « tous les individus sont égaux devant la monnaie » contribue à dépolitiser, naturaliser et donc légitimer les rapports sociaux capitalistes. Ainsi, les rapports d’exploitation et de domination — qui sont l’essence même du capitalisme — sont masqués par l’apparence d’égalité et de liberté de la monnaie11. Ces principes d’égalité et de liberté formels devant la monnaie sont aussi nécessaires à la constitution du sujet juridico-politique moderne (le sujet libre et égal défini par le droit) et à la figure de la citoyenneté, puisqu’ils occultent l’inégalité fondamentale des rapports de production capitaliste. Lorsque, dans les livres d’économie comme dans les discours politiques, la monnaie est représentée comme une catégorie neutre ; lorsque l’on affirme que la gestion de la monnaie doit être assurée par des experts et technocrates, comme c’est le cas au sein des banques centrales dites « indépendantes », la monnaie apparaît comme un élément technique plutôt que politique, et se trouve ainsi placée hors de portée des pressions démocratiques. Ce « fétichisme » de la monnaie, activement reproduit par les classes dirigeantes, doit être brisé — et la question de la nature de la monnaie et de son pouvoir de classe mise au cœur de tout projet émancipateur. Cela nous parait particulièrement important dans le contexte historique actuel : les processus de financiarisation et d’extension des relations monétaires sous forme de dette au cours des trente dernières années ont considérablement renforcé le pouvoir social de la monnaie, et ce alors que les rapports d’exploitation et de domination qui sous-tendent les relations monétaires et financières sont garantis et normalisés par les interventions de l’État néolibéral.
Monnaie et dette dans le capitalisme financiarisé de type néolibéral
L’une des caractéristiques centrales du capitalisme contemporain, que l’on peut qualifier de capitalisme financiarisé de type néolibéral, est que le pouvoir social de la monnaie a acquis une forme particulièrement aiguë. Les politiques néolibérales et autres reconfigurations à l’œuvre depuis les années 1970 ont donné lieu à une augmentation massive du recours à l’endettement. Or, si la dette est bien souvent présentée comme un « service financier » utilisé — à bon ou mauvais escient — pour obtenir des biens et services autrement inaccessibles, l’endettement généralisé est aujourd’hui bien plus qu’un choix personnel. Les dettes privées constituent non seulement un marché lucratif en soi, mais sont aussi devenues indispensables à l’accumulation du capital. Le renforcement et l’approfondissement du pouvoir social de la monnaie, par le biais de la dette et de l’intervention étatique notamment, ont été essentiels dans la recomposition des rapports de classe en faveur du capital. L’une des politiques phares de l’arsenal néolibéral est la privatisation accrue des biens et services autrefois publics. Ces privatisations, nombreuses depuis les années 1980, sont aussi au cœur des « politiques de rigueur » ou, comme on les appelle aujourd’hui, d’austérité. Les services de santé, l’éducation, les transports, le logement et les retraites, au lieu d’être gérés de façon collective ou par l’État (et donc via la collecte et redistribution des impôts), sont vendus par des entreprises privées.

(DR)
À la suite de ces privatisations, les prix sont déterminés par ces entreprises en contexte concurrentiel ; les individus ne peuvent se procurer ces services qu’en échange d’une certaine somme de monnaie. L’accès à la monnaie devient alors « une exigence grandissante pour accéder à la consommation présente et future12 ». Le pouvoir disciplinaire de la monnaie est donc par là même renforcé. Les privatisations massives se conjuguent ensuite à trois autres phénomènes : la concentration des richesses dans les mains d’une frange extrêmement réduite de la population ; le processus néolibéral de compression des salaires depuis les années 197013 ; les difficultés, pour la majorité, à trouver un emploi stable et correctement rémunéré — difficultés qui sont d’ailleurs aussi le résultat de politiques de « flexibilisation » du marché du travail, faisant partie des réformes structurelles voulues par les tenants de l’austérité. Il résulte de cette combinaison de facteurs une baisse générale des revenus du travail par rapport à ceux du capital. Pour de nombreuses personnes, vendre sa force de travail n’est alors plus suffisant : l’endettement devient inévitable. Les dettes des ménages couvrent les dépenses de la vie quotidienne, permettent l’accès au logement, à l’éducation et servent aussi de « filet de secours » en cas de difficulté soudaine (perte d’emploi, maladie grave, etc.).
« Pour de nombreuses personnes, vendre sa force de travail n’est alors plus suffisant : l’endettement devient inévitable. »
Une partie croissante de la population n’a d’autre choix que de se tourner vers les prêts hypothécaires, prêts étudiants et autres prêts à la consommation fournis par le système bancaire — lui-même souvent intimement lié au système financier plus global. En témoigne l’explosion du nombre et de la complexité des instruments de crédit disponibles à la population, allant des cartes de crédit et prêts auto, aujourd’hui considérés comme standards, à des pratiques plus récentes comme les prêts à taux révisables ou les prêts sur salaire (payday loans)14. L’augmentation du recours à la dette est manifeste dans la quasi-totalité des pays occidentaux depuis les années 1990, et ce particulièrement aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais aussi dans des pays comme la Grèce ou l’Espagne depuis les années 2000. En France, la dette des ménages représente en moyenne 104 % du revenu disponible en 2014 (contre 67 % en 1995). Ces chiffres étaient de 155 % au Royaume-Uni et de 274 % aux Pays-Bas, où les crédits hypothécaires sont largement répandus15. Cette interprétation de l’accroissement étourdissant de la dette des ménages comme moyen d’assurer le maintien d’un niveau de vie décent ou de répondre à une crise ponctuelle diffère de l’analyse dominante.
L’endettement, plus connu sous son appellation dépolitisée d’« accès au crédit », est présenté avant tout comme un « service financier » dont l’extension au plus grand nombre représente une bienvenue « démocratisation de la finance » et du crédit16. De même, les politiques d’« inclusion financière » visant les pays du Sud et les catégories les plus pauvres des pays du Nord sont perçues, même par certains observateurs progressistes, comme une avancée positive permettant aux travailleurs et travailleuses d’avoir accès à des produits et services financiers dont elles et ils étaient historiquement exclus17. Cette vision idyllique est fondée sur une conception de la dette comme échange d’argent contractuel d’égal à égal entre un créditeur et un débiteur, occultant ainsi le rapport de pouvoir décrit précédemment. Dans cette optique, la dette est, tout comme la monnaie, considérée comme un simple facilitateur mettant en relation deux individus aux besoins complémentaires. De même, le système bancaire et les marchés financiers sont présentés (et se présentent) comme des intermédiaires neutres entre détenteurs de monnaie et demandeurs de monnaie. Le revers d’une telle interprétation égalitaire et individualiste — chacun est libre de contracter une dette s’il ou elle estime que cela est dans son intérêt — est que les situations qualifiées de surendettement sont vues comme la conséquence de mauvais choix personnels, résultant au mieux d’un manque d’« éducation financière », au pire d’une attitude consumériste à l’extrême de la part de personnes vivant « au-dessus de leurs moyens » et méritant donc d’être rappelés à l’ordre18. Ainsi, la critique de la dette est à la fois restreinte aux cas les plus flagrants (le surendettement plutôt que l’endettement dans son ensemble) et focalisée sur la responsabilité individuelle et morale de chacun plutôt que sur l’aspect politique et social de la dette.

(Reuters)
La réalité est cependant tout autre — et les bénéfices proclamés ou attendus de l’extension du crédit rarement constatés. Par exemple, on peut se demander en quoi l’industrie des prêts sur salaire, qui affiche des taux d’intérêt dépassant régulièrement les 300 %, constitue réellement un service pour ses clients. En matière de stabilité financière, il est intéressant de rappeler que c’est la politique du « crédit pour tous » qui, couplée aux innovations financières les plus élaborées, a été l’un des éléments déclencheurs de la crise des subprimes aux États-Unis, avec les conséquences que l’on connaît. Quant aux promesses d’éradication de la pauvreté par la micro-finance et l’inclusion financière, si on attend encore de les voir se matérialiser dans les pays du Sud, leurs effets néfastes (surendettement, violence conjugale, suicides, etc.) ont été bien documentés par un certain nombre d’académiques et de professionnels19. En somme, le rôle de plus en plus envahissant et permanent de la dette dans la vie quotidienne des populations semble loin du projet démocratique annoncé. Comment, alors, comprendre la continuelle reproduction des relations de dette ? Notre interprétation s’inscrit dans une démarche historique et matérialiste. D’une part, repolitiser la dette implique de mettre en évidence son aspect inégalitaire. D’autre part, il faut comprendre l’explosion des dettes comme un phénomène politico-économique qui ne doit rien au hasard : l’État capitaliste a joué un rôle clé dans la reproduction des relations de dette, elles-mêmes devenues nécessaires à l’accumulation du capital.
« La dette, moyen de subsistance pour les uns, est un marché lucratif pour d’autres, une
véritable industrie de la pauvretéaux mains du secteur bancaire et financier privés. »
La dette, moyen de subsistance pour les uns, est un marché lucratif pour d’autres, une véritable « industrie de la pauvreté20 » aux mains du secteur bancaire et financier privés. Rappelons tout d’abord que ce sont les banques commerciales qui, en émettant des prêts par un jeu d’écriture électronique, sont responsables de l’immense majorité de la création de monnaie dématérialisée (les banques centrales étant responsables de l’émission de pièces et de billets, c’est-à-dire moins de 5 % de la masse monétaire existante)21. Les ménages et les particuliers sont devenus une source importante de revenus pour les banques, non seulement en termes d’intérêts payés sur les prêts, mais aussi grâce aux frais liés à la gestion des comptes et cartes bancaires, ainsi que ceux associés aux pénalités qu’engendrent les retards de paiement et autres découverts. L’ensemble de ces frais représentait par exemple plus du quart des revenus de la banque Barclays en 200622. De nombreuses entreprises dites « non-financières », comme les grandes enseignes ou les compagnies automobiles, se sont par ailleurs financiarisées : elles consacrent une large partie de leurs activités au crédit à la consommation, qui génère une part significative de leurs profits23. La titrisation, une technique qui s’est développée de façon exponentielle dans les années 2000, permet quant à elle de transformer des prêts (ou tout autre actif donnant lieu à des flux monétaires réguliers comme les paiements mensuels de factures médicales, de téléphone, d’électricité, etc.) en des produits structurés vendus à des banques d’investissement, des compagnies d’assurance, des fonds de pension, mais aussi des hedge funds et autres fonds mutuels. Les produits ainsi titrisés sont ensuite échangeables à l’envie sur les marchés financiers24. La dette des ménages alimente donc les marchés financiers — et les profits de tous les intermédiaires qui opèrent ces marchés, parmi lesquels les grandes banques européennes et américaines. Ces profits, bien qu’issus du marché du crédit, renforcent encore le pouvoir social des institutions financières.
En plus de l’inégalité de pouvoir sur laquelle elles sont fondées, les relations de dette sont aussi génératrices d’inégalités sociales toujours plus grandes. Les pratiques généralement jugées abusives (taux d’intérêt extrêmement élevés ou pouvant varier selon des conditions complexes, etc.) touchent de façon disproportionnée les populations les plus fragiles (classes sociales défavorisées, minorités ethniques, femmes, migrants et autres groupes marginalisés). Ce sont justement les ménages les plus démunis qui se voient refuser l’accès au crédit traditionnel — par exemple, si leur credit scoring (note de crédit) n’est pas assez élevé — et ce alors qu’ils sont justement les premiers affectés par les crises financières et économiques et n’ont donc souvent pas d’autre choix que d’entrer dans un cercle vicieux d’endettement usurier. À l’opposé, les catégories les plus aisées parviennent à profiter desdits services bancaires, l’ingénierie financière leur permettant par exemple de faire fructifier des richesses existantes, ou, comme l’a encore récemment souligné l’affaire des Panama Papers, d’échapper à l’impôt. Alors que les classes supérieures et les acteurs financiers sont renforcés dans leur position de détenteurs de monnaie, les groupes sociaux les plus vulnérables sont clairement les plus affectés par la violence du pouvoir disciplinaire de la monnaie sous sa forme actuelle.

(Getty Images)
Il est essentiel de souligner que l’endettement des ménages, compris dans une perspective plus large, est bien plus qu’une simple affaire de choix personnel. L’ampleur structurelle du marché de la dette est telle que certains y ont vu l’une des caractéristiques principales du capitalisme contemporain (« debt-driven capitalism »25). Que l’on parle d’un « modèle de croissance anglo-libéral » fondé sur la consommation et financé par la dette privée26 ou d’un « keynesianisme privé » sous-tendu par la croissance des marchés du crédit pour les classes moyennes et inférieures27, le constat est le même : la dette privée est devenue essentielle à la reproduction sociale dans la société néolibérale, que ce soit pour financer la consommation des ménages ou l’investissement des entreprises. Elle devient donc nécessaire au bon fonctionnement de nos économies — ou, en termes plus critiques, à l’accumulation du capital et donc à la reproduction du capitalisme dans son ensemble. Cette dépendance explique en partie pourquoi les gouvernements des États occidentaux (ainsi que les institutions européennes) accordent une telle importance au maintien de « l’accès au crédit ».
« La figure du bon citoyen est devenue celle de l’individu qui participe avec succès aux activités des marchés financiers, un sujet « entrepreneur de soi » qui se doit d’investir et de calculer les risques afin de survivre. »
Contrairement à ce que proclament les théoriciens d’un néolibéralisme qui serait foncièrement opposé à toute ingérence de l’État dans l’économie, l’apparition d’un endettement croissant des ménages n’est pas étranger à l’intervention centrale de l’État via la mise en place de mécanismes légaux et institutionnels spécifiques. Le développement des marchés du crédit n’a été possible que par certaines réorientations du système bancaire et financier, permises non seulement par certaines évolutions technologiques, mais aussi par d’importants changements législatifs — ce que l’on nomme communément la « déréglementation financière », entamée dans les années 1970–80. Citons par exemple le gouvernement Mitterrand qui libéralisa le secteur des services financiers au début des années 1980 et facilita la création de prêts en assouplissant le droit bancaire en la matière. La tendance fut similaire aux États-Unis et dans de nombreux pays d’Europe, où l’Union européenne elle-même a de longue date encouragé des changements allant dans ce sens. L’État néolibéral a donc facilité le « debt fix » (compensation de la baisse du revenu disponible par la dette) en promouvant crédits hypothécaires et crédits à la consommation. Susanne Soederberg, dans son récent ouvrage intitulé Debtfare States and the Poverty Industry : Money, Discipline, and the Surplus Population, explique que les politiques dites de « debtfare » sont aujourd’hui encore un élément essentiel des interventions de l’État néolibéral permettant de multiplier et normaliser les relations de dette monétisées et de soumettre à leur pouvoir disciplinaire les populations débitrices. Ainsi, l’État réforme et remodèle la législation de façon à assurer l’emprise des créditeurs sur les emprunteurs. On le voit par exemple aux États-Unis, au Royaume-Uni mais aussi au Canada à travers une série de lois et de réformes28 par lesquelles il devient de plus en plus difficile de se libérer de ses dettes en déclarant l’insolvabilité. C’est donc ici la loi, supposée juste et impartiale, qui joue le rôle de défenseur du pouvoir disciplinaire de la monnaie.
On assiste, avec l’avènement de l’État debtfare, à un transfert de responsabilité financière quand les choses tournent mal — tandis que les profits, eux, restent privés. Lors de la crise des subprimes aux États-Unis, lors des évictions des populations qui avaient contracté des emprunts immobiliers toxiques en Espagne, lorsque des travailleurs pauvres ne peuvent pas rembourser leurs prêts sur salaires à un taux supérieur à 400 %, lorsque des étudiants refusent ou sont dans l’incapacité de rembourser leurs prêts étudiants, la responsabilité est considérée comme exclusivement individuelle. Alors que les créditeurs sont incroyablement protégés par la loi, les défauts de paiement sont sévèrement punis, menant parfois jusqu’à l’emprisonnement. La figure du bon citoyen est devenue celle de l’individu qui participe avec succès aux activités des marchés financiers, un sujet « entrepreneur de soi » qui se doit d’investir et de calculer les risques afin de survivre. En d’autres termes, l’État a contribué à produire des formes de subjectivation qui naturalisent le pouvoir de classe de la monnaie. Le pendant de cette responsabilisation individuelle du côté des travailleurs est la responsabilité des pouvoirs publics lorsqu’il s’agit du défaut du système financier. En Europe, en dépit d’une certaine (et éphémère ?) reconnaissance du problème du « too big to fail29 » (ces institutions financières trop importantes et interconnectées pour qu’on puisse les laisser faire faillite), c’est l’État, et par son biais les contribuables, qui est venu au secours des banques. Le sauvetage du secteur financier a eu un coût impressionnant — 1,6 milliard d’euros toutes aides confondues ont été promis entre 2008 et 2010, soit plus de 13 % du PIB européen30 — qui a largement pesé sur le budget des États, contribuant au déclenchement de la crise des dettes souveraines dans la zone euro, et par là même aux mesures d’austérité drastiques misent en place depuis 2010 par les pays ayant fait appel à l’aide financière européenne. Ces mécanismes idéologiques et législatifs pérennisent ainsi les privilèges des acteurs du système financier, dont la responsabilité est rarement engagée en cas de difficulté, tout en mystifiant et approfondissant les rapports de classe et d’exploitation qui sous-tendent l’expansion de la dette.

(DR)
Résistances actuelles, luttes à venir
Il est clair que les taux d’intérêt et autres frais exorbitants ponctionnant les revenus des travailleurs et travailleuses doivent être fermement condamnés. Cependant, notre approche critique a un autre point de départ. La mise en place d’un simple plafond des taux d’intérêt ou d’une réforme superficielle de la protection des consommateurs ne sera jamais suffisante. Il nous semble nécessaire d’engager une réflexion plus fondamentale quant à la place de la monnaie dans une société post-capitaliste ; l’enjeu est de repenser le rôle de la monnaie, le pouvoir qu’elle incarne, ainsi que les fonctions qu’elle devrait accomplir dans une telle société. Pour cela, il est nécessaire de procéder à une « inversion » stratégique : de la monnaie en tant que pouvoir de classe qui subordonne la reproduction sociale à l’accumulation du capital, à la monnaie en tant que moyen rationnel à la réalisation des besoins humains, sociaux et écologiques31. Cette question est bien évidemment très complexe, mais deux pistes de réflexion nous paraissent importantes.
Premièrement, il faut mettre en place des mécanismes visant à limiter la capacité de la monnaie d’incarner le pouvoir social absolu, et à faciliter sa concentration et sa centralisation entre les mains d’individus ou de groupes sociaux particuliers. Par exemple, le théoricien monétaire du début du siècle dernier Silvio Gesell proposait la mise en place de formes de monnaie qui soient « périssables », c’est-à-dire qu’elles disparaissaient progressivement lorsqu’elles n’étaient pas mises en circulation. L’objectif étant d’empêcher que la monnaie soit accumulée en tant que pouvoir social par des intérêts privés, plutôt que d’être mise en circulation pour faciliter l’échange de biens et de services. Comme le dit David Harvey32, cela serait assez facile à instaurer, pusique l’immense majorité des monnaies contemporaines est gérée électroniquement. Deuxièmement, une réforme monétaire profonde doit avoir pour objectif d’établir la monnaie et le crédit comme moyens démocratiques de développement de système de production et de consommation écologiquement et socialement soutenable. La gestion sociale, démocratique, et à une échelle adaptée de la monnaie (en fonction de la taille des communautés économiques) peut jouer un rôle essentiel à la mise en place de tels systèmes, en permettant aux peuples de regagner le contrôle du fruit de leur labeur, de leurs ressources naturelles et intellectuelles, ainsi que de leurs finances33. À plus court terme, des mesures et formes de résistance au pouvoir disciplinaire de classe de la monnaie existent déjà. Ces mesures, bien que limitées, ont un rôle tactique crucial à jouer dans le dépassement des rapports sociaux actuels.
« Mettre en place de formes de monnaie qui soient « périssables » : empêcher que la monnaie soit accumulée en tant que pouvoir social par des intérêts privés. »
Au niveau national, on peut identifier trois catégories de lutte. D’une part, celles qui visent à sortir de la logique de l’emploi (compris comme travail subordonné aux injonctions capitalistes), et à rompre le lien entre emploi et salaire (en débat : salaire à vie théorisé par le Réseau Salariat, revenu de base de gauche, etc.). Cela inclut également la lutte contre la marchandisation du secteur public comme l’éducation et la santé et, de façon générale, contre la marchandisation/financiarisation de la reproduction sociale et de la nature ; la promotion de la gestion collective et collaborative des biens communs sur la base de démocratie radicale ainsi que la provision de biens publics à bas prix ou gratuitement. D’autre part, des mesures visent à limiter la fluidité et la liquidité du capital sous forme de monnaie, forme par laquelle il est extrêmement mobile (bien plus que sous sa forme de capital « fixe » en production par exemple) et qui lui permet d’exercer son « chantage » de façon particulièrement efficace. Ces formes de résistances comprennent le rétablissement de contrôles de capitaux stricts, la taxation des transactions financières et la sévère réglementation des activités bancaires, par exemple en (r)établissant une véritable séparation entre banques commerciales et d’investissement, en instaurant l’interdiction de pratiques spéculatives ainsi qu’une fiscalité qui s’attaque sérieusement aux pratiques d’optimisation/évasion fiscale. Enfin, les audits citoyens de la dette publique sont des outils importants ; ils permettent de mettre à nu l’origine des dettes que les peuples sont en train de payer, de révéler l’endettement public comme outil de transfert des ressources publiques vers le secteur financier privé, et sont nécessaires à l’annulation des dette illégales, odieuses et illégitimes.
À un autre niveau, mais tout aussi important, les initiatives collectives qui remettent en cause le pouvoir de la monnaie et de la dette se multiplient. Par exemple, la création de syndicats de débiteurs (« debtors unions ») nous semble être une piste prometteuse : rassembler des populations en situation de vulnérabilité financière (étudiants face à leurs prêts étudiants) et/ou menacées d’expulsion (prêts hypothécaires) permet de rééquilibrer le rapport de force, notamment grâce à la menace de grève collective de paiements (« debt strikes »). Cela permet également de rompre avec les dynamiques de « responsabilisation individuelle » précédemment évoquées. Ces quelques initiatives et formes de résistance ne sont bien sûr pas exclusives, et, nous voulons le souligner, n’ont pas pour objectif final de domestiquer la finance et son « exubérance irrationnelle34 », mais bien d’éroder le pouvoir social de la monnaie et l’emprise du capital sur notre existence. Ce sont donc in fine les rapports sociaux capitalistes d’exploitation et de domination, eux-mêmes arbitrés et sanctionnés par la monnaie, qui sont visés au travers de ces formes de lutte et de résistance dans les domaines financiers et monétaires.
NOTES
1. Pour une récente revue de littérature, voir le dernier ouvrage de Nigel Dodd, The Social Life of Money, Princeton University Press. Pour une récente collection d’essai sur les théories françaises de la monnaie, voir Alary et al., (2016), Théories françaises de la monnaie, PUF.
2. Bonefeld, W., Holloway, J., (1996), Global Capital, National State and the Politics of Money ; Soederberg, S., (2014), Debtfare States and the Poverty Industry : Money, Discipline and the Surplus Population, Routledge.
3. de Brunhoff, S. (2015), Marx on Money, Verso ; Lapavitsas, C., (2003), Social Foundations of Markets, Money and Credit, London : Routledge.
4. Marx, K., (1991 [1981]), Capital : A Critique of Political Economy, Vol. I, trans. Ben Fowkes, London : Penguin Classics.
5. Marx, K, (1973 [1857]), Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy, trans. M. Nicolaus, New York : Penguin Books, p.157.
6. Negri, T. (1991), Marx beyond Marx, Pluto Press.
7. Lapavistas, C., (2003). Opt cit.
8. Clarke, S. (2003), “The rationality and irrationality of money”, In Value and the World Economy Today, Palgrave Macmillan UK
9. Harvey, D., (1989), The Condition of Postmodernity : An inquiry into the origins of cultural change, Blackwell ; Soederberg, 2014, Opt cit.
10. Bonefeld, W., Holloway, J., (1996). Opt cit.
11. Bonefeld, W., Holloway, J., (1996). Opt cit.
12. Dos Santos, P. L., (2009), “On the Content of Banking in Contemporary Capitalism”, Historical Materialism 17, p. 182.
13. McNally, D., (2009), “From Financial Crisis to World-Slump : Accumulation, Financialisation, and the Global Slowdown”, Historical Materialism 17, p.60.
14. Aitken, R., (2015), Fringe finance : Crossing and contesting the borders of global capital. Routledge.
15. OCDE (2016), Dette des ménages (indicateur). doi : 10.1787/3154019b-fr (Consulté le 12 juin 2016).
16. Erturk, I., Froud, J., Sukhdev, J., Leaver, A. and Williams, K. (2007), “The democratization of finance ? Promises, Outcomes, Conditions”, Review of International Political Economy 14/4, pp. 553–576.
17. Bateman, M., & Chang, H. J. (2012), “Microfinance and the illusion of development : From hubris to nemesis in thirty years” World Economic Review, (1).
18. Cette analyse est aussi valide au niveau des États, notamment depuis la crise des dettes souveraines qui a éclaté dans la zone Euro en 2010. Les pays s’étant retrouvés en difficulté financière (pays que l’on a affublés de l’acronyme péjoratif ‘PIGS’ (Portugal, Irlande, Grèce, Espagne)) se sont vus accusés d’une mauvaise gestion budgétaire ainsi que d’une propension à l’emprunt exagérée et injustifiée, et ce alors même que les augmentations de leur ratio dette/PIB étaient en partie dues aux dépenses liées au sauvetage du système bancaire et aux « stimulus de relance économique » répondant eux aussi à la crise financière et à ses conséquences économiques…
19. Mader, P., (2015), The Political Economy of Microfinance : Financialising Poverty, Palgrave ; Roy, A. (2010). Poverty capital : Microfinance and the making of development. Routledge ; Taylor, M. (2012), “The antinomies of ‘financial inclusion’: debt, distress and the workings of Indian microfinance”, Journal of Agrarian Change, 12(4), 601–610.
20. Soederberg, 2014. Opt cit.
21. Voir aussi la campagne menée par PositiveMoney en Grande Bretagne et Monnaie Honnête en France.
22. Dos Santos, 2009, Opt cit., p. 193
23. Krippner, G., (2005), “The financialization of the American economy”, Socio-Economic Review 3(2): 173–208. Krippner, G., (2011), Capitalizing on Crisis : The Political Origins of the Rise of Finance, Cambridge, MA : Harvard University Press.
24. À ce sujet, il est intéressant de noter que la titrisation, dans une forme qui se veut ‘Simple, Transparente et Standardisée’, est depuis quelques années réhabilitée par l’Union Européenne en tant que pratique utile à l’économie dans son ensemble. Alors que le Parlement européen discute en ce moment-même deux projets de loi relatifs à la relance du marché de la titrisation, des chercheurs en économie, finance, politique et géographie issus de diverses universités européennes ont mis en garde contre les risques liés à un tel projet. Leur « lettre ouverte » (en anglais) : http://www.fb03.uni-frankfurt.de/61991286/open-letter-to-meps-sts-securitisation.pdf
25. Nesvetailova, A., (2005), “United in Debt : Towards a Global Crisis of Debt-Driven Finance?”, Science & Society, 69(3), p. 403
26. Hay, C., (2010), “Pathology Without Crisis ? The Strange Demise of the Anglo-Liberal Growth Model”, The 2010 Leonard Schapiro Lecture. Available at : http://www.princeton.edu/europe/events_archive/repository/Colin-Hay-Schapiro-Lecture-2010-Crisis-Final.pdf
27. Crouch, C., (2009), “Privatised Keynesianism : An Unacknowledged Policy Regime”, The British Journal of Politics and International Relations 11(3), pp.382–99.
28. Hembruff, Jesse & Susanne Soederberg (2015) “Debtfarism and the Violence of Financial Inclusion : The Case of the Payday Lending Industry,” Forum for Social Economics Special Issue.
29. Voir Finance Watch, note sur le problème du « too big to fail » en Europe : http://www.finance-watch.org/notre-travail/publications/913-tbtf-note-fw-fr?lang=fr
30. Voir le « Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l’UE présidé par Erkki Liikanen », Bruxelles, 2 octobre 2012, p. 3. Disponible (en anglais) : http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_fr.pdf
31. Clarke, S. (2003), opt cit.
32. Harvey, D. (2014), Seventeen contradictions and the end of capitalism, Oxford University Press (UK).
33. Itoh, M., & Lapavitsas, C. (1998), Political Economy of Money and Finance. Springer ; Hutchinson, F., Mellor, M., & Olsen, W. K. (2002). The politics of money : towards sustainability and economic democracy. Pluto Press.
34. Selon la fameuse expression d’Alan Greenspan, l’ancien président de la Reserve Fédérale états-unienne.
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Cédric Durand : « Les peuples, contre les bureaucrates et l’ordre européen », juillet 2015
☰ Lire notre entretien avec Yanis Varoufakis : « Que voulons-nous faire de l’Europe ? », août 2015
☰ Lire notre entretien avec Bernard Friot : « Nous n’avons besoin ni d’employeurs, ni d’actionnaires pour produire », septembre 2015
☰ Lire notre entretien avec David Graeber : « Nos institutions sont antidémocratiques », décembre 2015


