Entretien inédit pour Ballast
« On connaît le visage de vos attentats et de vos démolitions, de vos moqueries et humiliations. Comment vous entamez ce qu’on essaie de construire… », lançait Martine Delvaux à la fin de son livre Le Boys Club, paru en 2019. Essayiste et romancière québécoise, elle interroge les trop présents, les grandes absentes. Deux ouvrages ont particulièrement retenu notre attention dans le cadre de cette discussion : Le Monde est à toi et Pompières et pyromanes. Tous deux sont adressés à son adolescente, elle qui a « le féminisme pour langue maternelle« . Le premier a été écrit après l’élection de Trump, le second publié durant la pandémie. Comment élever une fille dans le monde qu’on sait — inégalitaire et brutal ? Il est alors question de transmission, d’échanges entre générations, d’idées ou de valeurs à interroger. Le combat écologiste, qui politise la jeunesse dans des proportions significatives, traverse particulièrement son dernier texte — et c‘est depuis l’image du feu que Martine Delvaux s’en empare.

Question difficile. Comment faire commencer un livre ? C’est mystérieux. L’image des chevaux est peut-être une des plus anciennes, en ce qui concerne ce projet : elle se retrouve ici et là dans le livre mais, dans mon imaginaire, l’image des chevaux dévalant une colline pour échapper à un feu, en Californie, est une des premières que j’ai convoquées. Fouillant les grands feux, lisant sur ces incendies qui dévastent entre autres la Californie, je me suis retrouvée à visionner cette vidéo où on voit la jument qui fonce pour sauver des chevaux familiers. Sans doute parce qu’il s’agit ici d’instinct, parce qu’il est question d’animaux, parce que tout est là — la maternité, le genre, mais aussi la famille — et parce qu’il y a quelque chose de pur chez les non-humains, hors conscience, hors langage, de profondément émotif, j’ai choisi cette image. Et puis les chevaux sont pour moi des êtres mystérieux — justement. Très impressionnants. Comme le feu.
Comme dans Le Monde est à toi, vous faites un collage poétique : esquisses d’idées, de souvenirs personnels, de références au cinéma, de mythes, de faits historiques ou scientifiques… Vos réflexions apparaissent donc en mouvement.
Pour tous mes livres, je procède en effet par accumulation d’images, de faits divers, d’informations, de citations, comme si je devais me construire, m’échafauder un imaginaire avant d’écrire. En même temps, la grande question pour moi c’était : comment faire pour écrire sur la crise climatique ? comment ne pas verser dans un désespoir complet ? comment faire dialoguer espoir et désespoir ? comment quitter l’univers des discours d’experts et permettre à la littérature de participer à cette prise de conscience (sans pour autant verser dans la science-fiction) ? D’où cette collection de tableaux et le montage que j’ai opéré. De fait : il n’y a pas de « fin » du monde. Un peu comme si, inconsciemment, j’avais voulu sublimer ou outrepasser la fin qui est annoncée, à l’image de cette phrase : « Souvent je me demande de quelle couleur sera la fin du monde. » Ce qui est le signe qu’il s’agit d’une fausse fin, qu’il n’y aura pas de fin puisqu’il y aura encore de la couleur… En ce sens, je m’inscris, je crois, dans la foulée de Timothy Morton et d’autres, qui refusent le désespoir sans pour autant opter, bien entendu, pour le déni. Regarder les choses en face mais ne rien céder à la beauté et à l’amour.
Vous déployez l’imaginaire du feu : réel, mythologique, symbolique. Il est à la fois destruction et lumière. De quelle façon est advenu, sous votre plume, ce lien structurant ?
« Au départ de ce livre, il y a cette insulte qui a été publiée à mon sujet, où un homme me décrivait comme une
pompière pyromane, parce que féministe. »
Au départ de ce livre il y a une insulte qui a été publiée à mon sujet : un homme me décrivait comme une « pompière pyromane« , parce que féministe. Un peu à la manière dont Emmanuel Todd accusait, récemment, les féministes d’être des pompiers pyromanes (au masculin, ici) : allumant des feux (créant ou provoquant de faux problèmes) pour ensuite pouvoir les éteindre. Cette expression, je l’avais en tête comme une invitation ou une provocation — sur le coup, je ne l’ai pas reçue comme une insulte. Quand j’ai eu envie d’écrire sur la crise climatique, dans cette suite au Monde est à toi, c’est l’image de la pompière pyromane qui m’est revenue, et avec elle celle du feu. On parle de réchauffement climatique, on évoque sans cesse le feu sans nécessairement le nommer. Moi je voulais y aller directement : creuser l’image du feu, étudier les grands feux, redonner le feu aux femmes, penser le pouvoir des femmes comme pompières et pyromanes.
On peut se dire, aussi, que le féminisme — l’égalité pour toutes et tous — peut tout brûler. Puis tout reconstruire.
Oui, le féminisme « de bas », pourrait-on dire, et qui aujourd’hui est décrit comme « intersectionnel », c’est-à-dire capable de prendre en compte les croisements des oppressions (et des privilèges, d’ailleurs) pour lire les atteintes systémiques à la liberté.
Une autre image de votre livre oppose le feu qui défriche en vue de l’expansion urbaine et celui, maîtrisé, des nations autochtones — « ces feux contrôlés sont la marque d’un savoir-vivre avec le feu plutôt que l’entretien d’un conflit ». Elle revient souvent, cette idée de maîtriser le feu, d’apprendre à vivre avec…
L’ouvrage de Joëlle Zask sur les grands feux, que je cite à plusieurs reprises, ainsi que nombre de documents, témoignages, films, mettent en exergue l’arrogance blanche, coloniale, capitaliste, qui fait fi du savoir des populations autochtones. Nous gérons les feux comme si on n’y connaissait quelque chose alors que des communautés entières savent, depuis très longtemps, comment s’occuper des forêts, comment effectuer des brûlis stratégiques de manière à éviter les grands feux dévastateurs. C’est ce savoir qu’il faut prendre en compte, absolument. Il faut se tourner vers les populations autochtones qui se sont transmis ce savoir, de génération en génération, et les écouter. Les suivre. Leur permettre de guider. Ce qui signifie d’être anticolonial, décolonial dans notre manière de faire avec la crise climatique. De s’engager à ne pas reproduire les erreurs responsables de l’état actuel du monde. Mais nous sommes encore bien loin de ça… L’arrogance blanche semble sans limites.

[Oh Mu]
Vous rappelez combien l’angoisse écologique dont hérite les plus jeunes, dans les pays du Nord, est aussi « l’aveu d’une peur blanche de perdre un certain mode de vie ».
Je crois qu’il faut reconnaître cette iniquité entre le Nord et le Sud — pour le dire ainsi. Comment les populations les plus privilégiées, celles qui n’ont pas connu de grandes difficultés (sans oublier pour autant les souffrances, la pauvreté, les violences dont sont victimes une portion importante des populations du Nord, principalement non-blanches), qui jouissent d’un confort, d’une sécurité, qui profitent du capitalisme, doivent être capables de sortir un peu d’elles-mêmes et de leur peur (une peur de perdre quoi, au juste ?) pour, d’une part, considérer le rôle qu’elles jouent dans la crise climatique, le privilège qui est le leur et qui participe de cette crise, et comment il va falloir dépasser l’anxiété et véritablement agir. Si je suis parfaitement sensible à cette anxiété, je m’interroge sur la paralysie dont elle se double. Une sorte de catatonie, qui est peut-être la reconnaissance, détournée, d’une incapacité d’agir parce qu’on a toujours tout eu. Que ce qui nous attend est doublement inquiétant parce qu’on a l’impression de ne pas avoir les moyens de nous battre. Comme si nous étions des enfants surprotégés qui, désormais, vont devoir prendre le risque de l’action.
Ce risque, qu’est-ce que c’est ? Apprendre à renoncer au « confort » ?
Oui, absolument. Et comment renoncer collectivement ? Comment choisir le renoncement d’emblée, ensemble ? C’est ce à quoi résiste et ce dont semblent incapables les gouvernements occidentaux, en tout cas nord-américains. Toujours consommer plus : voilà la ligne directrice, au détriment de la vie sur cette planète. La pandémie récente a été un révélateur, montrant comment les animaux et la nature reprennent leurs droits quand les humain·es se retirent un peu, quand la machine ralentit, qu’on vit tous et toutes un peu plus humblement.
En Australie, des oiseaux pyromanes seraient en partie responsables d’incendies de forêt, qu’ils propageraient pour faire sortir leurs proies. Des hommes ont également été jugés responsables du départ de mégafeux — des pompiers, des personnes en détresses sociales. Comme les chevaux, ces images mises ensemble contribuent à la mythologie de notre époque…
« Si je suis parfaitement sensible à cette anxiété, je m’interroge sur la paralysie dont elle se double. Une sorte de catatonie. »
Oui, ça fait partie pour moi d’un portrait de la souffrance, comme une sorte de rayon X. Qui sait que ces hommes pompiers pyromanes peuvent, dans certains cas, agir parce qu’ils sont eux-mêmes profondément blessés, victimes d’abus aux mains d’autres hommes qui les ont violentés ? Comme si sous un feu s’en cachait un autre, intime, secret. Et pour commencer à saisir la cause du réchauffement climatique, est-ce qu’il ne faut pas essayer de faire les liens entre différentes souffrances ? L’intersectionnalité — nécessaire à une compréhension systémique des dominations dans notre monde et qui sont responsables, d’une manière ou d’une autre, de la crise climatique — a à voir avec la capacité à regarder en face tout un réseau de blessures, parfois inimaginées.
En vous adressant à votre fille, vous vous tournez vers la jeunesse militante, mais jamais en surplomb. Vous reliez les générations. Pourquoi est-ce important pour vous ?
J’ai choisi mon camp ! Je suis avec elles et eux, à côté, dans la rue : jamais au-dessus. L’enjeu, il me semble, c’est d’être de son temps : si on refuse d’avancer avec les jeunes militant·es, on rate le train et on reste sur le quai. En même temps, ça veut dire qu’on les abandonne — et alors, quelle hypocrisie. Quelle chose indigne que d’avoir mis ces enfants au monde, de leur léguer un monde en péril où leur vie à elles et eux sera de plus en plus difficile (et ça continuera une fois que nous serons disparu·es), et de s’en laver les mains ! Je refuse cette position-là. J’ai décidé d’être de mon temps, dans mon temps, d’être leur contemporaine, pas leur aînée. Je suis le chemin qu’ils et elles tracent.
Élever une fille « en feu », serait-ce du féminisme « de terrain » ?
Oui, peut-être… Je ne m’en rends pas compte, mais c’est sans doute le cas. Ce qui est mystérieux, c’est comment ça se passe. Je ne sais pas si j’ai « élevé » une fille en feu. Je crois qu’on a grandi ensemble, elle et moi, et qu’elle a fait de moi une mère en feu peut-être plus encore que l’inverse.
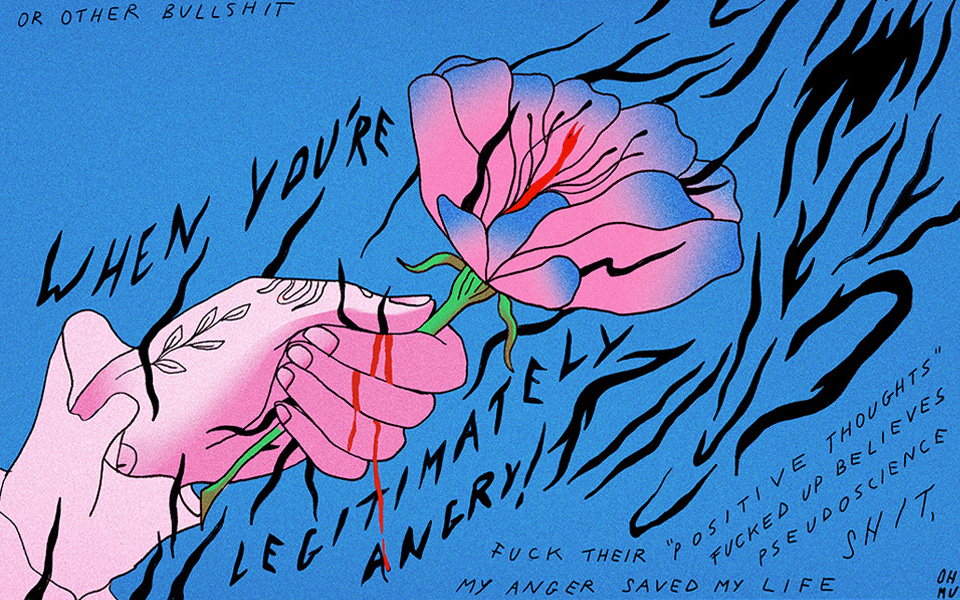
[Oh Mu]
La colère se musclerait avec la parentalité ?
Peut-être que la colère épouse l’amour. Que l’intensité des affects qui, dans mon cas, est arrivée avec l’accueil de l’enfant, laisse une place à la colère, à l’indignation, au désir de lutter. Je ne dirais pas qu’il s’agit de « se battre pour son enfant » — je n’aime pas quand on dit « Imaginez que ce soit votre fille, votre fils ! » pour convaincre de l’importance de lutter pour une cause, par exemple. Comme s’il fallait en passer par la mise au monde ou la venue dans nos vies à nous d’un·e petit·e humain·e pour sentir le besoin de s’engager. Il me semble qu’en tant qu’humain·e, nous sommes capables d’empathie, d’identification, que nous sommes capables de nous mettre à la place des autres d’une manière au moins minimale et suffisante pour sentir la nécessité de s’engager. Mais est-ce que la parentalité ouvre les vannes ? Est-ce qu’elle est un terrain privilégié pour la colère et l’engagement militant ? Peut-être.
Parler de maternité et d’adolescence, c’est évoquer un sujet doublement dénigré dans des espaces politiques où la mère est volontiers perçue comme un personnage à la fois aliéné et inexistant. L’adolescente est, dans la société, moquée ou fantasmée — elle n’existe pas. Pensiez-vous vous attaquer à un angle mort des transmissions féministes ?
Je n’aurais pas affirmé que c’est un angle mort parce que nombre de féministes se sont intéressées à la maternité de toutes sortes de façons. Mais c’est vrai que je voulais défendre les adolescentes et que je voulais lier maternité et militantisme, maternité et féminisme. Qu’on décide ou non d’accueillir un enfant (fabriqué ou adopté), c’est dans tous les cas un geste politique. On peut décider de faire un enfant pour contrer l’injonction à ne pas en faire, le pouvoir que peuvent vouloir exercer des gouvernements sur la natalité et donc sur le « donner la vie ». On peut décider de ne pas en faire pour les mêmes raisons, ou en tant que geste de grève tant et aussi longtemps que des décisions véritables pour contrer le réchauffement climatique n’auront pas été prises. Mais, toujours, je crois qu’il faut reconnaître ce pouvoir des femmes et redonner le temps aux femmes. Refuser cette expulsion des adolescentes hors de l’Histoire — toujours trop jeunes ou toujours déjà vieilles. Et de même pour les femmes — toujours trop vieilles et jamais suffisamment jeunes.
Ce lien entre mère « en lutte » et fille adolescente est tout de même très peu présent dans la littérature féministe.
« Quand je me trouve devant des adolescentes et des jeunes femmes — et plus généralement devant des jeunes personnes —, je me sens à ma place en tant que féministe. »
Ah oui, là-dessus je suis d’accord ! On continue à opposer mères et filles. C’est une opposition légendaire, que Freud a bien participé à enfoncer. On oublie ce lien important entre mère et adolescente, entre féministe et adolescente. Quand je me trouve devant des adolescentes et des jeunes femmes — et plus généralement devant des jeunes personnes —, je me sens à ma place en tant que féministe. Comme si j’avais enfin trouvé mes interlocutrices les plus importantes.
« Être une mère féministe, c’est aimer entièrement la vie des filles, et travailler contre leur effacement, cet effacement des femmes qui s’opère, de mille et une façons, à l’adolescence », dites-vous. Quel est cet effacement ?
Comment on apprend très tôt aux petites filles, encore aujourd’hui, à ne pas prendre de place. Comment les livres de littérature jeunesse qui sont donnés à lire ne présentent aucune héroïne et sont signés de noms d’homme. De tout son parcours scolaire — école primaire et secondaire —, ma fille n’a lu aucun roman écrit par une femme, ni aucun roman où les héros n’étaient pas masculins. Comment on cherche à contrôler, du moins dans les écoles secondaires, la manière dont les adolescentes s’habillent — on impose un code vestimentaire sous prétexte que les « formes » féminines dérangent les garçons. Alors que ces « formes » dérangent les adultes : entre jeunes, ça ne pose pas de problème. Ceci pour soi-disant contrer l’hypersexualisation des filles, à laquelle ces dernières participeraient, alors que, pendant qu’on impose ces codes vestimentaires, on continue à consommer sans sourciller des produits dont les « corps d’affiche » sur les publicités — parfum, maquillage, vêtements, etc. — sont ceux de filles de 12, 13, 14 ans…
N’y a-t-il pas eu, au Québec, des mouvements lycéens et étudiants luttant collectivement contre cet état de fait ?
Tout à fait. Différents mouvements dans des écoles privées et publiques qui se sont opposés aux divers codes vestimentaires. Les adolescent·es sont bien plus éduqué·es, informé·es et sophistiqué·es, politiquement, que ce qu’on leur concède.

[Oh Mu]
Une autre image du feu dans vos pages : la jeune poétesse Huguette Gaulin en 1972, qui aurait eu pour derniers mots « Vous avez détruit la beauté du monde » avant de s’immoler. C’est une image qui se consume aussi vite que l’esprit en rejette la violence. On retient le feu et non les raisons du désespoir : s’immoler par le feu pour révéler la violence des conditions de travail, s’immoler pour dénoncer la précarité étudiante… Celles et ceux qui font ce choix semblent dialoguer entre eux. En France, on connaît peu Huguette Gaulin.
Elle était une jeune écrivaine. Son seul recueil est paru de manière posthume. Elle était écologiste — j’ai envie d’écrire « avant la lettre » mais ce n’est pas le cas puisque les premières manifestations écologistes datent de 1970. Elle est morte cinquante-six heures après s’être imbibée d’essence et avoir mis le feu à ses vêtements. Elle avait un petit garçon de 7 ans — toujours vivant aujourd’hui. Si, après son décès, son éditeur François Hébert (décédé récemment) disait qu’elle souffrait d’une « difficulté d’être », son geste avait été posé avec sang-froid, par empathie et « conscience des problèmes du Québec et du Tiers-monde » (comme il l’écrivait dans la presse au lendemain de la disparition de la poétesse). 1972 : c’est après la crise d’Octobre, au Québec, moment politique important où les Québécois·es ont traversé une crise politique, exprimant leur désir d’être reconnu·es par le Canada comme une population distincte. Certaines portions de la population ont ainsi exprimé le désir que la province se sépare officiellement du Canada pour former un pays — ce qui ne s’est jamais fait. C’est aussi, comme ailleurs dans le monde, un moment important en ce qui concerne les luttes pour les droits civiques, la révolution sexuelle, la révolution féministe… Le geste d’Huguette Gaulin s’inscrit dans ce contexte. Mais c’est vrai que l’immolation est une image qui se consume en même temps qu’on rejette la violence parce qu’elle est impossible à regarder en face. Il y a le cas de cet avocat américain [David Buckel, ndlr] qui s’était consacré à la lutte pour les droits LGBTQ+ puis s’était immolé dans un parc de Brooklyn, en 2018, pour conscientiser la population au réchauffement climatique. Est-ce que ces gestes ont un impact ou est-ce qu’ils sont avalés par la mythologie ? Est-ce qu’ils sont ramenés à une santé psychique précaire, dans tous les cas, que ce soit d’ailleurs vrai ou faux ? C’est pour cette raison que j’ai voulu à mon tour leur rendre hommage. J’étais hantée par ces personnes et le geste posé.
Vous évoquez la souffrance psychique des plus jeunes, liée à la pandémie et à l’écoanxiété des pays du Nord. On a également vu, pendant le confinement français, un grand nombre d’étudiants et d’étudiantes faire la queue pour recevoir de l’aide alimentaire. Comment le Québec prend-il en charge cette question ?
La précarité étudiante et la hausse des frais de scolarité par le gouvernement du Québec en 2012 a provoqué ce qu’on appelle le Printemps érable : plusieurs mois de manifestations étudiantes et sociales, au cours desquels des milliers et des milliers de Québécois·es ont manifesté dans la rue et sur différentes plateformes, pour faire reculer le gouvernement libéral de l’époque quant à sa décision de hausser les frais de scolarités à l’université. Ce qui a été allumé par les associations étudiantes s’est retrouvé porté par nombre de syndicats et par la population en général, donnant lieu à une grande variété de manifestations quotidiennes, pendant des mois. Ce mouvement a provoqué en même temps une remontée des mouvements militants dans l’espace public québécois. Comme féministe, professeure d’études féministes et écrivaine, le Printemps érable a eu un impact immense sur mon travail. C’est en étant dans la rue avec les étudiantes, en étant témoin de leurs manifestations, des tactiques utilisées, que mon travail sur « les filles en série » s’est précisé pour finir par se matérialiser en un essai, en 2012 : Serial girls — Des barbies aux Pussy Riot et Beyoncé.
Fatima Ouassak, cofondatrice du syndicat Front de mères et de la Maison de l’écologie populaire Verdragon, a elle aussi relié parentalité, féminisme et écologie politique. Elle entend faire de la mère un « sujet révolutionnaire », héritière des luttes sociales des quartiers populaires. Non par essentialisme mais au nom d’une expérience de premier plan des enjeux de classe qui réduisent l’avenir et la dignité de certains enfants. Vous qui ne manquez pas de préciser que vous ne faites pas de l’expérience maternelle une identité centrale, ça vous parle quand même ?
« Ce qui a été allumé par les associations étudiantes s’est retrouvé porté par nombre de syndicats et par la population en général, donnant lieu à une grande variété de manifestations quotidiennes. »
Absolument ! Je continue à réfléchir à la maternité, à cet amour absolu pour des enfants, des personnes plus jeunes dont on prend soin comme un lieu éminemment politique et militant. Je suis féministe mais je ne crois pas en la « féminité ». Je suis mère mais je ne crois pas en la « maternité ». Je crois qu’on pose des gestes, qu’on fait des choses, qu’on aime, qu’on prend soin… mais que tout ça est modulable, modifiable, circonstanciel, parfois temporaire. Jamais fixe. Nous sommes constuit·es et nous nous construisons.
Simone de Beauvoir dit dans le deuxième tome du Deuxième sexe qu’une bonne mère est une mère aidée, qui travaille et n’a pas le temps d’être « fascinée par sa propre personne1 ». L’organisation d’une vie indépendante devrait donc nécessairement s’accompagner d’une éducation collective…
C’est Toni Morrison qui, aussi, rappelle combien c’est important. Qu’il ne s’agit pas de pleurer les grossesses adolescentes, de les penser comme la fin de la vie de la jeune mère, mais comme faisant partie de la vie — si c’est bien ce que la jeune femme souhaite — dans la mesure où la communauté, la collectivité aide cette jeune femme à avancer avec l’enfant qu’elle désire, participe de cette organisation de la vie où tout le monde a sa place, l’enfant autant que la jeune mère et ce qu’elle-même souhaite faire de sa propre vie. Ne pas être fascinée par soi en tant que mère : cette règle me paraît essentielle pour ne pas se faire piéger par la re-domestication qui s’opère en ce moment : sorte de retour des femmes à la maison à coups de décors sur Pinterest et de recettes sur Instagram. Comme s’il fallait faire la preuve de notre « bonne » maternité. Et c’est ainsi qu’on se retrouve à faire marche arrière, « back to the future » qui abat les femmes en les enfermant dans un retour aux années 1950.

[Oh Mu]
Dans la longue histoire du camp de l’émancipation, assez peu de figures, finalement, ont intégré dans leur boîte à outils les questions de famille, de faire communauté, de transmissions familiales. Les Black Panthers, bell hooks…
C’est vrai que la famille est souvent exclue de l’imaginaire militant. Pourtant, qu’il s’agisse de sororité, de communauté, de collectivité révolutionnaire, il est toujours question d’un imaginaire de la famille — choisie, inventée. Je suis une fille de la génération X2. Je suis devenue adolescente au moment où le VIH/Sida apparaissait. J’ai vite compris l’importance des familles choisies et militantes, activistes. Peut-être qu’une partie de ce qui m’a influencée vient de là. J’ai non seulement été témoin de ces familles mais j’ai étudié la littérature du Sida et les représentations entourant le virus et les personnes qui en étaient atteintes. Ça m’a marquée, profondément. Ensuite, tout l’héritage féministe des années 1970, les mouvements gays et lesbiens (comme on disait à l’époque), les groupes de prises de conscience… Tout ça, pour moi, participe d’un imaginaire « familial », « filial ».
C’est encore le cas aujourd’hui : les revendications LGBTQ et antiracistes, qu’on soit impliqués directement ou pas, sont une porte d’entrée de politisation de la jeunesse, au moins urbaine.
« Comment pourrait-on être féministe sans chercher à s’en prendre aux structures ? »
Oui, tout à fait. Cette jeunesse est non seulement diversifiée mais aiguisée en ce qui concerne la pensée entourant les inégalités. Les enjeux féministes sont ainsi indémaillables du reste : il n’est pas question de sacrifier la lutte antiraciste ou la lutte trans, par exemple, au profit d’un féminisme blanc, néolibéral, abolitionniste ou privilégié — qui, dans tous les cas, évolue à l’intérieur d’ornières qui lui permettent de faire abstraction de souffrances autres que sexistes à l’intérieur d’un régime bien binaire.
Revenons au feu. « Les suffragettes n’ont blessé ni tué personne [...] et les sorcières n’existent pas. Ce sont des femmes qu’on a mises sur le bûcher. » On ne peut parler du feu, de transmission, sans revenir à l’archétype de la sorcière. Pourquoi ce symbole est-il encore opérant, poétiquement et politiquement ?
Les sorcières doivent être démystifiées, vues pour ce qu’elles étaient : des femmes fortes d’une parole, d’un savoir, d’une autonomie, de liens entre elles et d’un pouvoir certain, puisque c’est pour cette raison qu’elles ont été assassinées. On parle d’un féminicide, ici, historique. Et qui avait pour but d’éliminer des proto-syndicalistes, des proto-gauchistes, des proto-féministes. En somme, des révolutionnaires. Il faut lire Silvia Federici pour prendre la mesure de cette mise à mort. Malgré la violence que représente la mise au bûcher — est-ce qu’on mesure vraiment ce que ça signifie ? —, les sorcières sont devenues des sortes de fées. Elles ont été sexualisées, iconisées au détriment d’une réelle prise de conscience par rapport au mal qui leur a été fait et dont on continue à payer le prix. La misogynie s’installait, et la voilà bien installée. Nous sommes donc bien les filles des sorcières, leurs filles appauvries, mal payées, déconsidérées, insultées, mises sous silence, battues, violées, assassinées… Et puis le feu reste l’image du pouvoir masculin, voire d’une pénétration masculine forcée, d’une agression sexuelle contre les femmes. Pourquoi mettre les femmes sur le bûcher, les envelopper de feu — ce symbole éminemment masculin — sinon pour les tuer par l’entremise d’un pouvoir sexuel ? En écrivant Pompières et pyromanes, je voulais redonner le feu aux femmes, les éloigner du bûcher et essayer de penser ce que peuvent des femmes en feu. Ce que ça peut vouloir dire pour des femmes de se transmettre le feu de mère en fille, et de tout faire pour échapper aux flammes qui « lèchent » le corps, qui l’avalent pour l’annihiler.
On avait envie, pour finir cette discussion, de citer l’ouverture du livre de la psychanalyste Anne Dufourmantelle. « Toute mère est sauvage. Sauvage en ce qu’elle appartient à une mémoire plus ancienne qu’elle, à un corps plus originel que son propre corps, boue, sable, eau, matière, liquide, sang, humeurs, à un corps de mort, de pourriture et de guerre, à un corps de vierge céleste aussi3… » Une des compagnes de votre traversée, non ?
Sans aucun doute. Et ce que je garde d’elle, hormis ses livres lumineux et ses propos essentiels entre autres sur les femmes, c’est l’immense empathie et l’immense bonté qui lui sont associées. Au prix de sa vie, comme on le sait4. Cette leçon-là, c’est la plus importante, il me semble, du féminisme. Comment pourrait-on être féministe sans chercher à s’en prendre aux structures ?
Illustration de bannière : Oh Mu
Photographie de vignette : François Roy | La Presse
- « C’est la femme qui travaille — paysanne, chimiste ou écrivain — qui a la grossesse la plus facile du fait qu’elle ne se fascine pas sur sa propre personne ; c’est la femme qui a la vie personnelle la plus riche qui donnera le plus à l’enfant et qui lui demandera le moins, c’est celle qui acquiert dans l’effort, dans la lutte, la connaissance des vraies valeurs humaines qui sera la meilleure éducatrice. » Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe, tome 2, Gallimard, 1976.[↩]
- Occidentaux nés entre les années 1960 et 1980. « Plusieurs choses caractérisent cette génération. D’abord, elle se situe dans un moment de déclin social, mais aussi de mondialisation de l’économie et de déclin de l’impérialisme colonial. »[↩]
- Anne Dufourmantelle, La Sauvagerie maternelle, Calmann-Lévy, 2001.[↩]
- En 2017, portant secours au fils d’un ami en train de se noyer, elle fit un arrêt cardiaque.[↩]
REBONDS
☰ Lire l’article « Mères », Fatima Ouassak, mai 2022
☰ Lire notre abécédaire de bell hooks, novembre 2021
☰ Lire notre entretien avec Amandine Gay : « Nous, né·es sous le secret », juillet 2021
☰ Lire notre entretien avec Aurore Koechlin : « Aucune révolution féministe sans renversement des classes », février 2021
☰ Lire notre entretien avec Aminata Traoré : « Le capitalisme détruit les sociétés, les économies locales et les écosystèmes », juin 2020
☰ Lire notre entretien avec les CUTE : « Étudier, c’est travailler », juillet 2019


