Depuis les grèves sauvages dans l’Italie des « années de plomb » jusqu’aux ZAD d’aujourd’hui, la mouvance autonome est souvent réduite aux actions sans lendemain de collectifs groupusculaires. Or c’est au sein d’usines qu’est née l’Autonomia italienne ; c’est contre la métropole que se sont regroupés les Autonomen allemands ; c’est pour mettre en échec l’extension de cette dernière à l’ensemble de la vie contemporaine que d’aucuns luttent et habitent dans un seul et même élan. Plus qu’un ensemble de pratiques, l’autonomie politique serait, pour ses partisans, une hypothèse théorique à réinvestir afin de nourrir à nouveaux frais les luttes en cours : en dressant la généalogie de ces mouvements et en discutant de leurs limites, le chercheur Julien Allavena livre avec L’Hypothèse autonome, tout juste paru aux éditions Amsterdam, une synthèse bienvenue. « Est-il réellement possible de provoquer un changement révolutionnaire en espérant radicaliser des mouvements sociaux ? » Nous en publions un extrait1.
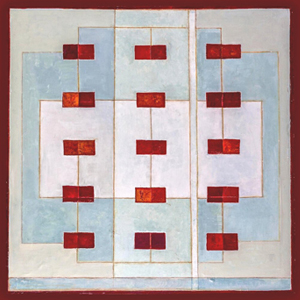
« Ce ne sont plus les luttes revendicatives qui sont à l’initiative des transformations sociales, mais les restructurations initiées au profit du capital. »
On ne saurait cependant prendre ce clin d’œil isolé comme le signe d’une quelconque équivalence ; tout au plus pouvait-il s’agir de l’un de ces « rendez-vous tacite[s] entre les générations passées et la nôtre » dont parle Walter Benjamin — rendez-vous en l’occurrence manqué. Car si les sorcières sont de retour avec le witch bloc, si le Collectif de libération et d’autonomie queer ou encore le Front monstrueux insurrectionnel rappellent les grandes heures de la dissidence homosexuelle, si lundimatin comme ACTA et d’autres sites peuvent prétendre s’être emparé du numérique pour reconduire l’expérience d’Alice ou de Rosso, si bien sûr le black bloc « [démystifie] les symboles de la manifestation et du cortège bien ordonnés » comme ces « vandales » apparus en 1969, peu d’autoréductions de masse4 ont en revanche vu le jour, et aucune occupation n’a survécu aux assauts policiers. Surtout, le « parti de PSA Montbéliard » se fait toujours attendre pour donner une force de frappe plus conséquente à cet ensemble, en mettant minimalement en crise les rapports productifs comme le « parti de Mirafiori5 » l’a jadis fait des années durant.
De défaites en défenses
Ce que manifeste la séquence de l’autonomie française évoquée, notamment sur sa fin, c’est précisément un décalage croissant entre certaines conditions de possibilité de l’expérience de l’autonomie, notamment dans son rapport au travail, et la réalité des mouvements sociaux, mobilisations ouvrières comprises, qui sont apparues depuis. Les puissantes luttes ouvrières de Longwy et Denain officient en effet comme une sorte de point de départ symbolique d’un nouveau cycle de lutte, à l’échelle des pays nord-atlantiques, caractérisé par la défense des emplois industriels et des acquis sociaux, dans un contexte de gouvernement par la crise économique, de nouvelle révolution technologique et de politique de désindustrialisation. Le développement capitaliste qui s’ensuit est alors marqué par le renversement suivant : ce ne sont plus les luttes revendicatives qui sont à l’initiative des transformations sociales, mais les restructurations initiées au profit du capital. En Italie, cette séquence se met en place à partir de la restructuration économique de la deuxième moitié des années 1970, justement pour compenser les concessions accordées à la fin de la décennie précédente. Selon les analyses opéraïstes, elle consiste en une radicalisation du taylorisme, menée dans le but de neutraliser le refus du travail ouvrier, via sa récupération et son intégration au processus même de production, par l’emploi systématique de machines qui feraient directement économiser le travail vivant. Cela signifie que les techniques ouvrières visant à s’épargner du labeur à l’insu du contrôle hiérarchique sont en quelque sorte intégrées à la machine et transformées en gains de productivité. « Le savoir collectif [est] mis à disposition de la production », quand il pouvait auparavant s’y opposer. Bien sûr, comme le note Toni Negri, « l’informatique et le système de l’automation » participent en premier lieu de cette « espèce de taylorisme perfectionné », en tant que machines qui « organisent aussi la force de travail intellectuelle (machines automatiques, machines informatiques, la robotisation) et augmentent le degré d’exploitation6 ».

[Christine Crockett]
Ce revers témoigne que la politique du sabotage avait fait preuve de courte vue, puisque « le sabotage, c’était aller contre les machines qui existaient » mais qu’« on ne parvenait pas, en revanche, à inventer une méthode pour saboter les machines futures7 ». […] Se réalise alors plus complètement ce que Marx avait théorisé dans son « Fragment sur les machines8 » : l’apparition d’« une nouvelle abstraction réelle
, le general intellect, c’est-à-dire le savoir objectivé dans le capital fixe et particulièrement dans le système automatique des machines9 ». […] Les conséquences à en tirer sont d’une ampleur inédite : ce n’est même pas la demande d’émancipation, mais le contenu même de l’expérience de libération qui a ainsi été irrémédiablement capturé par le capital — ce qui apparaît de façon plus flagrante encore dans la description du « nouvel esprit du capitalisme » qu’ont proposée Luc Boltanski et Ève Chiapello10. Ce n’est pas la satisfaction de revendications économiques qui ont abouti à une nouvelle gouvernementalité du travail, mais le refus de celui-ci et les désirs de nouvelles formes de coopération censés y échapper qui ont été traduits en de nouvelles manières de produire. Ce qui s’était séparé politiquement, pour reprendre l’expression de Tronti, est donc réintégré économiquement, au moyen d’une reconfiguration de l’entreprise et de sa culture du travail.
« La plupart des combats menés depuis les années 1980 interviennent d’emblée sur fond de défaite, pour négocier les conditions de leur défaite même. »
[…] Le processus révèle à ce titre combien l’expérience de l’autonomie ouvrière italienne était liée à une situation de stabilité et de disponibilité de l’emploi, qualifié ou non, combien elle était finalement hétéronome de la dynamique des Trente Glorieuses. Si par la suite, des formes d’auto-organisation ouvrière apparaissent à nouveau, c’est toujours en étant contraintes à une logique « défensive sur les acquis de l’ancien cycle, comme préservation de l’ancien rapport entre les classes11 ». L’extranéité12 qu’elles manifestent s’appuie en effet pour l’essentiel sur une défense de ce qui reste de travail salarié et d’État-providence, et non sur une contre-culture antitravailliste — précisément parce que, sur ce point aussi, l’hégémonie culturelle du capital a progressé. Ces luttes sont qui plus est rarement victorieuses, dans la mesure où le faible rôle que la force de travail joue dans le processus de production machinique implique que « les salariés ont ainsi perdu, même au sein de la médiation syndicale, toute influence sur les négociations13 ». Dans le cas des travailleurs migrants et réfugiés, dont les luttes se sont multipliées ces dernières années, cette faiblesse est redoublée d’une vulnérabilité juridique qui contraint leurs mobilisations à rester au niveau de la revendication de conditions de survie minimales, sans succès, sinon le temps d’occupations précaires, cibles privilégiées des raids policiers. À vrai dire, la plupart des combats menés depuis les années 1980 interviennent d’emblée sur fond de défaite, pour négocier les conditions de leur défaite même.
[…] C’est la même perspective, à vrai dire parfaitement hégémonique dans les courants contestataires, qui semble avoir bloqué le sursaut des gilets jaunes en 2018. Aussi impressionnants qu’aient été les moyens mis en œuvre dans cette séquence, ils se résumaient en fin de compte à la mobilisation des anciennes formes de la révolution dans une visée qui demeurait elle réformiste. Les aspects les plus « communalistes14 » du mouvement n’esquissaient en rien une tendance à la communisation, mais se rapportaient en fait à des techniques revendicatives visant une restauration du compromis keynésien. Les gilets jaunes auraient pris l’Élysée avec l’aide du black bloc, cela n’aurait rien donné de plus qu’un beau saccage. Après le 16 mars 2019, acmé des épisodes de destructions matérielles qui ont marqué le mouvement, son chant du cygne, celui-ci s’est d’ailleurs quasi éteint faute de réponses venues d’en haut. C’est que l’indiscipline, certes radicale, ne s’adressait toujours qu’à l’État, dans la continuité du cycle défensif. Elle élaborait certes une déclinaison de celui-ci autour des questions du pouvoir d’achat et du surendettement, mais n’interrogeait jamais ou presque les conditions de travail en situation. Aussi enthousiasmants fussent-ils, les ronds-points n’ont jamais été des soviets susceptibles d’acquérir quelque pouvoir que ce soit — du reste, un tel scénario est devenu depuis longtemps matériellement impraticable, avec la fin de la classe ouvrière de métier. Ils auraient pu tout au plus devenir des ZAD, en persévérant dans l’appropriation et l’édification d’espaces autonomes, se protégeant de la gouvernementalité au lieu de l’attaquer frontalement : en trouvant leur fin en eux-mêmes, et non plus dans l’espoir de réformes. […] C’est pourtant sur ce chemin non emprunté qu’auraient pu s’exprimer, de manière inédite, les savoir-faire ouvriers devenus inutiles à la production.

[Christine Crockett]
L’autre « modèle allemand »
Malgré ce contexte maintenant quarantenaire, des phénomènes qui se réclament de l’autonomie subsistent dans la plupart des grandes villes européennes, à l’échelle de petits réseaux pouvant compter jusqu’à quelques centaines de personnes. Tout un milieu, d’ailleurs plus « autonomiste » qu’autonome, le niveau de répression globale empêchant des pratiques illégales pérennes, continue ainsi de faire vivre la tradition issue des années 1970, ne serait-ce qu’en tant que courant d’opinion. […] Depuis les années 1980, ce milieu ne s’en est pas moins internationalisé et interconnecté en se greffant aux nouveaux mouvements sociaux, et, surtout, à partir de la fin des années 1990, au mouvement dit altermondialiste. Il a suivi en cela un modèle essentiellement dérivé de l’expérience allemande, qui, en survivant de façon mineure mais certaine à la contre-insurrection globale, est devenue l’épicentre à partir duquel se sont diffusées les pratiques et expériences autonomes. Dans les villes où ils existent, les milieux autonomes se confondent d’ailleurs en grande partie, en tout cas dans les années 1990, avec les milieux du squat, que ce soit à Amsterdam, Barcelone, Brighton, Copenhague ou encore Poznan, pour ne citer que des exemples qui ont été étudiés15.
« L’expérience allemande, en survivant de façon mineure mais certaine à la contre-insurrection globale, est devenue l’épicentre à partir duquel se sont diffusées les pratiques et expériences autonomes. »
Surtout, ils héritent du mouvement allemand un rapport désinhibé à l’autonomie du politique. Pour la plupart des Autonomen16 formés aux séquences de contestation étudiante, anti-nucléaire ou au squat, la réalité de la lutte organisée a en effet toujours résidé non pas dans un mouvement, c’est-à-dire un conflit répété sinon permanent, mais dans des campagnes ponctuelles, qui cherchent à mobiliser en réponse aux avancées de la métropolisation. Elles constituent avant tout une modalité d’organisation pratique, en l’absence d’un mouvement de fond durable, qui soit régulièrement porteur d’échéances durant lesquelles se retrouver — ce que les occupations n’ont jamais réussi à être plus de quelques mois. D’autres moments d’agglomération interviennent à un rythme soutenu, pour l’essentiel des congrès et des émeutes17 soit des phénomènes tout aussi événementiels. Le narcissime des petites différences semble quoi qu’il en soit l’emporter sur ces efforts, puisque les autonomes allemands ont toujours évolué par « petits groupes18 », souvent rattachés à leurs squats ou espaces alternatifs respectifs, et qui « n’ont jamais été capables de maintenir ne serait-ce qu’un degré minimum de coordination19 » entre eux.
Cette atomisation est néanmoins synonyme d’une grande liberté d’action, pouvant reposer sur la confiance mutuelle acquise au fil d’un quotidien partagé avec quelques personnes, mais à une échelle par conséquent très réduite. […] Dès les années 1970, ce sont les luttes anti nucléaires ou contre les projets d’aménagement qui deviennent autant d’occasions de mettre en œuvre la tactique de la campagne. La politique de l’Allemagne de l’Ouest en termes de privatisation du territoire amorce en effet le processus désormais bien documenté d’extension de la métropole au-delà des frontières du tissu urbain, notamment sur le plan des ressources énergétiques. C’est le premier moment d’accélération de l’expansion qui a conduit des autonomes français à écrire plus de trente ans plus tard, que « s’il y a bien des zones absolument métropolitaines, au sens de zones absolument sous contrôle, il n’y a pas de territoire non métropolitain. C’est la totalité du territoire qui, en tant que territoire, c’est-à-dire en tant que désert, est polarisé par la métropole. Une inexorable banlieue s’étend sans conteste de Paris jusqu’au village le plus reculé du Limousin20. »

[Christine Crockett]
L’implantation, à partir des années 1970, d’annexes de la ville et de ses fonctions économiques en zone rurale, et leur mise en réseau systématique, aboutissent en effet à la formation de ce type de « continuum sécurisé de dispositifs7 » quasi parfait. Pour prétendre lutter contre lui, il va désormais s’agir, pour les militants, d’opérer une jonction entre d’une part les « points focaux de l’activisme [en] zones rurales et villes de provinces21 », et de l’autre la « politique radicale des centres urbains7 », grâce à des rassemblement ponctuels. C’est la dynamique qui débute à Wyhl, une petite commune rurale de l’ouest du pays jusque-là bien éloignée des préoccupations des radicaux, contre le projet de construction d’une nouvelle centrale nucléaire, en réponse à la crise de l’énergie provoquée par le choc pétrolier de 1973. L’État allemand entendait aussi faire de cette centrale le réservoir énergétique d’une future industrialisation massive des alentours. En février 1975, le chantier est le lieu de rendez-vous de près de trente mille personnes, surtout issues du milieu militant urbain, ce qui provoque l’arrêt du projet, et bien sûr ragaillardit les participants à cette occupation22. Mais les prochaines échéances se déroulent bien moins pacifiquement, par exemple dès l’année suivante à Brokdorf, une agglomération du même type près d’Hambourg, où quarante mille personnes occupent le chantier d’implantation nucléaire en novembre 1976, cette fois au prix de rudes affrontements, impliquant des jets de grenades lacrymogènes depuis des hélicoptères, auxquels réplique l’usage de lance-pierres23. […]
« Black bloc : une uniformité vestimentaire sombre, cagoule comprise, garantissant au regroupement informel opéré pour l’occasion que les plus actifs ne soient pas distinguables des autres par la police. »
C’est donc l’extraparlementarisme et le raffinement dans la violence qui sont ainsi mis en avant. L’exigence de formes de luttes qui soient aussi dans le même temps des formes de vie — ce qui aurait par exemple consisté dans un effort pour que l’occupation des chantiers soit aussi communautaire que possible — passe elle au second plan, quand elle ne s’évapore pas purement et simplement. […] La centrale de Brokdorf sera quoi qu’il en soit achevée, comme d’autres après elles, face à ces capacités de résistances aussi spectaculaires qu’insuffisantes. […] Dès lors les actions des Autonomen semblent bel et bien être dépendantes d’une situation politique qui les dépasse, et dont ils sacrifient la prise en compte sur l’autel de leurs automatismes. Malgré l’échec de Brokdorf, ces techniques d’occupation et de manifestation violente n’en sont en effet pas moins appliquées une nouvelle fois à Francfort, à l’automne 1981, contre un projet d’extension de l’aéroport local. Un « village des opposants » est bâti sur place en s’appuyant sur les techniques de construction collective expérimentées dans les squats urbains, de sorte que la mobilisation se double d’une expérience de coexistence quotidienne dans un espace ouvert et partagé. Quand il est détruit par la police, les environs sont conduits « au bord de l’ingouvernabilité », avec des affrontements qui se déplacent « dans les forêts (le long de la clôture qu’on avait été érigée autour du chantier), le centre-ville, l’aéroport et sur les autoroutes environnantes », sans pour autant parvenir à la réoccupation24.
Comme plusieurs récits différents existent — à la manière d’un mythe, ce qu’il est d’ailleurs devenu depuis bientôt quarante ans — il est impossible de l’affirmer formellement, mais ce serait à cette occasion que la technique du Schwarze Block, désormais plus connu sous le nom de black bloc, aurait été expérimentée pour la première fois dans le format qu’on lui connaît25 : une uniformité vestimentaire sombre, cagoule comprise, garantissant au regroupement informel opéré pour l’occasion que les plus actifs ne soient pas distinguables des autres par la police. La pratique du camouflage collectif en vue de se protéger d’une identification n’était cependant pas une nouveauté. Donato Tagliapietra relève par exemple dans les usines italiennes, dès le début des années 1970, « l’utilisation de foulards rouges par les ouvriers pour ne pas être reconnus lorsqu’on “punissait” les chefs et les petits chefs26 ».

[Christine Crockett]
[…] Autonomes de tous les pays…
Les années 1990 s’amorcent sous le signe d’une bascule plus nette encore dans cette forme d’autonomie du politique. Avec la chute du mur de Berlin, un bref renouveau du mouvement des squats s’opère certes, en réaction directe à une redéfinition spatiale de l’est de la ville, sous le coup de privatisations des bâtiments qui appartenaient auparavant à l’administration publique de la RDA27. […] Sur ce front-là, c’est de ce fait la logique alternativiste qui l’emporte, avec, ces mêmes années, l’acquisition légale de bâtiments entiers. L’un d’eux, le centre Mehringhof de Berlin, consiste par exemple en un « immense bâtiment, doté d’une cour, fournissant des bureaux pour les groupes activistes, des salles de réunion, un centre des femmes, un théâtre, un café-librairie, des espaces de fête, et un bar ». Celui de la Hafenstraße de Hambourg comportait notamment une cantine populaire et un café tenu par des activistes turcs. Mais ces lieux s’apparentent de cette façon à autant d’« institutions alternatives sans contenu politique explicite » — contenu qui se déporte lui du côté des pratiques proprement militantes28. Le gros des activités des Autonomen se redéploie en effet dans deux registres différents. Le premier est l’antifascisme. Il s’impose en un temps où la réunification provoque une recrudescence importante du néonazisme. Des agressions sur les immigrés s’accompagnent d’avancées électorales importantes de l’extrême-droite, qui atteint près de 5 % des voies au niveau national en 199429, sans que le nouvel État allemand, et encore moins la police, ne s’en alarment.
« La plupart des autonomes refusent cependant cette invite. Leur action se concentre alors sur des interventions violentes ponctuelles. »
Un groupe nommé Autonome-Antifa (M) se crée en réaction, et mène des attaques contre les locaux néonazis, bloque leurs manifestations, protège manu militari les immigrés victimes d’agressions30. La formation assume aussi « un travail systématique en direction de la presse (chose complètement atypique pour des autonomes)31 », puisqu’elle rompt effectivement avec une interprétation répandue du séparatisme en termes de refus de toute apparition publique formellement médiatisée. Cela s’explique aussi par le fait que le groupe développe dans le même temps une orientation nettement léniniste32 : il propose aux autres autonomes un processus d’organisation plus classique33, et une réorientation anti-impérialiste qui tranche avec un passé peu sensible à la question34, voire qui la refusait explicitement de façon à se distinguer des groupes gauchistes des années 1960 et 1970.
La plupart des autonomes refusent cependant cette invite et continue d’évoluer sous la forme d’une mouvance diffuse, dans l’espoir de continuer à échapper autant que faire se peut aux radars des pouvoirs publics35. Leur action se concentre alors sur des interventions violentes ponctuelles. Ce sont d’une part les émeutes régulières, notamment chaque 1er mai, et diverses campagnes de protestation qui donnent lieu à des manifestations violentes, par exemple en réponse à la visite de Ronald Reagan à Berlin le 11 juin 1988. Dans les deux cas, la pratique du black bloc se ritualise. On relève aussi, à cette occasion, ce qui deviendra l’un des traits marquants de ces événements, à savoir que de nombreuses personnes avaient fait le déplacement depuis d’autres villes du pays, sinon depuis l’étranger, en perspective de l’émeute36. C’est en parallèle la pratique d’un « luddisme civil37 », à savoir de sabotages, orientés principalement contre l’industrie nucléaire et plus précisément contre le transport de déchets par la voie des rails. La seconde moitié des années 1990 est ainsi marquée par plusieurs centaines d’actions, parmi lesquelles l’installation de troncs d’arbre sur les voies, le sciage des rails, ou encore la pose de crochets sur des caténaires38. Comme le groupe L.U.P.U.S. l’indiquait déjà à la fin des années 1980, on s’oriente de cette façon toujours plus nettement vers une forme de « militantisme [qui] se concentre presque exclusivement sur la violence jusqu’à en oublier l’utopie d’un contre-pouvoir social39 ».

[Christine Crockett]
Si ces pratiques se maintiennent jusqu’à ce jour à leur rythme, pour ainsi dire, de croisière, la dynamique de rassemblements ponctuels de bases dispersées s’intensifie quant à elle à partir de la fin des années 1990, en prenant aussi une échelle nettement plus globale, avec la participation des autonomes de tous pays aux « contre-sommets » internationaux, comme celui de Seattle en 1999 ou de Gênes en 2001. Le mouvement « altermondialiste » ou « anticapitaliste », nouveau mouvement social s’il en est, avec ses manifestations médiatisées pour l’unique raison que certains en son sein recourent à la technique du black bloc, n’a en effet « que peu d’existence en dehors des mobilisations40 ». Il y réunit pour l’essentiel des militants de l’extrême-gauche ordinaire, des mouvements alternatifs, et des participants aux milieux d’opinions radicales internationaux. […] L’on ne saurait pour autant considérer la dynamique ouverte par les contre-sommets comme un phénomène « politique plutôt que social41 », tant les gestes dont elle est porteuse manifestent un désespoir diffus et transclassiste, directement produit par la décomposition de l’ancien compromis stato-capitaliste. Ce qui se manifeste en réalité avec ces surgissements réguliers, c’est une extranéité certes faible mais toujours vivace, qui ne peut se donner des formes plus durables du fait de la répression pérennisée et raffinée depuis le début de la séquence contre-insurrectionnelle.
«
Est-il réellement possible de provoquer un changement révolutionnaire en espérant radicaliser des mouvements sociaux ?»
Qu’elle s’appuie sur de l’idéologie, de la contre-culture ou des situations de précarité économique, elle n’en reste pas moins une marque d’autonomie sensible et morale, que seuls la masse et l’anonymat permettent désormais de manifester au grand jour, fût-ce de façon éphémère. Il faut ajouter à cela l’expérience de l’émeute en elle-même, dans la mesure où elle officie comme un espace de réappropriation de la violence, de la solidarité collective et de la capacité à s’organiser, et surtout comme un moment de contact avec ce qu’implique physiquement la conflictualité avec l’État42. Ce sont là aussi autant de facteurs d’extranéité susceptibles de nourrir par la suite d’autres expériences d’auto-organisation libératrices. La question qui s’est imposée aux autonomes allemands à partir du début des années 1980 n’en continue cependant pas moins de se poser aux émeutiers contemporains, sans trouver de réponse définitive : « est-il réellement possible de provoquer un changement révolutionnaire en espérant radicaliser des mouvements sociaux43 ? » […] Le doute s’impose d’autant plus que la pratique de l’action directe au cours de ces manifestations est pour l’essentiel « confondue avec le bris de vitrines44 ». Elles ne peuvent donc même pas être comparées aux émeutes expropriatrices des mouvements autonomes passés, ni à ces événements plus contemporains, qui vont des piqueteros argentins aux émeutes de Clichy-sous-Bois en passant par Ferguson et Baltimore45, et dont certains aspects constituent, selon Joshua Clover, autant de gestes de négation immédiate de la valeur marchande. […]
L’autonomie dans et contre la modernité
Une autre brèche s’est ouverte en parallèle de ce processus, donnant lieu à des formes d’autonomie inédites, du moins relativement à l’histoire que j’ai relatée. Celles-ci interviennent selon une logique de contestation en acte de la métropolisation et de son extension aux espaces ruraux, dans la continuité de ce dont il était question avec l’autonomie allemande des années 1980, mais en lui faisant faire un saut qualitatif. La dynamique plus contemporaine des « zones à défendre », et leur succès pratique et politique certain, s’inscrivent en ce sens dans un même temps défensif, mais en prenant le relai de luttes extérieures à la question ouvrière, par exemple celle menée en France par des paysans du Larzac pour la sauvegarde de leurs terres tout au long des années 1970. C’est là un tout autre phénomène d’autonomisation d’éléments étrangers à la production capitaliste, dans la mesure où il s’appuie sur des formes de vie rurales ayant pour certaines conservé, parfois au prix d’une lutte féroce, nombre d’usages précapitalistes. […] Si le mouvement NO TAV, dans le Val de Suse, n’est pas à proprement parler une ZAD dans la mesure où il n’implique pas d’occupations permanentes, il s’appuie néanmoins sur le même principe, en réunissant depuis les années 1990 des habitants et des militants opposés à la construction d’une ligne à moyenne vitesse devant relier Lyon et Turin, et pour cela transformer toute une vallée jusqu’alors préservée. Ce mouvement a ceci de particulièrement intéressant que, du fait de sa géographie, la « dimension villageoise » du territoire y est devenue un facteur d’auto-organisation locale. Des manières d’habiter non métropolitaines, fondées sur une forte interconnaissance de proximité, ont permis de mettre en place une solidarité et une logistique ayant jusqu’à présent réussi à bloquer l’avancée du chantier, tout en s’ouvrant à la participation des militants de Turin et à leurs « pratiques capables d’aller au-delà » de ce qui était jusque-là « toléré » par les locaux46.

[Christine Crockett]
Dans ce mouvement comme dans le cas des autres oppositions aux grands projets, on a en effet assisté à une assomption très large de la nécessité de la résistance violente contre les forces chargées de sécuriser le chantier, qu’elles soient policières ou issues de sociétés de sécurité privée. Gian Luca Pittavino note à ce titre : « c’était clair pour nous que, tôt ou tard, à un moment donné les pétitions et les prises de position verbales devraient se confronter à la force physique (politique) de l’État en tant que tel. Et il faut dire que là le mouvement a vraiment surpris tout le monde, faisant preuve d’une maturité politique collective très enviable : quand, après le 3 juillet 2011 (la plus dure manifestation du mouvement, un vrai siège du chantier Tav), les porte-parole du mouvement ont dit dans une conférence de presse il n’y a pas les bons et les méchants aujourd’hui : on est tous des black blocs !
7. » Il est aussi significatif que la mobilisation ait été l’occasion de produire tout une automythographie à travers l’exploration d’un imaginaire fondé sur une relecture des luttes contre les privatisations des terres à l’époque moderne, et plus précisément les utopies communales et religieuses, par exemple les diggers anglais47. […] Dans le cadre de ces mouvements territoriaux, l’autonomie peut en effet être redéfinie comme le geste de retrouver des formes communautaires, des manières d’habiter et des savoir-faire provenant du passé précapitaliste, en les ré-élaborant d’une manière syncrétique. Elle intervient de cette façon comme un geste non plus seulement de destruction du monde moderne, mais de préservation, voire de restauration, dans tous les sens du terme, du monde d’avant la métropole.
« L’autonomie peut être redéfinie comme le geste de retrouver des formes communautaires, des manières d’habiter et des savoir-faire provenant du passé précapitaliste. »
[…] C’est aussi ce qui s’est opéré près de la petite ville de Notre-Dame-des-Landes, dans la périphérie nantaise, quand l’opposition à la construction d’un nouvel aéroport a donné lieu à l’occupation sous forme de ZAD la plus connue, tant du fait des conflits répétés et spectacularisés par les médias auxquels elle a donné lieu, que des expériences de vie qui s’y sont déroulées. En lien avec le combat des paysans locaux pour conserver leurs terres, l’implantation de près de 200 personnes sur plus de 1 500 hectares a là aussi acté ce renouveau important de la notion d’autonomie, qui a irradié en retour par-delà le bocage. Marcello Tarì définit ce qui est ici en jeu de la façon suivante : « Autonomie, dès lors, dans un sens politique, n’indique guère une tactique pour les affrontements de rue, ni une stratégie pour la prise du pouvoir par le bas, mais désigne l’espace et le temps d’une reprise de l’usage, de cette capacité d’habiter librement, selon la règle contenue dans la forme de vie au sein de laquelle nous avons décidé de persévérer48. » Dans l’espace circonscrit par l’occupation rurale, une conjonction entre forme de lutte et forme de vie a en effet pu réapparaître, dans la mesure où le fait même d’habiter sur le site constituait un facteur de blocage du chantier et de sauvegarde du territoire. Mais la conjonction va au-delà de ce seul geste, dans la mesure où c’est surtout un espace d’expérimentation, sociale et matérielle, qui s’est ouvert avec cette ZAD.
D’abord, la notion d’autonomie héritée des luttes des années 1970 et reconduite au sein des réseaux radicaux y a été comprise pour la première fois en termes de subsistance, du fait bien sûr de la présence de terres agricoles et de plusieurs fermes. Margot Verdier, dans sa thèse sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, note ainsi qu’« en quelques années, la ZAD a pratiquement atteint l’autosuffisance alimentaire notamment grâce à la production maraîchère et boulangère qui fournit une base nutritive à l’ensemble des occupant⋅e⋅s. Le résultat de ces différentes activités est distribué via des espaces destinés à rendre les ressources accessibles à tou⋅te⋅s49. » L’expérience de la vie sur la zone est en cela l’occasion d’éprouver combien nombre d’industries contemporaines fabriquent des produits inutiles dans ce contexte de frugalité volontaire, ce qui plaide d’une autre façon contre la perspective d’autogestion de l’ordre économique existant. Si elle peut apparaître comme tel d’un point de vue extérieur, elle n’a rien en effet d’un simple renoncement frustré au confort du consommateur métropolitain.

[Christine Crockett]
Les zadistes esquissent aussi ce qui apparaît comme un premier dépassement effectif de la contradiction primaire de l’autonomie, puisqu’ils peuvent prétendre se passer, selon leurs modes de vie, de tout ou partie de la production ordinaire, et ainsi former une contre-société réelle, alliant subsistance et sécession. Ils transcendent, qui plus est, le dilemme italien entre une émancipation dans le travail et une libération par l’oisiveté en élaborant une forme de libération qui passe par la mise en œuvre d’une production post-capitaliste, y compris si celle-ci ressemble étrangement par certains côtés à une pratique précapitaliste. […] Côté forme de vie, on a donc un territoire presque auto-suffisant, sorti du salariat et de l’idéologie de la consommation métropolitaine ; côté forme de lutte, une technique de blocage conséquente du chantier de l’aéroport, et une zone d’opacité pouvant servir de point de départ à d’autres nuisances, à commencer par les importantes manifestations qu’a connues la ville de Nantes. Surtout, en prenant au sérieux ce qu’implique une conjonction des deux, c’est-à-dire en lui faisant dépasser le stade de la reproduction sociale alternative pour l’étendre à la question de la subsistance, la ZAD donne bel et bien lieu à une forme de vie en lutte et non à une forme de lutte pour la survie.
« La ZAD donne bel et bien lieu à une forme de vie en lutte et non à une forme de lutte pour la survie. »
En outre, on retrouve également des éléments d’auto-organisation hérités des séquences italiennes et allemandes évoquées : des organes médiatiques et informatifs propres50, appuyés sur une certaine maîtrise de l’autodéfense numérique ; une contre-culture locale avec son vocabulaire, sa mythologie ; le parasitage des services sociaux, avec notamment l’utilisation du RSA ou d’autres formes de revenus garanti s pour financer ce qui pourrait manquer à la production locale ; un recours au chantier collectif et à une forme d’architecture autonome ; une organisation raffinée de la défense militaire, impliquant des barricades durables, des miradors, l’accumulation d’outils d’autodéfense, des réseaux de contacts nationaux voire internationaux ; mais aussi le lot habituel de sources informelles de pouvoir et de reconduction d’inégalités héritées des parcours biographiques précédant l’engagement dans l’occupation51. La durée de l’expérience, de 2009 à 2018 sinon à ce jour, sa capacité réitérée à repousser les agressions policières, sa résonance — à Sivens, à Bure, dans l’Aveyron, il y a peu à Brétignolles-sur-Mer — et sa réussite à remplir son objectif initial — le projet d’aéroport est annulé en 2018, celui du maintien de certaines occupations est encore en discussion —, font ainsi de la ZAD l’exemple le plus élaboré de ce à quoi peut s’assimiler une forme de communisme immédiat aujourd’hui, quand la défaite de l’ancienne tradition révolutionnaire bicentenaire rend les formes de lutte et de vie qui la précédaient porteuses d’une paradoxale modernité.
Illustrations de bannière et de vignette : Christine Crockett | www.christinecrockettstudios.com
- Les séquences historiques abordées ainsi que les concepts employés issus du mouvement autonomes sont expliqués et développés dans les chapitres précédents.[↩]
- Séquence de mobilisations à Bologne où « une conflictualité quasi permanente et protéiforme oppose les autonomes, appuyés notamment par des occupations d’universités, aux forces de l’ordre, à tel point qu’un jeune militant est tué par celles-ci », ndlr.[↩]
- Le terme Autonomia est revendiqué « comme dénominateur politique conscient et espace identifiable » au cours des années 1970 en Italie. Il peut alors être défini comme un « double processus d’auto-organisation et de séparatisme », ndlr.[↩]
- Réduction spontanée des dépenses ou du temps de travail ; vol ou rabais organisés, ndlr.[↩]
- Du nom de l’usine Fiat d’où commencèrent les grèves sauvages de 1962 marquant une rupture avec les stratégies usuelles du Parti communiste italien et des syndicats ouvriers, ndlr.[↩]
- Antonio Negri, « La défaite de 77 », dans N. Balestrini et P. Moroni (dir.), La Horde d’or, éd. de l’éclat, 2017, p. 590.[↩]
- Ibid.[↩][↩][↩][↩]
- Karl Marx, « Capital fixe et développement des forces productives », Manuscrit de 1857–1858 dits « Grundrisse », éd. J.-P. Lefebvre, Éditions sociales, 2011, p. 650–670.[↩]
- Temps Critiques, « Quelques précisions sur Capitalisme, capital, société capitalisée », 8 janvier 2010.[↩]
- Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Gallimard, 2011.[↩]
- Roland Simon, Théorie du communisme, vol. 1, Au- delà de l’affirmation du prolétariat, Senonevero, 2001, p. 81.[↩]
- Substantif d’étranger, ndlr.[↩]
- Temps Critique, art.cité.[↩]
- Laurent Jeanpierre, In girum, La Découverte, 2019, p. 137.[↩]
- Bart van der Steen, Ask Katzeff et Leendert van Hoogenhuijze, The City is Ours: Squatting and Autonomous Movements in Europe From the 1970s to the Present, PM Press, 2014.[↩]
- Militants autonomes allemands revendiquant le nom d’Autonomen pour se distinguer de formations marxistes dans les années 1970, ndlr.[↩]
- Sébastien Schifres, « Les autonomes allemands » dans La mouvance autonome en France de 1976 à 1984.[↩]
- Donatella Della Porta, Social Movements, Political Violence, and the State : A Comparative Analysis of Italy and Germany, Cambridge University Press, 1995, p. 96.[↩]
- Ibid., p.46.[↩]
- « Un communisme plus fort que la métropole (3/3) — Thèse sur Lille 2004 », lundimatin, 6 mai 2019[↩]
- Geronimo, Fire and Flames : A History of the German Autonomist Movement, PM, 2014, p.121.[↩]
- Ibid. p.84.[↩]
- « La révolution est une question technique — Les vidéos [2/4] — Fanny Lopez — Hauke Benner », lundimatin, 24 février 2020.[↩]
- Ibid., p.107–109.[↩]
- Maxime Boidy, « Une iconologie politique du voilement. Sociologie et culture visuelle du black bloc », thèse de doctorat, Université de Strasbourg, 2014, p. 106–107.[↩]
- «
Libération signifie contre-pouvoir
: entretien avec Donato Tagliapietra sur les Collectifs Politiques de Vénétie », Acta, 22 septembre 2019[↩] - Alexander Vasudevan, Metropolitan Preoccupations : the Spatial Politics of Squatting in Berlin, Wiley Blackwell, 2016 p. 133–134.[↩]
- Georgy Katsiaficas, The Subversion of Politics : European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life, AK., p. 191.[↩]
- Ibid. p.165.[↩]
- Ibid., p.165–166.[↩]
- Bernd Langer, Antifa. Histoire du mouvement antifasciste allemand, Libertalia, 2018, p. 190.[↩]
- Georgy Katsiaficas, The Subversion of Politics, op. cit., p. 166.[↩]
- Bernd Langer, Antifa, op. cit., p. 190.[↩]
- Georgy Katsiaficas, The Subversion of Politics, op. cit., p. 165.[↩]
- Bernd Langer, Antifa, op. cit., p. 191.[↩]
- Geronimo, Fire and Flames, op. cit., p. 148–150.[↩]
- Georgy Katsiaficas, The Subversion of Politics, op. cit., p. 187.[↩]
- « La révolution est une question technique — Les vidéos [2/4] — Fanny Lopez — Hauke Benner », art. cité.[↩]
- Geronimo, Fire and Flames, op. cit., p. 159.[↩]
- Aufheben, « L’anti-capitalisme comme idéologie et comme mouvement », Théorie Communiste, février 2003, n° 18, p. 13.[↩]
- Ibib.[↩]
- Voir à ce sujet Romain Huët, Le Vertige de l’émeute. De la ZAD aux gilets jaunes, Puf, 2019[↩]
- Geronimo, Fire and Flames, op. cit., p. 123.[↩]
- Aufheben, « L’anti-capitalisme comme idéologie et comme mouvement », art. cité, p. 24.[↩]
- Joshua Clover, L’Émeute prime, Entremonde, 2018, p. 27.[↩]
- Gian Luca Pittavino, «
Ça va être dur, mais pour eux !
: retour sur les luttes No Tav dans la Vallée de Suse », Platenqmil, 21 novembre 2017.[↩] - La Guerra Delle Foreste. Diggers, lotte per la terra, utopie comunitarie, Tabor, 2018.[↩]
- Marcello Tarì, Il n’y a pas de révolution malheureuse. Le communisme de la destitution, Divergences, 2019, p. 123.[↩]
- Margot Verdier, « La Perspective de l’autonomie : la critique radicale de la représentation et la formation du commun dans l’expérience de l’occu-pation de la ZAD de Notre- Dame- des-Landes », thèse de doctorat, Paris 10, Nanterre, 2018, p. 158.[↩]
- Ibid., p.225.[↩]
- Ibid., p.293–305.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Floréal Romero : « Communalisme : se doter d’une organisation », mai 2020
☰ Lire notre reportage « Vendée : une ZAD contre un port de plaisance », Roméo Bondon et Léon Mazas, octobre 2019
☰ Lire notre entretien avec Raoul Vaneigem : « Sauvez les acquis sociaux ? Ils sont déjà perdus », juin 2019
☰ Lire notre entretien avec Frédéric Lordon : « Rouler sur le capital », novembre 2018
☰ Lire notre article « N’être pas gouvernés », Roméo Bondon, mai 2018
☰ Lire notre entretien avec Danièle Obono : « Il faut toujours être dans le mouvement de masse », juillet 2017


