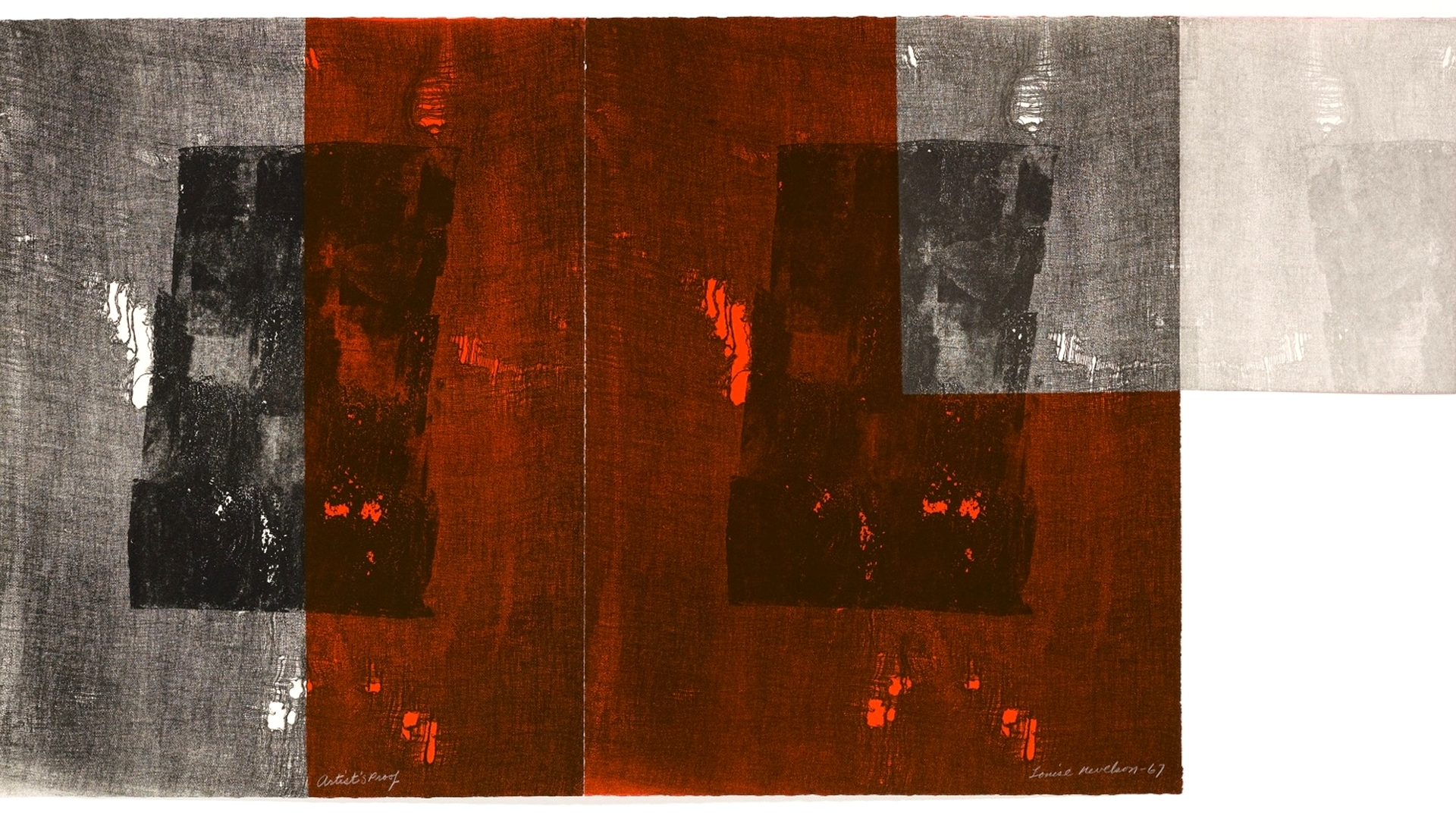Traduction inédite | Ballast | Série « Italie : des écrivaines et leurs luttes »
En 1980 paraît aux éditions Maspero Une femme de Sicile, un texte écrit et publié une vingtaine d’années plus tôt en Italie. Son autrice, Maria Occhipinti, y relate son enfance dans une société rigide et fondée sur l’honneur, sa progressive émancipation de la tutelle familiale et sa révolte contre la guerre, qui lui vaudra deux années d’enfermement. Sa libération n’aura rien d’une fête : ses voisins, ses amis et sa famille réprouvent en bloc son geste d’insoumission, qui ne trouve d’approbation qu’auprès de quelques camarades anarchistes. C’est de ce retour dont il est question dans ce texte traduit par Eugenia Fano, extrait de Una donna libera, le second volet de l’autobiographie de Maria Occhipinti, publié de façon posthume. Deuxième volet de notre série « Italie : des écrivaines et leurs luttes ».
[premier volet : « Maria Occhipinti : corps et âme contre la guerre »]
Maria Occhipinti se remémore sa vie durant la Seconde Guerre mondiale, déclarée deux ans après son mariage. Elle suit son mari à Cassino, dans le sud de la péninsule italienne où il a été affecté, avant de revenir à Raguse, en Sicile, au moment d’un nouveau transfert. Maria est affaiblie à cause des rations médiocres attribuées aux soldats et à leur famille et sa première fille meurt quelques heures après l’accouchement. Elle livre peu après ses premier discours antimilitaristes, ferments du mouvement « Non si parte ! » qu’elle initia.
À l’aube, la porte s’ouvrit toute grande. Le parfum du printemps s’immisça partout, c’était le mois de mai, de nombreuses fleurs étaient en train d’éclore ainsi que l’espoir dans le cœur des gens, mais le mien avait été blessé. Dans le quartier, la nouvelle de l’événement s’était répandue, les femmes qui avaient des fils au front regardaient le petit cadavre au pied du lit et disaient : « Bienheureuse, tu t’es envolée au ciel dès ta naissance, ainsi tu n’as pas vu la laideur du monde. »
Ma petite fille avait été victime de la guerre, elle était née anémique à cause de la faim que j’avais endurée à Cassino. La sage-femme n’avait pas remarqué que son état de santé était critique ; si j’avais été emmenée à l’hôpital, peut-être que les médecins auraient pu la sauver, mais à cette époque on accouchait à la maison.
À mon mari, j’avais envoyé un télégramme annonçant la naissance et la mort de la petite. Le colonel ne lui donna même pas congé, notre douleur fut piétinée.
Leur pouvoir me semblait monstrueux et la résignation du peuple m’effrayait. Dans l’état d’esprit dans lequel j’étais, je ne supportais pas les plaintes des autres, et, pour ne pas les entendre, je couvrais ma tête avec un coussin. Mon grand-père maternel se désola en voyant la petiote, un mois plus tard son mal empira et quand le moment critique arriva, la maison se remplit de parents. Grand-mère envoya tout le monde dans une autre petite chambre, moi seule pus rester à ses côtés et je vis comment elle prépara son homme au trépas.
Elle priait et l’encourageait en lui disant : « Tous ceux qui t’aiment te suivront un jour. »
Il pouvait à peine répondre aux oraisons. Le chêne fut abattu physiquement mais, spirituellement, resta vivant dans nos cœurs. Sa fin fut douce parce qu’il avait eu près de lui une âme sensible et pleine d’amour.
J’étais fatiguée d’entendre toujours les mêmes discours et les mêmes plaintes, j’avais envie de briser cette absurde monotonie. J’étais convaincue qu’il suffisait d’un peu de courage pour renverser n’importe quelle situation.
Les conseils d’Erasmo1 furent très importants. Il me suggéra de faire aux femmes une conférence contre la guerre pour leur expliquer ce qu’était le communisme.

[Louise Nevelson, Double Imagery, 1967]
Un dimanche après-midi, la maison de ma cousine Sara se remplit de gens, les petites vieilles arrivèrent couvertes d’un châle noir et regardèrent stupéfaites le drapeau rouge accroché au mur derrière moi. Nous laissâmes la porte ouverte à cause de la chaleur et les passants s’arrêtaient pour écouter : ils voulaient entendre ce que pouvait bien dire une jeune femme sans instruction.
Tout le monde me connaissait, j’avais grandi dans le quartier. Les mots brûlaient sur mes lèvres et mes pensées explosaient dans mon esprit comme un volcan en éruption. Le cœur plein d’amertume, je dis que les mères avaient été considérées comme inférieures aux bêtes durant trop de siècles ; car une chienne si elle voit ses chiots en danger, elle affronte la mort pour les sauver.
Si les femmes s’étaient révoltées contre les puissants qui organisaient les guerres, elles auraient évité de nombreux massacres. À la fin, j’affirmai que seul le communisme, s’il avait été au pouvoir, aurait pu nous garantir la paix, la liberté et du travail. Les femmes pleuraient, les quelques hommes présents baissèrent la tête comme quand le cercueil d’un mort passe. Je me sentais épuisée, ce jour-là, j’avais lancé la graine contre la guerre.
Quand il y eut le deuxième appel aux armes, j’étais prête à tout. Erasmo me pria de suivre la ligne du parti, nous devions inciter les jeunes à partir pour chasser les Allemands d’Italie du Nord. Les Siciliens qui avaient survécu aux enrôlements forcés des Allemands et ceux qui avaient passé la ligne de feu et étaient arrivés à la maison par miracle devaient de nouveau affronter la mort au nom de la Maison de Savoie2.
Mais comment ! Quelques mois auparavant j’avais fait une conférence contre la monarchie, et, maintenant, je devais renier tout ce que j’avais dit ? Furibonde, j’explosai contre le parti. Erasmo, indigné de mon comportement, me donna une gifle. Je m’enfuis de la grande salle où il y avait les rescapés en m’exclamant : « Tu ne me verras plus jamais ! Gare à celui qui ose me toucher d’un doigt ! »
Deux semaines après, à onze heures du soir, on entendit comme un coup de feu près de la maison. Le lendemain je sus qu’Erasmo avait fait sauter deux doigts de sa main gauche avec une petite bombe qu’il avait fabriquée, et qu’il refusait de se faire soigner.
Sa sœur me supplia de l’accompagner à l’hôpital. Il subit les soins médicaux sans se plaindre et, au retour, avant de rentrer dans la grande salle, il me dit : « Comme ça, j’ai frappé la main qui t’a giflée. »
À ces mots, je compris combien il tenait à mon amitié. Son père et ses frères me remercièrent de lui avoir pardonné mais j’étais bouleversée par la folie qu’il avait commise. Depuis lors, quoique je pense ou fasse, je ne lui demandai plus aucun conseil.
Quand on lui raconta que je m’étais jetée devant les roues du camion qui était en train de rafler les jeunes, il fut stupéfait parce qu’il ne pouvait pas m’imaginer capable de soutenir seule la protestation contre la guerre. Je ne sais pas, je ne me suis jamais demandé pourquoi j’avais eu besoin d’être à la tête de la révolte. Ainsi, comme par enchantement, nous y fûmes impliqués, à l’insu l’un de l’autre. […]
Durant ces moments de révolte, mes compatriotes luttèrent héroïquement contre un régiment bien armé : le front était à un kilomètre de leur habitation. Les mamans, enfermées chez elles, priaient Dieu pour que leur fils soit sauvé du danger de mort. À leur place, j’aurais enfermé le mien à la maison et je serais allée me battre contre les assassins qui voulaient me le prendre.
En effet, lors des journées de révolte, mon mari resta caché, je ne voulais pas que le père de la petite que je portais dans mon ventre devienne de la chair à canon.
Certains insurgés me demandèrent : « Pourquoi ton mari n’est pas ici avec nous ? ». Je répondis : « Mais pourquoi vos femmes et vos mères ne font pas comme moi ? ».
Une fois, mon mari vint me voir ; les responsabilités que j’assumais l’émouvaient. Il me demanda de faire l’amour.
Je fus atterrée par cette demande. Comment pouvais-je le serrer dans mes bras ? J’avais secouru des morts et des blessés, dont le sang s’était déversé dans mes mains, j’aurais eu la sensation de désacraliser la mémoire de ces morts. Pour ne pas le vexer, je lui dis que je n’allais pas bien, mais ces jours-là, je ne pouvais pas remplir mes devoirs d’épouse parce que j’appartenais aux souffrants.
Pour moi, la défaite de cette révolte fut atroce. Je n’aurais jamais imaginé que j’allais subir autant d’humiliations morales. La suspicion que je fus la maîtresse d’Erasmo Santangelo avait suffi pour me jeter tant de boue au visage. Les gens ne savent pas qu’un amour spirituel merveilleux peut naître quand on lutte ensemble pour une cause. Si notre passion avait été physique, nous aurions évité le danger de mort pour profiter de la vie.
Et donc, une fois la tempête passée, de nombreuses personnes oublièrent notre générosité et souillèrent un tel héroïsme. Avec leurs calomnies, elles voulaient me faire baisser le front, mais j’étais tellement convaincue de la rectitude de mes actions que je n’acceptais pas de me plier devant une mentalité arriérée. Avec ces préjugés, l’évolution de notre terre était entravée, car le peuple, en perdant du temps à commérer, négligeait des problèmes bien plus importants, et les plaies sociales ne guérissaient jamais. Tout cela ne pouvait profiter qu’aux réactionnaires. J’enviais les femmes du Nord, elles avaient aidé les partisans contre les Allemands durant la résistance, elles avaient été comprises, aimées et elles pouvaient continuer de lutter pour faire prospérer l’Italie.

[Louise Nevelson, Double Imagery, 1967]
Maria Occhipinti est condamnée à plusieurs années de prison pour avoir initié la révolte pacifiste qui s’est déroulée à Raguse en janvier 1945. Elle les passe sur l’île d’Ustica, au large de Palerme, où elle accouche d’une fille, puis dans la prison pour femmes des Bénédictines. Inquiète des conséquences des conditions de détention sur sa fille, elle finit par la confier à sa mère. Maria est amnistiée quelques jours après la proclamation de la République et libérée en décembre 1946. Elle revient à Raguse.
Sortie de prison, j’espérais trouver à la maison un accueil affectueux qui aurait pu me guérir physiquement et spirituellement des peines endurées à cause de la guerre. Je n’aurais jamais imaginé que les médisances puissent obscurcir l’esprit des gens de ma famille. Leur froideur et leur silence me pesaient sur le cœur comme un tas de décombres. Je n’osais pas demander pourquoi mon mari ne venait pas me voir, je n’avais pas la force d’affronter certains sujets, depuis plusieurs mois il avait emménagé dans la maison de sa mère. Mon unique consolation était la petite, Maria Lenina, que tout le monde appelait Mariuccia ; je la voyais jouer, heureuse, avec d’autres jeunes filles, la nuit je la serrais dans mes bras et regardais son petit visage rose et ses boucles blondes, elle ressemblait à un ange. J’espérais qu’elle aurait un meilleur destin que le mien et je me jurais que je ferais tout pour la comprendre et créer une harmonie parfaite entre nous.
Deux semaines après mon retour, un samedi soir, mon père revint nerveux de la place [du village] : « Qui cherche un mari, cherche l’honneur, tu dois aller chez ta belle-mère. »
Je répondis, indignée : « J’ai risqué ma vie pour qu’il ne soit pas envoyé à la guerre, et, maintenant, je dois m’humilier en plus de ça ? »
« Si tu n’obéis pas, je te tue » répondit-il. Il savait très bien que je n’avais peur de personne face à la vérité. Ma mère et ma petite sœur Rosina, craignant une tragédie, se mirent à pleurer.
Très en colère, je criai : « Mon mari est un lâche, il ne mérite pas autant d’importance ! »
Ma mère, avec son regard, me suppliait de céder.
J’éprouvai alors de la pitié et de la reconnaissance à son égard, elle avait pris soin de ma fille pendant mon absence. À contrecœur, je me fis accompagner chez ma belle-mère. En me voyant, elle vint à ma rencontre en pleurant et me prit dans ses bras.
Peu après, son fils arriva aussi ; il m’embrassa ému et obéit comme un esclave à mon père qui lui ordonna de revenir chez nous. Mais quand nous fûmes seuls dans la petite pièce où nous avions passé notre première nuit d’amour, il s’exclama : « Putain, salope, j’espérais qu’on te tuerait pendant que tu étais en tôle ! »
Avec toute la haine que j’avais dans le cœur, à voix basse, je lui répondis : « Avec quel courage oses-tu m’offenser ? Dis-moi combien de fois tu as été au bordel pendant que j’étais en prison ! »
Je maudis mon père qui m’avait obligée à avaler cet autre calice amer.
Alors que Maria Occhipinti revient d’une visite chez une institutrice communiste, son père la fouette violemment au bas du dos, trouvant qu’elle était rentrée trop tard et estimant qu’une femme devait rester le soir chez elle. Sa mère ne réagit pas, mais sa sœur Rosina s’interpose avant de s’évanouir, ce qui interrompt le déluge de violence. Cette nuit-là, le mari de Maria, qui a assisté à la scène sans intervenir, lui chuchote qu’il espérait que son père la tuerait.
Je compris enfin que ma famille était disposée à me tuer pour sauver leur honneur.
Je réussis à peine à me laver et à aller chez Leggio3, sa mère m’aida à monter les escaliers. En me voyant dans cet état, elle alla chercher la médecin, notre amie qui, ayant touché les bleus au bas de mon dos, me dit qu’il fallait porter plainte. J’étais contre, mais elle, en bonne compagne, me fit comprendre qu’il était nécessaire d’intimider ma famille avec la loi, car la prochaine fois, elle me tuerait. Je lui donnai mon consentement.
Le commissaire passa un savon à mon père et à mon mari ; il leur dit qu’ils auraient pu être condamnés à quelques mois de prison si je n’avais pas retiré ma plainte. Ils revinrent à la maison doux comme des agneaux.
Je cherchai désespérément une maisonnette à louer, mais personne ne voulait de moi en tant que voisine parce que j’avais la réputation d’être poursuivie par la police mais aussi d’avoir trahi mon mari. Certains parents que j’avais tellement aimés ne me saluaient plus ; quand ils me voyaient, ils faisaient semblant de ne pas me connaître. […]

[Louise Nevelson, Double Imagery, 1967]
Le quotidien de Maria Occhipinti est de plus en plus étouffant. Son engagement dans le mouvement « Non si parte ! » a été considéré comme un acte de débauche. De plus, elle a appris à son retour que son mari a eu une petite fille avec une autre femme pendant son absence. Elle comprend qu’elle n’a plus d’autres solutions que celle de partir avec son propre enfant.
Je me mis à réfléchir à l’avenir de ma fille. Si elle grandissait en Sicile, elle aurait été humiliée parce que fille d’une rebelle, d’une femme adultère. Elle aurait sûrement fini par me haïr ; si j’étais morte, mes parents lui auraient mis les brides et la pauvre innocente serait tombée malade si elle n’avait pas eu la force de se révolter.
Je devais lui enlever ces épines du pied avant qu’il ne fût trop tard.
Je suppliai Leggio de m’aider à m’enfuir ; pour faire un premier pas, je voulais aller à Palerme. De là, avec l’aide de mon camarade Paolo Schicchi4, j’envisageai de partir à New York. Pour concrétiser cette fuite, j’apportai petit à petit le strict nécessaire de mon linge chez une amie, Leggio acheta le billet et déposa la valise à la gare.
[lire le troisième volet : l’abécédaire de Goliarda Sapienza]
Traduction inédite par Eugenia Fano de plusieurs extraits de Maria Occhipinti, Una donna libera, Sicilia Punto L, 2021
Illustration de bannière : Louise Nevelson, Double Imagery, 1967
- Erasmo Santangelo (1917–1996) communiste révolutionnaire Sicilien de Gaeta (la ville de Goliarda Sapienza). Envoyé au confino, aux confins, sur l’île d’Ustica, avec Maria Occhipinti, il fut le seul à être jugé pour cette révolte et condamné à 23 ans de prison. Douze ans plus tard, il mit fin à ses jours dans la prison de Rebibbia, à Rome. Après le guerre, les rouages politiques et judiciaires n’avaient pas été purgés des éléments fascistes, et le dirigeant communiste Palmiro Togliatti lui-même resta inactif. Seuls Franco Leggio, Maria Occhipinti et Paolo Schicchi tentèrent de défendre sa cause, mais en vain [note de la traductrice].[↩]
- Après une succession de revers militaires et des dissensions au sein de l’appareil fasciste, le roi d’Italie Victor-Emmanuel III fait arrêter Mussolini et nomme à sa place le maréchal Pietro Badoglio en juillet 1943. En septembre, une armistice est signée avec les Alliés. Rome est abandonnée, Victor-Emmanuel III et le nouveau gouvernement se réfugient à Brindisi, dans les Pouilles. La structure constitutionnelle du royaume d’Italie est maintenue et le roi déclare officiellement la guerre à l’Allemagne un mois plus tard, sollicitant une seconde fois des soldats entre-temps démobilisés [ndlr].[↩]
- Franco Leggio (1921- 2006), anarchiste, militant important actif surtout dans la presse libertaire et a été lié à l’insurrection antimilitariste « Non si parte ! ». En 1947, il fut le seul à rendre visite à la révolutionnaire à sa sortie de prison et à l’aider à partir de Raguse. Il a été un ami précieux de l’autrice, toute sa vie durant [note de la traductrice].[↩]
- Paolo Schicchi (1865–1950) était un anarchiste radical sicilien, fervent antimilitariste et anticolonialiste. Il fonda le Cercle international des étudiants anarchistes, dont le manifeste fut largement diffusé en Italie, en Suisse et en France. Son engagement militant lui valut plusieurs condamnations, notamment une peine de onze ans de prison pour désertion, ainsi que pour son implication présumée dans les attentats de Palerme et de Gênes, et une tentative d’assassinat. Très actif dans la presse libertaire et socialiste, il incita également les paysans à s’approprier et à cultiver les terres en friche [note de la traductrice].[↩]
REBONDS
☰ Lire les bonnes feuilles « Sur les traces de la révolutionnaire Lucy Parsons », Francis Dupuis-Déri, septembre 2024
☰ Lire notre traduction « Constance Markievicz, socialiste irlandaise », David Swanson, décembre 2022
☰ Lire notre article « Paule Minck : le socialisme aux femmes », Élie Marek, janvier 2022
☰ Lire notre article « La langue retrouvée », Eugenia Fano, juin 2021
☰ Lire notre article « Goliarda Sapienza, vivre absolument », David Guilbaud, février 2019