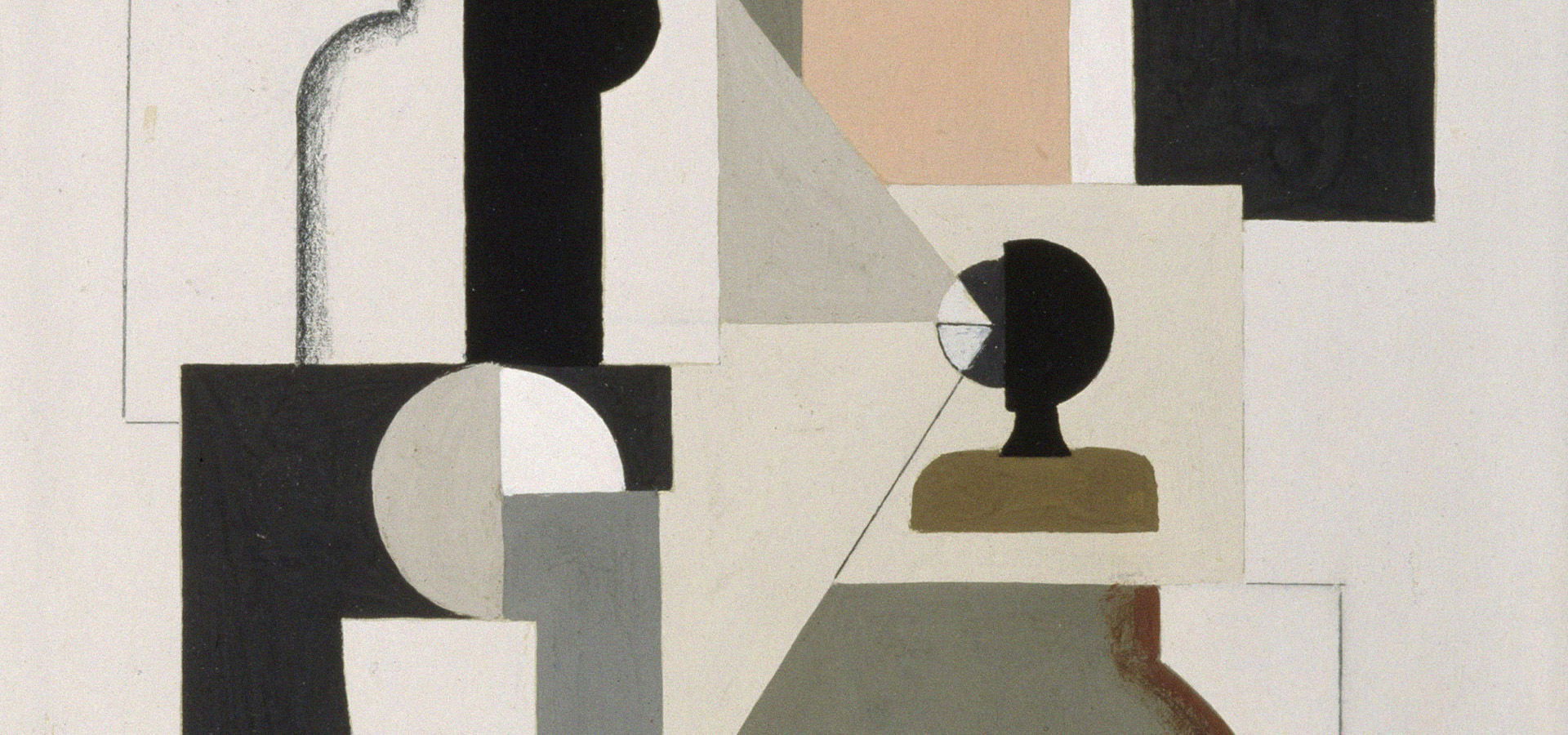Bien sûr, nous ne vivons pas, en France, sous un régime fasciste. Mais on ne compte plus les signes de radicalisation — nationaux, européens et mondiaux. Des généraux annoncent par voie de presse leur désir d’en découdre, les agressions politiques se multiplient, un intellectuel libéral avoue préférer voter pour un parti familial cofondé par un caporal de la Waffen-SS plutôt que pour un républicain des plus traditionnels, un journaliste favorable aux déplacements forcés de populations (quoi qu’il en dise désormais, menteur éhonté1) apparaît comme une option possible au second tour de la présidentielle et, fort du soutien de quelque millionnaire, appelle à unir les classes populaires et la bourgeoisie. Chaque jour, sur les plateaux de « débats », on discute de « guerre civile » et d’« épuration ethnique » sous l’œil gourmand de journalistes complices. Daniel Guérin, historien et militant communiste libertaire, avait analysé la progression fasciste et ses liens avec le capitalisme dans un copieux ouvrage, Fascisme et grand capital, paru en 1936 et amendé en 1945. Il réfléchissait également aux moyens de contrer ce mouvement de masse dont il se demandait, alors, s’il disparaîtrait ou non. Nous en publions un extrait.

« On ne peut vaincre un principe qu’en lui opposant un autre principe, un principe supérieur. »
[…] La menace fasciste a fait découvrir à beaucoup de gens le problème des classes moyennes. Naguère, les partis de gauche ne voyaient en elles qu’une facile et fidèle et stable clientèle électorale. Mais du jour où il a été démontré que leurs oscillations, amplifiées par la crise économique, pouvaient les conduire dans le camp d’en face, qu’elles pouvaient être prises de folie collective, qu’elles pouvaient revêtir des chemises de couleur, ces mêmes partis ont connu les angoisses de la mère-poule menacée de perdre ses poussins : comment retenir les classes moyennes ? Malheureusement ils n’ont rien compris (ou voulu comprendre) au problème. […] Les classes moyennes et le prolétariat ont des intérêts communs contre le grand capital. Mais ils n’ont pas que des intérêts communs. Ils ne sont pas « anticapitalistes » de la même façon. La bourgeoisie, sans doute, exploite, aggrave à plaisir ces divergences d’intérêts, mais elle ne les crée pas de toutes pièces. Il est donc impossible de rassembler le prolétariat et la petite-bourgeoisie autour d’un programme commun qui les satisfasse pleinement tous deux. L’une des deux parties doit faire des concessions. Le prolétariat peut, bien entendu, en consentir quelques-unes. Il doit s’efforcer d’éviter que les coups portés par lui au grand capital ne frappent en même temps les petits épargnants, artisans, commerçants, paysans. Mais, sur certains points essentiels, il doit demeurer intransigeant, car, s’il cédait sur ces points-là, pour ménager les classes moyennes, rassurer boutiquiers ou cultivateurs, il renoncerait à porter au capitalisme les coups décisifs.
C’est précisément chaque fois qu’il a manqué à sa mission d’abattre le capitalisme, chaque fois qu’il n’a pas poussé son avantage jusqu’au bout que les classes moyennes, coincées entre un grand capital demeuré nocif et une classe ouvrière revendicatrice, sont devenues enragées, qu’elles se sont tournées vers le fascisme. En bref, il ne s’agit pas pour le prolétariat de capter les classes moyennes en renonçant à son propre programme socialiste, mais de les convaincre de sa capacité à conduire la société dans une voie nouvelle : par la force et la sûreté de son action révolutionnaire. […] L’antifascisme ne triomphera que s’il cesse de traîner à la remorque de la démocratie bourgeoise. Défions-nous des formules « anti ». Elles sont toujours insuffisantes, parce que purement négatives. On ne peut vaincre un principe qu’en lui opposant un autre principe, un principe supérieur.

[Willi Baumeister]
Le monde d’aujourd’hui, au milieu de ses convulsions, ne recherche pas seulement une forme de propriété qui corresponde au caractère collectif et à l’échelle gigantesque de la production moderne ; il recherche aussi une forme de gouvernement capable de substituer un ordre rationnel au chaos, tout en libérant l’homme. Le parlementarisme bourgeois ne lui offre qu’une caricature de démocratie, de plus en plus impuissante et de plus en plus pourrie. Déçu et écœuré, il risque de se tourner vers l’État fort, vers l’homme providentiel, vers le « principe du chef ».
« L’éradication du fascisme ne sera totale et définitive que le jour où nous présenterons à l’humanité, et où nous ferons triompher, une forme nouvelle de gouvernement des hommes, une démocratie authentique. »
Sur le plan des idées, l’éradication du fascisme ne sera totale et définitive que le jour où nous présenterons à l’humanité, et où nous ferons triompher, par l’exemple, une forme nouvelle de gouvernement des hommes, une démocratie authentique, totale, directe, associant tous les producteurs à l’administration des choses. Ce type nouveau de démocratie n’est pas une chimère, une invention de l’esprit. Il existe. La grande Révolution française a fait entendre ses premiers balbutiements. La Commune de 1871 en a été la première tentative d’application, comme l’ont fait ressortir, de main de maître, Marx et Lénine. Les soviets russes de 1917 en ont proposé, de façon inoubliable, le modèle au monde. Depuis, la démocratie soviétique3 a connu, en Russie même, pour des raisons qu’il serait trop long de rappeler ici, une longue éclipse. Cette éclipse a coïncidé avec la montée du fascisme. Aujourd’hui, le fascisme a du plomb dans l’aile. Nous lui donnerons le coup de grâce en prouvant par nos actes que la démocratie vraie, la démocratie du type communal ou soviétique, est viable et qu’elle est supérieure à tous les autres types de gouvernement des hommes. « Tout le pouvoir aux soviets », disait Lénine. Mussolini a caricaturé ce mot d’ordre pour en faire le slogan de l’État totalitaire : « Tout le pouvoir au fascisme. » L’État totalitaire est un monstre qui chancelle. Nous en serons à jamais délivrés si nous faisons triompher son antithèse : la république des conseils de travailleurs.
[…] Le régime politique de la plupart des États modernes évolués était, jusqu’à présent, la « démocratie » — la pseudo-démocratie : démocratie parlementaire et non démocratie directe, démocratie bourgeoise et non démocratie prolétarienne, démocratie frelatée et non démocratie vraie. Bien souvent même, si l’on y regarde de plus près, cette « démocratie » était fortement mâtinée de césarisme. Mais, en gros, l’on peut dire que, dans les États évolués, elle était, de nos jours, la solution politique la plus généralement pratiquée. Or, dans deux grands pays de l’Europe occidentale, l’Italie et l’Allemagne, ce régime a fait place à un régime nouveau, qui tranche sensiblement avec le précédent : le fascisme4. Comme il s’est manifesté pour la première fois en Italie, on lui a donné un nom d’origine romaine. Mais il n’a rien de spécifiquement italien. C’est pourquoi le vocable emprunté à l’Italie a fini par désigner un phénomène de caractère universel. Il était admis jusqu’à ces dernières années que la « démocratie » était pour la classe dominante le meilleur régime politique.

[Willi Baumeister]
[…] Les révolutionnaires ont une tendance bien naturelle à tout ramener à eux-mêmes. Ils ont l’impression que la bourgeoisie recourt uniquement à la solution fasciste pour briser la révolution prolétarienne menaçante. Il y a, bien entendu, dans cette explication quelque chose de vrai, mais elle est trop simpliste. Les possédants, certes, ont peur de la révolution et ils subventionnent des bandes de nervis pour tenir en respect les ouvriers. Mais ce n’est pas tant pour étouffer la révolution qu’ils se décident à confier au fascisme le pouvoir. […] Ils recourent à la solution fasciste pour se protéger moins contre les troubles de la rue que contre les troubles de leur propre système économique. Le mal qu’il s’agit de conjurer est davantage au-dedans qu’au-dehors. La loi du système capitaliste est le profit. Pendant une longue période qu’on pourrait appeler la phase ascendante du capitalisme, le développement continu de la production, l’élargissement incessant des débouchés ont assuré à la bourgeoisie, malgré des crises périodiques de croissance, une progression ininterrompue de ses profits.
« Mais ce n’est pas tant pour étouffer la révolution qu’ils se décident à confier au fascisme le pouvoir. »
[…] Aux crises économiques cycliques s’est superposée une crise chronique, une crise permanente du système. Le profit capitaliste est menacé à sa source. Durant la période précédente, la « démocratie » était avantageuse pour le capitalisme. On connaît la ritournelle : la démocratie est le gouvernement le moins cher ; l’esprit d’entreprise ne peut s’épanouir que dans la liberté ; les droits politiques accordés aux masses agissent comme une soupape de sûreté et préviennent des heurts violents ; la « démocratie » accroît les débouchés du capitalisme en développant dans les masses des besoins nouveaux et en leur donnant quelques moyens de les satisfaire, etc. Quand le festin est abondant, on peut, sans dommage, laisser le peuple en ramasser les miettes. Mais dans la période actuelle, dans la phase de déclin du capitalisme, la classe dominante est amenée à mettre dans la balance les avantages et les inconvénients de la « démocratie » ; perplexe comme l’âne de Buridan, elle regarde les deux plateaux et elle hésite. Dans certains pays et dans certaines circonstances, il arrive que les inconvénients lui paraissent l’emporter sur les avantages. Quand la crise économique (cyclique et chronique à la fois) sévit d’une manière particulièrement aiguë, quand le taux du profit tend vers zéro, elle ne voit d’autre issue, d’autre moyen de remettre en marche le mécanisme du profit que de vider jusqu’au dernier centime les poches — déjà peu garnies — des pauvres bougres qui constituent la « masse ».
C’est ce que Joseph Caillaux, ce grand bourgeois au verbe fleuri, appelait chez nous la « grande pénitence » : brutale réduction des salaires, des traitements et des charges sociales, augmentation des impôts — des impôts de consommation en premier lieu. Avec le produit de cette rafle dans les poches du bon peuple, l’État renfloue les entreprises au bord de la faillite, les soutient artificiellement à coups de subventions et d’exonérations fiscales, à coups de commandes de travaux publics et d’armements ; l’État, en un mot, se substitue à la clientèle privée, à l’épargne défaillante. Mais le régime « démocratique » se prête assez mal à la réalisation d’un tel plan. Tant que la « démocratie » subsiste, les diverses catégories sociales qui composent le peuple (bien que copieusement dupées et grugées) ont tout de même quelques moyens de se défendre contre la « grande pénitence » : liberté de la presse, suffrage universel, droit syndical, droit de grève, etc. Moyens insuffisants sans doute, mais qui imposent quelques limites aux exigences illimitées des puissances d’argent. La résistance, notamment, du prolétariat organisé rend assez difficile le massacre des salaires. C’est pourquoi, dans certains pays et dans certaines circonstances, lorsque ses profits sont particulièrement menacés, lorsqu’une « déflation » brutale lui paraît nécessaire, la bourgeoisie jette par-dessus bord la traditionnelle « démocratie » et appelle de ses vœux — en même temps que de ses subsides — un État fort. Lequel prive le peuple de tous ses moyens de défense, lui ligote les mains derrière le dos, pour mieux vider ses poches.

[Willi Baumeister]
[…] À un moment donné, les magnats capitalistes […] lancent le fascisme à la conquête de l’État. Pour bien comprendre la tactique fasciste au cours de cette seconde phase, il importe de dissiper une erreur assez répandue, selon laquelle le problème de la prise du pouvoir se poserait de la même façon pour le socialisme prolétarien et pour le fascisme. Or, il y a entre la prise du pouvoir par l’un et par l’autre une différence capitale : le socialisme est l’adversaire de classe de l’État bourgeois, même « démocratique », tandis que le fascisme est au service de la classe que représente cet État. Le socialisme révolutionnaire sait qu’il ne conquerra le pouvoir que de haute lutte, qu’il lui faudra briser la résistance acharnée de l’adversaire : s’il utilise tous les moyens légaux qui lui sont fournis par la loi ou la Constitution, il le fait sans la moindre illusion ; il sait que la victoire est, en définitive, une question de force. (Bien entendu, ce qui vient d’être dit ne s’applique pas au « socialisme » opportuniste, qui ne vise pas à conquérir le pouvoir, mais tout au plus à l’« exercer » et à gouverner pour le compte de la bourgeoisie.) Au contraire, le fascisme, à partir du moment où il se lance à la conquête du pouvoir, a déjà l’assentiment de la fraction la plus puissante de la bourgeoisie capitaliste. Il est assuré, en outre, de la complicité des chefs de l’armée et de la police, dont les liens avec ses bailleurs de fonds sont étroits ; quant à ceux qui tiennent encore les rênes de l’État bourgeois « démocratique », il sait que, même s’ils représentent des intérêts quelque peu différents de ceux de ses bailleurs de fonds, ils ne lui opposeront pas une résistance armée : la solidarité de classe sera plus forte que les divergences d’intérêts ou de méthode.
« À partir du moment où le fascisme marche vers le pouvoir, le mouvement ouvrier ne dispose plus que d’une seule ressource : s’emparer avant lui du pouvoir. »
[…] Le fascisme sait donc qu’en réalité la conquête du pouvoir n’est pas pour lui une question de force. Il pourrait d’ores et déjà, s’il le voulait, prendre possession de l’État. Pourquoi ne le fait-il pas ? Parce qu’il n’a pas encore avec lui une fraction suffisamment importante de l’opinion publique. Or, il est impossible, de nos jours, de gouverner sans l’assentiment de larges masses. Il lui faut donc s’armer de patience, gagner d’abord à lui ces foules, donner l’impression qu’il est porté au pouvoir par un vaste mouvement populaire et non pas simplement parce que ses bailleurs de fonds, parce que les chefs de l’armée et de la police sont prêts à lui livrer l’État. Aussi sa tactique est-elle essentiellement légaliste. Il veut arriver au pouvoir par le jeu normal de la Constitution, du suffrage universel. […] À partir du moment où le fascisme marche vers le pouvoir, le mouvement ouvrier ne dispose plus que d’une seule ressource : gagner le fascisme de vitesse, s’emparer avant lui du pouvoir. […] [L]e mouvement ouvrier, à la veille de la victoire fasciste, est profondément affaibli et démoralisé. Non seulement à cause du chômage, non seulement par suite des défaites répétées provenant d’un manque d’audace dans les rixes journalières avec les bandes fascistes, mais surtout parce que les organisations syndicales n’ont pas su conserver les avantages acquis par la classe ouvrière.
[À] partir du moment où la classe ouvrière a laissé passer la vague fasciste, une longue période s’ouvre d’esclavage et d’impuissance, une longue période au cours de laquelle les idées socialistes — ou simplement « démocratiques » — ne sont pas seulement rayées des frontons des monuments publics ou des bibliothèques, mais sont — ce qui est bien plus grave — extirpées des cerveaux. Le fascisme détruit, au sens physique du mot, tout ce qui s’oppose, si peu que ce soit, à sa dictature ; autour de lui il fait le vide, derrière lui il laisse le vide. […] Les travailleurs ne sortent de leur passivité que lorsqu’un événement leur révèle du dehors qu’ils ne sont pas seuls, que, de l’autre côté des frontières, d’autres travailleurs sont en lutte. C’est ainsi que les grandes grèves de juin 1936, en France, malgré les efforts de la presse fasciste pour en minimiser l’importance, ont un écho profond parmi les ouvriers d’Italie et d’Allemagne.

[Willi Baumeister]
[…] [L]a leçon des drames italien et allemand est que le fascisme n’a aucun caractère de fatalité. Le socialisme eût pu et dû l’exorciser s’il s’était arraché à son état de paralysie et d’impuissance ; s’il avait gagné de vitesse son adversaire ; s’il avait conquis, ou pour le moins neutralisé, avant lui, les classes moyennes paupérisées ; s’il s’était emparé, avant le fascisme, du pouvoir — non pour prolonger tant bien que mal le système capitaliste (comme l’ont fait trop de gouvernements portés au pouvoir par la classe ouvrière), mais pour mettre hors d’état de nuire les bailleurs de fonds du fascisme (magnats de l’industrie lourde et grands propriétaires fonciers) : en un mot, s’il avait procédé à la socialisation des industries clés et à la confiscation des grands domaines. En conclusion, l’antifascisme est illusoire et fragile, qui se borne à la défensive et ne vise pas à abattre le capitalisme lui-même.
Illustrations de bannière et de vignette : Willi Baumeister
- « Au terme d’une conversation sur Le Suicide français, les échecs de l’assimilation et du modèle multiculturel, je lui ai posé la question suivante :
Mais vous ne pensez pas que ce soit irréaliste de penser qu’on prend des millions de personnes, on les met dans des avions…
; il ajoute :Ou dans des bateaux
, et je reprends :Pour les chasser ?
» rapportait le journaliste italien Stefan Montefiori à propos de son entretien avec Éric Zemmour réalisé le 30 octobre 2014. Et Zemmour d’ajouter : « Je sais, c’est irréaliste mais l’Histoire est surprenante. Qui aurait dit en 1940 qu’un million de pieds-noirs, vingt ans plus tard, seraient partis d’Algérie pour revenir en France ? Ou bien qu’après la guerre, cinq ou six millions d’Allemands auraient abandonné l’Europe centrale et orientale où ils vivaient depuis des siècles ? » Aussi, en septembre 2021, nie-t-il farouchement avoir jamais utilisé le terme « remigration » — un concept apparu en France dans les années 2010, au sein des espaces d’extrême droite, visant à qualifier et promouvoir le déplacement forcé de populations entières. Un mensonge de plus : le 27 janvier 2021, sur CNews, il avait ainsi déclaré : « Vouloir la remigration ce n’est pas êtreraciste
. C’est considérer qu’il y a trop d’immigrés en France, que ça pose un vrai problème d’équilibre démographique et identitaire, que l’identité de la France est en danger… » [↩] - Par « prolétariat », il faut entendre « la classe des travailleurs salariés modernes qui, ne possédant pas en propre leurs moyens de production, sont réduits à vendre leur force de travail pour vivre » (Engels).[↩]
- Cette formule renvoie au modèle politique fondé sur la démocratie des soviets, autrement dit des conseils ouvriers et paysans. Il ne saurait être question, pour Daniel Guérin, de louer ici le régime stalinien.[↩]
- Dans la Rome antique, certains magistrats étaient précédés d’officiers, dits « licteurs », qui portaient, comme signe de leur pouvoir, des verges de bouleau liées en faisceau autour d’une hache. Dans le jargon politique moderne en Italie, on a appelé fascio (pluriel fasci) diverses ligues d’actions politique et sociale, de tendances souvent très avancées. Puis le fascisme mussolinien s’est emparé du vocable [ndla].[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « L’hypothèse communiste libertaire », Victor Cartan, mai 2021
☰ Lire notre semaine thématique consacrée aux 150 ans de la Commune, mars 2021
☰ Lire notre article « Orwell : faire front, puis la révolution », Elias Boisjean, novembre 2019
☰ Lire notre entretien avec Jean-Paul Jouary : « De tout temps, les démocrates ont refusé le suffrage universel », mars 2019
☰ Lire notre abécédaire de Daniel Guérin, novembre 2018
☰ Lire « La Commune ou la caste — par Gustave Lefrançais », juin 2017