Texte inédit pour le site de Ballast
Son œuvre — vingt livres, quatre décennies de publications — interroge son parcours social et familial, complexe, fait d’un mélange de fierté et de honte. Le geste de l’écriture lui permit de surmonter cette dernière : « Bourdieu m’a donné le courage de parler de ce dont j’avais honte, il m’a légitimée. » Soucieuse d’écrire dans une langue « blanche », l’auteure défend un « je » collectif pour aller au plus près de « la chose ressentie » — une volonté politique, même : ne pas tricher, tant « l’intime est encore et toujours du social ». ☰ Par Laélia Véron

« C’est peut-être ce dynamisme qui fait la séduction et la violence de l’écriture d’Annie Ernaux : une écriture qui accompagne le monde tel qu’il va et s’y oppose dans un même élan. »
Ces jugements par trop expéditifs ne rendent pas justice à la richesse des écrits d’Ernaux. Si son œuvre est fascinante, c’est bien parce qu’en mêlant des approches intimes, sociologiques et historiques, elle questionne avec exigence le statut et le rôle de ce qu’on appelle littérature. Mais cette quête est dynamique et exigeante. Les écrits d’Annie Ernaux ne se réduisent pas à l’application répétée d’une même formule. Ils se lisent comme autant de recherches, recherches de nouvelles formes pour dire de nouvelles réalités sociales, recherches qui réinterrogent le monde tout comme elles réinterrogent l’écriture, présente et passée. C’est peut-être ce dynamisme qui fait la séduction et la violence de l’écriture d’Annie Ernaux : une écriture qui accompagne le monde tel qu’il va et s’y oppose dans un même élan. Avec, malgré tout, une stabilité : celle d’une vision du monde reposant sur des convictions et sur un engagement. Que peut la littérature ? Sauver, analyser, faire comprendre, faire ressentir et ce sont des démarches éminemment politiques. Car « [i]l y a des émotions plus politiques que d’autres3 ».
Renoncer au beau pour dire le réel
Les premières œuvres d’Annie Ernaux sont caractérisées par la présence d’un « je » qui raconte l’histoire tout en faisant partie de l’histoire. Ce « je » désigne d’abord une héroïne distincte de l’auteure (Denise, dans Les Armoires vides, puis Anne dans Ce qu’ils disent ou rien). Puis, dans La Femme gelée, le « je » devient anonyme. Mais le livre est signé du vrai nom de l’auteure, Annie Ernaux. C’est un premier pas vers le refus de la fiction et de l’étiquette « roman », la naissance d’une écriture qui assume d’écrire à partir de soi, sans n’écrire pour autant que sur soi. Car l’écriture à la première personne d’Annie Ernaux n’est jamais narcissique, ni même traditionnellement psychologique ; l’examen de soi se fait à travers celui des autres, dans un mouvement de va-et-vient du singulier au collectif, du « je » au « nous », puis au « elles/ils ». Il ne s’agit pas d’un récit de soi classique, d’une introspection égotiste, mais bien au contraire d’un décentrement sociologique et historique — ce qu’on peut appeler non pas l’autobiographie, mais l’auto-sociobiographie.

(Serge Poliakoff)
La personnalité de la narratrice, ses sentiments (la honte, la colère, la fierté), se comprennent en grande partie à cause de son statut et son parcours social, celui d’une femme qui quitte sa classe d’origine, celle de ses parents, pour aller dans un autre monde, celui de l’école religieuse, puis de l’université. Cette trajectoire individuelle est hantée par l’impossible réunion de ces deux mondes (La Honte), la distance de classe qui s’instaure entre elle et ses parents devenant « comme de l’amour séparé » (La Place). La relation affective se définit ainsi par rapport à la culpabilité sociale d’avoir abandonné, avec ses parents, sa classe d’origine. Ainsi dit-elle en parlant de sa mère : « J’étais certaine de son amour et de cette injustice : elle servait des pommes de terre et du lait du matin au soir pour que je sois assise dans un amphi à écouter parler de Platon4. »
« Mais quelle forme littéraire adopter quand on veut
venger sa race? »
« [É]crire, c’est le dernier recours quand on a trahi », disait Jean Genet (épigraphe de La Place). Transfuge, souffrant toujours de la culpabilité ou du soupçon d’être une renégate, Ernaux a choisi d’écrire sur les siens et pour les siens. Mais quelle forme littéraire adopter quand on veut — comme elle l’écrivait dans ses cahiers d’étudiante — « venger sa race » ? Ce choix se dessine et s’affermit peu à peu au fil des œuvres. Rendre hommage à ses parents, écrire sur ses parents5 ne peut se réaliser qu’en refusant le romanesque. Le roman donnerait l’illusion mensongère d’un destin singulier ou héroïque. Le roman paraît une forme factice quand on prétend décrire des vies « soumise[s] à la nécessité ». Une forme trop souvent attachée au plaisir, à une lecture réconfortante, faite pour s’envoler vers des horizons imaginaires. Le roman est trop littéraire pour évoquer la réalité du monde social.
Comment faire, alors, pour évoquer par la littérature — c’est-à-dire par les mots — sans faire de la littérature esthétisante et mensongère ? C’est d’abord, pour Ernaux, refuser la recherche d’une littérature exceptionnelle, renoncer à ses rêves d’enfant qui imaginait la littérature comme moyen d’élévation personnel (« Elle imaginait aussi le livre fini comme la révélation aux autres de son être profond, un accomplissement supérieur, une gloire6. »). C’est assumer une littérature non fictionnelle, prosaïque, réelle. Ainsi Ernaux écrit-elle sur ses parents, sur leur personnalité, leurs singularités, mais en replaçant leurs parcours individuels dans l’histoire collective, par exemple en montrant comment leur rêve de sortir enfin de leur condition précaire d’ouvrier, d’avoir leur commerce à eux, résonnait à l’époque avec l’espoir partagé par tous les prolétaires d’une vie meilleure, un espoir porté par le Front populaire et l’été 1936. Espoir éphémère dans les deux cas, avec le retour à la dureté d’une vie toujours précaire… L’écriture d’Ernaux réunit ainsi la petite et la grande Histoire. Ironie du sort, la mère d’Annie Ernaux, choquée par Les Armoires vides, se protègera de la réalité décrite par sa fille (leur milieu social, son avortement), en prétendant ne lire la publication de sa fille que comme un roman, c’est-à-dire comme une fiction. Tout ça n’est que littérature…
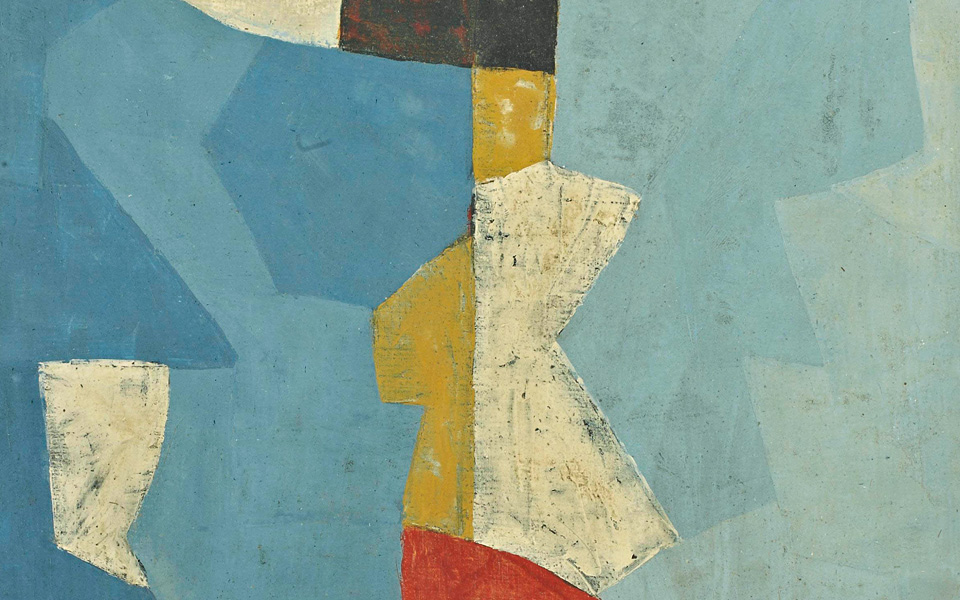
(Serge Poliakoff)
Les choix stylistiques d’une transfuge de classe
Renoncer au roman, c’est aussi renoncer à la littérarité, cette langue qui se signale comme supérieure parce que littéraire. Il faut insister sur ce point : le choix de ce qu’on appelle l’« écriture plate » ou l’« écriture blanche » d’Ernaux, pour désigner une langue qui paraît a priori très simple, sans images, sans fioritures littéraires, est un choix social. Ernaux pose à plusieurs reprises clairement le problème : comment écrire quand on est issue d’un milieu populaire où la langue littéraire est une langue scolaire et étrangère, mais qu’en même temps on vit en enseignant et en expliquant cette langue ? Une telle narratrice peut-elle échapper aussi bien au misérabilisme, ce qui voudrait dire négliger une langue populaire jugée inférieure parce que dominée, qu’au populisme qui mettrait en valeur, par exemple, le patois ou les régionalismes normands employés par ses parents, comme vifs et colorés alors même qu’elle-même ne parle plus ainsi ? Choisir l’un, n’est-ce pas passer dans le camp ennemi ? Choisir l’autre, n’est-ce pas être hypocrite ? Les premiers écrits d’Ernaux, comme Les Armoires vides, optent plutôt pour une langue qu’on pourrait qualifier de populaire, bien que le terme, comme l’a signalé Bourdieu, uniformise facticement une variété de parlers. Il s’agit en tout cas d’une langue qui met à mal les canons de beauté littéraires. Le lexique est familier, les tournures oralisantes sont fréquentes (comme la reprise du sujet par un pronom personnel : « Mon père, il est jeune, il est grand, il domine l’ensemble »), le rythme et la syntaxe sont irréguliers, avec une alternance de longues phrases qui miment le flot de pensée de la narratrice, et de phrases très brèves, souvent averbales7.
« C’est en tout cas la langue qui peut potentiellement s’adresser à tous. »
Ce choix stylistique évolue. Ernaux renonce aussi bien aux artifices d’une langue pseudo-populaire qu’à ceux de la langue littéraire. Elle choisit l’écriture plate qu’elle employait pour écrire à ses parents, une langue qui a peu recours aux figures de style, à la syntaxe brève, régulière, qui permet de parler aux autres. L’écriture blanche est un choix militant. Est-ce la langue « de tous », comme l’écrit Ernaux dans Les Années8 ? C’est en tout cas la langue qui peut potentiellement s’adresser à tous. Cette langue n’est pas identifiable comme littéraire, elle n’est pas a priori rangée dans une case destinée à un certain type de lecteurs et de lectrices. C’est une langue qui refuse certaines superficialités formelles qui, en créant une complicité avec le lecteur lettré, excluraient d’autres types de lecteurs. Ainsi, Ernaux refuse le passé simple, qu’elle identifie, comme Barthes9, à un signal imposé : s’il y a passé simple, il y a littérature. Elle lui préfère l’imparfait mais surtout le présent et le passé composé, qui ne sont pas seulement des temps plus simples, mais des temps de la prise de parole au discours direct, qui font entendre la narration en cours, qui relient l’acte de raconter et l’acte de lire. Ernaux substitue une complicité à une autre, celle du plaisir de la reconnaissance d’un code littéraire à l’émotion éprouvée par l’expression simple et directe d’une formule pertinente.
De même, Annie Ernaux utilise l’italique de manière toute personnelle. Si l’italique est souvent employée en littérature pour indiquer au lecteur des jeux de biais, d’implicite (c’est le cas par exemple avec l’ironie : l’italique signale qu’il y a quelque chose d’autre à lire au-delà du discours explicite), Ernaux emploie l’italique non pas pour suggérer mais pour souligner. L’italique attire ainsi notre attention sur des mots qui peuvent sembler banals, bien loin d’une rhétorique littéraire, qu’il s’agisse de tournures sociolectales10 ou d’expressions populaires. Le procédé est très fréquent dans La Place : la narratrice évoque le monde de ses parents à partir de leur parlure, de leur manière de parler : des expressions figées, des proverbes, mis en valeur par l’italique. Les discours directs apparaissent souvent détachés typographiquement, au milieu de paragraphes descriptifs. Ce sont les mots qui disent le caractère difficile du grand-père, la domination du mari (« Sa femme ne riait pas tous les jours »), l’acceptation résignée ou angoissée de la vie précaire (« Il y avait plus malheureux que nous », « On ne peut pas être plus heureux qu’on est », « Comment ça va finir tout ça »), le rapport à la politique (« le grand Charles »), l’aspiration à la retraite pour « profiter un peu de l’existence ». L’italique souligne souvent aussi l’éternelle opposition sociale, la confrontation des deux mondes. Alors que le père s’inquiète de bien recevoir les amies de sa fille, et adopte instinctivement à leur égard un ton déférent (« Est-ce que mademoiselle Geneviève aime les tomates ? »), les amies s’adaptent tout aussi instinctivement, malgré elles, à sa position sociale et à sa prise de parole : « Bonjour monsieur, comment ça va-ti ? » Ernaux souligne l’intérêt, la profondeur et la portée individuelle et sociale de ces choix langagiers, de ces expressions populaires qu’on aurait pu croire banales ou anodines.

(Serge Poliakoff)
L’écriture plate est donc bien loin d’être une écriture de la facilité, du non-style compris comme non travail sur la langue. C’est un autre travail sur la langue. La langue romanesque cède le pas à la langue prosaïque et à la langue analytique qui ne veut pas embellir le réel, mais le nommer. Cela ne veut pas dire éradiquer les sensations, les sentiments — au contraire, l’écriture d’Annie Ernaux évoque toutes les passions, poussées à leur paroxysme —, mais les raconter sur le mode impersonnel. Peut-être est-ce encore une fois un choix militant. En effet, alors que les thèmes évoqués par Annie Ernaux pourraient être rangés dans ce que certains appellent avec dédain « la littérature féminine » (le témoignage, les histoires d’amour), son écriture, analytique, sociologique, empêche tout critique de parler de sensiblerie. Certains de ces critiques (bien souvent des hommes, comme le soulignait la sociologue Isabelle Charpentier11) ont ainsi reproché à l’auteure aussi bien son impudeur (alors que les écrivains masculins qui narrent à loisir leurs aventures sexuelles ont l’air de ne déranger personne) que sa froideur (une femme qui analyse n’est pas rationnelle, elle est froide). Ernaux, elle, assume ce mariage du prosaïque et de l’analyse.
« La langue romanesque cède le pas à la langue prosaïque et à la langue analytique qui ne veut pas embellir le réel, mais le nommer. »
Dans L’Occupation, le vocabulaire analytique, scientifique même (« idealtype12 », « transsubstantiation ») surgit au milieu des insultes (« Salope », « Restes-y, grand con, avec ta pouffiasse »). Ce vocabulaire sociologique permet d’analyser, de comprendre des comportements qui peuvent paraître anodins, des détails prosaïques, comme lorsque sa mère, qui vit chez sa fille et son gendre, réclame qu’on lui donne du ménage à faire : « En feignant de se considérer comme une employée, elle transformait instinctivement la domination culturelle, de ses enfants lisant Le Monde ou écoutant Bach, en une domination économique, imaginaire, de patron à ouvrier : une façon de se révolter13. » Mais les liens logiques ne sont pas systématiquement explicités par la narratrice. Ainsi dit-elle simplement de sa mère : « Elle est morte huit jours avant Simone de Beauvoir14. » Pourquoi ? Au lecteur, à la lectrice de s’interroger sur ce rapprochement. De même, l’opposition saisissante des images de deux mondes sociaux différents suggère la différence entre la vie de la fille et celle du père, mais sans s’attarder : « Ses mots et ses idées n’avaient pas cours dans les salles de français ou de philo, les séjours à canapé de velours rouge des amies de classe. L’été, par la fenêtre ouverte de ma chambre, j’entendais le bruit de sa bêche aplatissant régulièrement la terre retournée15. » Expliquer pour faire comprendre, suggérer pour faire sentir. Ernaux a parlé de « l’écriture comme un couteau ». Ce serait l’écriture qui, en trouvant la bonne « distance objectivante » ne nous permettrait pas d’échapper au réel.
Du singulier au collectif ; du je au ils, elles, nous…
Ce dépassement du singulier, cette recherche objective de soi-même, Annie Ernaux la poursuit dans des romans qu’on range trop rapidement dans la série des œuvres « intimes ». Sous sa plume, intime et social ne s’opposent pas. On le remarque dans toutes ses histoires de femmes : l’aménorrhée (Ce qu’ils disent ou rien), les premières relations sexuelles, l’anorexie, la boulimie (Mémoire de fille), l’avortement (L’Événement), la maternité (La Femme gelée) la maladie, qu’il s’agisse de ses propres maladies, de l’Alzheimer dont a souffert sa mère, ou du cancer du sein (L’Autre fille, Une Femme, L’Usage de la photo). Par un jeu de balancement constant du singulier au pluriel, Annie Ernaux souligne à quel point ces expériences de ce qui peut paraître le plus intime, le corps, sont sociales et collectives.
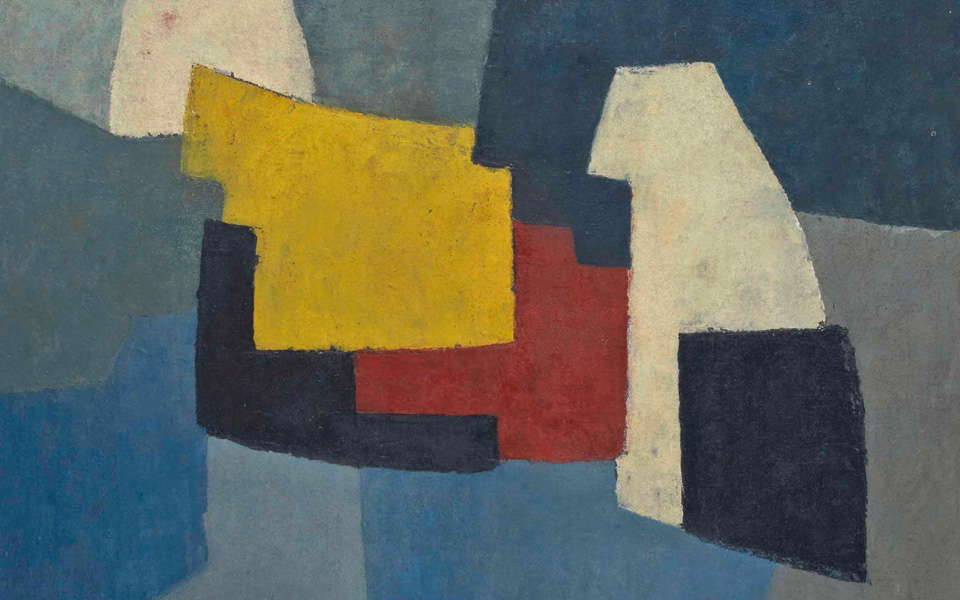
(Serge Poliakoff)
Le récit de l’avortement est celui qui emblématise le mieux ce décentrement vers le collectif. Raconter les étapes d’un avortement conduit dans la clandestinité du début des années 1960 (L’Événement), c’est mettre des mots sur une réalité historique, sur le pouvoir oppressif de la loi sur le corps des femmes. C’est représenter ce que signifie concrètement l’avortement pour une jeune fille sans argent à l’époque : la vie quotidienne avec une sonde, l’humiliation du médicament refusé sans ordonnance, le fœtus expulsé dans les toilettes, le curetage-punition. La valse des hommes, méprisants, émoustillés, hargneux, autour de ce corps de jeune femme enceinte, la violence du chirurgien qui l’opère en hurlant « Je ne suis pas le plombier ! » Pour dévoiler cette réalité vécue par de nombreuses femmes, Ernaux explore les limites du dicible. Ainsi, elle ne se contente pas d’évoquer le symbole de l’avortement clandestin, les « grandes aiguilles, bleu électrique », elle décrit avec une extrême précision le geste de la femme forcée d’agir seule : « J’ai glissé l’aiguille à tricoter dans mon sexe avec précaution. Je tâtonnais sans trouver le col de l’utérus et je ne pouvais m’empêcher d’arrêter dès que je ressentais de la douleur. » L’intérêt politique d’un pareil choix littéraire est théorisé dans le livre même : « Il n’y a pas de vérité inférieure. Et si je ne vais pas jusqu’au bout de la relation de cette expérience, je contribue à obscurcir le destin des femmes et je me range du côté de la domination masculine du monde. » À la hiérarchie du monde social, celle qui oppose les hommes aux femmes, les nantis aux pauvres, Ernaux oppose le geste de l’écriture, qui expose ce qui était caché, qui souligne l’aspect politique de cette liberté qui reste à conquérir. Avorter, c’est aussi pour la narratrice lutter contre la terreur d’être rattrapée par un déterminisme de classe, l’idée d’un destin qui voulait qu’elle manque ses études en tombant enceinte hors mariage, le cauchemar d’une « fatalité de la transmission d’une pauvreté dont la fille enceinte était, au même titre que l’alcoolique, l’emblème. » Cette terreur est condensée par une image frappante — les images sont peu nombreuses dans les textes d’Ernaux, mais elles n’en sont que plus vives, elles condensent tout le sujet du livre : « J’étais rattrapée par le cul et ce qui poussait en moi c’était, d’une certaine manière, l’échec social. »
« Se reconnaître dans les autres, parmi les gens de sa classe ou de son sexe, peut provoquer aussi bien un sentiment de délivrance que de terreur. »
Annie Ernaux poursuit cette recherche d’un au-delà du « piège de l’individuel » y compris dans les expériences a priori les plus singulières comme la jalousie jusqu’à la folie (L’Occupation), la passion amoureuse et sexuelle jusqu’à l’épuisement (Passion simple, Se perdre), le deuil (L’Autre Fille, Une femme, Je ne suis pas sortie de ma nuit). Comment retrouver les autres dans les expériences intimes d’un individu ? Bien entendu, par la possible projection du lecteur dans ces sentiments. Mais aussi par la présence inattendue mais irréversible de réflexes sociaux dans nos expériences particulières. Ainsi la narratrice dévorée par l’image obsédante d’une rivale inconnue (L’Occupation) découvre-t-elle qu’on ne peut pas ne pas imaginer l’autre d’abord à partir de données descriptives sociales. La prétendue neutralité de ces données (âge, profession, lieu de vie) devient le point de départ des souffrances de la jalousie. Si la découverte de certaines caractéristiques communes entre celle qui est délaissée et celle qui est préférée par l’homme (dans ce cas, l’âge, 47 ans, le métier d’enseignante) est source de douleur, c’est parce qu’elle brise l’illusion de l’unicité de l’individu. Le choix amoureux est aussi un choix social, le choix d’un homme dans la trentaine qui préfère, pour des raisons de confort, une femme plus âgée. L’échec amoureux devient alors la cristallisation d’insécurités à la fois personnelles et sociales. Les moindres détails de la vie ou des comportements de l’autre, celle qui est préférée (« J’allais jusqu’à me sentir mortifiée qu’il puisse regarder chez l’autre femme la chaîne Paris-Première que je ne reçois pas »), sonnent comme des marques de distinctions sociales.
Ces mêmes interrogations sociales ressurgissent parmi les tourments amoureux décrits dans Passion Simple et Se perdre. Encore une fois, la réflexion sur l’autre, par exemple sur le statut de parvenu de S., l’amant soviétique, visible à travers son comportement proche du gigolo, son goût enfantin des marques, permet de se connaître soi. Aimer un parvenu, n’est-ce pas pour la narratrice retrouver « la partie la plus parvenue de [s]oi-même », retrouver l’adolescente grandie dans un milieu populaire qui est « avide de robes, de disques, et de voyages, privée de ces biens parmi les camarades qui les avaient16 » ? Mais se reconnaître dans les autres, parmi les gens de sa classe ou de son sexe, peut provoquer aussi bien un sentiment de délivrance que de terreur. C’est sur cette projection effarée, malgré soi, de soi dans les autres, que se clôt La Femme gelée : « Juste au bord, juste. Je vais bientôt ressembler à ces têtes marquées, pathétiques, qui me font horreur au salon de coiffure, quand je les vois renversées, avec leurs yeux clos, dans le bac à shampooing. Dans combien d’années. Au bord des rides qu’on ne peut plus cacher, des affaissements. » Retrouver jusque dans son intimité le déterminisme social, lutter contre ce même déterminisme : la lutte individuelle est une lutte contre le monde social.

(Serge Poliakoff)
« Ce sont les autres, qui […] nous révèlent à nous-mêmes. »
Ce souci de décentrement du singulier vers le social se développe et se transforme dans l’œuvre d’Ernaux. Dans La Vie extérieure, Journal du dehors, Regarde les lumières mon amour, la voix de la narratrice se limite presque à un point de focalisation, celui du regard vers le monde extérieur, celui des lieux publics, des transports en commun, des supermarchés. Il s’agit toujours de chercher sa vérité, mais aussi la vérité d’une société, d’une époque (« Et je suis sûre maintenant qu’on se découvre soi-même davantage en se promenant dans le monde extérieur que dans l’introspection du journal intime17. »). Le choix de l’appréhension de cette réalité est militant. C’est particulièrement net dans Regarde les lumières, mon amour, où Ernaux dévoile comme objet de représentation — et comme objet digne de valeur — un lieu prosaïque négligé aussi bien par la littérature qu’inconnu de nombreux politiciens et de leurs experts : les hypermarchés. Ernaux cite des statistiques : depuis une quarantaine d’années, la majorité des gens s’y rend environ cinquante fois par an. Elle peut donc en conclure que « Tous ceux qui n’ont jamais mis les pieds dans un hypermarché ne connaissent pas la réalité sociale de la France d’aujourd’hui. » Or les hypermarchés ne sont pas selon elle un simple lieu de consommation, mais « un grand rendez-vous humain comme spectacle ». C’est bien ce que montre le titre même : Regarde les lumières, mon amour, phrase qui, hors contexte, pourrait renvoyer à l’univers romanesque, à un ciel étoilé, aux gratte-ciel brillants de New York, à un dialogue romantique. Or, dans l’ouvrage d’Ernaux, la phrase prend place dans le discours d’une mère qui, poussant son caddie, sourit à sa fillette en lui désignant les décorations de Noël de l’hypermarché de banlieue. Le lieu prosaïque de l’hypermarché devient digne d’intérêt, tout comme les personnes qui l’occupent, comme cette mère tendre, comme ce vieil homme « comme un scarabée admirable venu braver les dangers d’un territoire étranger pour rapporter sa nourriture ».
« La violence sociale est partout, cachée sous la séduction marketing de la viande à un euro, l’invocation du respect des clients pour multiplier surveillances et interdictions. »
Populisme alors ? S’agit-il de faire de l’hypermarché un lieu de beauté et de bonté sous prétexte que c’est un lieu populaire ? Non pas. Ernaux montre, encore et toujours, la violence sociale et la violence contre les femmes. Le supermarché ressemble à une miniature du monde social. La violence sociale est partout, cachée sous la séduction marketing de la viande à un euro, l’invocation du respect des clients pour multiplier surveillances et interdictions. Et cette domination s’exerce d’abord sur les femmes, qu’elles soient caissières, acheteuses ou cibles du marketing, dans une peinture modernisée du Bonheur des Dames. Toutes ces scènes de séduction, de domination, de violence dans l’hypermarché peuvent être mieux comprises une fois mises en rapport avec le reste du monde social — qu’il s’agisse des incendies et effondrements d’usines de textile au Bangladesh, usines qui fabriquent entre autres des vêtements vendus dans les hypermarchés (ces empires de la famille Mulliez) ou des conversations de ces hommes qui s’amusent de constater que leurs mères remplissent toujours leurs frigidaires, à leur âge : « Ils en riaient de satisfaction. D’être restés, quelque part, des nourrissons. »
Les Années et Mémoire de fille poursuivent cette relation dialectique entre l’histoire individuelle et l’Histoire, en réunissant le temps du passé et le temps du présent. La narratrice interroge le lien entre celle qu’elle était dans le passé et celle qu’elle est dans le présent, entre le temps d’hier et celui d’aujourd’hui. Dans Les Années, les photos de la narratrice, bébé, enfant, jeune fille, femme mûre, mère, grand-mère, âgée, matérialisent cette imbrication du passé et du présent. Ces photos sont la source d’une profusion d’images, celles des autres, des paysages, des objets, des attitudes, des scènes, des langues. Les Années forme ainsi une fresque qui va de l’après-guerre, avec ses repas de fête et ses paysages dévastés, à la première décennie du XXIe siècle et ses frénésies technologiques. Au milieu des détails de la vie intime de la narratrice et de sa famille défilent les évocations de l’effondrement de l’URSS, du 11 septembre, du passage à l’euro. Dans Mémoire de fille, le lien entre passé et présent est plus difficile à établir. Il prend la forme d’une quête. La femme mûre de 2014 regarde avec distance la fille qu’elle était en 1958, cette fille qui a quitté pour la première fois le foyer pour être monitrice dans une colonie, pour qui la découverte d’un autre monde a rimé avec violence et humiliation sexuelle : « Suis-je elle ? » Comment la comprendre ?, se demande la narratrice de 2014 en consultant, décrivant, citant photos, journal intime, correspondance de la fille de 1958. Comment savoir quel effet a produit, sur cette jeune femme de 1958, traitée d’idiote et de putain, la lecture du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir ? « J’opte pour l’indécision : d’avoir reçu les clefs pour comprendre la honte ne donne pas le pouvoir de l’effacer. » L’écriture ne trouve pas toujours de réponses.

(Serge Poliakoff)
L’expérience est à la fois riche et imparfaite. Ainsi en 1958, obsédée par les garçons et par son avenir individuel, cette fille ne pense rien de la guerre d’Algérie. Comment combler ces lacunes ? Comment représenter une réalité sous le prisme individuel, sans l’y réduire pour autant ? En multipliant, reprenant, complétant. En témoignent les reprises fréquentes, dans l’œuvre d’Ernaux, des mêmes sujets, vus de manières différentes. Ainsi, Passion simple et Se perdre évoquent la même passion dévastatrice, tout comme Une Femme et Je ne suis pas sortie de ma nuit évoquent la mère d’Annie Ernaux, sa maladie et sa mort. L’écrivaine a en effet décidé de publier, après des ouvrages plus travaillés, ses journaux intimes. Ils mettent à jour un désespoir brut insoutenable. C’est une manière de déstabiliser le lecteur et de repousser encore les limites de la littérature : elle ne nous offre pas le réconfort artificiel de la clôture, de l’œuvre terminée, achevée. Tant que la vie n’est pas achevée, l’événement pourra prendre un autre sens, un autre éclairage, être vécu différemment. C’est ce que montre la distance du journal à l’œuvre, ou d’une œuvre à une autre.
« Comment représenter une réalité sous le prisme individuel, sans l’y réduire pour autant ? »
Ainsi, dans Les Années, un paragraphe résume la trame de L’Occupation, mais en l’analysant différemment. La jalousie est comprise cette fois-ci par rapport à la trame des Années, au cycle de la vie, au temps qui passe : « une jalousie vis-à-vis de la nouvelle compagne d’âge mûr du jeune homme, comme si elle avait besoin d’occuper le temps libéré par la retraite — ou de redevenir “jeune” grâce à une souffrance amoureuse qu’il ne lui avait jamais procurée quand ils étaient ensemble […] ». De même, dans La Vie extérieure, la maladresse de D., qui maladroitement croit briller socialement en faisant remarquer ses vêtements, fait revoir autrement, socialement, l’amant soviétique parvenu qui, dans Passion simple et Se perdre, citait fièrement avec son accent slave la marque de chacun de ses vêtements en se rhabillant : « Comme les pièces d’armure d’un chevalier du Moyen Âge réendossés religieusement. Dessous, il avait un marcel blanc et un slip informe des pays de l’Est. » Et Mémoire de fille, le dernier livre d’Ernaux, n’est-il pas l’aboutissement d’une histoire — celle de la violence des premières expériences sexuelles, éprouvée par le corps féminin, intégrée dans cette peau qui sort de l’enfance — sans cesse suggérée depuis Ce qu’ils disent ou rien ?
Se retrouver dans les autres… connaître sa vérité grâce à celle des autres… C’est une vieille idée. La tarte à la crème de la critique littéraire, qui affirme encore que l’expérience la plus intime du « je » contient l’universel dans lequel chacun peut se retrouver. Idée largement rebattue, et versée souvent parmi un florilège de citations : Montaigne n’écrivait-il pas que tout homme « porte en lui la forme entière de l’humaine condition » ? Baudelaire : « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ». Et Hugo d’ajouter : « Insensé qui crois que je ne suis pas toi ! » Pourtant, dans l’œuvre Annie Ernaux le décentrement du singulier vers le collectif n’a rien d’un universel abstrait. Il ne s’agit pas de n’importe quels autres, de n’importe quelle histoire, de n’importe quel collectif, mais d’une vision du monde orientée politiquement. Le point de focalisation, qui ne se laisse pas oublier, est celui d’une femme. Une femme issue d’un milieu social populaire, engagée politiquement. Ainsi, reconnaît-on peut-être la crainte d’une femme dans la réflexion qui suit la description d’un parking souterrain : « On n’entendrait pas les cris en cas de viol14. » Ainsi n’est-il pas à la portée de tous de se reconnaître dans le « on », ou le « nous » marqué politiquement des Années, ce « nous » déçu par Mitterrand par exemple (« Nous qui avions rompu avec Mitterrand quand nous l’avions vu apparaître sur l’écran et proférer d’une voix blanche Les armes vont parler
[…] »). Chacun ne partage peut-être pas l’émotion ressentie par la narratrice lorsqu’elle dépeint l’humiliation de la vieille caissière par la surveillante et la cliente mécontente (Journal du dehors). L’un des ouvrages les plus engagés d’Ernaux, celui où son point de vue s’affirme particulièrement, est sans doute La Vie extérieure, où l’évocation des hommes et des femmes à la rue, morts de froid, mendiant dans le métro, revient de manière lancinante. La Vie extérieure est un livre noir, qui représente une époque où les moments d’espoir ont fait place aux scènes de déréliction extrême. Cette misère est directement mise en lien avec l’attitude de certains hommes politiques, qu’elle n’hésite pas à nommer.
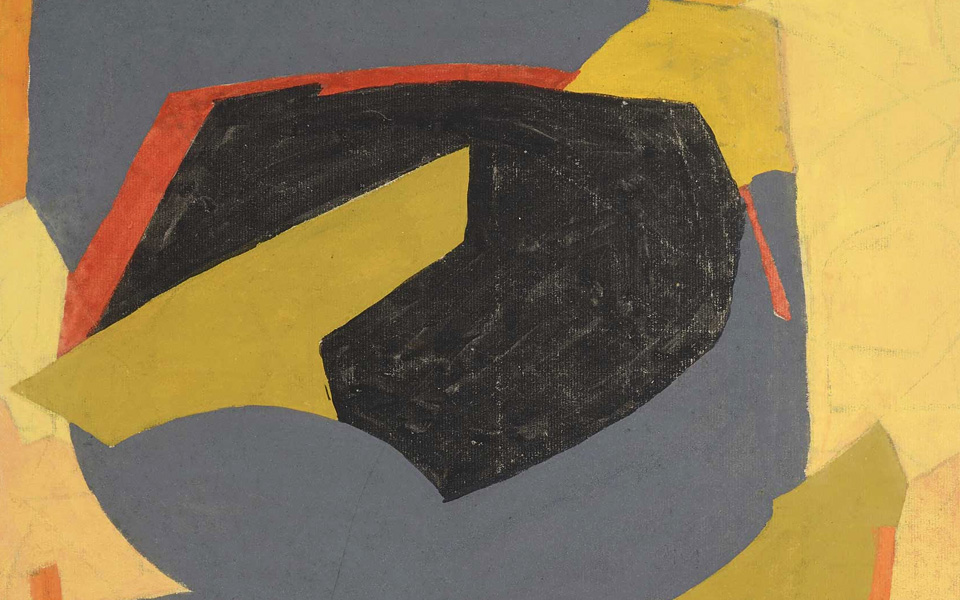
(Serge Poliakoff)
Se reconnaître dans l’expérience, la sensibilité, le jugement de l’écriture d’Ernaux ne va donc pas de soi. Certes, il n’est pas besoin de se reconnaître dans une œuvre pour apprécier la qualité d’une écriture, la justesse d’une représentation. Mais l’œuvre d’Ernaux ne vise pas à accueillir confortablement le lecteur. Les effets de distance ou d’adéquation peuvent être à la fois d’une grande vérité et d’une grande violence. En témoigne l’incipit bouleversant de Mémoire de fille où Ernaux, pour la première fois, nous interpelle en utilisant la deuxième personne. Les premières lignes, à la troisième personne du pluriel (« Il y a des êtres qui sont submergés par la réalité des autres, leur façon de parler, de croiser les jambes, d’allumer une cigarette. Englués dans la présence des autres. Un jour, plutôt une nuit, ils sont emportés dans le désir et la volonté d’un seul Autre »), laissent brusquement la place à un « vous » dévastateur : « Puis l’Autre s’en va, vous avez cessé de lui plaire, il ne vous trouve plus d’intérêt. Il vous abandonne avec le réel, par exemple une culotte souillée. » La conjonction dans la même phrase de l’interpellation directe « vous » et du passage de l’abstrait au concret on ne peut plus prosaïque et féminin (la « culotte souillée ») est une plongée saisissante dans le réel, dans notre réel de femmes. Ce prologue peut se lire à la fois comme le résumé du livre et en même temps comme son contraire, puisqu’il se termine sur ses paroles de silence : « Vous vous promettez d’oublier tout et de ne jamais en parler à personne. » Est ce une épreuve vécue par la narratrice ou l’expérience vécue par la personne qui lit ces lignes ? L’ouvrage brise ce mutisme, l’écriture défie fièrement l’humiliation du silence : « Disproportion inouïe entre l’influence sur ma vie de deux nuits avec cet homme et le néant de ma présence dans la sienne. Je ne l’envie pas, c’est moi qui écris. » L’écriture comme revanche, l’écriture comme dépassement. C’est contre ce silence, contre tous les silences humiliés que la voix d’Annie Ernaux s’élève. Représenter, expliquer, mais aussi dénoncer : autant de défis que relève sa littérature. Il ne suffit pas de dire le monde, il faut aussi vouloir le transformer.
Illustration de bannière : Serge Poliakoff
Portrait d’Annie Ernaux : Yann Rabanier, pour Les Inrockuptibles (2016)
- Entretien accordé à Claire Devarrieux. Cf. « Annie Ernaux : “L’écriture, une aventure de l’être” », Libération, avril 2016.[↩]
- Cf. Isabelle Charpentier, « De corps à corps. Réceptions croisées d’Annie Ernaux », Politix, n° 27, 1994, p. 45-75.[↩]
- Annie Ernaux, L’Écriture comme un couteau, Paris, Folio, 2011.[↩]
- Annie Ernaux, Une femme, Paris, Folio, 1989.[↩]
- La Place a été écrit après la mort de son père ; Une Femme, après celle de sa mère.[↩]
- Annie Ernaux, Les Années, Paris, Folio, 2010.[↩]
- « Je ne pourrais pas écrire trois lignes d’affilée, je n’ai rien à dire sur Gide ni sur qui que ce soit, je suis factice, les bouteilles gaufrées à la devanture de chez mes parents, factice aussi Bornin avec ses mots suçotés, son sexe racorni, informe, ses mains me passent devant la figure, il sait sûrement, la face d’œuf grasse et vicieuse, il s’élargit, le flot de viandox est arrivé au bord de la bouche, j’ai bien serré les dents, si j’étais sortie, tout le monde aurait su que j’étais enceinte. La déchéance, c’est ça. Plutôt crever. » (Annie Ernaux, Les Armoires vides, Paris, Folio, 1984).[↩]
- Cf. « […] Elle n’écrirait jamais qu’à l’intérieur de sa langue, celle de tous, le seul outil avec lequel elle comptait agir sur ce qui la révoltait » (Annie Ernaux, Les Années, op. cit.).[↩]
- Cf. « Le passé simple fait donc partie d’un système de sécurité des Belles-Lettres. Image d’un ordre, il constitue l’un de ces nombreux pactes formels établis entre l’écrivain et la société, pour la justification de l’un et la sérénité de l’autre. Le passé simple signifie une création : c’est-à-dire qu’il la signale et l’impose » (Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, Paris, Points, 2014).[↩]
- On appelle « sociolecte » un dialecte social, c’est-à-dire une façon de parler caractéristique d’une classe sociale.[↩]
- « En effet, depuis 1974 et tous supports confondus, on n’a relevé sur Ernaux aucun article franchement défavorable rédigé par une femme » (Isabelle Charpentier, op. cit.).[↩]
- L’« idealtype » ou « idéal-type » est un outil sociologique formé par Max Weber. L’idealtype est une opération synthétique d’éléments communs à plusieurs phénomènes. Il fonctionne sur un double mouvement d’abstraction et de généralisation.[↩]
- Annie Ernaux, Une Femme, op. cit.[↩]
- Ibid.[↩][↩]
- Annie Ernaux, La Place, Paris, Folio, 1986.[↩]
- Annie Ernaux, Passion simple, Paris, Folio, 1994.[↩]
- Annie Ernaux, Journal du dehors, Paris, Folio, 1995.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Assia Djebar — la mémoire est une voix de femme », Jonathan Delaunay, avril 2017
☰ Lire notre entretien avec Wajdi Mouawad : « Je viens d’une histoire qui ne se raconte pas », mars 2017
☰ Lire notre abécédaire de Pierre Bourdieu, janvier 2017
☰ Lire notre article « Svetlana Alexievitch, quand l’histoire des femmes reste un champ de bataille », Laélia Véron, janvier 2016
☰ Lire notre entretien avec Édouard Louis : « Mon livre a été écrit pour rendre justice aux dominés », janvier 2015


