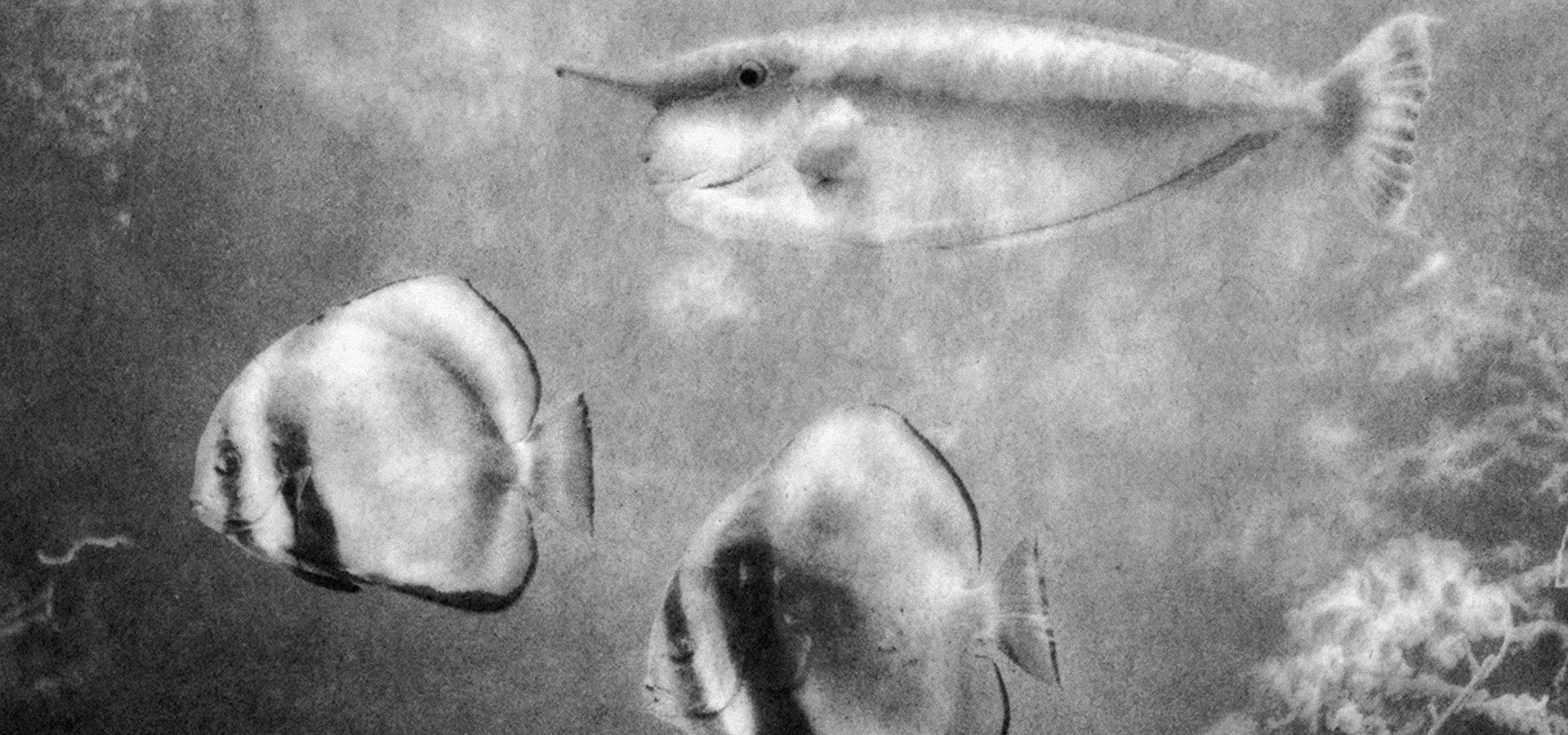Texte inédit | Ballast
Notre ordre s’en verrait tout entier menacé, écrivait Alain dans Les Dieux, dès l’instant où nous accepterions l’idée que l’animal nous voit. « C’est aux travaux sur la bête que l’homme apprend à ne pas penser. Il se détourne ; et il y a du fanatisme dans ce mouvement. L’animal ne peut être un ami, ni même un ennemi ; n’en parlons plus, parlons d’autre chose, ou parlons sans penser. » En la matière, le philosophe ne s’était pas trompé. De regards et de pensées, il est question ici à la faveur de trois rencontres : un ours, un crocodile et un loup. Et celles-ci de tracer l’esquisse d’une autre relation à autrui — politique et poétique. ☰ Par Roméo Bondon

« Une politique oscillant entre visible et invisible, donnant sens à l’accueil, pourrait dès lors être une piste à suivre. »
On peut trouver vain de chercher la catégorie définitive pour décrire tel ou tel animal ; pour cause : c’est en mouvement que les animaux vivent, habitent et meurent. Bien que le graphite ou le pinceau miment avec précision l’agitation d’un personnage, c’est immobile — autant que soi les regardant —, sur une feuille, que l’on croise tout jeune les animaux de nos bandes dessinées. Notre appréhension en est déterminée, et ce n’est qu’au gré de rencontres fortuites ou provoquées que nos certitudes peuvent évoluer. Et là, souvent, tout s’effondre : le canidé ne chevauche plus l’équidé comme sur la page de l’album mais est tenu en laisse, pourchassé ou célébré, tandis qu’au loin l’oiseau disparaît en silence. Les mots, alors, manquent pour saisir l’ampleur du désastre. Ça n’est pas seulement que l’on ne sait ou ne peut plus voir, comme le pensent certains, mais que les conditions de la rencontre ont changé.
C’est pour cela qu’il convient de prêter attention à une série d’expériences limites, et en un certain sens radicales, afin de saisir ce qu’elles disent des relations entre humains et animaux2, et ce qu’en disent, en retour, leurs acteurs. Les rencontres de l’anthropologue Nastassja Martin avec un ours3, de l’écoféministe Val Plumwood avec un crocodile4 et du philosophe Baptiste Morizot avec un loup5 nous serviront de ressources. Comparer ces différentes expériences permettra de définir une poétique de la rencontre individuelle entre humains et animaux. Celle-ci répond à un contexte singulier : les animaux concernés sont des prédateurs et les rencontres, qu’elles soient souhaitées ou non, se déroulent dans le milieu de vie de l’animal. Si une telle ébauche structurale présente des écueils certains, il reste fécond de plonger dans le récit comme on peut le faire parmi les bulles et les cases. Il s’agira toutefois de s’extraire d’un contexte donné comme de catégories éculées pour, du poétique au politique, interroger l’épreuve collective que constitue l’intrusion d’animaux au sein d’une ville, d’un quotidien, d’une habitude — épreuve décisive pour définir une vie commune avec les animaux, dans le contact comme dans le retrait. Une politique oscillant entre visible et invisible, donnant sens à l’accueil, pourrait dès lors être une piste à suivre.

[Sophie Alyz]
Rejouer le temps du mythe
Tandis qu’il se prêtait au jeu de l’entretien-fleuve avec un jeune élève, Claude Lévi-Strauss répondit en ces termes lorsque celui-ci lui demanda de définir le mythe : « Si vous interrogiez un Indien américain, il y aurait de fortes chances qu’il vous réponde : une histoire du temps où les hommes et les animaux n’étaient pas encore distincts6. » Si l’anthropologue souscrit à cette proposition, c’est pour en souligner l’aspect tragique : vivre avec des semblables mais ne pouvoir communiquer avec eux. Certains naturalistes, philosophes et ethnologues tentent de saisir ce moment mythique en une époque qui l’est pourtant bien peu. Trois récits de ces tentatives nous semblent les plus révélateurs de ce qui se joue lorsque le temps du mythe est, de manière intentionnelle ou non, remobilisé.
« Si vous interrogiez un Indien américain, il y aurait de fortes chances qu’il vous réponde : une histoire du temps où les hommes et les animaux n’étaient pas encore distincts. »
« Ce jour-là, le 25 août 2015, l’événement n’est pas : un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L’événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête, qui en se confrontant ouvrent des failles sur leur corps et dans leur tête. C’est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité ; le jadis qui rejoint l’actuel ; le rêve qui rejoint l’incarné. » Nastassja Martin assume ici ce qui, pour elle, n’est pas de l’ordre de l’affrontement, mais bien de la rencontre entre deux êtres vivants. Celle-ci a tout du hasard : elle, marchant sur un plateau glacé afin d’échapper un instant à la pression qu’exercent malgré eux ses hôtes évènes ; lui, l’ours, loin de toute forêt et rivière, comme errant dans le sens du vent. D’ours, elle n’a cessé de rêver les jours précédant l’événement. « [J]e ne me sens plus vraiment moi-même, je me transforme en rêve de plus en plus régulièrement », écrit-elle alors sur l’un de ses cahiers de notes, seul lien lui promettant une distance avec ce qu’elle observe et vit, intervalle qui peu à peu se réduit. Si une date reste gravée, la rencontre est an-historique et les frontières temporelles se brouillent : « […] dans le cas isolé de la rencontre que je relate, les rêves rejoignent l’événement, les mythes entrent en résonance avec la réalité. » C’est même avec un lieu antérieur à l’Histoire qu’elle se sent le plus en adéquation pour accueillir l’expérience qui lui arrive, un lieu que parcourt « un temps proche de celui où les humains peignent la scène du puits à Lascaux. Un temps où moi et l’ours, mes mains dans ses poils et des dents sur ma peau, c’est une initiation mutuelle ; une négociation au sujet du monde dans lequel nous allons vivre ».
Val Plumwood se remémore également la date de sa rencontre avec un prédateur, au nord de l’Australie, comme d’un moment original et originel : c’était un jour de février 1985, tandis qu’elle pagayait « à bord de [son] canoë sur les eaux stagnantes ». La saison et les conditions météorologiques installent cependant une dimension mythique certaine : « Ce fut là, sous une pluie diluvienne réunifiant le ciel et la terre, que je fis une rencontre initiatique avec un crocodile. » Alors que, comme l’a soutenu l’historien des religions Mircea Eliade, c’est au sein d’une habitation, par un pilier, une colonne ou une ouverture donnant sur le ciel que l’union de la terre avec les cieux se matérialise dans nombre de cosmogonies7, c’est pour Val Plumwood une rencontre ponctuelle et inattendue, hors de toute construction humaine, qui assure ce lien mythologique. Réécrit à plusieurs reprises par l’autrice, cet événement a pris avec le temps et la répétition l’épaisseur du rite.
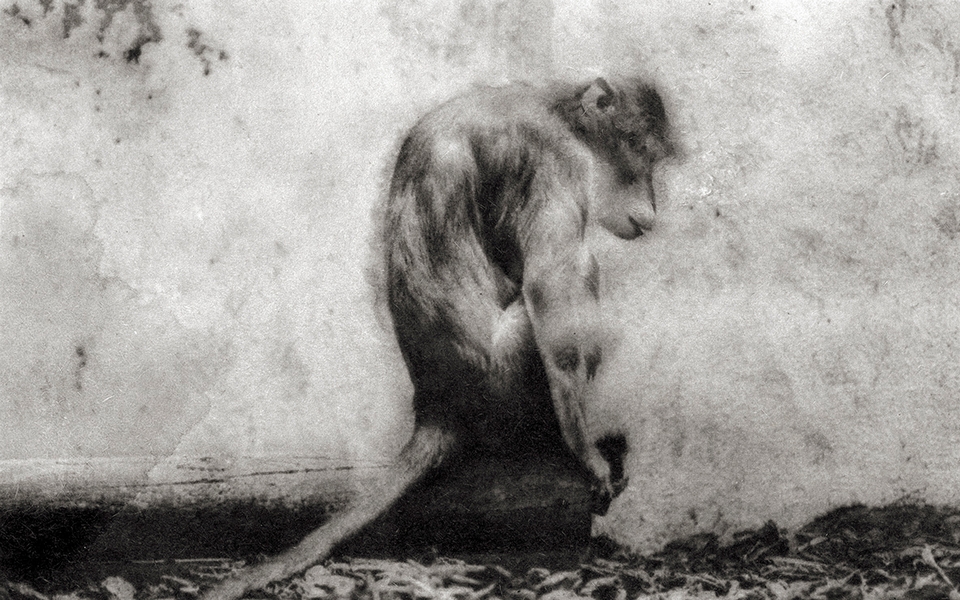
[Sophie Alyz]
C’est une dimension rituelle qu’explore lui aussi Baptiste Morizot dans sa pratique philosophique du pistage. La réflexivité ne vient toutefois pas seulement dans la rencontre et ce qui lui fait suite, mais prend place avant, la prépare. Le rite est institué avant la rencontre, de manière intentionnelle, et non par elle, de manière accidentelle. Ça n’est pas uniquement de l’événement que s’ouvrent les questionnements, mais aussi en amont de celui-ci, depuis les lectures, les rêves, l’imagination. Ainsi vient-il à la rencontre « conjointement pour tenir le loup loin des brebis et comprendre le moment critique, le drame nocturne où le loup entre en conflit avec les sociétés humaines — quand l’animal sauvage attaque l’animal domestique ». Des catégories sont identifiées, une dramaturgie prend place, un dualisme s’instaure : la rencontre organisée gagne en rigueur ce qu’elle perd en spontanéité. L’approche a été informée par l’expérience d’une cohorte de pratiquants ou de peuples qu’il considère comme des « diplomates8 », puis théorisée pour répondre à une recherche de sens. À l’inverse de Val Plumwood, le mythe ne se dessine pas tandis que le temps dilue la violence de la rencontre, mais est convoqué avant et pendant l’événement, pour mieux être questionné. Toutefois, l’imprévisibilité du comportement d’un animal, aussi normalisé soit-il par des conditions extérieures, l’habitude ou l’évolution, apporte son lot de surprises. Le mythe dès lors s’actualise. Et tout commence par un regard.
S’apercevoir
« Si nous devions réaliser le bonheur de tous ceux qui portent figure humaine et destiner à la mort tous nos semblables qui portent museau […], nous n’aurions certainement pas réalisé notre idéal. »
« Leurs yeux se rencontrèrent9 » : motif littéraire entre tous10, l’échange de regards entre deux protagonistes a irrigué le roman moderne. La vue, plus que tout autre sens, est mobilisée par la rencontre. Il en est de même lorsqu’un des protagonistes n’est pas humain. Val Plumwood, plus que quiconque, a insisté sur l’œil du prédateur qu’elle a dû affronter. Planche de bois ballottée par le courant, l’animal s’est révélé lorsque son regard a croisé celui de la philosophe. Le temps que leurs routes se rejoignent, elle a eu tout le loisir de détailler son interlocuteur. « L’œil du crocodile — du crocodile estuarien géant du nord de l’Australie — est pailleté d’or, reptilien, magnifique. Il a trois paupières. Il semble vous soupeser froidement, comme si vous ne l’impressionniez pas et qu’il avait pris la mesure de votre être. Toutefois, une étincelle étonnamment intense peut l’illuminer si vous parvenez à susciter son intérêt. » Attiré par la proie qui glisse sur l’eau à quelques mètres de lui, l’animal ne quitte pas la femme du regard : leurs chemins s’apprêtent à converger.
C’est là que Val Plumwood dit s’être rappelée la place qui serait la sienne dans la chaîne alimentaire et le fait qu’elle puisse, elle aussi, être de la nourriture. « Au moment où je plongeais mon regard dans celui du crocodile, je pris pourtant conscience que j’avais négligé cet aspect essentiel de l’existence humaine lors de mes préparatifs, et nettement sous-estimé la vulnérabilité qui était la mienne en tant qu’animal comestible. » Elle sera saisie à quatre reprises par les crocs de son assaillant, l’écoféministe ne s’échappant que grâce à un arbre auquel elle réussira à se pendre. La vulnérabilité inhérente à chaque vie, déniée par les conditions de vie occidentales, est rappelée dans la chair même de la philosophe. Mais, plus que la mâchoire du crocodile, c’est l’un de ses yeux qui a retenu avant tout son attention : « […] l’œil, un lieu depuis lequel parler, depuis lequel penser. » Aussi peut-on avancer avec elle la proposition suivante : cheminer avec un prédateur serait un pas pour une éthique environnementale matérialiste fondée sur une approche holistique11 des relations interspécifiques. L’autrice l’écrit en ces termes : « Je propose précisément de considérer cet imaginaire de la nourriture et de la mort avec lequel nous avons perdu contact comme une des pierres de touche permettant de ré-imaginer notre identité en termes écologiques, en tant que membres d’une communauté terrestre élargie et radicalement égalitaire. » L’égalité entre les êtres vivants, expression qui en rappelle une autre, du géographe libertaire Élisée Reclus cette fois : « Si nous devions réaliser le bonheur de tous ceux qui portent figure humaine et destiner à la mort tous nos semblables qui portent museau et ne diffèrent de nous que par un angle facial moins ouvert, nous n’aurions certainement pas réalisé notre idéal. Pour ma part, j’embrasse aussi les animaux dans mon affection de solidarité socialiste12. » Prémisses différentes mais conclusions similaires — l’une écologique, l’autre politique.

[Sophie Alyz]
C’est également depuis le regard de l’animal observé que naissent les écrits de Baptiste Morizot. À plusieurs reprises, il revient sur cette rencontre, attendue mais pourtant surprenante, faite avec un loup sur un terrain militaire du Var. Ce n’est alors pas la chaîne alimentaire qui est soulignée, mais une commune condition d’apex prédateur à l’humain et au loup. À l’affût parmi les pierres, il entend l’animal descendre la pente qui le surplombe. Celui-ci le fixe : « Il m’a examiné comme un égal. Face à face. » « D’homme à homme », dira-t-il plus loin. D’abord gêné de cette comparaison, il se dit ensuite certain que c’est là une clé de ce qui s’est joué entre lui et l’animal lorsque ce dernier a subitement disparu. Dans le regard de l’autre, le chercheur trouve un alter ego, pour qui la curiosité et l’empathie est permise — la pitié, même, si l’on se rappelle la définition qu’en donne Rousseau dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes : « la répugnance à voir souffrir son semblable ». Et parmi ces semblables, Lévi-Strauss l’a souligné, il y a aussi les animaux13. C’est bien comme tel que le loup qui fait face à Baptiste Morizot est reconnu : « Le eye contact révèle ce que ces animaux comprennent de ce que nous sommes. Ils nous attribuent une intériorité nous qui peinons tant à leur rendre cette politesse, que leur geste pourtant appelle : il n’y a qu’une intériorité pour en reconnaître une autre, parmi les rochers, les forêts, les nuages. » De là l’idée suivante : penser avec un loup, une reconnaissance politique de l’animal et un premier pas vers une relation diplomatique bilatérale.
« D’humain à humain comme d’ours à ours, ce sont deux êtres équivalents qui se sont aperçus et se sont confrontés. »
C’est aussi un semblable qu’a rencontré Nastassja Martin sur un plateau sibérien ; mais celui-ci eut comme particularité de s’être reconnu en elle et de ne pas avoir supporté le visage qu’il y vit. Il l’a alors déchiré. C’est de cette manière que Vassia, l’un des hôtes de l’anthropologue dans le Kamtchatka, interprète la rencontre de son amie avec l’ours et son issue : « Un ours qui croise le regard d’un homme cherchera toujours à effacer ce qu’il y voit. » Effacer non celui ou celle qu’il rencontre, mais bien ce qu’il perçoit de l’intérieur du regard dans lequel, malgré lui, il plonge. L’homme poursuit : « C’est pour ça qu’il attaque inévitablement s’il voit tes yeux. Tu l’as regardé dans les yeux, n’est-ce pas ? » Voilà comment il explique finalement l’attaque : « Les ours, ce qui les différencie de nous, c’est qu’ils ne peuvent pas se regarder en face. » D’humain à humain comme d’ours à ours, ce sont deux êtres équivalents qui se sont aperçus et se sont confrontés. Non qu’il y ait une hiérarchie entre les vivants ; c’est plutôt que certains se répondent avec plus de résonance. Ainsi, entrer dans la gueule de l’ours : ne plus comprendre ce que les genres et les espèces relatent ; entrevoir seulement le partage d’un événement avec un être qui, à cet instant, correspond à soi. Et l’écho se répercute sur des corps — humains ou non —, au sein de paysages et de territoires partagés ou disputés.
Habiter la limite
De ces trois récits, deux dimensions supplémentaires peuvent être soulignées : l’engagement du corps dans la rencontre, jusqu’à son altération pour Nastassja Martin et Val Plumwood, ainsi que le sentiment d’entrer dans un territoire qui n’est pas le sien. Cette transgression tient à l’animal concerné — un prédateur dans les trois cas —, mais aussi à une conception restreinte à sa seule appropriation de la notion de territoire. On doit à Vinciane Despret d’avoir récemment fait la généalogie de cette notion en ce qui concerne les études biologiques, écologiques et éthologiques sur les oiseaux14. Pour elle, le territoire déborde largement le cadre de l’appropriation : cet usage restreint à propos des animaux est contemporain de son apparition en droit, au XVIIIe siècle, et de la disparition de l’emploi des communs dans les sociétés rurales. Les recherches sur la territorialité des oiseaux depuis la naissance de ce questionnement ont montré une multitude d’hypothèses qui ont souvent dépendu de cette seule approche, projetant de façon générale sur le comportement des animaux des préoccupations humaines (insistance sur la séduction, la reproduction, la défense d’un lieu approprié face à un ennemi etc.). Si un territoire peut être défendu, accaparé ou assailli, il est avant tout habité. Dès lors son approche physique est à examiner.

[Sophie Alyz]
Les territoires mis en jeu dans les rencontres de Nastassja Martin, Val Plumwood et Baptiste Morizot sont approchés par un corps soit en mouvement et aux aguets, soit immobile et à l’affût. Leur appréhension dépend ainsi forcément de l’animal rencontré, mais aussi d’une perception proprement humaine de celui-ci et de l’idée que l’on se fait de son monde. L’anthropomorphisme, patent chez Nastassja Martin et Baptiste Morizot, n’est pas un écueil de leur part ; plutôt la retranscription depuis leur point de vue de l’événement qui a eu lieu. Mais, allant plus loin, ils postulent également qu’un même genre d’affect s’est produit pour l’animal en face d’eux. Pour Baptiste Morizot, c’est une manière de se mettre à la place de l’animal sans tricher avec ce qui est perçu, c’est le reconnaître comme égal. Il rejoint par là le philosophe canadien Brian Massumi, pour qui l’anthropomorphisme (la projection de caractères humains sur des animaux par identification avec eux), pour peu qu’il soit dissocié de l’anthropocentrisme (la primauté, dans toute situation ou raisonnement, des intérêts humains sur les non-humains), est une hypothèse de travail féconde dans la mesure où elle fait place au qualitatif et au subjectif, aux côtés des études éthologiques ou écologiques statistiques et quantitatives15.
« Raconter ces histoires de rencontres singulières reviendrait alors à peupler par les mots des territoires animaux qui restent peu accessibles autrement. »
Baptiste Morizot ajoute que cette piste mène, dans sa mise en récit, à une ouverture du sens : « La narration, structurellement, produit un ensauvagement sémantique16. » Raconter ces histoires de rencontres singulières reviendrait alors à peupler par les mots des territoires animaux qui restent peu accessibles autrement. Les êtres cherchés fuient, se terrent, se camouflent dans le paysage. Les bords de leurs mondes sont autant de seuils plus ou moins opaques selon la connaissance que l’on en a. Passer les limites de ces territoires revient alors à questionner d’un même élan celles entre les espèces, les catégories et les espaces. Les marques laissées sur les corps de Val Plumwood et Nastassja Martin sont peut-être la preuve que ce type de rencontre ne se fait pas sans un coût physique, un coup que le corps doit encaisser. Si l’anthropologue française écrit avoir souhaité fermer ses propres frontières, demandé « des nuits noires, silencieuses, dépeuplées », le choc avec l’ours a fait de ce monde clos une vaine armure. Pour citer de nouveau les quelques mots résumant l’histoire, « un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent ». Les limites tant conceptuelles que géographiques sont remobilisées, déplacées, distordues.
Ces trois récits nous montrent ainsi des expériences à la fois liminaires et limitrophes, jouant avec des lignes peu interrogées, solidement ancrées dans l’imaginaire. On peut suivre pour les bousculer la piste évoquée par Jacques Derrida : par la mise en évidence d’une « limitrophie », ce dernier entendait étudier « ce qui avoisine les limites mais aussi ce qui se nourrit, s’entretient, s’élève et s’éduque, se cultive aux bords de la limite […] ce qui pousse et croit à la limite, autour de la limite, en s’entretenant de la limite », mais aussi « ce qui nourrit la limite, la génère, la complique, l’élève et la complique17 ». Les relations entre humains et non humains sont par là remobilisées. Nous avons porté l’accent sur trois prédateurs, dont la rencontre tient autant à des contingences qu’à une attirance pour des êtres qui, par certains aspects, nous ressemblent. Pourtant, si l’on suit les propos éclairants de Jean-Christophe Bailly, « chaque animal est un frémissement de l’apparence et une entrée dans le monde18 » : se porter au-devant de l’animal, tout animal, pour en saisir le point de vue, « le parti pris », est une manière de changer de perspective, d’être informé différemment par des manières de faire autres qu’humaines19. Néanmoins, si la posture active du pisteur peut informer sur un rapport défensif de l’animal à son territoire, privilégier un simple accueil, comme celui pratiqué par l’observateur, pourrait permettre d’accéder à des animaux différents, et différemment. La curiosité n’est pas à proscrire, au contraire. Peut-être pourrait-elle trouver son soulagement dans une observation moins intrusive et plus réceptive.

[Sophie Alyz]
Par « habiter une limite », nous entendons ainsi cheminer là où les animaux surviennent, où par leur surgissement ils interrogent : au bord des champs, au sein des villes, à la lisière d’une forêt, auprès d’un ruisseau. Alors que les prédateurs entrevus ou étreints par Val Plumwood, Baptiste Morizot et Nastassja Martin informent sur un rapport existentiel et ontologique au monde, nous pensons que notre attention gagnerait à se porter sur ces animaux qui ne se cachent pas ou plus, mais habitent là où la pression humaine est la plus forte, s’en accommodant jusqu’à s’en servir. Saisir l’intrusion d’animaux inattendus au cœur de la cité — sangliers, renards, perruches à collier, parmi tant d’autres — nous permet d’entrevoir ainsi ce que pourrait être une manière d’habiter en commun avec ce qui est autre qu’humain.
Accueillir la nuisance : politique du voir
« Saisir l’intrusion d’animaux inattendus au cœur de la cité nous permet de passer du poétique au politique, et d’entrevoir ainsi ce que pourrait être une manière d’habiter en commun avec ce qui est autre qu’humain. »
Tirer les enseignements d’un ensemble de rencontres individuelles, de récits bien personnels n’est pas aisé. Certains animaux, plus que d’autres peut-être, ou qui ont simplement plus que d’autres suscité la réflexion, invitent à aller du singulier au collectif, d’une poétique au politique. Ainsi le loup guetté puis pisté par Baptiste Morizot n’est qu’un épiphénomène dans sa tentative diplomatique auprès d’une espèce en son ensemble. En se focalisant sur un animal particulier, il choisit de formaliser ce qu’il considère avant tout comme « un problème géopolitique », soit le retour d’une puissance un temps disparue sur le territoire français, et « un problème politique », en ce qu’il est saisi par des camps opposés16. Actant la caducité des modes de gestion classique de la faune sauvage — régulation par la chasse ou sanctuarisation par la protection de l’espace —, c’est une approche bilatérale qui est proposée : « La carte du nouveau mode d’interaction avec le loup, c’est la diplomatie. Le mode d’interaction, ou chemin de l’action que l’on peut en déduire, est la négociation. » C’est néanmoins de manière asymétrique que s’élabore cette dernière. La diplomatie relève d’une « compréhension fine des modes d’existence des autres animaux, et l’insertion dans leurs éthogrammes20 ».
Le philosophe décrit le loup comme une espèce cryptique, dont le mode d’apparition se fait en tant que « présence invisible ». Se mettre à la place d’un loup relève de l’expertise. On repère les traces, les morsures sur le bétail ou le gibier, mais peu sont ceux qui peuvent se targuer d’avoir aperçu l’animal en chair et en os. Or depuis quelques années les loups se donnent à voir au bord des routes ou près des sentiers : non qu’ils soient plus menaçants ou affamés qu’auparavant, mais leur population, plus nombreuse, ne peut résider dans les trop rares domaines laissés à la faune. Le caractère dispersant de l’espèce leur intime également de coloniser de nouveaux territoires. L’asymétrie diplomatique, sous la contrainte, s’équilibre en partie. Dès lors, ça n’est plus avec une espèce absente qu’il faut parlementer, mais avec des animaux qui se livrent ; non plus un compétiteur discret et abstrait, mais des semblables qui s’ouvrent, par leur présence, à la cohabitation. D’une espèce singulière à des individus particuliers. Ils gravitent désormais entre de ce que Sue Donaldson et Will Kymlicka ont qualifié de « sauvage » d’un côté et de « liminaire » de l’autre, soit des animaux qui ne font pas partie de la société humaine comme c’est le cas pour les animaux domestiques ou d’élevage, et qui ne sont pour autant pas complètement extérieurs à cette société21.

[Sophie Alyz]
Il semblerait que l’artificialisation des sols, la fragmentation des paysages ainsi que l’intrusion toujours plus forte des pratiques humaines dans les milieux naturels entraînent un développement important des espèces liminaires. Les images ont pu être fortes : ours polaires assaillant des poubelles aux abords d’une ville russe, sangliers trottinant auprès de touristes sur une plage ou de passants sur une place, renards allant de parc en parc à la recherche d’un lieu sûr où s’abriter… Les exemples ne manquent pas. C’est dans l’attention à ce qui survient auprès de nous que naît le traitement politique des relations aux animaux. Dépasser la rencontre individuelle implique de ne pas seulement aller voir, mais aussi d’accueillir ce qui trouble le cœur géographique du politique, la polis. De laisser une place à ce rat que l’on abhorre ou à ces goélands et mouettes qui survolent les villes littorales, pour penser avec eux, depuis leur inscription dans des territoires jusqu’alors considérés comme strictement humains.
« De laisser une place à ce rat que l’on abhorre ou à ces goélands et mouettes qui survolent les villes littorales, pour penser avec eux. »
Être ouvert ne signifie pas être dans une attente passive et flegmatique ; c’est plutôt la posture du naïf qui définirait le mieux une telle attitude. Ainsi de Mattis, le protagoniste du roman du Norvégien Tarjei Vesaas, Les Oiseaux. Une passée de bécasses survole un matin le personnage et tout en est transformé : « Et puis il y eut un petit bruit. Un cri soudain, étrange. Et en même temps, il perçut quelques brefs coups d’ailes rapides, là-haut, en l’air. Puis quelques appels étouffés dans un langage d’oiseau désemparé. Cela passa au-dessus de la maison. Mais cela passa aussi juste à travers Mattis22. » Réhabiliter la contemplation n’est pas faire de toutes et tous des êtres en attente, mais plutôt redonner sens à l’attention, propre à faire accepter l’accueil — d’une sensation, d’un événement, d’une personne. Ça n’est pas avec de la chevrotine que Mattis salua les bécasses, mais avec la place ample qu’il avait gardée en lui pour une telle rencontre. Son désir brûlant d’en partager le récit, avec sa sœur ou les autres villageois, ajoute à l’instant une durée dans le temps, en soi mais aussi pour les autres.
Ainsi la contemplation a‑t-elle cette fonction commune avec la poésie, celle de détourner un regard, de faire changer imperceptiblement la manière de considérer ce qui survient. Du politique, simplement esquissé faute de conclusions satisfaisantes, nous retournons au poétique : peut-être est-ce là un aveu d’échec, un manque qui ne peut être comblé. Ou bien est-ce une reconnaissance, celle d’une dimension que la poésie, malgré tout, persiste à embrasser de ses mots — mots auxquels la politique ne doit pas rester indifférente. Derrida l’a formulé ainsi : « La pensée de l’animal, s’il y en a, revient à la poésie23. »
Illustration de bannière et de vignette : Sophie Alyz
- Bestiaire pioché dans De capes et de crocs, d’Ayroles et Masbou, Gaston Lagaffe, de Franquin et Astérix et Obélix, de Goscinny et Uderzo.[↩]
- Le terme « animal » a été employé par commodité : « non-humain » n’est pas satisfaisant car il reproduit un dualisme laissant les humains dans un état d’exception ; « autre-qu’humain » conviendrait mieux, mais reste moins commode pour une lecture fluide. Il convient d’ajouter que si l’on emploie le terme au singulier, ce sera toujours d’un individu singulier qu’il sera question. L’animalité, comme l’ont montré Jacques Derrida et à sa suite Jean-Christophe Bailly, ne correspond à aucune essence.[↩]
- Nastassja Martin, « Vivre plus loin », Terrain, n° 66, 2016 ; Croire aux fauves, Verticales, 2019.[↩]
- Val Plumwood, « Human Vulnerability and the Experience of Being a Prey », Quadrant, vol. 39, n° 3, 1995 ; The Eye of the Crocodile, ANU Press, 2012, partiellement traduit par la revue Terrestres.[↩]
- Baptiste Morizot, Les Diplomates, Wildproject, 2016 ; Sur la piste animale, Actes Sud, 2018.[↩]
- Claude Lévi-Strauss et Didier Eribon, De près et de loin, Odile Jacob, 1988.[↩]
- Mircea Eliade, Le Sacré et le Profane, Gallimard, 1965.[↩]
- 15 d’entre eux interviennent au cours du livre éponyme, Les Diplomates, parmi lesquels saint François, l’éthologue Konrad Lorenz, l’écologue Lucy King, les chasseurs amérindiens des plaines, ou encore un des pionniers de l’éthique environnementale, le forestier Aldo Leopold.[↩]
- Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, Le Livre de poche, 1972.[↩]
- Jean Rousset, Leurs Yeux se rencontrèrent — La scène de première vue dans le roman, José Corti, 1981.[↩]
- Il est à noter que des débats récurrents ont lieu parmi les écologues à propos de la notion d’équilibre, d’inspiration holiste ; celle-ci est mise à mal depuis les années 1970 par l’émergence de l’écologie des perturbations, mettant en évidence la prégnance des déséquilibres au sein d’un milieu naturel donné. Par ailleurs la notion d’holisme est en elle-même sujette à caution en ce qu’elle nie au sein d’un tout, par son approche englobante, les particularités des parties.[↩]
- Élisée Reclus, lettre à Richard Health [1884], Les Grands Textes, Flammarion, 2014.[↩]
- Claude Lévi-Strauss, « Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’homme », Anthropologie structurale deux, Plon, 1973.[↩]
- Vinciane Despret, Habiter en oiseau, Actes Sud, 2019.[↩]
- Brian Massumi, Ce que les bêtes nous apprennent de la politique, éditions Dehors, 2019.[↩]
- Baptiste Morizot, Les Diplomates, Wildproject, 2016.[↩][↩]
- Jacques Derrida, L’Animal que donc je suis, Galilée, 2006.[↩]
- Jean-Christophe Bailly, Le Parti pris des animaux, Christian Bourgois, 2013.[↩]
- Sur le perspectivisme, voir Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, PUF, 2009.[↩]
- En éthologie, la science des comportements animaux, l’éthogramme est la liste exhaustive de ces comportements pour ce qui est d’un individu, d’un groupe ou d’une espèce.[↩]
- Sue Donaldson et Will Kymlicka, Zoopolis, Alma, 2016.[↩]
- Tarjei Vesaas, Les Oiseaux, éditions Plein chant, 2012.[↩]
- Jacques Derrida, op. cit.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Dalila Awada : « Si la justice exclut les animaux, elle demeure partielle », décembre 2019
☰ Lire notre article : « En quête de l’invisible : paradoxes animaux », Roméo Bondon, octobre 2019
☰ Lire notre article : « L’antispécisme ? Une politique de l’émancipation », Elias Boisjean, février 2019
☰ Lire notre entretien avec Sue Donaldson et Will Kymlicka : « Zoopolis — Penser une société sans exploitation animale », octobre 2018
☰ Lire notre entretien avec Yves Bonnardel et Axelle Playoust-Braure : « Les animaux au cœur de l’émancipation », Septembre 2018