Texte inédit pour le site de Ballast
À gauche, l’étiquette libérale lui colle volontiers à la peau. C’est qu’en écrivant des lignes pour le moins critiques sur Marx et en qualifiant le stalinisme de « totalitaire » au même titre que le régime hitlérien, Hannah Arendt s’est rendue infréquentable aux yeux du marxisme orthodoxe de son époque. Dans le même temps, les polémiques suscitées par la publication de son Essai sur la banalité du mal, consacré au « cas » Eichmann, et la sévérité du jugement qu’elle porte publiquement sur le mouvement sioniste l’ont parfois tenue à distance de sa communauté d’origine. Loin des vitrines déformantes qui la présentent le plus souvent, retour sur les engagements et les conceptions politiques de la penseuse qui, pourtant, se revendiquait à la fois de la tradition révolutionnaire et de la tradition juive. ☰ Par Lora Mariat

« Si
être philosopherevient à tendre vers l’universel, l’intemporel, l’inconditionnel, alors Arendt ne l’est assurément pas. »
Si « être philosophe » revient à tendre vers l’universel, l’intemporel, l’inconditionnel, alors Arendt ne l’est assurément pas. Pour elle, la pensée ne peut ni ne doit se désolidariser de l’existence et de son rapport concret au monde si elle veut faire sens : « Ma conviction est que la pensée elle-même naît d’événements de l’expérience vécue et doit leur demeurer liée comme aux seuls guides propres à l’orienter. » Une parabole de Kafka, qui décrit la bataille permanente de l’Homme installé dans une « brèche » entre passé et futur2, lui permet de disqualifier la quête d’absolu qui a animé la philosophie depuis Parménide et Platon jusqu’à Hegel, son espoir d’atteindre une posture de surplomb, hors de l’espace et du temps, de « s’évader des premières lignes pour se retrouver au-dessus de la mêlée » ; tout cela n’est pour Arendt qu’un rêve, une illusion toujours déçue. La pensée s’enracine dans un sol, duquel elle tire sa puissance de signification, et qui n’est autre que le présent, celui de la « ligne de combat » où nos existences se trouvent jetées.
Itinéraire d’une paria
Issue d’une famille juive dans l’Allemagne du début du XXe siècle, Arendt a été happée par son présent et comme poussée à ces conclusions par la force des choses. Le milieu universitaire qu’elle fréquente au moment où, au début des années 1930, les premières lois discriminatoires contre les Juifs sont adoptées dans l’Allemagne nazie, semble vouloir maintenir l’illusion d’une neutralité et d’une indépendance de la philosophie relativement au contexte politique. Or, comme l’écrira plus tard Arendt dans une lettre à son ami Jaspers, « La philosophie [n’est] pas tout à fait innocente3 ». Ne pas prendre position revient en fait toujours à accepter tacitement l’ordre des choses — à prendre position, donc, de facto. C’est l’hypocrisie de ce monde auquel elle appartenait alors qui la décida à rompre avec la philosophie académique : « Suivre le mouvement était pour ainsi dire la règle pour les intellectuels […]. Et cela, je n’ai jamais pu l’oublier. Je quittai l’Allemagne avec cette résolution, bien sûr un peu exagérée : plus jamais ! Jamais plus aucune histoire d’intellectuels ne me touchera. Je ne veux plus avoir affaire à cette société4. » La situation historique à laquelle son existence s’est trouvée liée pousse finalement Arendt à se tourner vers la politique, vers ce qu’elle appelle la vita activa — par opposition à la vita contemplativa —, loin de l’idéal, forgé par la tradition philosophique, d’une vie de spéculation pure dans laquelle les intellectuels qu’elle côtoie trouvent confortable de s’abriter. Elle s’y tourne, néanmoins, non en tant que philosophe (la « philosophie politique » est désormais un oxymore irrecevable à ses yeux5), mais en tant que simple « penseuse ».

[Robert Motherwell]
Ayant grandi dans l’atmosphère culturelle d’une famille assimilée, Arendt s’était d’abord désintéressée de son appartenance au judaïsme ; elle admet même que, jeune femme, elle « trouvait la soi-disant question juive
tout à fait assommante ». C’est encore une fois le contexte politique qui, en s’immisçant dans sa vie quotidienne, va l’obliger à « ouvri[r] les yeux sur ce problème » : « Lorsqu[e] […] le judaïsme allemand se vit obligé de réagir, dans son ensemble, contre l’isolement infligé par les lois d’exception, […] tous les Juifs, de gré ou de force, durent prendre conscience d’eux-mêmes en tant que Juifs ». Si la judéité est par la suite devenue un trait essentiel de son identité, en dépit de son indifférence initiale, si c’est comme « femme juive » qu’elle se présente6, c’est parce qu’« on ne peut se défendre que dans les termes de l’attaque », parce que « lorsqu’on est attaqué en tant que Juif, c’est en tant que Juif que l’on doit se défendre. Non en tant qu’Allemand, citoyen du monde ou même au nom des droits de l’homme4 ». Il ne s’agit pas, en d’autres termes, de contourner le problème spécifique qu’est l’antisémitisme en adoptant un discours universaliste surplombant ; il s’agit de se saisir du stigmate associé au nom de « Juif », et de le faire valoir contre la société dont les valeurs universalistes ont pourtant légitimé sa discrimination ; il s’agit de s’ériger en paria7.
« Ce qu’exige la lutte du Juif paria pour son émancipation, c’est au contraire la transformation complète de la société. »
Le paria, dont la figure fait irruption dans la littérature romantique à partir des années 1820, c’est alternativement la femme et l’ouvrier chez Flora Tristan, le Noir chez W. E. B. Du Bois, le Juif chez Bernard Lazare. Contrairement au « parvenu » qui a pleinement assimilé les valeurs de la société — celle-là même qui, pourtant, le rejette — et qui a su en tirer profit, le paria est « conscient » : il revendique son statut et s’en sert pour alimenter une critique radicale de la structure sociale qui produit son exclusion. La différence est de taille : le parvenu accepte de nier son identité pour accéder à la reconnaissance ; le paria refuse de payer ce prix. Bien plus, derrière la victoire apparente de sa promotion sociale individuelle, le parvenu fait en réalité obstacle à l’émancipation collective : son exemple entérine la raison adverse, puisqu’il constitue la preuve vivante qu’il est possible de se libérer d’une oppression en s’assimilant, en se conformant aux valeurs environnantes, en épousant la logique de l’oppresseur. Ce qu’exige la lutte du Juif paria pour son émancipation, c’est au contraire la transformation complète de la société, et en l’occurrence l’« admission des Juifs en tant que Juifs dans les rangs de l’humanité ».
Arendt renoue donc avec ses origines juives, non pas par la voie religieuse, ou même culturelle, mais bien par la voie politique : « Manifestement, l’appartenance au judaïsme était devenue mon problème, et mon problème était politique. Purement politique4 ! » Lorsqu’elle se rapproche, à la fin des années 1920, de la résistance sioniste, ce n’est pas motivée par des justifications théologiques ou idéologiques. La théologie, à ses yeux, est encore une de ces « histoire[s] d’intellectuels » avec lesquelles elle ne veut plus avoir affaire : ceux qui se satisfont d’un tel motif, exclusivement théorique, pour épouser la cause des Juifs, sont politiquement indéfendables, car « déconnect[és] des réalités de ce monde » — déconnectés de la réalité de la situation des Juifs d’Europe, mais aussi de la situation en Palestine, vers laquelle ils veulent émigrer « comme on pourrait avoir envie de fuir sur la lune », écrit Arendt. Si elle recourt bien plutôt à la figure du Juif paria pour rendre compte de son engagement, c’est parce que la conscience politique qu’il développe est le pur produit d’une expérience vécue — celle de l’oppression. Aux antipodes du sionisme d’un Theodor Herzl, nationaliste et révisionniste, qui s’imposera progressivement après la guerre8, Arendt prend part à un sionisme « révolutionnaire » ou libertaire, héritier de Bernard Lazare, dont le fondement n’est pas la revendication d’un territoire extérieur pour la fondation d’un État hébreu, mais la lutte contre des conditions sociales concrètes, l’organisation, sur le sol européen, de la résistance à l’isolement, la « mobilisation du peuple contre ses ennemis ».
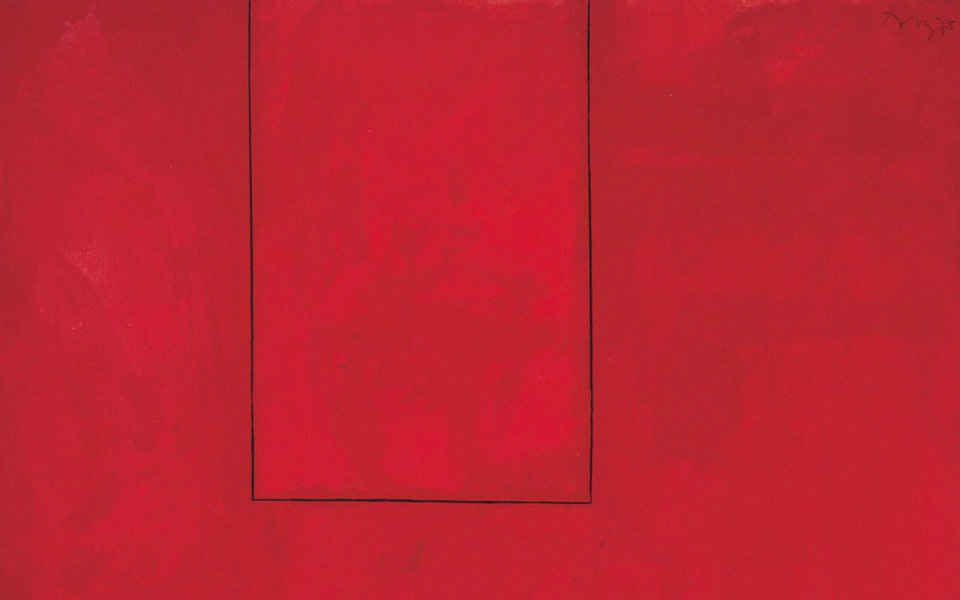
[Robert Motherwell]
Opposé à son homologue « parvenu », le Juif paria qui s’engage — pour des raisons plus pragmatiques qu’idéologiques — dans le mouvement sioniste est en ce sens plus proche des autres catégories qui, au sein de la société, subissent les « ignominies de l’exploitation capitaliste ». C’est leur position d’exclus qui fait d’eux de potentiels révolutionnaires, et il n’était pas rare alors d’hésiter entre ce sionisme révolutionnaire et le marxisme, tant les raisons qui poussaient à l’engagement en faveur de l’un ou de l’autre étaient proches. Les couples Arendt-Stern et Arendt-Blücher — Arendt connaîtra deux mariages — sont caractéristiques de cette proximité : alors que la rencontre d’Arendt avec Kurt Blumenfeld et Gershom Scholem la conduit à se rapprocher du sionisme, son premier mari Gunther Stern (qui se fera appeler plus tard Gunther Anders pour dissimuler la consonance juive de son patronyme), lui, fréquente les milieux communistes, tandis que son second mari Heinrich Blücher milite aux côtés de la Ligue spartakiste. Les lectures de Bernard Lazare et de Martin Buber côtoient bien volontiers celles de Marx, de Lénine, de Trotsky, puis de Rosa Luxemburg.
« Elle décide de quitter l’Allemagne sur-le-champ et rejoint Paris, où elle reprend son activité militante. »
Les actions militantes, au quotidien, se ressemblent également : il s’agit essentiellement, dans l’un et l’autre mouvement, de procurer de faux papiers et de constituer des réseaux de passeurs pour aider l’émigration de ceux qui sont menacés de déportation par le régime nazi (Juifs ou opposants politiques). Mais cet activisme, du côté d’Arendt, est vite interrompu : chargée au cours de l’année 1933 de rassembler des éléments de propagande antisémite en vue de l’organisation d’un congrès sioniste, elle est arrêtée par la Gestapo. Relâchée in extremis grâce à la sympathie que lui témoignera un agent peu zélé, elle décide de quitter l’Allemagne sur-le-champ et rejoint Paris, où elle reprend son activité militante. Quelques années plus tard, en mai 1940, c’est la France qui l’interne au titre d’« ennemi extérieur » dans le camp de Gurs dont elle réchappera, encore une fois de justesse, au bénéfice d’un flottement dans les relations diplomatiques entre la France et l’Allemagne. Plus chanceuse que son ami Walter Benjamin (qui se suicide à la frontière espagnole, pour ne pas subir le rapatriement en France qui lui a été annoncé), elle parvient à passer, avec son second mari, de Marseille à Lisbonne, puis à embarquer en mai 1941 pour les États-Unis, où la paria qu’elle était en Europe deviendra apatride.
« Heureux celui qui n’a pas de patrie »
À New York, Arendt se plonge dans la rédaction de l’ouvrage monumental qu’elle mettra 10 ans à écrire et qui contribuera à la rendre célèbre : Les Origines du totalitarisme. Sa parution, en 1951, donne la mesure du parcours intellectuel de cette femme qui, 20 ans plus tôt, alors qu’elle soutenait sa thèse sur « Le concept d’amour chez saint Augustin », se destinait à une carrière universitaire de philosophe. Emportée par les vents de l’Histoire loin de la « vie de l’esprit9 », elle se consacre désormais à la compréhension de ces « sombres temps » dont elle a été témoin, à commencer par cet « événement inouï » qu’a été le système totalitaire. L’une des grandes thèses défendues dans cet ouvrage est que l’antisémitisme, l’impérialisme et le totalitarisme (sujets respectifs des trois tomes qui le composent) ont été les conséquences dramatiques de la crise du modèle qui a structuré toute la politique européenne moderne, à savoir l’État-nation. Ce modèle est également responsable du caractère « insoluble10 » du problème des apatrides, ces sans-droits vivant sur un sol national étranger, dont Arendt fait directement l’expérience à cette époque.

[Robert Motherwell]
C’est que, dans le cadre politique de l’État-nation, la reconnaissance d’un droit dérive nécessairement du principe de nationalité. Pas de droits de l’homme en général, en somme, antérieurs aux (et indépendants des) droits du citoyen, si ce n’est dans une déclaration abstraite, vouée à l’impuissance puisqu’à jamais séparée des États, qui sont les seuls garants du « droit d’avoir des droits ». L’expérience de l’exil est à cet égard, pour Arendt comme pour tant d’autres, une expérience paradoxale : avec sa citoyenneté, c’est de son statut de sujet de droit tout entier dont elle est dépouillée. Pourtant, c’est quand il n’est plus « citoyen » qu’un individu devrait justement pouvoir faire valoir des « droits de l’homme ». « Si un être humain perd son statut politique [comme c’est le cas de l’apatride, ndla], il devrait, en fonction des conséquences inhérentes aux droits propres et inaliénables de l’homme, tomber dans la situation précise que les déclarations de ces droits généraux ont prévue. En réalité, c’est le contraire qui se produit. Il semble qu’un homme qui n’est rien d’autre qu’un homme a précisément perdu les qualités qui permettent aux autres de le traiter comme leur semblable », à savoir le statut de ressortissant national.
« Perçu par Arendt comme la cause de son exil et de sa situation irrégulière, l’État-nation fait l’objet de critiques profondes et récurrentes de sa part. »
Perçu par Arendt comme la cause de son exil et de sa situation irrégulière, l’État-nation fait l’objet de critiques profondes et récurrentes de sa part. Ce modèle, issu de la théorie politique moderne, repose sur un idéal d’unification du peuple en « nation », permise par la centralisation du pouvoir souverain dans un État. Il a été théorisé en réponse au problème fondamental qui a traversé toute la philosophie politique moderne, à savoir : « Comment constituer une singularité à partir d’une pluralité — c’est-à-dire, dans les termes de Rousseau : “réunir une multitude en un corps”11 ? ». Pour qu’une masse se constitue en peuple, pour que des éléments épars et amorphes se rassemblent en corps social organisé, pour que la multitude se mue en unité stable, en somme, il faut en passer par la fondation d’une entité politique transcendante : l’État. Mais Arendt n’a pas de mots assez durs pour qualifier cette idée d’État souverain, aux conséquences « fatales », « pernicieuse[s] », « dangereuse[s] » politiquement.
La mention de Rousseau n’est pas innocente : il est celui qui, à ses yeux, en a proposé la formulation la plus achevée, la plus aboutie. Dans son traité Du contrat social, Rousseau soutient en effet qu’une multitude (à l’état « naturel ») se mue en peuple (dans l’état « social ») lorsqu’elle est capable de faire émerger, sur le modèle de la volonté individuelle, une « volonté générale », et de s’exprimer ainsi comme d’une seule voix12 au sujet de son devenir commun, de se mouvoir dans cette direction comme un seul corps. Pour Arendt, cet idéal de la nation « une et indivisible » est un fantasme, d’abord, puisqu’il suppose une homogénéité chez ce « peuple » qui lui est étrangère, niant ainsi la pluralité fondamentale de toute communauté politique13. Mais l’idéal de la nation est aussi, et surtout, un fantasme dangereux, puisqu’il implique, pour être opératoire, de se constituer contre ce qui diffère, ce qui diverge, ce qui est susceptible de briser son unité intrinsèque. Ce n’est pas à autre chose qu’ont été confrontés les Juifs d’Europe, quand les États-nations qui les hébergeaient comme des « corps étrangers » leur ont proposé de choisir entre l’assimilation et l’expulsion — ou, pire, l’extermination. Ce n’est pas non plus pour d’autres raisons qu’Arendt s’est alarmée de la tournure nationaliste prise par le mouvement sioniste dans l’après-guerre : Israël ne pouvait, dans ces conditions, que reproduire sur le territoire palestinien les erreurs dramatiques des États-nations européens et endosser leur ferveur impérialiste.

[Robert Motherwell]
Réduite à la condition d’apatridie du fait des conséquences de ce modèle politique, Arendt fait le choix de demeurer indépendante de toute nation pendant près de 15 ans. En 1951, cependant, elle adopte la nationalité américaine. Après son exil forcé, la revendication d’appartenir désormais à un État fédéral fait sens pour elle, dans la mesure où le modèle théorique sur lequel il est fondé prend le contre-pied de son homologue national. La Révolution américaine dont il est issu, loin de viser l’unité transcendante de la nation comme l’a fait la Révolution française — héritière en cela de la pensée rousseauiste — a fait le choix d’inscrire le principe de pluralité au cœur de sa constitution. Pour autant, au-delà de la valeur symbolique de cette « fondation », les États-Unis dont Arendt est la contemporaine sont loin de constituer un modèle politique à ses yeux. Malgré leur organisation fédérale, les États-Unis se sont dotés du même régime de gouvernement que celui des États-nations européens, lequel passe par l’élection et la représentation, par la séparation hiérarchique, donc, entre des gouvernants et des gouvernés. La critique du caractère hiérarchique et dominateur du système électoral est intimement liée à celle de la théorie rousseauiste de la souveraineté. Synonyme de contrôle, de puissance, la notion même de souveraineté enveloppe le germe de la domination.
« Qu’est-ce, en effet, qu’un souverain, si ce n’est un homme qui commande, un homme qui impose sa volonté ? »
Qu’est-ce, en effet, qu’un souverain, si ce n’est un homme qui commande, un homme qui impose sa volonté ? À partir de là, les efforts de Rousseau pour transférer cette souveraineté à la société civile tout entière, pour la répartir également entre tous les sujets, sont vains : le vice est structurel, et le « gouvernement démocratique » recherché est une « évidente imposture », si ce n’est une contradiction dans les termes14. Car la fondation de l’État-nation est indissociable de l’érection des individus en sujets, précisément. Et quand bien même ces sujets n’accepteraient de se soumettre à la puissance étatique que parce qu’ils semblent, ce faisant, « n’obéi[r] pourtant qu’à [eux]-même[s]15 », cela n’enlève rien au fait qu’ils le feraient sur la base de la reconnaissance d’un pouvoir qui s’impose, quoiqu’il s’impose à tous. Il apparaît alors que, pour Rousseau — et pour détourner la formule d’Erich Mühsam —, « la liberté de chacun [s’acquiert] par la sujétion de tous ».
Pensées an-archiques
Contre Rousseau, Arendt reprendrait bien plutôt à son compte la tournure libertaire de la formule originale de Mühsam, qui proclame « La liberté de chacun par la liberté de tous ». Dans l’essai « Qu’est-ce que la liberté ? », elle écrit que, alors qu’elles sont appariées dans la théorie politique moderne classique, « La liberté et la souveraineté sont si peu identiques qu’elles ne peuvent même pas exister simultanément » ; ainsi, « Si les hommes veulent être libres, c’est précisément à la souveraineté qu’ils doivent renoncer ». « An-archiste », Arendt l’est manifestement au sens littéral et étymologique du terme. De même que Proudhon luttait, en son temps, contre le préjugé selon lequel « le gouvernement est indispensable à la société16 », de même Arendt s’attaque-t-elle au « lieu commun […] que toute communauté politique est faite de ceux qui gouvernent et de ceux qui sont gouvernés ». L’un et l’autre refusent la réduction de la politique à sa dimension hiérarchique, à sa fonction de commandement, qui est contenue dans les termes grecs d’arkhê et de kratos — qui désignent le pouvoir et interviennent dans la construction des mots monarchie, oligarchie, aristocratie ou démocratie. Pour Arendt, la politique est même, au sens strict, fondamentalement an-archique ; elle affleure précisément lorsqu’une communauté choisit un mode d’organisation égalitaire rompant radicalement avec les logiques « -archiques » ou « -cratiques ». C’est ce que donne à voir l’expérience grecque de l’isonomie17 : « Depuis Hérodote, elle était conçue comme une forme d’organisation politique dans laquelle les citoyens vivaient ensemble dans un état de non-domination (no-rule), sans distinction entre gouvernants et gouvernés18. Le terme d’isonomie exprimait cette notion de non-domination ; […] la notion d’autorité (l’“-archie” dans monarchie et oligarchie ou la “-cratie” dans démocratie) en était totalement absente. »

[Robert Motherwell]
L’expérience démocratique grecque, si éloquente soit-elle, n’est pas pour autant la seule digne d’être mobilisée pour illustrer l’idéal an-archique arendtien de la communauté politique. D’autres épisodes de l’Histoire ont témoigné de la possibilité de fonder un nouveau mode d’organisation politique non-gouvernemental, non-hiérarchique, non-vertical ; ce sont les Conseils. « Rien […] ne contredit plus nettement les vieilles idées admises sur les tendances “naturelles” à l’anarchie [au sens péjoratif de “chaos”, dans l’usage courant, ndla] et au non-respect des lois chez un peuple laissé à l’abri de la contrainte de son gouvernement que l’émergence des Conseils, lesquels, où qu’ils soient apparus […] se sont employés à réorganiser la vie politique et économique du pays et à établir un ordre nouveau. » En négatif du long récit lumineux tracé par l’histoire des États-nations, Arendt fait poindre des zones d’ombre, des brèches, des interruptions profondes ; ce qu’elle appelle des « trésors perdus ». Pêle-mêle, il s’agit du projet de « républiques élémentaires » dans la Révolution américaine naissante19, de la révolution française de 1848, de la Commune de Paris, de la révolution russe de 1905, puis des Soviets de février 1917, des Räte de la révolution allemande de 1918-19, de l’insurrection de Budapest de 1956 ou encore du Printemps de Prague de 1968.
« Ce qui fascine Arendt dans ce modèle des Conseils, c’est sa dimension profondément révolutionnaire. «
Tous ces épisodes, sans cesse allégués par Arendt, ont en commun l’émergence spontanée de conseils révolutionnaires (civils, ouvriers, militaires, artistiques, étudiants ou autre), « à savoir cette même organisation qui émerge […] toutes les fois qu’on laisse le peuple, l’espace de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, poursuivre ses propres objectifs politiques sans qu’un gouvernement (ou un programme de parti) lui soit imposé d’en haut ». « Trésors perdus » du passé, engloutis par la longue hégémonie des États-nations, ces expériences peuvent néanmoins jeter une lumière nouvelle sur le présent. Loin de la souveraineté nationaliste, c’est cette démocratie de Conseils, cette « auto-administration coopérative » qu’Arendt aurait notamment souhaité voir s’établir en Palestine : « Une auto-administration locale et des conseils municipaux et ruraux judéo-arabes, à une échelle restreinte et en aussi grand nombre que possible, sont les seules mesures politiques réalistes qui puissent conduire en définitive à l’émancipation politique de la Palestine. »
Ce qui fascine Arendt dans ce modèle des Conseils20, c’est sa dimension profondément révolutionnaire. Brusquement, l’ambition des individus qui y prennent part outrepasse les revendications économiques ou sociales qui devaient aboutir à l’amélioration, dans la société présente, des conditions de vie des travailleurs, pour prendre à bras le corps la question de leur émancipation politique, et changer en profondeur les structures de la société. Dans ces « “révolution[s] spontanée[s]” à la Rosa Luxemburg », un peuple opprimé se « soulèv[e] soudain, luttant pour la liberté et pratiquement pour rien d’autre ». Le nom de Rosa Luxemburg n’est que peu de fois mentionné, mais ses réflexions imprègnent à l’évidence celles d’Arendt. Celle que ses étudiants surnommaient justement « Rosa » et dont un chapitre de ses Vies politiques est consacré à la biographie de la militante spartakiste, a pleinement fait sienne « sa vision pénétrante de la nature de l’action politique » : « Elle avait appris, et c’est le point essentiel, auprès des conseils révolutionnaires de travailleurs (les soviets) qu’“une bonne organisation ne précède pas l’action, mais en est le produit”, que “l’organisation de l’action révolutionnaire peut et doit être apprise dans la révolution elle-même, de même qu’on ne peut apprendre à nager que dans l’eau” ; que les révolutions ne sont “faites” par personne, mais éclatent “spontanément”, et que “les forces qui contraignent à l’action” viennent toujours “d’en bas”. »

[Robert Motherwell]
Critiquant le marxisme — quoique de l’intérieur — comme le fera Arendt après elle, Rosa Luxemburg théorise l’action proprement politique comme praxis révolutionnaire. À la différence de la théorie marxiste orthodoxe, l’objectif de la révolution n’est pas situé en dehors de cette dernière — dans la conquête et le retournement, au profit des classes laborieuses, d’un pouvoir central dominateur et violent —, mais en elle-même, dans l’élaboration d’un nouveau type de pouvoir. Ce pouvoir, le seul pouvoir politique légitime car non-hiérarchique, est « inséparable de l’existence des communautés politiques » et « correspond à l’aptitude de l’homme à agir, et à agir de façon concertée ». Les moments révolutionnaires qui le découvrent sont des « trésors » car ils inscrivent dans la chair des protagonistes le sentiment de joie21 que procure cette expérience politique par excellence qu’est l’action. Au sein du Conseil, l’homme fait l’expérience de sa propre liberté parce qu’il fait celles de sa propre initiative, de sa propre spontanéité. Au sein du Conseil, le citoyen se perçoit dans l’espace public comme « participant » en première personne et non seulement comme « représenté » — l’action elle-même restant, par ailleurs, « la prérogative du gouvernement ». Au sein du Conseil, en somme, l’individu assume de faire peser sur ses propres épaules la charge fragile du « monde commun ».
Arendt n’a jamais revendiqué pour son compte aucune étiquette. Son œuvre et sa pensée, à l’image de ses engagements, se sont constituées dans la coïncidence la plus étroite avec ses expériences vécues, avec toutes les ambiguïtés et les complexités que peut charrier l’existence. Celle qui refusait le qualificatif de « philosophe » aimait à répéter que, contrairement au vieil adage aristotélicien qui déclare « Socrate m’est cher, Platon m’est cher, mais la vérité m’est encore plus chère », elle ne serait jamais prête à sacrifier, dans l’activité de pensée, « l’amitié, l’ouverture au monde et, finalement, le véritable amour des hommes » à la primauté d’une vérité absolue. En l’occurrence, ses amis22, ceux qu’elle a choisis comme « compagnons parmi les hommes » témoignent pour elle de ses affinités théoriques. Outre la culture marxiste transmise par ses maris, à partir de laquelle — et parfois contre laquelle — elle pensera toute sa vie, c’est bien une sensibilité anarchiste ou socialiste libertaire qui se dégage de son amitié (réelle ou intellectuelle23) avec Bernard Lazare, Rosa Luxemburg, Martin Buber, Bertolt Brecht ou Walter Benjamin. Gageons que ces amitiés — sans doute bien davantage que ceux qui, dans les camps libéraux ou conservateurs, s’en revendiquent aujourd’hui — permettent de comprendre avec un peu plus de justesse la personnalité et la pensée d’Hannah Arendt.
BIBLIOGRAPHIE
Les citations d’Arendt proviennent des ouvrages suivants :
Pour la première partie (« Itinéraire d’une paria ») : La Crise de la culture (Gallimard, 1989, préface : « La brèche entre le passé et le futur »), Rahel Varnhagen — La Vie d’une Juive allemande à l’époque du romantisme (Pocket, 1994), Vies politiques, (Gallimard, 1986, « De l’humanité dans de sombres temps
, réflexions sur Lessing ») et Écrits juifs (Fayard, 2011, « Un guide pour la jeunesse : Martin Buber », « Le Juif comme paria : une tradition cachée », « Pour sauver le foyer national juif. Il est encore temps », « Réexamen du sionisme » et « Herzl et Lazare »).
Pour la deuxième partie (« Heureux celui qui n’a pas de patrie ») : Les Origines du totalitarisme (Gallimard, 2002, t. II : « L’Impérialisme »), Journal de pensée (Seuil, 2005), La Crise de la culture (Gallimard, 1989, « Qu’est-ce que la liberté ? »).
Pour la troisième partie (« Pensées an-archiques ») : La Condition de l’homme moderne (Calmann-Lévy, 1961), Essai sur la révolution (Gallimard, 2013, « La Tradition révolutionnaire et son trésor perdu »), Les Origines du totalitarisme (Gallimard, 2002, « Réflexions sur la révolution hongroise »), Vies politiques, (Gallimard, 1986, « Rosa Luxemburg ») et Du mensonge à la violence (Pocket, 1989, « De la violence »).
- La relation d’Arendt avec Heidegger, qui s’est largement compromis avec le régime nazi, est parfois brandie pour discréditer, en bloc et sans autre forme de procès, son œuvre et sa pensée. Alors qu’elle a 17 ans et qu’elle arrive à Marbourg pour étudier la philosophie, elle entame effectivement une relation intime avec ce professeur qui exerce une grande fascination sur ses auditeurs. Arendt met néanmoins un terme à cette relation l’année suivante et quitte son université, pour aller suivre les cours de Husserl puis de Jaspers. Cette rencontre a indéniablement marqué la vie de la jeune femme. Personnellement, d’abord, elle affectionnera toujours le souvenir de ce qu’Heidegger était pour elle à cette époque ; intellectuellement, ensuite, elle reprendra le geste philosophique (la phénoménologie existentielle) ainsi que certains concepts de son maître. Pour autant, l’exil d’Arendt hors d’Allemagne l’a très tôt éloignée du philosophe et de ses agissements sous le régime d’Hitler (qu’elle affirmera ne pas comprendre et qu’elle lui reprochera lors d’une dernière entrevue). Par ailleurs, la pensée d’Arendt — comme toute pensée, au demeurant — s’est affirmée en s’émancipant de celle de ses maîtres, en s’appropriant certaines idées mais en les infléchissant, en les tordant dans sa perspective propre. Une lecture attentive des œuvres d’Arendt et une compréhension authentique de ses thèses invalident clairement l’idée de sa stricte subordination théorique à celles de Heidegger.[↩]
- La parabole en question est la dernière histoire de la série « Notes des années 1920 », intitulée « HE ». L’expression « brèche entre passé et futur » est celle qui donne son titre — bien mal traduit — à l’ouvrage La Crise de la culture (en anglais Between Past and Future).[↩]
- Lettre à Karl Jaspers du 4 mars 1951.[↩]
- Entretien avec G. Gaus, 1964.[↩][↩][↩]
- Voir l’ouvrage de Miguel Abensour, Hannah Arendt contre la philosophie politique ?, Sens & Tonka, 2006.[↩]
- Cf. : « Si je souligne si explicitement mon appartenance au groupe des Juifs tôt chassés d’Allemagne, c’est que […], pendant de nombreuses années, j’ai considéré que la seule réponse adéquate à la question “qui êtes-vous ?” était : “une Juive”. Seule cette réponse tenait compte de la réalité de la persécution » (Hannah Arendt, « De l’humanité dans de “sombres temps”, réflexions sur Lessing », Vies politiques, Gallimard, 1986).[↩]
- Le mot « paria », qui désigne à l’origine les intouchables, ceux qui sont exclus du système de castes en Inde, est ensuite employé pour désigner tout individu ou communauté mis au banc de l’humanité du fait de son « impureté » présumée.[↩]
- Le sionisme, qui apparaît au XIXe siècle et englobe à l’origine une multitude de courants (parfois radicalement opposés dans leurs motivations et leurs ambitions), se resserre étroitement, en réaction au génocide des Juifs d’Europe durant la Seconde Guerre mondiale, autour d’une mouvance nationaliste. À partir de cet événement et du traumatisme qu’il a engendré, l’exigence sioniste maximale, à savoir l’établissement d’un État juif souverain, devient l’exigence minimale, et tous ceux qui n’en partagent pas les fondements sont considérés comme des ennemis de la cause juive. En dénonçant très tôt les dérives du mouvement sioniste nationaliste et en se désolidarisant de ses actions, Arendt elle-même a fait l’objet d’accusations d’antisémitisme, y compris de la part de son ami Gershom Scholem, qui la traite, dans une lettre du 28 janvier 1946, de « trotskiste antisioniste ».[↩]
- Elle y reviendra tardivement, néanmoins, puisque La Vie de l’esprit est le titre de son dernier ouvrage, inachevé.[↩]
- « [Le] problème des apatrides […], dans un monde de nations souveraines, est insoluble » (Hannah Arendt, « Une patience active », Écrits juifs, Paris, Fayard, 2011).[↩]
- Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. 7 : « Du souverain ».[↩]
- La métaphore de l’unisson est de Rousseau lui-même : « Plus le concert règne dans les assemblées, c’est-à-dire plus les avis approchent de l’unanimité, plus aussi la volonté générale est dominante ; mais les longs débats, les dissensions, le tumulte, annoncent […] le déclin de l’État » (Du contrat social, livre IV, chap. 2 : « Des suffrages »).[↩]
- Arendt multiplie, au fil de ses ouvrages, les variantes de cette idée qui ouvre La Condition de l’homme moderne et qui rend compte de « la condition humaine de la pluralité » : « Ce sont des hommes et non pas l’Homme qui vivent sur terre et habitent le monde. […] Cette pluralité est spécifiquement la condition […] de toute vie politique » (Hannah Arendt, La Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, 1961).[↩]
- « L’électeur peut seulement accepter ou refuser de ratifier un choix qui […] se fait sans lui » ; « Même s’il y a communication entre élus et électeurs, entre nation et Parlement, […] cette communication n’a jamais lieu entre égaux, mais entre ceux qui aspirent à gouverner et ceux qui consentent à se laisser gouverner » (Hannah Arendt, « La Tradition révolutionnaire et son trésor perdu », Essai sur la révolution, Gallimard, 2013).[↩]
- Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. 6 : « Du pacte social ».[↩]
- Proudhon, Confessions d’un révolutionnaire.[↩]
- Le terme « isonomie » désigne étymologiquement le principe ou la règle de l’égalité. Le régime « démo-cratique » qui l’a instauré à Athènes était, de ce point de vue, mal nommé : « La polis passait pour être une isonomie et non une démocratie. Exprimant le règne de la majorité, le règne de la multitude, ce mot de démocratie avait été forgé précisément par les adversaires de l’isonomie » (Hannah Arendt, Essai sur la révolution, op. cit.).[↩]
- « Je ne veux ni commander, ni être commandé », clame le défenseur de la démocratie dans le célèbre passage d’Hérodote sur les constitutions (Histoires, livre III, § 80-82).[↩]
- « Jefferson savait pertinemment lui-même que ce qu’il proposait pour le “salut de la République”, c’était en réalité le salut de l’esprit révolutionnaire à travers la République. Ses réflexions sur le système des districts commençaient toujours par rappeler combien “l’élan donné à notre révolution à ses débuts” était redevable aux “petites républiques”, qui avaient “plongé la nation entière dans une action pleine d’énergie” […], “l’énergie de cette organisation” étant telle qu’il “n’était pas d’individu dans leurs États qui ne se fût pas jeté à corps perdu dans l’action” » (Hannah Arendt, « La Tradition révolutionnaire et son trésor perdu », op. cit.).[↩]
- Dans une lettre à K. Blumenfeld datant du 16 décembre 1957, Arendt présente son texte « Réflexions sur la révolution hongroise » comme un « hymne au système des Conseils ».[↩]
- Cette joie est ce que le XVIIIe siècle avait appelé le « bonheur public » ou que Benjamin Constant qualifiait de « liberté des Anciens ». Arendt fait ce commentaire des mouvements de protestation étudiante du début des années 1970 : « Participer à la vie publique donne accès à une dimension de l’expérience humaine qui, sinon, demeurerait inconnue, et […] cette expérience est en quelque sorte inséparable du “bonheur” complet » (« Politique et révolution », entretien avec Aldebert Reif pour la New York Review of Books, 12 avril 1971).[↩]
- Le qualificatif d’« amis » est important : il s’agit d’une affinité choisie et non d’une affinité supposée naturelle, donnée. Dans une lettre fameuse à Gershom Scholem, qui lui reprochait, à la lecture de ses thèses sur Eichmann, d’avoir perdu son « amour du peuple juif », Arendt répond : « Vous avez tout à fait raison : je n’ai jamais “aimé” de toute ma vie quelque peuple ou quelque collectivité que ce soit […]. Je n’aime effectivement que mes amis et je suis absolument incapable de tout autre amour » (Lettre du 20 juillet 1963).[↩]
- Dans un éloge de l’« humanisme » romain, Arendt écrit que cet idéal consiste à « [savoir] choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses, les pensées, dans le présent comme dans le passé » (« La Crise de la culture », La Crise de la culture, Gallimard, 1989).[↩]
REBONDS
☰ Lire notre abécédaire de Cornelius Castoriadis, février 2018
☰ Lire notre article « Castoriadis ou l’autonomie radicale », Galaad Wilgos, juillet 2017
☰ Lire notre article « Erich Mühsam — la liberté de chacun par la liberté de tous », Émile Carme, mars 2017
☰ Lire notre article « L’émancipation comme projet politique », Julien Chanet, novembre 2016
☰ Lire notre abécédaire de Rosa Luxemburg, octobre 2016


