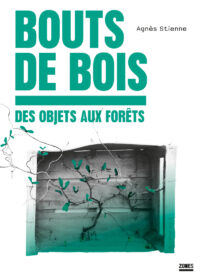Une grève méconnue de sardinières bretonnes, le quotidien d’un travailleur en maison de retraite, la violence conjugale d’une femme envers une autre, la forêt mise en cartes, l’histoire renouvelée du génocide des Tutsi, un voyage brisé par un viol, le journal d’une installation paysanne, une analyse stylistique de la littérature réactionnaire, la philosophie face à un monde en flammes : nos chroniques du mois de juin.
☰ Une belle grève de femmes — Les Penn sardin, Douarnenez, 1924, d’Anne Crignon

Beaucoup ont connu les sardinières, celles de Douarnenez, par le biais d’une chanson entonnée à l’occasion d’une manifestation ou d’une veillée. « Écoutez l’bruit d’leurs sabots / voilà les ouvrières d’usine », commence le refrain en l’honneur des grévistes de l’année 1924. Un refrain que la journaliste Anne Crignon a entendu souvent elle aussi. Toutefois, son livre ne commence pas par des vers, mais par une image. C’était un jour d’hiver : une vieille photographie trouvée dans une brocante déclenche une obsession. « Ces sardinières d’usine, je les disais depuis longtemps mes sœurs ; à vingt ans par romantisme, à quarante ans par engagement », écrit-elle en introduction. Un livre plus tard, la relation s’est affermie : après la contemporaine des sardinières Lucie Colliard, la documentariste Marie Hélia, la chercheuse Anne-Denes Martin et la chansonnière Claude Michel, Anne Crignon relate à son tour et magnifiquement la vie de celles qui étaient alors les ouvrières les moins bien payées de France. On s’étonne du peu d’écho qu’a eu la grève des sardinières jusqu’à présent : « Alors que ce soulèvement fut l’un des plus éclatants de la IIIe République […], on ne trouve quasi pas de noms ni de visages pour représenter celles qui marchèrent quarante-huit jours dans la ville et le froid. » Si quelques figures apparaissent dans une série de photographies — la déjà citée Lucie Colliard, enseignante communiste et première exégète du mouvement, Daniel Le Flanchec, l’historique maire « rouge » de la ville, ou encore Joséphine Pencalet, actrice de la lutte et première femme élue de France alors que les femmes ne votaient pas encore — le mouvement se présente sous un jour collectif. Durant un hiver, « Douarnenez plonge avec joie dans le communisme ». En dépit du violent mépris des capitaines d’industrie, de la pâleur des remontrances du gouvernement à l’égard des patrons, de l’arrivée de quelques briseurs de grève aguerris, la protestation tient bon et finit victorieuse. « En six semaines, des sardinières sans éducation politique ont appris le rapport de force » note l’autrice, qui convainc que, malgré l’adversité, « aucune [lutte] n’est perdue d’avance ». [E.M.]
Libertalia, 2023
☰ T’as pas trouvé pire comme boulot ? Chronique d’un travailleur en maison de retraite, de Nicolas Rouillé
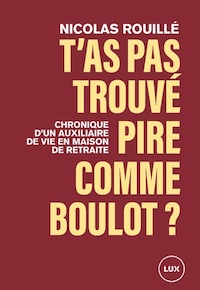
C’est en cherchant un boulot alimentaire suite au confinement de 2020 que Nicolas Rouillé est devenu agent des services hospitaliers (ASH) en EHPAD. Comprendre : travailleur — dans un univers où ce sont surtout des travailleuses — chargé des tâches d’entretien, de service et d’accompagnement. Il commence alors à tenir des chroniques, initialement parues dans le mensuel CQFD, qui « n’ont d’autre ambition que de montrer à travers un éventail de scènes du quotidien les dernières années de vie passées en collectivité, dans un établissement à qui on ne donne pas les moyens de subvenir de façon adaptée à tous les besoins ». De nombreux reportages ont pointé les dysfonctionnements dans les EHPAD, qui vont jusqu’à la maltraitance des pensionnaires. Le livre de Nicolas Rouillé, lui, permet de saisir des instants de la vie quotidienne, épuisante pour celles et ceux qui y travaillent, rythmée par les rituels de la journée pour les habitant·es (toilette, repas, activités quand il y en a). Ces dernier·es, l’auteur a veillé à ne pas les réduire aux symptômes de leur âge avancé. De façon toujours délicate et respectueuse, mais sans occulter les difficultés, il dépeint l’humanité de ce collectif de personnes que rien n’avait prédestiné à vivre ensemble, avec toutes les tensions, les moments de joie ou de peine que cela implique. Les sentiments aussi, car l’amour ne s’éteint pas avec l’âge. Les auxiliaires de vie dans les maisons de retraite sont également des travailleuses sociales : des liens se nouent avec les résident·es, et souvent l’action des ASH dépasse le cadre de leur fiche de poste. Ces chroniques étant celles d’un travailleur, elles abordent également les conditions d’exercice du métier d’ASH, souvent déconsidéré, et ses effets sur les personnes, que l’auteur éprouve pendant les seize mois passés dans l’établissement : la fatigue intense, les douleurs dans le corps, l’EHPAD qu’on finit peu à peu par ramener chez soi parce qu’on s’inquiète pour tel·le ou tel·le résident·e. [L.]
Lux, 2023
☰ Dans la maison rêvée, de Carmen Maria Machado

Christian Bourgois, 2019
☰ Bouts de bois — Des objets aux forêts, d’Agnès Stienne
Quel est l’arbre, quelle est la forêt qui se cachent derrière un cageot, une palette, les pages d’un journal, une table basse ou un bouchon de liège ? Quelle essence, quelle géographie, quel système industriel ? En somme, quel monde forestier porte les objets en bois qui nous entourent ? Autant de questions posées par la cartographe indépendante et plasticienne Agnès Stienne, un temps contributrice régulière au Monde diplomatique et co-fondatrice du site Visioncarto. Avec une certaine légèreté — qui ne cache pas, toutefois, un profond sentiment de révolte face à l’état des forêts françaises et mondiales — l’autrice tire les fils de ces « bouts de bois » qu’elle manie au quotidien dans son travail d’artiste ou qu’elle rencontre régulièrement au cours de ses promenades. Ainsi des traverses de chemin de fer utilisées sous les rails et longtemps réemployées pour servir d’éléments décoratifs dans les jardins : Agnès Stienne souligne à la fois les traitements cancérigènes dont elles sont l’objet et l’histoire du réseaux ferré que ces morceaux de chêne révèlent. Elle compare, cartes à l’appui, l’évolution des lignes depuis plus d’un siècle et dénonce leur progressive disparition. Ailleurs, ce sont les épicéas et les pins maritimes, les attaques de parasites et les grands feux qu’ils subissent, qui servent d’exemples pour mettre en évidence l’« absence d’une authentique politique forestière » en France. Et l’autrice de se demander, d’ailleurs, s’il est « possible d’associer symboliquement le paysage d’une ville inscrite dans son environnement à un système politique ». La réponse tient en sept représentations, « de l’anarchisme à l’ultralibéralisme », dont les éléments sont de plus en plus ordonnés à mesure que le système politique envisagé se durcit, tandis que les structures paysagères sont quant à elles de plus en plus rationalisées, simplifiées, appauvries. Perdons-nous un moment dans les forêts rêvées des cités anarchistes, communardes ou fédérées pour garder un peu d’espoir. [R.B.]
Zones, 2023
☰ Le génocide au village, de Hélène Dumas
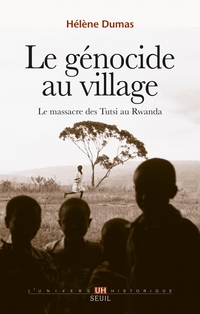
Comprendre les mécanismes du génocide des Tutsi au Rwanda nécessite de restituer les temporalités multiples dans lesquelles il se déploie : l’héritage des taxinomies racistes nées de l’administration coloniale et d’une « construction politique et idéologique de l’ethnicité » qui se prolonge après l’indépendance ; la mémoire des massacres des années 1960–1970 et la transmission des pratiques de violence ; les conséquences de la guerre civile qui débute en octobre 1990, avec ses effets de « cristallisation d’un socle de représentations et son inscription concrète dans la vie des habitants ». Dans ce temps spécifique de la guerre, deux logiques meurtrières convergent progressivement jusqu’à fusionner au moment du génocide en 1994 : « une dynamique verticale, impulsée par l’État, et une logique horizontale de pogroms au sein des communautés de voisins », reliées entre elles par toute une série d’acteurs intermédiaires qui jouent un rôle charnière. Mais ce qui ressort du travail d’Hélène Dumas, ce sur quoi insistent toutes les victimes et constitue la radicale nouveauté de ce « génocide de proximité », c’est l’implication des voisins et la « réversibilité meurtrière de leur monde social ». Le souvenir des exactions passées peut ainsi se retourner contre les victimes : les stratégies de survie héritées deviennent caduques et les refuges d’hier, bâtiments administratifs ou institutions religieuses, « se muent en pièges » mortels. « Tout comme le retournement des voisins, la violation des lieux réputés sûrs marque la spécificité du génocide. » Remarquable, ce livre l’est aussi pour sa démarche scientifique singulière. Hélène Dumas assiste pendant cinq années aux audiences des tribunaux gacaca de l’ancienne commune de Shyorongi, au nord du Rwanda. Elle porte une attention particulière aux affects et à la langue, dont témoigne le soin apporté à la traduction pour restituer au plus près les mots des acteurs, « le grain de la langue » et « le caractère vivant de cette parole ». Elle sillonne aussi, en compagnie des rescapés, les lieux du génocide afin de reconstituer « le paysage du massacre » et dévoile ainsi la manière dont les tueurs ont su mobiliser « leur savoir topographique afin d’assurer l’efficacité » des tueries. [B.G.]
Seuil, 2014
☰ Pente raide, de Marvic
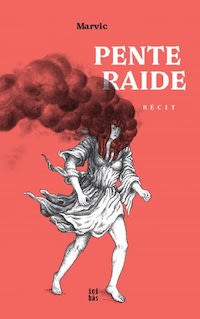
Ici-bas, 2023
☰ Bambois, la vie verte, de Claudie Hunzinger

La préface nous prévient : dans Bambois, la vie verte, publié pour la première fois en 1973, « il ne s’agit pas de faire de la littérature, mais de porter témoignage ». Et c’est en cette qualité de témoins que Claudie Hunzinger, dite Mélu, et Francis Hunzinger, dit Pagel, débutent leur prise de note : « Nous étions vraiment perdus à cette époque, je veux dire que nous ne nous étions pas encore trouvés nous-mêmes, ou quoi que ce soit. » C’était en 1964, dans les Vosges, quatre ans avant les migrations étudiantes et militantes vers les montagnes cévenoles ou ariégeoises pour recommencer la vie ailleurs et autrement, loin des villes. Mélu et Pagel devancent d’un peu le retour à la terre de leurs contemporain·es, et se confrontent sans repères aux difficultés de l’acquisition de terres ou de la réfection d’une bergerie. Dans ce livre, il est question de lieux, serrés les uns contre les autres sur le dos d’une montagne. Il y a les fermes de Bourse-Noire, Targoutte et enfin la maison de Bambois. En arrivant, ils le savent : « la seule issue, c’est de savoir faire quelque chose ». Mélu et Pagel ont appris et ne sont jamais repartis. Les vieux monts qui les accueillent ont quelque chose de la montagne de Lure où, dans les années 1930, des jeunes gens venaient se rassembler auprès de Lucien Jacques et de Jean Giono. En Provence comme dans les Vosges, il y a eu de la joie, de vraies et très simples richesses. Mais, à Bambois, il a également fallu apprendre les rudiments de l’élevage, puis du tissage et de la teinture, qui assurent au couple sa subsistance, et composer avec la dureté des conditions. « Vivre là-haut, ce n’est pas la poésie imaginaire des citadins, c’est une méchante bagarre où il faut mettre toute sa force. » On est pris par des réflexions tendres, lumineuses, parfois amusantes. « Curieux : la montagne fauchée ressemble à une brebis tondue. » Petit à petit, les activités du couple, le territoire dans lequel il vit et les mots de Claudie Hunzinger se confondent : « je ne suis moi-même qu’ici, dans ce paysage de feuilles et d’air, qu’ici seulement je vis tous mes âges à la fois ». [E.M.]
Cambourakis, 2023
☰ Le Style réactionnaire — De Maurras à Houellebecq, de Vincent Berthelier
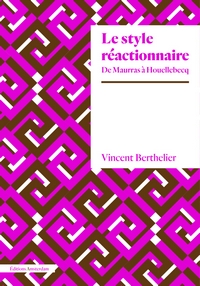
Depuis soixante-dix ans les journalistes ressassent l’idée que les grands écrivains français seraient tous réactionnaires, là où la prose des progressistes serait encombrée de leurs idées politiques : « à gauche […], la pesanteur idéologique, à droite, la légèreté », en somme. C’est parce qu’ils cultivent ce que l’historien de la littérature Vincent Berthelier appelle le « style réactionnaire » que les penseurs de la contre-révolution se font passer pour des écrivains intéressants. Selon l’auteur, ce style se reconnaît à un ensemble de motifs (le bon sens, l’ironie cinglante, l’éternelle misogynie, un certain respect de la culture scolaire), qui forment le portrait-type de l’« antimoderne ». Chapitre après chapitre, il analyse les excès stylistiques d’une poignée d’écrivains (« de Maurras à Houellebecq », comme l’indique le sous-titre du livre), dans l’intention affichée de « mettre au jour une dynamique littéraire qui a partie liée avec la réaction politique ». L’auteur dégage ainsi de son corpus trois moments d’esthétisation, où chaque style correspond à une nouvelle tendance idéologique : le nationalisme des années 1910 et son style impeccable qui donne des allures d’aristocrate (Maurras) ; le fascisme des années 1930 et son style esthète qui renvoie dos à dos la droite et la gauche (Drieu la Rochelle) ; le déclinisme des années 1970 et son style exigent et élitiste qui prétend résister à l’abaissement du niveau culturel ambiant (Cioran). Dans le sillage de Bourdieu, Berthelier considère que ces mises en forme littéraire ne sont qu’un processus d’euphémisation des discours xénophobes ambiants. Le livre s’achève sur trois écrivains contemporains : Renaud Camus, Richard Millet et Michel Houellebecq. Berthelier démontre que, sous couvert d’une écriture recherchée et d’une posture antilibérale, leur style et leurs idées véhiculent des « fantasmes nobiliaires ». Au cours du siècle dernier, l’extrême droite littéraire a finalement renouvelé son style sans changer le fond de ses haines. [T.B.]
Amsterdam, 2022
☰ Quand la forêt brule — Penser la nouvelle catastrophe écologique, de Joëlle Zask
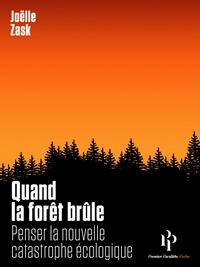
Sur fond de casseroles, le ministre de la Transition écologique a récemment présenté son plan pour lutter contre les incendies, dont le nombre s’accroît chaque année. Ses mesures : des sentinelles, des caméras de surveillance, une nouvelle « météo des forêts », des bouts de chandelle pour les pompiers et une obligation de débroussaillage. À lire Quand la forêt brûle, on se dit que dans ce domaine comme ailleurs, le gouvernement vit dans un monde parallèle au nôtre. Car si le paradoxe que constitue « la nature sociale de ces très grands feux de forêts humainement incontrôlables » rend difficile toute politique conséquente à leur égard, il est certain que le court-termisme ne changera rien et que ces mesures pèsent bien peu lorsque leurs auteurs contribuent activement au dérèglement climatique. Dans un essai aussi effrayant que brillant, la philosophe Joëlle Zask essaye de tenir ensemble deux faits contradictoires : les mégafeux qui dévastent des surfaces de plus en plus importantes de forêt sont d’origine humaine et il est impossible de les maîtriser avec les moyens à notre disposition. Après avoir été domestiqué il y a plusieurs centaines de milliers d’années, jusqu’à être exclu, au siècle dernier, des sites préservés pour leur naturalité, le feu s’ensauvage désormais — et il semble qu’il n’y a pas de retour possible. L’autrice s’attache ainsi à reprendre la littérature scientifique existante, tant écologique qu’historique, et place ses maigres espoirs dans une « culture du feu » où attention et soin envers les milieux naturels — envers toute chose, finalement — prendraient une place prépondérante. Difficile d’y croire, néanmoins, tant les mots de Walter Benjamin, écrits en 1939 et cités en conclusion de Quand la forêt brûle paraissent d’actualité : « Que les choses continuent à aller ainsi
, voilà la catastrophe. » [R.B.]
Premier Parallèle, 2022
Photographie de bannière : Shirley Baker
REBONDS
☰ Cartouches 83, avril 2023
☰ Cartouches 82, janvier 2023
☰ Cartouches 81, novembre 2022
☰ Cartouches 80, octobre 2022
☰ Cartouches 79, septembre 2022