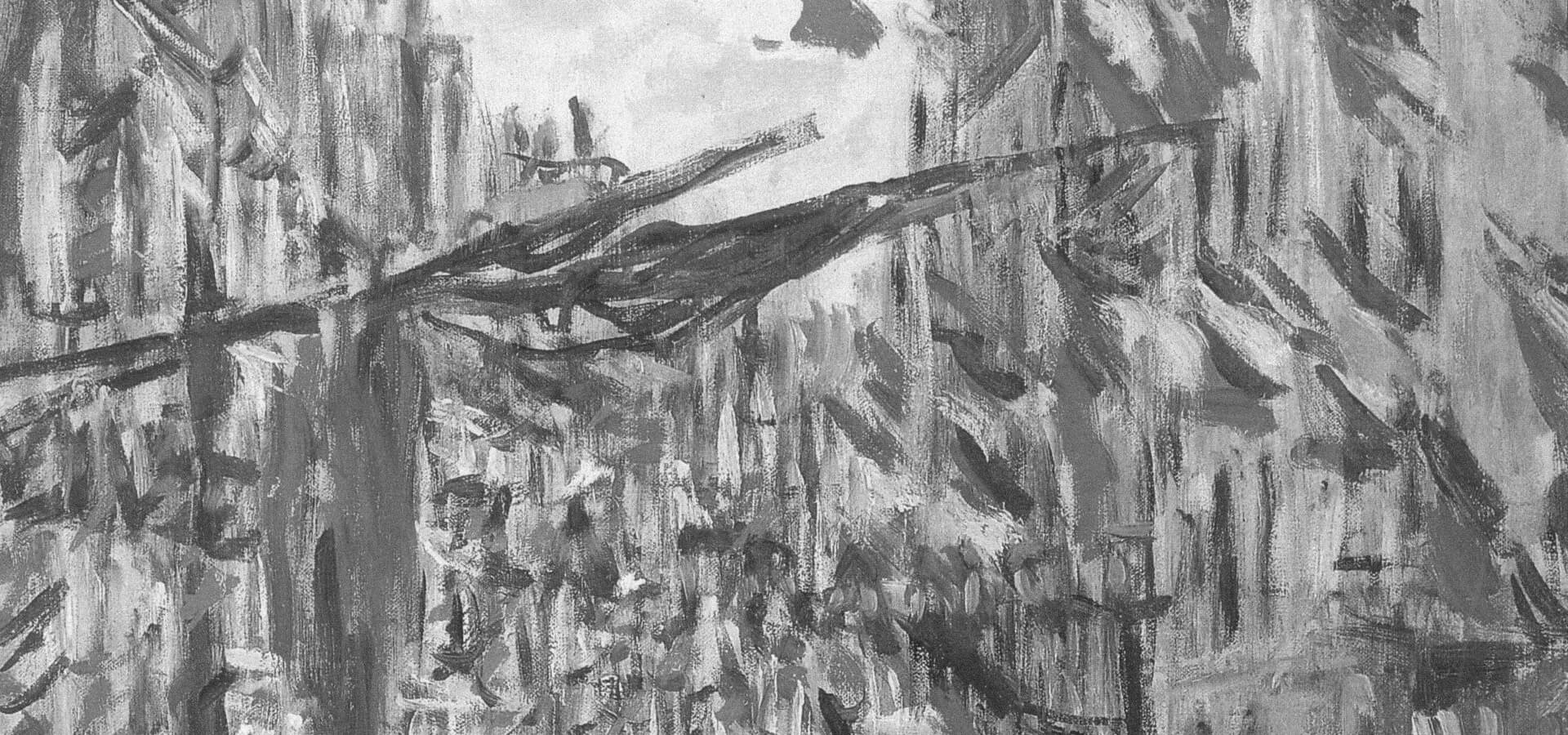Entretien inédit pour le site de Ballast
La révolution et la République : gros morceaux que voici. La première paraît tenir du rêve impossible ou ravive trop souvent de lointaines visions de guillotine en place publique ; la seconde est devenue le terrain de jeu favori des opulents et des mafieux, du parti unique des affaires (LR-En Marche-PS) à l’extrême droite… « Républicain, oui ; mais ce mot ne précise rien », lançait déjà Proudhon. Pour en discuter ou en débattre, nous sollicitons l’historienne Mathilde Larrère, chroniqueuse pour Arrêt sur images ainsi que Mediapart et directrice de l’ouvrage collectif Révolutions — Quand les peuples font l’Histoire. Celle qui ferrailla avec Manuel Valls à propos de la figure de Marianne et dispense chaque semaine sur Twitter des « fils » historiques et politiques afin de rendre l’Histoire accessible au plus grand nombre en jure : « Tout est possible, partout, à tout moment. »

Vaste question ! Qui en comporte plusieurs en réalité… Passé-présent-futur, quels liens ? Vous avez trois heures… L’histoire, comme discipline, permet d’abord de connaître son passé : un travail à partir des sources et des traces qui permet donc de le comprendre dans son altérité avec le présent. Reste que les questions posées par les historien.ne.s au passé sont posées depuis le présent — ce qui fait souvent dire que « Toute histoire est contemporaine ». L’historien.ne s’interroge sur le passé et interroge le passé dans un présent qui l’habite, le pousse à questionner tels ou tels groupe social, institution ou pratique, à chercher des sources qu’il ou elle n’avait pas utilisé auparavant. Cela explique le surgissement de questionnements historiques en fonction du présent. D’où, par exemple, les premiers travaux en histoire des femmes quand se structure, dans les années 1970, un nouveau féminisme ; d’où la décision de nous lancer dans un livre collectif sur les révolutions1 alors que Ben Ali « dégageait » en Tunisie et que la place Tahrir était occupée. Le travail historique permet de questionner les continuités, les ruptures, les actualisations, les modifications — en d’autres termes, la lente, chaotique et fort rarement linéaire construction de ce dont nous héritons dans le présent. Ce faisant, si l’histoire ne suffit pas seule à comprendre le présent, on ne saurait le comprendre en ignorant le passé. Elle permet également d’établir que ce qui se donne aujourd’hui comme inévitable ou nécessaire, comme existant « de tout temps », n’est jamais qu’une construction plus ou moins récente, et pour cela transitoire, comme l’ont été toutes les réalités antérieures. L’histoire permet ainsi de se déprendre des évidences du présent, de les inscrire dans des processus de construction, d’inscrire le présent dans une temporalité qui, d’abord, intègre le passé.
« Relativisons, tout de même : un McDo saccagé, on ne va pas en faire un fromage — dégueulasse qui plus est, dans cette officine ! »
Mais, justement, parce qu’on sort du présent, qu’on l’ouvre sur le passé, ce travail permet de rouvrir le futur. Quand on s’enferme dans le présent, dans ce que François Hartog appelle le « présentisme », quand le passé est comme muséifié, sédimenté, mis à l’écart, on ne saurait penser des futurs. Faire de l’histoire, c’est faire l’histoire des changements passés, des moments de renversement, de redéfinition des rapports de force, des alternatives — qu’elles aient échoué ou réussi — pensées, tentées ; ce faisant, c’est permettre de penser des renversements futurs, des alternatives futures. La « fin de l’Histoire » (Fukuyama) et le « There is no alternative » (Margaret Thatcher ayant le copyright de ce mantra largement repris) marchent de concert. S’il y a une « leçon à tirer » du passée, c’est d’abord que tout peut changer. « Le passé est source d’énergie présente », dit ainsi Jérôme Baschet dans son livre que je ne saurais que vous conseiller, Défaire la tyrannie du présent2 — lequel apporte, avec force détails, une réponse éclairante à votre question !
Le mot « révolution » semble désormais inséparable de celui de « violence »… Le McDo fracassé lors du 1er mai a apparemment chamboulé la France entière — quant à la gauche radicale, elle s’est copieusement engueulée sur le sujet… Vous écrivez que la violence « illégale » devient « légitime » lorsque s’opère le « passage » révolutionnaire : simple constat ou approbation militante ?
Commençons par rappeler que l’association révolution-violence est une construction des contre-révolutionnaires. Quoi de mieux pour dénigrer la révolution que de l’associer à la violence ? Quoi de mieux pour oublier le Maximum (1793) que de brandir la guillotine ? Les Versaillais n’ont rien fait d’autre au lendemain de la Commune. Et la France (mais c’est quoi, « la France » ?) est d’autant plus « chamboulée » qu’on lui ressasse images et récits de l’événement violent (relativisons, tout de même : un McDo saccagé, on ne va pas en faire un fromage — dégueulasse qui plus est, dans cette officine !) isolé de son contexte. La monstration de la violence sert de discours-écran, à but d’effroi et de délégitimation. Passons sur le fait que ce type de discours revient aussi à ne pas questionner les violences politiques hors des périodes révolutionnaires. La « Terreur rouge » de l’an I (et II) n’a pas fait plus de morts que la « Terreur blanche » du Directoire et de la Restauration. Pourtant, on ne parle que de la première… Que dire des 20 000 morts de la Semaine sanglante de mai 1871 ? C’est aussi pourquoi Jaurès, attaqué par Clemenceau sur les violences en marge des grandes grèves de 1906, opposait la violence sourde, invisible des patrons à celle des ouvriers. Il y a de fait plusieurs arguments qui peuvent être mobilisés pour légitimer le recours à la violence : la réponse à la violence d’État ou des patrons (en légitime défense, presque), et/ou l’argument numérique du soutien massif à la violence employée (ce à quoi on ajoutait au XIXe siècle la démonstration que la violence était pratiquée et soutenue par plusieurs classes de la société ; l’union des classes sur les barricades, objet d’innombrables images, étant ainsi une figure imposée des représentations révolutionnaires).

Le siège de Paris, Jean-Louis-Ernest MEISSONIER (1815 – 1891) © RMN-Grand Palais – H. Lewandowski (extrait)
Vous soulevez là une vaste question : celle de la violence légale/légitime. S’agissant de l’extrait que vous citez, il ne s’agit pas d’une approbation mais d’une grille d’analyse de ce qui s’opère dans un phénomène révolutionnaire. Je partirai d’un constat : quand une révolte ou une insurrection menace l’ordre établi, que des biens, ou pire, des personnes sont attaqués, les responsables de ces violences sont jugés et condamnés dès que l’ordre est rétabli. Au lendemain de la prise de la Bastille, les protagonistes de l’événement ne sont pas arrêtés, ni jugés, mais célébrés, récompensés et valorisés3. Ainsi, des combattants de 1830 sont enterrés en martyrs dans la crypte de la colonne de Juillet à la Bastille où viennent ensuite reposer à leurs côtés les combattants de 1848. Mêmes « violences », destructions, mises à mort dans les révoltes et les révolutions, mais la différence de traitement montre qu’elles ne sont pas perçues, interprétées de la même façon. Car la révolution parvenant à renverser l’ordre bouleverse le sens de ce qui est légitime ou ne l’est pas et construit, a posteriori, les violences qui l’ont portée comme légitimes. On pourrait dire que ce n’est pas d’abord la violence légitime (ce qui serait bien vague) qui fait la révolution, mais la révolution qui reconnaît sa violence comme légitime. Depuis les travaux de Max Weber sur la violence légitime et son monopole par l’État, la notion de violence légitime, quoique souvent travaillée, reste un objet malaisé à saisir. De fait, ce concept peut être utilisé dans le cadre d’une approbation militante. Anticiper sur la légitimité de la violence exercée, en plus de justifier son usage, est aussi, par conséquent, un moyen de la définir comme de nature révolutionnaire.
« Les pouvoirs révolutionnaires s’installent bien souvent dans les lieux mêmes du pouvoir qu’ils viennent de renverser, sur les mêmes bancs, sous les mêmes ors. »
D’une certaine façon, les révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, en reprenant les philosophes des droits de l’homme et du contrat social, avaient posé quelques cadres. Pourquoi les révolutions anglaise, mais surtout américaine et française, s’ouvrent par des déclarations des droits de l’homme et du citoyen ? Parce que le droit de résistance à l’oppression (qui peut impliquer la violence), formulé comme un droit de l’homme, permet de légitimer la révolution qui s’opère, et donc de légitimer les violences par lesquelles la révolution est passée (ou passera). Pour dire les choses un peu simplement : Dieu (on y croit, alors) a créé les Hommes dotés de droits naturels ; les Hommes se mettent en société pour garantir ces droits ; ils contractent, se donnent un gouvernement. Mais si ce gouvernement en vient à violer ces droits, alors les Hommes sont en droit de changer de gouvernement. Et cela peut impliquer le recours à la violence, d’autant plus que le gouvernement, on s’en doute, ne se laisse pas renverser sans résistance. « La prudence enseigne, à la vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour des causes légères et passagères, et l’expérience de tous les temps a montré, en effet, que les hommes sont plus disposés à tolérer des maux supportables qu’à se faire justice à eux-mêmes en abolissant les formes auxquelles ils sont accoutumés. Mais lorsqu’une longue suite d’abus et d’usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur sécurité future », peut-on lire dans la Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique, en date du 4 juillet 1776 — et ce alors que de nombreuses violences avaient visé les intérêts britanniques et les agents de la couronne. Le « droit de résistance à l’oppression » est formulé dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; celle de 1793 allant plus loin en instituant « l’insurrection » comme droit et devoir. C’est ce que nous voulions expliquer dans le livre : dans la révolution s’opère la transformation de la violence illégale en violence légitime, sans intention d’approuver en militant.e.s — mais parce que cela permet de comprendre la spécificité d’une révolution.
Toutes les révolutions victorieuses ont débouché sur un pouvoir autoritaire, sinon pire, qu’elles soient française, russe, cubaine, chinoise, algérienne ou vietnamienne. La gauche a rebondi, grosso modo, de deux façons : s’emparer de l’État par la voie électorale, réformiste et non-violente puis garantir le pluralisme ; refuser la conquête du pouvoir central pour bâtir des alternatives locales, marginales, sécessionnistes ou autogérées. Penser la révolution, c’est donc penser l’État ?
Je m’amuse de voir que vous m’opposez tous les topoï du discours anti-révolutionnaire !
Rien que ça !
La révolution, c’est la violence ; la révolution débouche sur la dictature… Mais bon, il faut pouvoir répondre à ça. Je botterai juste un peu en touche en précisant deux choses. Dans le livre, nous avons justement choisi, après en avoir discuté, de ne travailler que sur les processus révolutionnaires, et non sur les États post- (voire contre-) révolutionnaires. Et de nous interdire de lire la révolution à l’aune de ce sur quoi elle a pu déboucher, pour la saisir dans sa complexité, sa polyphonie, sa fusion de projets parfois contradictoires — même si certains ont vite été enterrés. Dans cette équipe d’historiennes et d’historiens, j’étais la dix-neuviémiste : aussi suis-je bien moins capable que mes co-auteur.e.s de parler des révolutions du XXe siècle dont ils ou elles sont les spécialistes ! Dans les sociétés étato-centrées qui sont les nôtres, la révolution, pour renverser l’ordre établi, a pris la forme de la prise du palais d’Hiver (ou des Tuileries, selon !), puis s’est employée à combler le vide en recréant un État fondé sur d’autres légitimités, d’autres souverainetés. Mais en glissant souvent ses pieds dans les chaussures de l’ancien monde. Cela se marque par exemple par le fait que les pouvoirs révolutionnaires s’installent bien souvent dans les lieux mêmes du pouvoir qu’ils viennent de renverser, sur les mêmes bancs, sous les mêmes ors. Pas toujours, bien sûr : en quittant, sous la pression de la marche des femmes des 5 et 6 octobre 1789, la salle des Menus plaisirs construite pour les états généraux à Versailles, l’Assemblée nationale constituante a donné à la révolution de nouveaux espaces de pouvoir… pour finir par s’installer dans un ancien palais aristocratique, le palais Bourbon… D’où le fait que dans Premières mesures révolutionnaires, Éric Hazan et Kamo notent qu’il ne faut pas « s’asseoir dans les fauteuils vides » mais inventer de nouveaux espaces.

Lénine, par Vladimir Serov (extrait)
La révolution peine à penser totalement un État neuf : elle doit faire avec l’ancien ; elle est aussi faite par des hommes (plus souvent que des femmes) de l’ancien monde ; elle doit donc composer, métisser le passé et le présent. Les formes dictatoriales des États post-révolutionnaires sont un mélange de résurgences de l’ancien (lui-même dictatorial) et des projets révolutionnaires. Ne perdons pas de vue non plus que les pouvoirs post-révolutionnaires se construisent souvent dans des situations de guerre, civile comme extérieure, qui doivent aussi être prises en compte pour expliquer — je ne dis pas excuser — les formes dictatoriales des régimes. On notera aussi qu’au cœur d’une révolution qui s’en prend à l’État, il peut y avoir des formes de dilution. C’est net dans la guerre d’Espagne, qui est aussi une révolution. Dans les régions « républicaines » aux mains des anarchistes, il y a des formes d’alternatives autogérées et sécessionnistes. Au cœur des révolutions de 1848 et de la Commune de Paris, les ouvriers inventent et construisent des associations qui sont autant d’alternatives à la révolution qui, au sommet, renversent et reconstruisent tout à la fois en reprenant les vieilles pierres et le pouvoir central.
« Le révolutionnaire veut changer le monde, il le dépasse vers l’avenir, vers un ordre de valeurs qu’il invente ; le révolté a soin de maintenir intacts les abus dont il souffre pour pouvoir se révolter contre eux. […] Il ne veut ni détruire ni dépasser mais seulement se dresser contre l’ordre », a écrit Sartre dans son Baudelaire. Cette opposition entre révolution et révolte vous paraît-elle pertinente ?
« Chercher les révoltes au cœur des processus révolutionnaires et les projets révolutionnaires au cœur des révoltes. »
Je me retrouve à ne pas être d’accord avec un bout de citation de Sartre… lequel a par ailleurs écrit mille choses très justes sur la révolution et la violence révolutionnaire ! Mon désaccord porte sur « a soin de maintenir intact les abus dont il souffre » : voilà qui fait porter une lourde responsabilité au révolté dans le maintien des abus et le prive ensuite de tout projet politique ou social. Nombreux avant Sartre sont ceux qui ont cherché à distinguer révolte et révolution. Sous la monarchie de Juillet, les légitimistes — les partisans du régime déchu et de son prétendant — cherchaient à déconsidérer les Trois Glorieuses en affirmant qu’il ne s’agissait « que d’une révolte qui a réussi ». À l’inverse, lors du procès qui suivit la répression de l’émeute de juin 1832, les accusés cherchèrent à démontrer que leur révolte (qui risquait de leur coûter la tête) était une révolution qui avait échoué (et que les condamner reviendrait pour le régime à condamner ses propres origines : habile !). Le 24 février 1848, l’issue des événements est encore incertaine et le Comité démocratique de Paris proclame sur une affiche : « À la garde nationale seule il appartient de distinguer une révolution d’une émeute »… Mais il voyait bien que les compagnies citoyennes se refusaient à réprimer les barricades.
Victor Hugo livre de nombreuses pages des Misérables sur la différence entre révolte et révolution — lui qui rapporte dans son roman la révolte de 1832, à l’ombre de celle de juin 1848, qu’il avait condamnée en son temps. D’ailleurs, révolte ou révolution, ces journées de juin qui, loin de se dresser seulement contre la fermeture des ateliers nationaux ou de n’être que des émeutes de crève-la-faim, comme on a pu le dire, portaient le rêve de la Sociale, celui de février ? Révolte ou révolution, cette Commune de Paris qui ne dure que quelques mois, échoue à dépasser le cadre parisien et se fait écraser dans le sang ? Et la révolte des canuts, n’était-elle pas, elle aussi, porteuse de projets politiques ? Dans notre livre, nous avons consacré un chapitre à la Commune mais seulement évoqué les canuts dans le chapitre sur 1830 : ce que nous justifions entre autre par la place que prend immédiatement la Commune et qu’elle conserve dans la mémoire des révolutions. Au XIXe siècle, les penseurs tranchent souvent en considérant que la révolution seule agrège à sa cause quand la révolte échoue à dépasser le groupe de ceux qui se soulèvent. La révolution permet une temporaire union des classes, ce à quoi la révolte ne parvient pas. Mais en pensant une révolution prolétarienne, Marx redistribue les cartes. La question de la différence entre révolte et révolution, donc celle de leur opposition, est éminemment complexe : je serais bien présomptueuse de la régler d’un coup de plume, qui plus est face à Jean-Paul Sartre ! Je m’en sortirai en disant que plutôt que de les opposer, il faut chercher à les rapprocher. À chercher les révoltes au cœur des processus révolutionnaires et les projets révolutionnaires au cœur des révoltes.

Combat devant l’Hôtel de Ville le 28 juillet 1830, Jean-Victor Schnetz, 1833 (extrait)
Vous avez évoqué la Terreur, sous la Révolution française. Dans votre livre, vous dites qu’elle n’a jamais existé en tant que « politique globale » et qu’il s’agit là d’une invention.
Je reprends là ce qu’écrivent les historiens de la Révolution française : Jean-Clément Martin4, Guillaume Mazeau5, Michel Biard6. Pour résumer : il n’y a pas une politique de la « Terreur » mais des politiques, lesquelles ont, de juin 1793 à juillet 1794, entrainé à la fois l’élimination de centaines de milliers d’opposants, la stigmatisation de communautés et l’invasion de pays étrangers mais ont aussi inspiré des projets inédits de réduction des inégalités politiques et sociales. Il ne s’agit donc pas de nier les violences ni les régressions démocratiques mais de montrer qu’elles n’ont jamais fait système et qu’on ne saurait réduire la période à cela. La « Terreur » comme « pathologie de la démocratie » (Cynthia Fleury) a été inventée par ceux qui ont pris le pouvoir en 1794, à la mort des robespierristes, afin de se présenter en victime de Robespierre : un mythe ensuite repris par toute une tradition libérale. La « Terreur » ainsi construite donne l’impression d’un excès d’État avec à sa tête un dictateur en herbe. Les travaux historiques qui analysent les discours et les pratiques effectives montrent qu’au contraire c’est une dérégulation qui est à la source des violences. Il y a une grande hétérogénéité sur le territoire et une discordance entre discours et pratiques. Ce ne sont pas des ordres de tuer qui sont transmis d’en haut mais des chaînes de commandement rompues qui expliquent les massacres. Nulle présence d’un « système de terreur », donc, si ce n’est dans le vocabulaire au cœur de l’univers de fantasme que fut et reste la Révolution française. Qui plus est, en 1793, la répression politique et la terreur d’État qui se caractérise par un usage extrême et ciblé de la violence n’est pas nouvelle : les Français la subissent depuis longtemps ; elle était pratiquée dans toutes les monarchies de l’Europe moderne. La nouveauté serait plus à chercher dans le fait que, pour la première fois, elle était soumise à un impératif de légalité, de justice et de morale.
Les Mémoires des communards rendent souvent compte de leur affection pour la République. À l’exception de la France insoumise, l’idéal républicain ne semble plus soulever les cœurs anticapitalistes. La « République bourgeoise » sonne comme un pléonasme ; l’extrême droite jure être plus républicaine que quiconque ; le Printemps républicain n’a de passion que pour les musulmans. À quel moment ce signifiant a-t-il perdu, pour une partie significative de la gauche, sa charge subversive et émancipatrice ?
« Le parti Les Républicains, l’extrême droite et le Printemps républicain s’inscrivent dans l’héritage de l’autre République, la
bourgeoise, la conservatrice. »
Il y a toujours eu deux républiques. La « République bourgeoise », libérale, et la Sociale. La République montagnarde contre celle des Thermidoriens et du Directoire. La République de février 1848 contre celle qui ferme les ateliers nationaux. La Commune d’un côté, la République des opportunistes de l’autre… Deux républiques, deux Mariannes. La Sociale à bonnet phrygien, cheveux détachés, poitrine découverte, guerrière, combattante ; la Marianne sage, couronne de laurier ou de rayon, cheveux attachés, buste couvert, sagement assise, désarmée. Deux républiques dont les contemporains du XIXe siècle ont parfaitement conscience qu’elles existent toutes les deux, qu’elles s’opposent et qu’elles ne sauraient se rassembler que dans les cas où il faut lutter contre la monarchie (ou contre la droite nationaliste à la fin du XIXe). Allez, je vous cite Hugo, sa profession de foi pour les législatives partielles de juin 1848. Un Hugo alors tout juste rallié à la République, qu’il ne pouvait envisager que conservatrice : « Deux républiques sont possibles. L’une abattra le drapeau tricolore sous le drapeau rouge […] ; fera banqueroute, ruinera les riches sans enrichir les pauvres, anéantira le crédit, qui est la fortune de tous, et le travail, qui est le pain de chacun, abolira la propriété et la famille, promènera des têtes sur des piques, remplira les prisons par le soupçon et les videra par le massacre, mettra l’Europe en feu et la civilisation en cendres, fera de la France la patrie des ténèbres, égorgera la liberté, étouffera les arts, décapitera la pensée, niera Dieu […]. L’autre sera la sainte communion de tous les Français dès à présent, et de tous les peuples un jour, dans le principe démocratique ; fondera une liberté sans usurpations et sans violences, une égalité qui admettra la croissance naturelle de chacun, une fraternité, non de moines dans un couvent, mais d’hommes libres […]. De ces deux républiques, celle-ci s’appelle la civilisation, celle-là s’appelle la terreur. Je suis prêt à dévouer ma vie pour établir l’une et empêcher l’autre. »
Les communards sont républicains, oui, bien sûr ! Mais leur république est la Sociale. Une république qui est aussi celle de la France insoumise, qui manie les références à 1793 ou à la Commune, qui fut celle des socialistes puis des communistes après 1936 — et dont on retrouve l’héritage dans la Constitution de la IVe République. Les Républicains (le parti), l’extrême droite et le Printemps républicain s’inscrivent dans l’héritage de l’autre République, la « bourgeoise », la conservatrice, celle des politiques économiques libérales. Pourquoi la République a-t-elle perdu de sa charge subversive et émancipatrice ? Il faut d’abord rappeler que ce n’est pas nouveau et que bien souvent, à gauche, la République a perdu cette charge pour ensuite la retrouver. Après juin 1848, le mouvement ouvrier et les socialistes rejettent la République qui les a écrasés : ils n’iront pas mourir sur les barricades du 4 décembre pour la sauver. Mais sous l’Empire autoritaire, ils renouent avec les souvenirs de la Sociale et tentent de la réaliser avec la Commune. Nouvelle déception après la Semaine sanglante : la République est de nouveau récupérée par sa frange conservatrice… Mais suite aux affaires Boulanger et Dreyfus, c’est autour des valeurs de la République émancipatrice que se refonde le modèle républicain. Années 1920 : pour les communistes, la République bourgeoise est sans espoir. Mais voici que les ligues prennent la rue ; on craint un complot fasciste. Thorez, dans un contexte international qui le pousse aux fronts populaires, revêt l’écharpe tricolore, entonne La Marseillaise et se réconcilie avec une République qu’il veut sociale. Elle le sera au lendemain de la guerre. De nos jours, la difficulté est que la République conservatrice, de nouveau, l’a emporté. Elle semble d’autant moins menacée que, comme vous le signalez, même l’extrême droite se dit républicaine ! Difficile, dès lors, de porter la République émancipatrice — d’autant plus quand son histoire est doucement sortie des programmes scolaires et que domine l’impression qu’il n’y aurait qu’une République… Sauf qu’il y en a bien deux !

L’arrestation de Louise Michel, Jules Girardet, 1871 (extrait)
La Commune de Paris reste, comme vous nous l’avez dit, une inspiration vivace : de Nuit Debout à Tolbiac en passant par la ZAD… Est-ce l’échec de cette révolution — comme celle, plus tard, des spartakistes et des partageux espagnols — qui la rend paradoxalement si désirable à nos mémoires parfois sujettes au romantisme ?
La Commune, la Révolution allemande de 1919 et la Révolution espagnole sont d’abord et avant tout désirables du fait de leur contenu, bien plus que du fait de leur échec. Oui, les martyrs, ça pousse au désir de vengeance ; oui, les échecs donnent envie de remettre l’ouvrage sur le métier tout en tirant les leçons de ce qui a pu foirer. Mais si l’on s’y réfère, c’est pour les projets d’alternatives sociales et politiques qu’ils portent, chacun.
L’effondrement de l’URSS et l’extension du mode de production capitaliste aux quatre coins du monde ont annoncé cette fameuse « fin de l’Histoire ». Plus personne ne parlait de « révolution », sinon pour parler du Goulag ; le soulèvement zapatiste a bousculé la donne et, depuis 2012, le Rojava en porte à son tour les couleurs. L’Europe est-elle condamnée à regarder au loin pour espérer ?
Réponse 1 : l’historien.ne ne peut rien savoir de l’avenir. Réponse 2 : l’historien.ne sait en revanche une chose, tout est possible, partout, à tout moment ; et souvent, on ne l’attendait pas du tout ! Réponse 3 : C’est justement quand on espère, que les choses sont possibles.
Le sociologue et économiste Bernard Friot lie révolution et émancipation du travail. Poursuivre la sortie du travail capitaliste pour arriver à l’institution communiste du travail, en somme. Il insiste sur la notion de « déjà-là » et les bases révolutionnaires dont nous disposons. Faut-il en finir avec l’idée de révolution entendue comme basculement ?
Je ne sais pas si vous êtes allés voir la pièce Amargi ! Anti-tragédie de la dette et de la monnaie, de Judith Bernard ?
Oui !
« Mais lutter tout de même. Toujours. Sans se réfugier dans nos tours d’ivoires académiques mais en entrant dans l’arène, quitte à ferrailler parfois violemment, quitte à s’en prendre plein la gueule. »
Eh bien, dans la dernière partie, elle met en scène cette société que prône Friot. Je vous assure que c’est un basculement, une rupture complète. Alors oui, quelque part, il y a du « déjà-là », notamment dans le régime de la Sécurité sociale tel qu’il a été pensé en 1947 ; pour autant, l’étendre à tout le fonctionnement de la société n’en serait pas moins un changement profond, l’exception devenant la norme. À l’inverse, toutes les révolutions passées s’appuyaient aussi sur un déjà-là, qu’il ait été pensé, tenté puis effacé, qu’il existe ailleurs ou dans un petit recoin. L’image de rupture complète des révolutions passées est en réalité plus complexe, dans les faits…
L’historien Eric Hobsbawm écrit dans L’Âge des extrêmes que la jeunesse vit dans le « présent permanent » et qu’elle n’a plus « aucun lien organique avec le passé ». Comment ne pas laisser le passé aux conservateurs ou aux réactionnaires ; comment rendre aux morts leur parfum de scandale émancipateur ; comment, finalement, faire de la mémoire autre chose qu’un bien pieux « devoir » ?
La boucle est bouclée, pourrait-on dire, avec votre première question ! Je me garderai bien de dire que la jeunesse vit dans un présent permanent — pourtant, j’ai un profond et total respect (et même de l’admiration) pour Hobsbawm. Il faut faire, en outre, la différence entre un passé vécu et un passé rapporté. Tout.e militant.e qui fait le récit de sa vie enchaîne les souvenirs de ses mobilisations, chacune contribuant à lui construire son passé de luttes, des souvenirs de barricades ou de manifs, un savoir-faire qui s’enrichit et qu’il ou elle réactive naturellement à chaque mobilisation. Le primo militant/manifestant/occupant de sa fac n’a pas cette expérience personnelle. Là, de fait, il n’a pas de lien « organique » avec un passé qui serait le sien. Mais s’y supplée parfois la mémoire familiale, souvent essentielle et dont l’importance dans l’engagement est largement documentée par les études portant sur ces questions : je pense par exemple aux travaux de Julie Pagis sur Mai 68. Enfin, il y a le passé qu’on apprend à l’école, à travers les cours d’histoire. Comment dès lors ne pas laisser le passé aux réactionnaires ? Eh bien, en faisant de l’histoire ! Et je dis bien de l’histoire, avec ses méthodes, ses doutes, ses tâtonnements. Pas de la « mémoire ». Une histoire des luttes, une histoire des rêves, une histoire des moments d’empowerment — tout en déconstruisant les romans nationaux et les tentatives de muséifier le passé. En occupant l’espace du plus qu’on peut. En s’organisant en association comme peuvent le faire le Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire ou le collectif Aggiornamento, qui travaille sur les programmes scolaires et propose des alternatives passionnantes. Il faut lire, écrire, travailler, publier et diffuser. Et diffuser partout, avec tous les supports. « Vulgariser », comme on dit. En investissant les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube ; en publiant des tribunes, en créant des blogs, en faisant des bandes dessinées (c’est le projet de l’Histoire dessinée de la France des éditions La Découverte), en participant à l’écriture de pièces (comme le fait Guillaume Mazeau), en animant des podcasts (comme le nouveau venu Paroles d’histoire), des émissions (comme Les Détricoteuses que j’anime avec Laurence De Cock sur Médiapart, ou Quand l’histoire fait dates sur Arte, de Patrick Boucheron), en multipliant les interventions, les rencontres dans des librairies, des bibliothèques, des théâtres, des universités populaires ou des prisons. Difficile de lutter contre les Bern, Deutsch et consorts, auxquels le service public ouvre ses plateaux. Difficile aussi de lutter dans ces temps de retour du roman national. Mais lutter tout de même. Toujours. Sans se réfugier dans nos tours d’ivoires académiques mais en entrant dans l’arène, quitte à ferrailler parfois violemment, quitte à s’en prendre plein la gueule.
Illustration de bannière : extrait de la toile La Rue Montorgueil, à Paris, Fête du 30 juin 1878, de Claude Monet
Portrait de Mathilde Larrère : Stéphane Burlot, pour Ballast
- M. Larrère, F. Chartreux, M. Chirio, V. Lemire et E. Palieraki, Révolutions — Quand les peuples font l’Histoire, Belin, 2013.[↩]
- Jérôme Baschet, Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits, Paris, La Découverte, 2018.[↩]
- Voir à ce propos le travail d’Haim Burstin.[↩]
- Notamment dans son dernier ouvrage, La Terreur, vérité et légende, Paris, Perrin, 2018.[↩]
- « La Terreur, laboratoire de modernité », dans Pour quoi faire la révolution, Marseille, Agone, 2012.[↩]
- Politique de la Terreur, Rennes, PUR, 2008.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Saïd Bouamama : « Des Noirs, des Arabes et des musulmans sont partie prenante de la classe ouvrière », mai 2018
☰ Lire « La Commune ou la caste — par Gustave Lefrançais » (Memento), juin 2017
☰ Lire notre entretien avec Edgar Morin : « Il y a toujours eu deux France », février 2017
☰ Lire notre entretien avec Judith Bernard : « Armer le spectateur d’une pensée en mouvement », novembre 2016
☰ Lire notre entretien avec Olivier Besancenot : « Le récit national est une imposture », octobre 2016
☰ Lire notre entretien avec Bernard Friot : « Nous n’avons besoin ni d’employeurs, ni d’actionnaires pour produire », septembre 2015
☰ Lire notre article « Victor Hugo, la grande prose de la révolte », Alain Badiou, juin 2015
☰ Lire notre entretien avec Philippe Marlière : « La République est un consensus mou », juin 2015
☰ Lire la lettre-testament de Victor Serge (Memento), janvier 2015