Texte inédit pour le site de Ballast
Face à la submersion néolibérale et à la privatisation généralisée du monde, la notion de « commun » est revenue en force. On ne compte plus les ouvrages et les discours louant la nécessité des « communs » ou du « bien commun », qu’il s’agisse de ressources naturelles (une forêt), matérielles (un musée) ou immatérielles (un logiciel). Un succès qui appelle donc à la vigilance : outre le « commons washing », les communs peuvent devenir le cheval de Troie d’un marché qui met en œuvre la casse du service public. L’essayiste Édouard Jourdain retrace ici son histoire et entend bien rappeler, et donc préserver, la radicalité libertaire de cette notion.
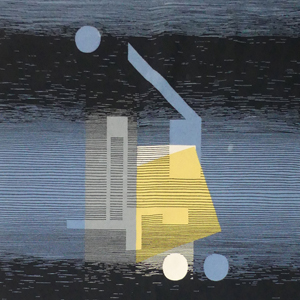
« La liberté sans égalité est libérale, et justifie l’exploitation d’un individu par un autre ; l’égalité sans liberté est autoritaire, et justifie la domination d’un groupe sur un autre. »
« Pour que l’anarchie triomphe, il faut qu’elle soit déjà une réalité concrète avant les grands jours qui viendront1 », assurait le géographe Élisée Reclus. Ainsi entendu, le terme d’utopie pourrait toutefois correspondre à l’anarchie si, comme le rappelle le philosophe Gilles Deleuze dans Qu’est-ce que la philosophie ?, nous l’appréhendons dans le sens que lui donnait l’auteur britannique Samuel Butler : « Erewhon
ne renvoie pas seulement à No-where
, ou Nulle part, mais à Now-here
, Ici et maintenant2. ». Malgré la multiplicité des théories qui s’en réclament, l’anarchisme repose sur plusieurs principes, lesquels peuvent constituer quelques dénominateurs communs. Nous pouvons les concevoir à chaque fois dans leur double acceptation : négative et positive. Le rejet de l’autorité coercitive, incarnée par l’État ou le gouvernement, appelle à la libre association ou fédération d’individus ou de groupes entre eux ; le rejet du capitalisme et de l’exploitation appelle à l’abolition des classes sociales par la réorganisation de la production ; le rejet de l’aliénation conduit au développement de l’esprit critique et antidogmatique, premier pas pour briser la servitude volontaire.
Aussi, la liberté ne peut se séparer de l’égalité dans l’anarchisme : elles se soutiennent l’une l’autre. La liberté sans égalité est libérale, et justifie l’exploitation d’un individu par un autre ; l’égalité sans liberté est autoritaire, et justifie la domination d’un groupe sur un autre. En cela, l’anarchisme se veut être un dépassement du libéralisme comme du marxisme. Le mouvement des communs s’inscrit potentiellement dans une telle perspective, dès lors qu’il ne se réduit pas a priori à certains biens (comme les biens naturels) ni à un certain économicisme prétendument apolitique.
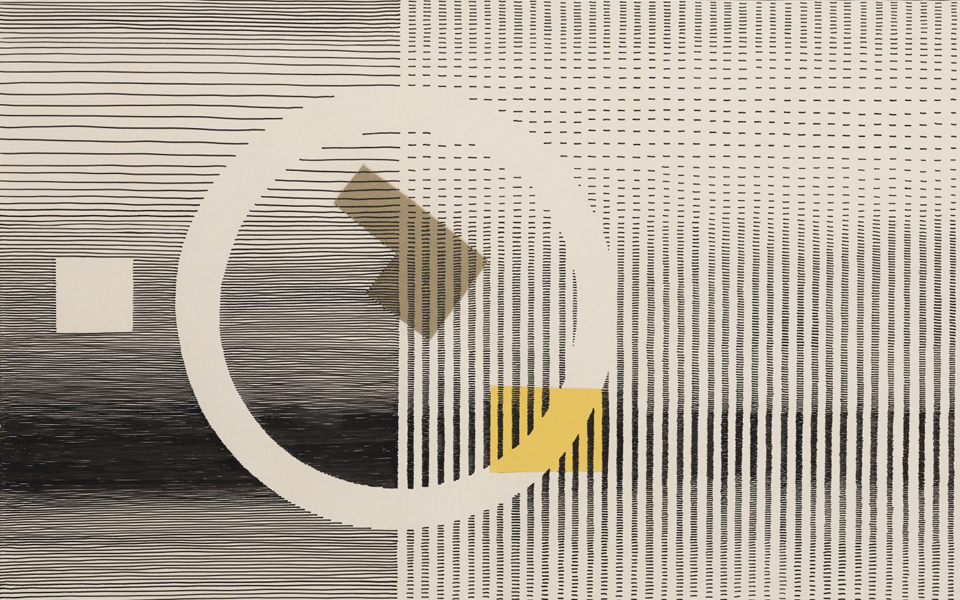
[Michel Seuphor]
Qu’est-ce que les communs ?
Leur histoire remonte aux origines de l’humanité, désignant une gestion collective de ressources communes. Un point de bascule important a lieu en Angleterre au XVIIe siècle, où les communs disparaissent au profit d’une gestion exclusive de la propriété. Au Moyen Âge, certaines terres, qu’on appelait « les communaux », pouvaient être ouvertes aux récoltes de tous : tout un chacun avait la possibilité d’aller ramasser du bois de chauffage ou des champignons et les paysans pouvaient y laisser paître leurs moutons. Le mouvement des enclosures, qui consistait pour les propriétaires fonciers à fermer l’accès aux terres, va peu à peu provoquer la fin de ces communs et jeter dans la misère une grande partie de la population rurale3. La création de communs va toujours de pair avec des tentatives de nouvelles enclosures, les ressources partagées faisant l’objet de prédations de la part de certains pour en avoir la propriété exclusive. C’est particulièrement le cas aujourd’hui concernant le numérique (question des licences) ou les ressources naturelles (brevetabilité du vivant). Le mouvement des communs cherche à conjurer, par des règles et des modalités de gestion collective, celui des enclosures.
« La notion de commun est politique dans la mesure où elle suppose la capacité naturelle des individus à délibérer et décider collectivement de ce qui est juste. »
La notion de communs resurgit en 1968 à l’occasion de la publication d’un article intitulé « La tragédie des communs » par le sociobiologiste Garrett Hardin. Considérant des pâturages communs où des bergers cherchent à nourrir individuellement le plus grand nombre d’animaux, réduisant ainsi considérablement la quantité d’herbe disponible, il concluait que le libre usage des communs conduisait à la ruine de tous. S’ensuivait, à ses yeux, que deux solutions seulement étaient à même de remédier à cette tragédie : l’imposition de lois protégeant les ressources par l’État, ou la propriété privée délimitée par des enclos. Le mérite de la chercheuse étasunienne Elinor Ostrom est d’avoir démontré que cette conception des communs reposait sur une vision abstraite qui a peu à voir avec la réalité, et remonte parfois à plusieurs centaines d’années. Les communs sont en effet liés à des communautés d’habitants ou d’usagers, et donc à des valeurs et des règles collectives grâce auxquelles les individus communiquent et négocient — selon des objectifs qui ne se réduisent pas à leurs intérêts immédiats.
« Tant les partisans de la centralisation que ceux de la privatisation acceptent comme principe central que les changements institutionnels doivent venir de l’extérieur et être imposés aux individus concernés4. » Or la notion de commun est politique dans la mesure où elle suppose la capacité naturelle des individus à délibérer et décider collectivement de ce qui est juste. C’est la participation à l’activité commune qui fonde l’obligation. Les choses sont rendues communes par cette activité : rien n’est commun en soi. Le commun est une institution vouée à perdurer par l’élaboration continuée de règles et de pratiques, prenant en charge les conflits et les décisions en vertu d’un principe d’autogouvernement. Il prévaut aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère sociale, subordonnant ainsi toute velléité d’abus de pouvoir (économique ou politique) à des limites. Enfin, le commun détermine ce qui est inappropriable et est réservé à l’usage de tous.

[Michel Seuphor]
À partir des travaux d’Elinor Ostrom, les communs peuvent se définir par la combinaison de trois facteurs : 1) une ressource en accès partagé ; 2) un système de droits et d’obligations — un faisceau de droits — pour ceux qui ont accès à la ressource ; 3) des règles de contrôle et de gestion des conflits. Faisant l’objet d’une gouvernance qui n’est imposée ni par le marché, ni par l’État, le souci des biens communs conduit toujours à concilier le droit d’usage avec la préservation des ressources. Ce sont les parties elles-mêmes qui élaborent leur propre contrat et se tiennent mutuellement pour responsables de sa bonne exécution. Ce contrat a lieu en connaissance de cause, les parties étant en possession d’informations essentielles liées à leur activité et leur environnement. Ici, l’autogouvernement a cette vertu quasi absente dans l’exercice de l’autorité centrale, qui consiste, pour les personnes, à avoir suffisamment d’informations pour évaluer la politique la plus pertinente à mener en fonction de la situation. Aussi, la surveillance mutuelle des parties et leur évaluation des sanctions en cas de non respect du contrat s’avère plus efficace et moins coûteux que l’appel à une autorité externe.
« La gestion par les communs est beaucoup plus efficace que celle de l’État ou du marché. »
En cela, la gestion par les communs est beaucoup plus efficace que celle de l’État (extérieur aux ressources concernées et incapable d’en comprendre les enjeux) ou du marché (où la concurrence des propriétaires et leur recherche de profit conduit à l’épuisement des ressources). La production de biens communs est donc un construit social et politique, dépendant de l’arbitrage de la collectivité entre ce qu’elle peut ou veut supporter pour le bénéfice de tous et la production de biens libres d’accès. Si l’on suit les développements d’Ostrom concernant l’organisation de la gestion égalitaire des biens communs, nous pouvons distinguer trois niveaux de règles qui s’emboîtent dans le cadre de l’utilisation de ressources communes. En premier lieu les règles opérationnelles, composées notamment des processus d’appropriation, de fourniture ou de surveillance, qui influent directement sur les décisions des appropriateurs. En second lieu, les règles de choix collectifs, qui comprennent les processus de gestion et de décision politique. Enfin, les règles de choix constitutionnels, qui affectent l’ensemble de la gouvernance concernant les processus de décision, déterminant les règles de choix collectifs et les règles opérationnelles. Nous retrouvons ici la dimension éminemment politique de la gestion de la propriété.
Le mouvement des communs s’est d’abord développé à partir des problématiques liées à la gestion des ressources naturelles. Il s’est ensuite élargi à la question des connaissances puis des données personnelles liées au numérique, Internet constituant un espace à l’origine ouvert mais faisant désormais l’objet de multiples enclosures. Ces deux premiers domaines ne sont pas vierges de théories et pratiques libertaires que l’on retrouve déjà au XIXe siècle. Les deux suivants n’en sont encore qu’à leurs balbutiements concernant l’approche par les communs mais ont déjà, là encore, fait l’objet d’une attention particulière dans le mouvement anarchiste : il s’agit de la gestion des moyens de production et de l’organisation politique par les communs territoriaux.
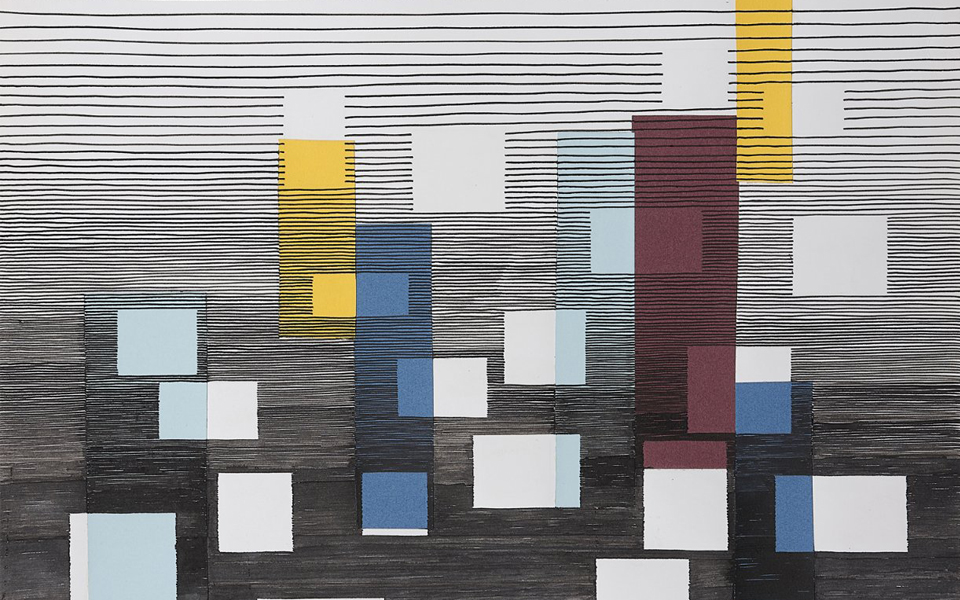
[Michel Seuphor]
Les communs des ressources naturelles
Cette catégorie, très vaste, rassemble des objets divers mais caractérisés par les effets significatifs que peut avoir leur usage sur la population mondiale : environnement, fonds marins, génome, corps humain, patrimoine culturel, eau, atmosphère… Une réflexion sur ce qui appartient à la catégorie des biens communs globaux vise à définir les formes de protection des ressources qui doivent être retirées de la sphère commerciale, ou dont l’utilisation marchande a vocation à être fortement encadrée par de nouveaux droits fondamentaux. Selon l’Association internationale de l’étude des communs, les communs de subsistance constitués autour de ressources naturelles, qui existent donc hors du marché et sans droit de propriété privée, sont vitaux pour environ deux milliards d’individus dans le monde. Dans le Nouveau-Mexique, par exemple, les communautés autochtones gèrent collectivement depuis le XVIIe siècle des systèmes de cours d’eau connus sous le nom d’acequias, satisfaisant les besoins en eau de la communauté et respectant les limites écologiques de la ressource. Les acequias disposent certes de la sanction légale de l’État du Nouveau-Mexique, mais ce sont les communautés elles-mêmes qui gouvernent cette institution. Chaque membre participe à son bon fonctionnement, à la fois en permettant la satisfaction de l’approvisionnement en eau et en préservant les ressources naturelles.
« C’est le cas par exemple du Parc de la pomme de terre, au Pérou, qui vise à protéger les 900 variétés de pommes de terre développées pendant des millénaires par différents peuples des Andes. »
Certains communs sont créés pour la préservation de la biodiversité et de la culture des peuples indigènes. C’est le cas par exemple du Parc de la pomme de terre, au Pérou, qui vise à protéger les 900 variétés de pommes de terre développées pendant des millénaires par différents peuples des Andes. Soustrayant ainsi cette biodiversité aux tentatives de brevetages de multinationales, quelque 7 000 villageois de six communautés indigènes gèrent collectivement ce parc. Cette conception écologique se retrouve dans certaines intuitions formulées dans les écrits des premiers libertaires, de Proudhon à Kropotkine, mais aussi et surtout dans l’œuvre d’Élisée Reclus, célèbre pour sa Nouvelle géographie universelle en 19 volumes. Selon lui, l’humain est un élément de la nature qui constitue un tout équilibré : « L’homme est la nature prenant conscience d’elle-même5. » Il doit veiller à ne pas rompre ce fragile équilibre qui lui confère sa liberté. L’observation par Reclus de l’équilibre précaire entre l’humain et la nature lui permet de déduire que le capitalisme et le productivisme sont dommageables pour l’un comme l’autre : dans une grande métropole comme Londres, note-t-il, le mauvais traitement de l’eau entraîne un taux de mortalité trois fois plus élevé dans les quartiers pauvres que dans les quartiers riches.
Les développements théoriques de l’anarchisme concernant l’écologie, très avancés dès la deuxième moitié du XIXe siècle6, connaîtront un nouveau souffle dans le dernier quart du même siècle, notamment aux États-Unis, avec l’écologie sociale — dont Murray Bookchin est le principal représentant. Selon lui, ce sont les conditions économiques, politiques et sociales qu’il est indispensable de changer si l’on veut préserver une nature environnementale. Partant du constat que le fondement de l’État et du capitalisme est la domination, il en déduit que le principe même de domination, y compris sur la nature, relève d’une logique illégitime et dangereuse. L’écologie sociale de Bookchin suppose une organisation fondée sur une coopération de communautés naturelles (non façonnées par l’État ou par une autorité politique coercitive), notamment par le biais d’un municipalisme libertaire. Les individus participeraient aux affaires de la commune et à la gestion de leur environnement, ce qui supposerait le contrôle de l’économie par les citoyens.
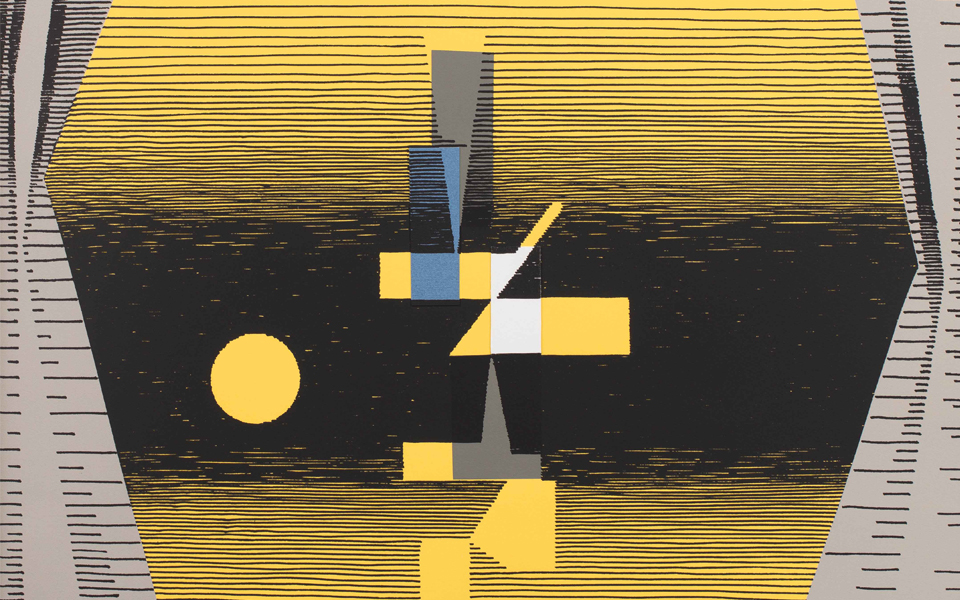
[Michel Seuphor]
Les communs numériques
Si le renouveau des communs a eu lieu en grande partie en raison de l’urgence écologique, il fut aussi accompagné par l’émergence d’une nouvelle technologie qui constitue un espace ouvert, en cela similaire en de nombreux points aux communs du Moyen Âge : Internet. Dans cet espace, nous retrouvons des ressources numériques de la connaissance qui ont pour caractéristique de se multiplier lorsqu’elles sont partagées (alors que le partage d’un bien matériel suppose sa division). Les pionniers d’Internet ont une conception assez libertaire du Web : il doit constituer un espace affranchi des réglementations gouvernementales et des prédations capitalistes, notamment en matière de propriété intellectuelle et de données personnelles. John Perry Barlow, par exemple, cofondateur en 1990 de l’Electronic Frontier Foundation, une ONG visant à protéger les libertés sur Internet, rédige en 1996 une Déclaration d’indépendance du cyberespace. Il écrit en s’adressant aux États et aux entreprises : « Je viens du cyberespace, la nouvelle résidence de l’esprit. […] Vous n’êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n’avez pas de souveraineté là où nous nous rassemblons7. » Très vite, les licences de type Creative Commons se développent de manière à protéger les œuvres de la connaissance de toute prédation publique ou privée et assurer leur circulation. Des créations collaboratives avec des règles partagées émergent, comme en témoigne Wikipédia.
« Le coopérativisme de plateformes entend ainsi rendre aux utilisateurs la gestion de ces dernières, et ce dans une ligne autogestionnaire chère à la tradition libertaire. »
La cryptologie devient un outil pour protéger les communs de la connaissance contre les nouvelles enclosures qui, elles aussi, se développent8. Comme le notait déjà Timothy C. May en 1989 dans son Manifeste crypto-anarchiste : si « une invention apparemment mineure comme le fil de fer barbelé a rendu possible la clôture de vastes ranchs et fermes, changeant ainsi pour toujours les concepts de terre et de droits de propriété en Occident, la découverte apparemment mineure d’une branche mystérieuse des mathématiques deviendra le coupe-file qui démantèlera les barbelés autour de la propriété intellectuelle9 ». D’autre part, de nouvelles formes d’organisation du travail se développent dans l’économie des plateformes numériques, privilégiant l’association des travailleurs, la mutualisation du capital, ou valorisant des finalités liées à l’environnement, aux circuits courts et à la solidarité, dans la lignée des premières coopératives, et non à la recherche de profits comme les plateformes capitalistes de type Uber ou Airbnb.
Trebor Scholz, professeur à la New School de New York, a élaboré le concept de « coopérativisme de plateforme » pour désigner ces nouvelles organisations. Dans l’article « Platform Cooperativism : Challenging the Corporate Sharing Economy », il le qualifie par les 10 principes suivants : « une propriété partagée de la plateforme entre ses utilisateurs ; des rémunérations décentes accordées aux utilisateurs de la plateforme (en cas de prestations de services marchands) ; une transparence dans la collecte et l’usage des données personnelles ainsi qu’une libre portabilité de ces dernières entre plateformes ; un dialogue/une médiation entre la plateforme et ses utilisateurs ; une codétermination du travail entre utilisateurs et gestionnaires de la plateforme ; la promotion d’un cadre juridique protecteur, notamment en matière de concurrence entre plateforme et travailleurs, et en matière de droit du travail ; des droits et des protections portables pour les utilisateurs entre différentes plateformes ; une protection contre les décisions arbitraires des plateformes ; une limitation de la surveillance de l’activité des utilisateurs et un droit à la déconnexion10 » Le coopérativisme de plateformes entend ainsi rendre aux utilisateurs la gestion de ces dernières, et ce dans une ligne autogestionnaire chère à la tradition libertaire. L’un des enjeux de ces plateformes est de maintenir leur modèle dans un environnement économique qui ne leur est pas favorable, comme en témoigne l’initiative Linux, système issu de la rencontre entre le mode opératoire hacker et des principes du logiciel libre, désormais possédé à 90 % par des entreprises capitalistes.
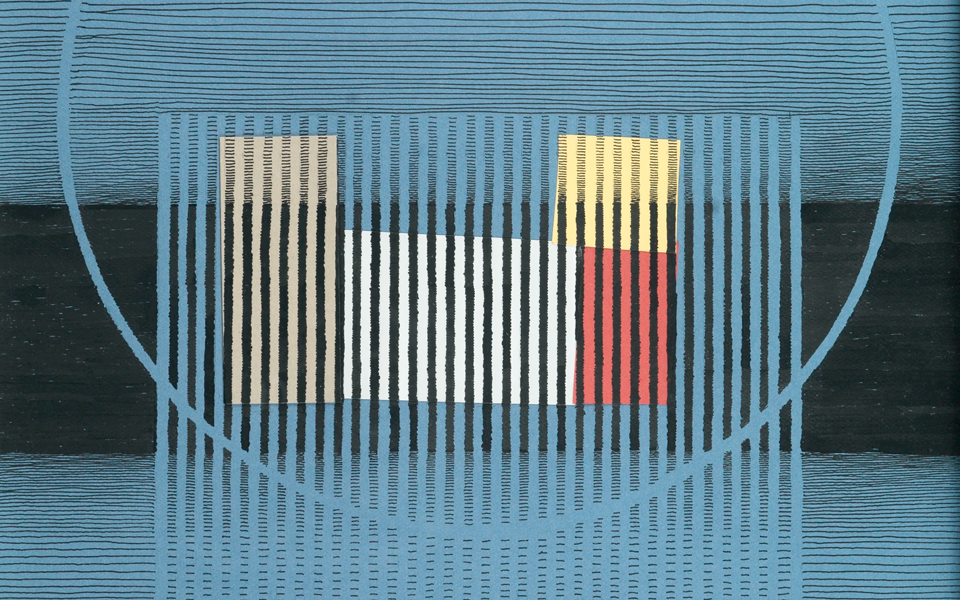
[Michel Seuphor]
Les communs de production
Les communs peuvent également désigner des moyens de production. Ils supposent que tous ceux sur qui s’exercent les décisions d’une unité de travail ont vocation à pouvoir participer à ce pilotage : au premier chef les employés, mais aussi les riverains dans le cas d’entreprises polluantes, ou encore les consommateurs… Ces idées rejoignent les principes autogestionnaires développés dans la deuxième moitié du XIXe siècle sous l’impulsion de Proudhon (notamment dans son ouvrage De la capacité des classes ouvrières), puis par le syndicalisme révolutionnaire ou l’anarcho-syndicalisme dans la théorie et la pratique. Elinor Ostrom l’illustre en mobilisant le cas des pêcheurs d’Alanya, en Turquie.
« L’expérience la plus vaste et la plus radicale demeure sans doute celle de l’Espagne anarchiste de 1936, dont il reste de nombreux enseignements à retirer. »
Dans les années 1970, ces travailleurs sont confrontés à une double contrainte : la concurrence pour la ressource précarise leur condition et peut entraîner des conflits ; laquelle entraîne une surexploitation des ressources, en l’occurrence les poissons, qui se raréfient. Pour y répondre, les pêcheurs du littoral d’Alanya décident de se réunir et d’expérimenter des solutions, débouchant en moins d’une décennie à l’adoption des règles suivantes : tout d’abord, les pêcheurs et les lieux de pêche doivent être listés. Les zones de pêche sont réparties au tirage au sort entre tous les travailleurs, l’activité étant autorisée de septembre à mai de manière à ce que les poissons puissent se reproduire le reste de l’année. Les pêcheurs doivent passer d’une zone à l’autre, d’ouest en est, permettant à chacun de pouvoir pêcher sur l’ensemble du littoral durant toute la période. Cette approche par les communs du travail et de la production, en garantissant l’égalité en capacité et en droit des producteurs, ainsi que la sauvegarde des ressources naturelles, s’avère plus efficace que la concurrence capitaliste ou l’administration étatique, trop éloignée pour comprendre et régler les problèmes.
Cette pratique d’une production autogérée, sans État ni capitalisme, se retrouve à de multiples reprises durant ces deux derniers siècles. L’expérience la plus vaste et la plus radicale demeure sans doute celle de l’Espagne anarchiste de 1936, dont il reste de nombreux enseignements à retirer. Dès le début de la révolution, toute une partie de l’Espagne se soulève, forte de ses plusieurs centaines de milliers de militants anarchistes de la Fédération anarchiste ibérique (FAI) et de la Confédération nationale du travail (CNT), afin de socialiser les moyens de production. Barcelone est au cœur de cet enthousiasme libertaire, comme en témoigne George Orwell dans son Hommage à la Catalogne. C’est ainsi que dans le secteur de la métallurgie, l’entreprise Hispano Suiza à Barcelone, comptant 1 400 travailleurs, est réquisitionnée par les syndicats en juillet 1936. L’industrie du bois, très importante dans la ville, a aussi fait l’objet de socialisations. La production est organisée entre collectivités de façon à ce que les types de produits fabriqués soient complémentaires et fassent l’objet d’échanges, et ce afin d’éviter la concurrence et l’augmentation de la production. Bien d’autres branches de l’industrie sont alors socialisées : si les situations peuvent différer, toutes répondent au même principe anarchiste de l’autogestion qui consiste à conjuguer l’autonomie et l’égalité. En juillet 1936, il faut rentrer les récoltes et reprendre en main les terres abandonnées. Des centaines de milliers de paysans vont collectiviser les terres, tout en autorisant les quelques propriétaires individuels désireux de garder les leur à le faire dès lors qu’ils n’y exploitent personne.
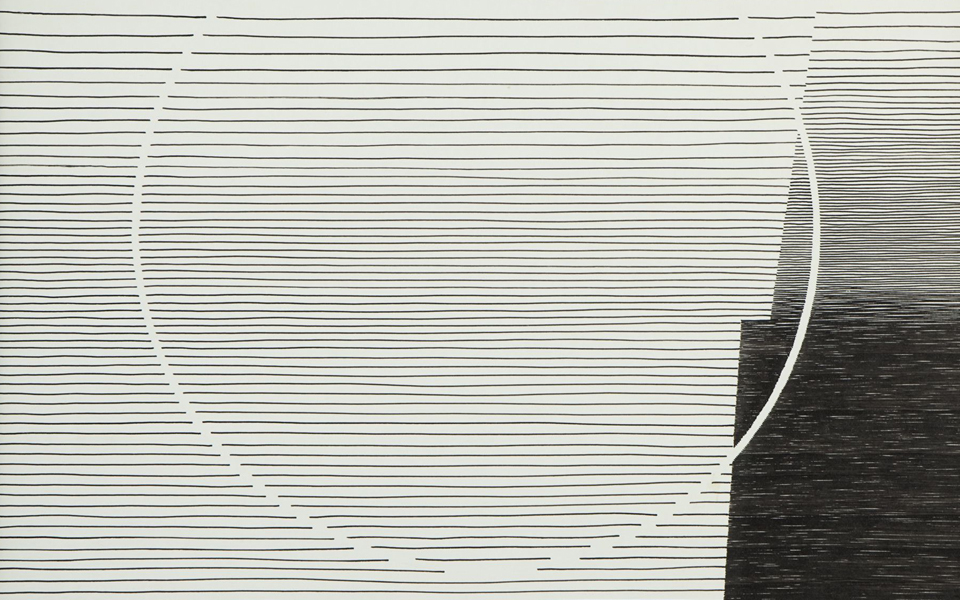
[Michel Seuphor]
Souvent, ces propriétaires rejoignaient la collectivité afin de bénéficier de ses avantages. On dénombre environ 350 collectivités en Catalogne, 500 au Levant, 450 en Aragon ou encore 240 en Nouvelle-Castille11. L’autogestion est organisée dans trois domaines complémentaires : les statistiques pour organiser l’économie, réunies par fédérations ; les nouvelles techniques, qui doivent permettre d’améliorer et de restructurer l’économie en concentrant les industries et en développant les innovations ; la culture, qui ouvre sur une nouvelle vision du monde, essentiellement grâce aux écoles. Cette formidable expérience a en grande partie été victime des luttes entre anarchistes et staliniens, ainsi que de l’absence de soutien des démocraties européennes. Mais si l’on conçoit que l’économique ne peut se restreindre à un domaine exclusif où seuls les travailleurs détiendraient un pouvoir de décision sur la production, il est nécessaire d’envisager son corollaire : les communs territoriaux.
Les communs territoriaux
« Avec la gouvernance des communs, nous retrouvons là le dépassement de la forme traditionnelle de l’État fondée sur une souveraineté monolithique. »
Les communs territoriaux désignent la faculté pour les citoyens de s’autogouverner en commun sur un territoire donné (quartier, commune, région, etc.). Ils supposent des délibérations et des capacités de prise de décision réelle de la part des citoyens, concernant la gestion de leur territoire (ce qui inclut toute activité économique ayant une incidence sur leur territoire). C’est dans cette perspective que la remunicipalisation des eaux à Naples a été établie, ou qu’ont été créés à Bologne des Pactes de collaboration associant les collectivités territoriales et les citoyens dans des procédures de décision12. Comme l’écrivent le philosophe et le sociologue Pierre Dardot et Christian Laval dans leur ouvrage Commun : « [P]our répondre réellement à des besoins collectifs
, il convient que [les services publics] soient exprimés, débattus, élaborés selon des votes démocratiques. À défaut de cet engagement civique, l’usager est soit un sujet, soit un client, parfois les deux à la fois. Dans les deux cas, il y a usurpation ou dilution de l’intérêt général et perte de la dimension de la citoyenneté. Mais à quelle condition peut-on passer du service public au service commun ? Ceci implique une modification considérable de la conception que l’on se fait de l’État. Si l’on peut bien rappeler les origines lointaines de la notion de service public, enracinée dans les catégories antiques et médiévales de l’utilité publique
et de l’intérêt général
, on ne peut oublier que l’État s’est principalement construit comme imperium et non comme obsequium13. »
Or c’est précisément comme obsequium que Proudhon entend l’État, c’est-à-dire comme entité ayant le devoir d’assurer la charge publique confiée par la collectivité. Il faut le mettre à la hauteur de la société et lui ôter son caractère absolu, comme à la propriété. L’État, si on peut encore l’appeler « État » (dans la mesure où il n’est plus à proprement parler marqué par le sceau de la souveraineté), devient alors « le proviseur de la société, la sentinelle du peuple14. » Avec la gouvernance des communs, nous retrouvons là le dépassement de la forme traditionnelle de l’État fondée sur une souveraineté monolithique. Comme le résume le militant étasunien David Bollier dans La Renaissance des communs : « Cette gouvernance ne prendra pas la forme de structures formelles et hiérarchiques imposées et administrées par les États-Nations, mais bien plutôt celle d’une coalescence de grands réseaux de systèmes de production par les pairs motivés par leur intérêt mutuel. Ce n’est pas une vision utopique. On peut d’ores et déjà observer une telle fédération coopérative à l’œuvre au sein des communs d’Internet15. »
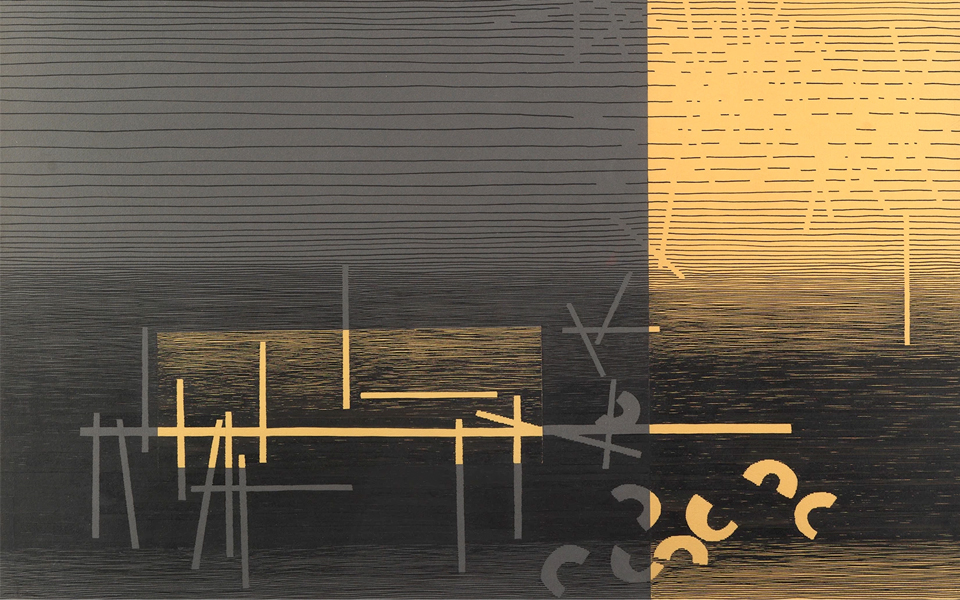
[Michel Seuphor]
Les communs supposent un dépassement de l’État dans une approche tournée vers le lieu d’élection originaire du politique, à savoir la Cité. Ici, le municipalisme libertaire, largement théorisé par Bookchin, se retrouve naturellement investi. Il affirme l’idée que des institutions libertaires peuvent naître parallèlement à l’État et en marge du capitalisme pour peu à peu les supplanter. Cette stratégie est rendue possible à partir de la commune qui constitue le lieu d’élection de la liberté politique, ce au moins depuis la Cité grecque. Ainsi, « [l]e seul moyen de reconstruire la politique est de commencer par ses formes les plus élémentaires : les villages, les villes, les quartiers et les cités où les gens vivent au niveau le plus intime de l’interdépendance politique au-delà de la vie privée. C’est à ce niveau qu’ils peuvent commencer à se familiariser avec le processus politique, un processus qui va bien au-delà du vote et de l’information16 ». Les grandes métropoles comme New York, Londres ou Paris n’ont évidemment plus grand-chose à voir avec les cités de l’Antiquité comme Athènes, qui permettaient l’exercice de la démocratie directe — dont les femmes et les esclaves étaient toutefois exclues…
« Bookchin met en évidence un danger : que les travailleurs soient seuls à décider de la politique de production. Très vite, ils rentreraient dans des logiques corporatistes. »
Cependant, quelle que soit la taille des villes, chacune est divisée en un certain nombre de quartiers qui permettent de concevoir des territoires à taille humaine permettant un tel exercice. La grandeur d’une ville n’est ainsi en rien déterminante de la forme politique qui doit la régir, à moins que l’on concède que si la démocratie directe ne peut avoir lieu que dans des cités de 20 000 habitants, il ne peut alors régner qu’une bureaucratie dictatoriale dans celles de 2 millions. Bookchin prend l’exemple de la ville de Paris de 1793, alors peuplée de 5 à 600 000 habitants, qui, grâce à sa fédération en sections, avait fort bien pu organiser l’approvisionnement et la sécurité, faire respecter le maximum des prix ou encore assurer des tâches administratives complexes. Bookchin met du reste en évidence un danger : que les travailleurs soient seuls à décider de la politique de production. Très vite, ils rentreraient dans des logiques corporatistes, voire seraient conduits à réitérer les méfaits de la concurrence capitaliste. Ce serait donc bien l’ensemble de la population d’une commune où d’un territoire donné qui déciderait de la politique de production. La dimension locale du municipalisme ne saurait toutefois faire l’économie du fédéralisme pour envisager des problématiques globales, par exemple en ce qui concerne l’environnement.
La notion de fédéralisme est centrale dans les théories anarchistes : on la retrouve chez Proudhon dans son ouvrage Du principe fédératif ou chez Bakounine, dans Fédéralisme, socialisme, antithéologisme. Le fédéralisme ne saurait non plus faire l’économie d’outils comme ceux de la comptabilité, nécessaires pour réenvisager la notion de capital soumis aux finalités décidées par les groupes constituant les communs17. Le fédéralisme constitue ainsi la garantie institutionnelle de l’autonomie de groupes, en partant de la plus petite unité à la plus grande (de l’individu à la planète), se coordonnant de bas en haut en fonction de l’échelle des enjeux.
*
Comme certains font de la prose sans le savoir, d’autres s’organisent en communs et vivent en anarchistes sans nommer ainsi leurs pratiques, et finissent par se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls, que l’idée qui les inspire leur préexiste depuis des temps immémoriaux et qu’il leur appartenait de lui donner corps. Si certains communs peuvent être l’objet de fortes inégalités (par exemple entre hommes et femmes), en raison de règles issues de traditions non discutées n’ayant pas intégré le principe d’une égalité incluante, la radicalité libertaire, en ce qu’elle prend les choses à la racine et préserve l’esprit d’autonomie, constitue un antidote aux récupérations autant qu’aux iniquités et aux exclusions. En cela, dans la mesure où il existe une congruence entre théories et pratiques, les apports mutuels et les critiques réciproques entre anarchisme et communs ne peuvent être que féconds.
Illustrations de bannière et de vignette : Michel Seuphor
- Élisée Reclus, L’Anarchie [1896], Mille et une Nuits, Paris, 2009.[↩]
- Gilles Deleuze, Qu’est-ce que la philosophie ? Éditions de Minuit, 1991.[↩]
- Voir notamment Karl Polanyi, La Grande Transformation, Gallimard, 2009.[↩]
- Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs — Pour une nouvelle approche des biens naturels, De Boeck, 2010, p. 27.[↩]
- Élisée Reclus, [1905], L’Homme et la Terre, La Découverte, 1998.[↩]
- Voir notamment Serge Audier, La Société écologique et ses ennemis, La Découverte, 2017.[↩]
- John Perry Barlow, « A Declaration of the Independence of Cyberspace », Electronic Frontier Fondation.[↩]
- Dans son ouvrage The Public Domain : Enclosing The Commons Of The Mind (2003), le juriste américain James Boyle compare l’extension des droits de propriété intellectuelle à un « second mouvement d’enclosure ».[↩]
- Timothy C. May, Le Manifeste crypto-anarchiste, 1989.[↩]
- Guillaume Compain, Philippe Eynaud, Lionel Morel, Corinne Vercher-Chaptal, Les Plateformes collaboratives : Éléments de caractérisation et stratégies de développement, 2019, pp. 12–13.[↩]
- Gaston Leval, Espagne libertaire 1936–1939 — L’œuvre constructive de la révolution espagnole, La Tête de Feuilles, 1971.[↩]
- « Bologne à l’épreuve des communs », Enacting the communs.[↩]
- Pierre Dardot et Christian Laval, Commun, La Découverte, 2014, pp. 516–517.[↩]
- Proudhon, Confessions d’un révolutionnaire, Tops/Trinquier, 1997, p. 197.[↩]
- David Bollier, La Renaissance des communs, Charles Leopold Meyer, 2014, pp. 150–151.[↩]
- Murray Bookchin, From Urbanization to Cities, Cassell, 1995.[↩]
- Voir Édouard Jourdain, Quelles normes comptables pour une société du commun ?, ECLM, 2019.[↩]

