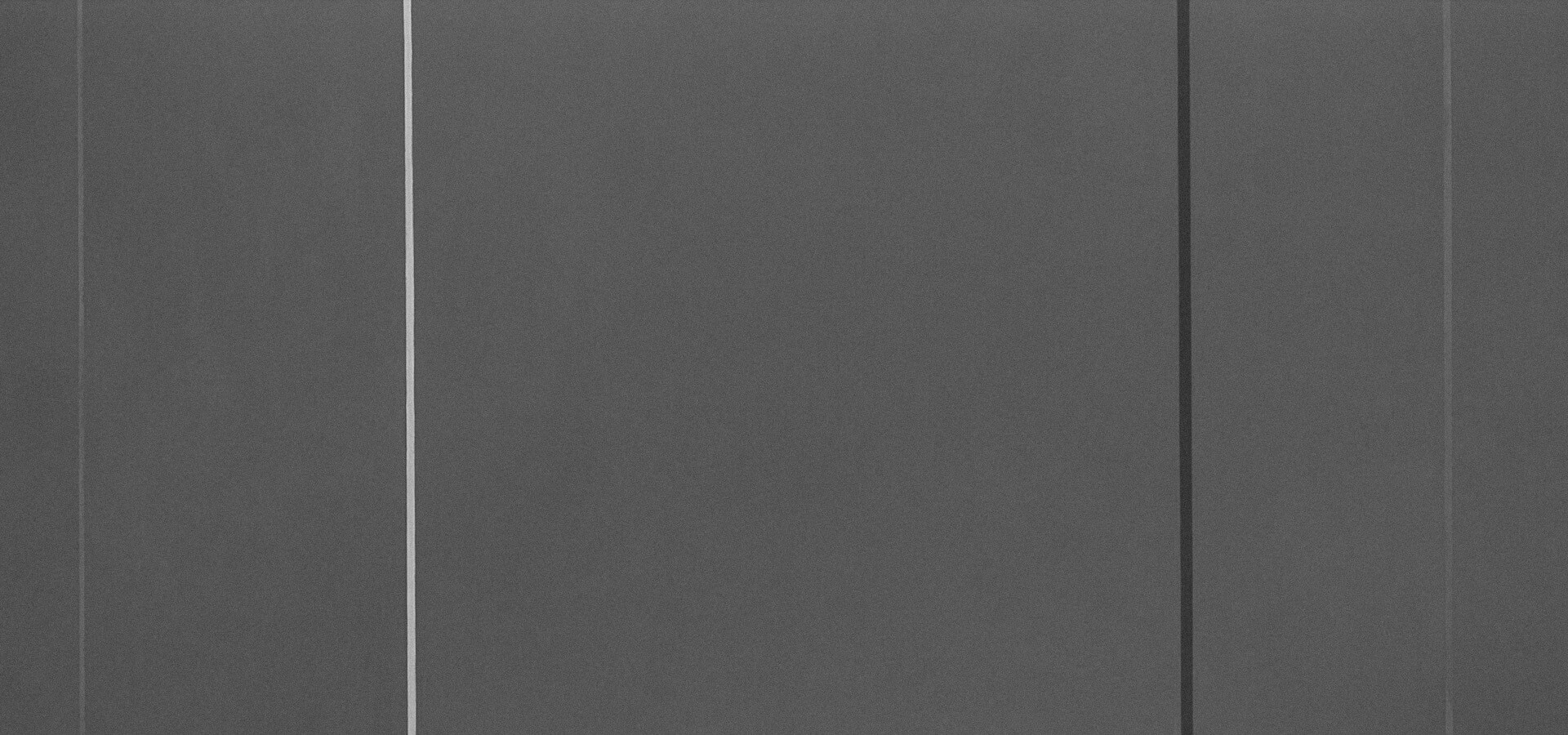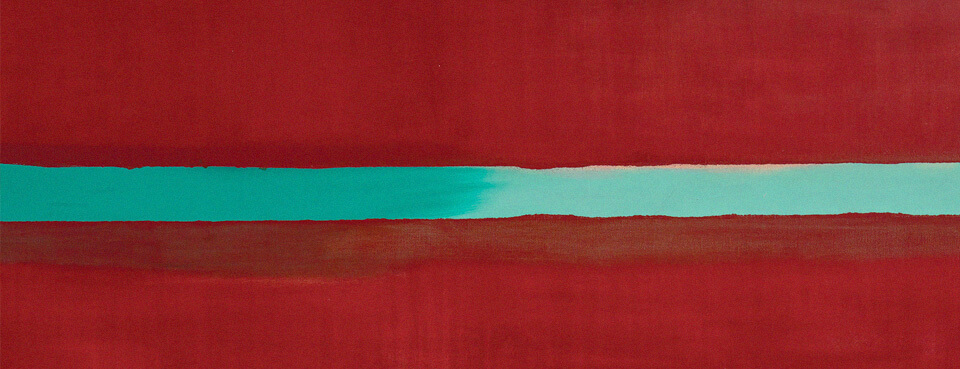Tribune
Depuis que les éditions Hatier ont publié un manuel qui applique en partie l’écriture inclusive1, le débat fait rage. Une simple mesure d’égalité, qui applique les recommandations du Guide pratique pour une communication publique sans stéréotypes de sexes mis en ligne par le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes ? Un « péril mortel » pour la langue, comme l’a proclamé l’Académie française — qui ne compte pourtant pas de linguiste dans ses rangs ? Ou, plus simplement, un débat sans importance ? C’est pour tenter de clarifier certains termes du débat, pour dénoncer l’incompétence et l’anachronisme de l’Académie, que plus de 70 linguistes francophones ont décidé de riposter, par la présente tribune, en exprimant un souhait commun : que la langue française devienne un objet de réflexion collective.
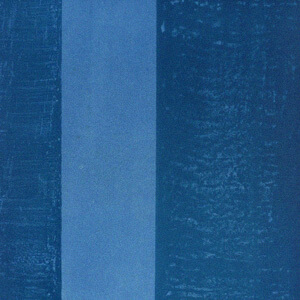
Des débats sur le vocabulaire, la prononciation, l’orthographe, la grammaire ou, de manière plus large, sur les règles de bienséance sociale en matière de comportement langagier ont toujours eu lieu ; ils accompagneront toujours l’évolution d’une langue vivante, parlée et écrite par autant de gens. Mais à certains moments plus qu’à d’autres, ces débats passent sur le devant de la scène, comme c’est le cas aujourd’hui.
« Que cela plaise ou non, il n’est pas seulement question de linguistique, mais également de politique. »
Les polémiques actuelles sur l’expression du genre en français existent depuis des siècles et se poursuivront tant que le genre des mots (pronoms, adjectifs, noms) qui se réfèrent aux êtres humains en français sera associé au genre social des personnes désignées. La situation est la même dans toutes les langues romanes, et les débats s’y tiennent dans les mêmes termes. Tant que nous dirons « elle, une actrice talentueuse », lorsque nous identifions une femme, et « lui, un acteur talentueux », lorsque nous identifions un homme, le genre ne sera pas arbitraire et nous aurons besoin de construire des réponses aux questions qui touchent à son expression. Mais comment parler d’un groupe dans lequel nous avons identifié vingt femmes et un homme, ou au contraire, vingt hommes et une femme ? Est-ce pertinent de dire « ils » pour des groupes de compositions aussi différentes, ou vaut-il mieux utiliser un pronom accordé à la majorité ? Comment parler d’un groupe composé d’un très grand nombre de personnes : est-ce suffisant de dire « les ouvriers » pour signifier qu’on se préoccupe des temps partiels imposés et des congés de maternité ? Sommes-nous plus explicites lorsque nous disons « les ouvriers et les ouvrières » ? Les réponses à cette question n’ont rien qui relève de l’évidence. Et laisser croire que c’est l’usage qui a spontanément résolu la question en imposant la règle du « masculin qui l’emporte sur le féminin » est d’une mauvaise foi sans bornes. Il s’agit bien d’une intervention des académiciens du XVIIe siècle, destinée à influencer des pratiques linguistiques fort variables, et non pas d’un enregistrement de l’usage. Ainsi, il est tout à fait possible d’émettre au XXIe siècle des recommandations différentes afin de faire évoluer cette convention : accord avec le mot le plus proche, accord à la majorité…
Que cela plaise ou non, il n’est pas seulement question de linguistique, mais également de politique. Pour les personnes qui se sentent à l’étroit dans l’opposition binaire femme/homme, il n’y a pour l’instant pas de pronom neutre en français : la forme « iel », ainsi que de nombreuses autres nouvelles formes, sont en train de se diffuser et pourraient permettre de combler ce besoin. Les grammaires actuelles ne proposent pas de réponses à tout, et quand elles le font, ces réponses sont parfois politiquement contestables ou obsolètes. C’est pour cela que ces questions sont visibles plus dans les médias que dans les livres de grammaires. Il nous semble important de faire savoir que la grammaire prescriptive, celle qui codifie la langue, est liée à la politique et à l’organisation sociale des personnes qui partagent une langue ; elle n’a rien d’immuable, comme la force d’attraction gravitationnelle ou la course de la Terre autour du Soleil ! Différentes règles linguistiques se font concurrence, car les gens ne parlent ni n’écrivent de manière homogène. L’institution chargée de l’enseignement permet de faire pression sur les règles en concurrence permanente, en attribuant une valeur prestigieuse à une variante plutôt qu’à une autre, ou bien en acceptant la variation, selon les cas. Mais cela se renégocie sans cesse. Il en sera toujours ainsi, et il n’y a là rien d’inquiétant. Au fond, il suffit de faire participer le plus grand nombre à ces débats et, au bout d’un moment, des tendances émergent, les dictionnaires et les grammaires les enregistrent, et les débats se calment… avant de reprendre, trente ou cinquante ans plus tard.
Les positions exprimées récemment par des membres de l’Académie française montrent leur ignorance des mécanismes des changements linguistiques, ce qui n’est pas surprenant. Ce n’est pas parce que l’on utilise un outil que l’on sait comment il est construit. On peut avoir des avis sur son efficacité, son utilité, et même son esthétique, sans pour autant savoir comment il est structuré. Pourtant, la diffusion massive du féminin pour nommer les métiers et les fonctions exercées par les femmes, en dépit des recommandations de l’Académie, aurait dû servir de leçon aux Immortel·les et les inciter à des prises de position plus mesurées et plus prudentes. En matière de langage, les recommandations ne sont que des conseils, que l’on peut suivre, ou non. Certes, la cohérence entre institutions est toujours préférable : lorsque le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, en France, incite à faire évoluer les usages linguistiques vers des pratiques plus égalitaires et moins sexistes et que, parallèlement, une autre institution, l’Académie française, s’arcboute pour bloquer ces préconisations, cela ne rend pas la lecture des règles aisée. Pourtant, personne n’a autorité à trancher, ou, plus exactement, tout le monde partage cette autorité. La langue évolue non pas seulement à cause du « bon usage » prescrit par les institutions en tout genre, mais aussi parce que les locuteurs et locutrices se l’approprient. Au fil du temps, dès que l’on prend le recul qu’impose le regard historique, on s’aperçoit que les changements linguistiques sont parfois amorcés par une élite, avec plus ou moins de succès, et parfois imposés à cette même élite par l’usage majoritaire, lequel échappe au contrôle institutionnel.
« Toucher à la langue fait ressurgir des émotions ressenties durant l’enfance, interroge le sentiment d’appartenance à une communauté, le rapport identitaire à l’histoire et au patrimoine. »
L’évolution du registre des mots donne de nombreux exemples de ce fait : « bouquin » a d’abord été un terme précieux, puis il est devenu familier, voire argotique. Parfois, ce changement s’effectue sur une échelle temporelle si longue que le débat n’a pas lieu ; d’autres fois, comme pour l’accord de genre, une discussion s’engage (et le XVIIe siècle n’y a pas plus échappé que le XXIe). Ces discussions sont toujours vives : toucher à la langue fait ressurgir des émotions ressenties durant l’enfance, interroge le sentiment d’appartenance à une communauté, le rapport identitaire à l’histoire et au patrimoine. Si l’on se penche sur les diverses polémiques du siècle dernier, que ce soit au sujet de l’expression du genre, de l’orthographe ou des anglicismes, l’on retrouve les mêmes arguments et les mêmes métaphores, par lesquelles la langue devient une personne de sexe féminin à la fois faible, belle et pure qu’il est urgent de protéger car elle est « défigurée », « enlaidie », nous dit la Coupole2 ; selon Michael Edwards, elle est même « atteinte d’une maladie qui couvre la page comme une sorte d’eczéma », sa « chair […] est rongée ».
Or, si les images aident à comprendre le monde, il ne faut pas pour autant oublier qu’elles ne sont que des comparaisons et non des réalités ; car « [c]e qui se conçoit bien s’énonce clairement », parait-il. Une langue n’a pas de visage ; c’est un système avec des règles en partie arbitraires, en partie motivées. Quand ces règles ne correspondent plus aux besoins, elles changent, que les puristes veuillent l’admettre ou non. Si l’on observe les courriels, tracts, textes officiels et même certaines professions de foi politiques, on ne peut que constater que des changements d’usage sont déjà en cours. Faut-il les entériner, les freiner ou les accélérer ? Les débats sont vifs. Mais personne ne peut nier ces débats, et personne ne doit les confisquer, pas même l’Académie, qui a récemment publié un communiqué alarmiste — qu’on aurait pu prendre pour une parodie ! — pour mettre en garde les francophones contre un soudain et mystérieux « péril mortel » qui guetterait le français (déclaration du 26 octobre 2017).
Nous l’affirmons sans l’ombre d’un doute : le français n’est pas en danger. Tous les paramètres sont au vert : parlé sur tous les continents, le français est une langue de culture, du quotidien, d’apprentissage, de compétences (professionnelles, administratives…) pour des millions de personnes dans le monde. Il ne risque strictement rien si quelques règles sont modifiées. Au contraire, les propositions récentes sur un accord de proximité ou de majorité ne pourraient qu’améliorer les performances écrites de nombreux locuteurs et locutrices. L’Académie est (encore !) en passe de rater une occasion de montrer sa pertinence. Rien ne lui interdit de contribuer à faire évoluer des règles, et elle a su le faire à de nombreuses reprises, comme le rappelle son site Internet. Gardienne du temple, elle pourrait choisir d’impulser des réformes si elle s’apercevait que l’usage frappe à sa porte (nous aimons, nous aussi, parfois, les métaphores osées). Ses membres, qui plus est, dans leurs ouvrages, toquent eux aussi : s’ils étaient obligés d’appliquer la totalité des prescriptions du dire / ne pas dire formulées par leur cénacle, ou de se limiter aux seuls mots acceptés dans leur dictionnaire, bien des pans de leur production s’en trouveraient irrémédiablement tronqués. Les auteurs francophones non hexagonaux enfin accueillis sous la Coupole ne sauraient nous démentir : leur virtuosité passe justement par ce mariage heureux entre usage parlé et (bon) usage écrit. Le débat sur l’évolution des règles est déjà dans leurs lignes, dans les bouches de leurs personnages. Celui sur l’accord au féminin des noms de métiers, titres et grades vient enfin d’être reconnu officiellement comme débat ouvert au sein de l’Académie ; celui sur l’accord de proximité ne manquera pas d’émerger par la suite.
« Le français se trouvera en péril mortel le jour où l’on cessera d’en débattre. »
Comment un débat pourrait-il être évité dans toutes les aires de la francophonie actuelle ? Et surtout, pourquoi chercher à empêcher qu’il ait lieu ? Est-ce là l’une des fonctions de l’Académie et des écrivains, voire de certains linguistes qui oublient leurs fondamentaux, entrainant dans leur sillage celles et ceux qui leur font confiance sans vérifier leurs dires ? La liberté d’expression, lorsqu’elle concerne la langue même qui permet d’exercer cette liberté, n’est-elle donc pas « sacrée » ? La désinformation à grand renfort de métaphores aussi fausses que violentes, si elle est l’un des piliers du discours polémique, n’en est pas pour autant respectable quand elle émane d’une institution et de personnes qui veulent faire figure d’autorité.
Nous appelons donc solennellement toutes et tous les francophones à débattre sereinement et sans aucune crainte, et à s’informer, auprès de sources fiables, portant notamment sur l’histoire de la langue, pour en comprendre les mécanismes. Le français se trouvera en péril mortel le jour où l’on cessera d’en débattre. L’Académie disparaitra le jour où l’on cessera de lui accorder de l’audience. Si quelque chose devait être en péril mortel aujourd’hui, ce serait plutôt l’Académie.
SIGNATAIRES
Maxime Amblard, université de Lorraine, France
Laurence Arrighi, université de Moncton — Nouveau Brunswick, Canada
Christophe Benzitoun, université de Lorraine, France
Philippe Blanchet, université Rennes 2, France
Mylène Blasco, université de Clermont Auvergne, France
Caroline Bogliotti, université Paris Nanterre, France
Yannick Bosquet, université de Maurice, République de Maurice
Annette Boudreau, université de Moncton — Nouveau Brunswick, Canada
Josiane Boutet, université Paris-Sorbonne, Directrice de la revue Langage et Société, France
Maria Candea, université Sorbonne nouvelle, France
Véronique Castellotti, université François Rabelais de Tours, France
Yannick Chevalier, université Lyon 2, France
Jean-Pierre Chevrot, université Grenoble Alpes, France
Stéphanie Clerc, université Rennes 2, France
Hugues Constantin de Chanay, université Lyon 2, France
James Costa, université Sorbonne Nouvelle, France
Corinne Denoyelle, université Grenoble-Alpes, France
Émilie Devriendt, université de Toulon, France
Daniel Elmiger, université de Genève, Suisse
Jean-Michel Eloy, université de Picardie Jules Verne, France
Cécile Fabre, université de Toulouse, France
Karën Fort, université Paris Sorbonne, France
Béatrice Fracchiolla, université de Lorraine, France
Françoise Gadet, université Paris Nanterre, France
Claudine Garcia-Debanc, université Toulouse Jean Jaurès — ESPE Midi-Pyrénées, France
Médéric Gasquet-Cyrus, université Aix-Marseille, France
Lucile Gaudin-Bordes, université de Toulon, France
Jean-Michel Géa, université de Corse Pascal Paoli, France
Philippe Gréa, université Paris Nanterre, France
Luca Greco, université Sorbonne Nouvelle, France
Pascal Gygax, université de Fribourg, Suisse
Benoît Habert, Ecole Normale Supérieure, Lyon, France
Monica Heller, université de Toronto, Canada
Stavroula Katsiki, université Saint-Denis Vincennes, France
Alice Krieg-Planque, université Paris-Est Créteil, France
Dominique Lagorgette, université Savoie Mont-Blanc, France
Patricia Lambert, Ecole Normale Supérieure, Lyon, France
Anne Le Draoulec, CNRS et université Toulouse Jean Jaurès, France
Matthieu LeBlanc, université de Moncton — Nouveau Brunswick, Canada
Michelle Lecolle, université de Lorraine, France
Amélie Leconte, université Aix-Marseille, France
Fabienne Leconte, Normandie université, France
Gudrun Ledegen, université Rennes 2, France
Florence Lefeuvre, université Sorbonne Nouvelle, France
France Martineau, université d’Ottawa, Canada
Marinette Matthey, université Grenoble Alpes, France
Valérie Méot-Bourquin, université Grenoble Alpes, France
Grégory Miras, Normandie université, France
Claudine Moïse, université Grenoble Alpes, France
Michèle Monte, université de Toulon, France
Clara Mortamet, Normandie université, France
Sandrine Ollinger, CNRS, Analyse et Traitement Automatique des Langues, France
Nadia Ouabdelmoumen, université Rennes 2, France
Marie-Paule Péry-Woodley, université de Toulouse Jean-Jaurès, France
Gaëlle Planchenault, Simon Fraser University — Vancouver, Canada
Bénédicte Pivot, université Paul Valéry — Montpellier 3, France
Josette Rebeyrolle, université Toulouse Jean Jaurès, France
Wim Remysen, université de Sherbrooke — Québec, Canada
Marielle Rispail, université Jean Monnet — Saint Etienne, France
Didier de Robillard, université François Rabelais de Tours, France
Laurence Rosier, université Libre de Bruxelles, Belgique
Marion Sandré, université de Toulon, France
Julie Sorba, université Grenoble-Alpes, France
Sandra Tomc, université Jean Monnet — Saint Etienne, France
Nicolas Tournadre, université Aix-Marseille, France
Cyril Trimaille, université Grenoble-Alpes, France
Henry Tyne, Président de l’Association for French Language Studies, université de Perpignan Via Domitia, France
Émilie Urbain, université de Moncton — Nouveau Brunswick, Canada
Andrea Valentini, université Sorbonne Nouvelle, France
Cécile Van den Avenne, université Sorbonne Nouvelle, France
Marie Veniard, université Paris Descartes, France
Cécile Vigouroux, Simon Fraser University — Vancouver, Canada
Valeria Villa-Perez, université Jean Monnet — Saint Etienne, France
Sylvie Voisin, Aix-Marseille université, France
Sandrine Wachs, université Sorbonne Nouvelle, France
Sylvie Wharton, université Aix-Marseille, France
Naomi Yamaguchi, université Sorbonne Nouvelle, France
Toutes les illustrations sont extraites de toiles de Barnett Newman.
- Rappelons que l’écriture inclusive désigne la représentation égale des femmes et des hommes dans la langue. Ses modalités possibles sont multiples : féminisation des titres, des métiers, double flexion (les étudiantes et les étudiants), accord de proximité, accord à la majorité et, enfin, utilisation de points médians ou de tirets (les étudiant·e·s.).[↩]
- La Coupole est une salle de l’Institut de France (siège de l’Académie française), où les académiciens se réunissent.[↩]