La rubrique MEMENTO publie des textes introuvables sur Internet
Christian Erwin Andersen est poète. Belge, aussi. Né en 1944 et aujourd’hui très souffrant. Cet ancien militant trotskyste (il fut l’un des fondateurs de la section belge de la IVe Internationale) passé à l’anarchisme (« Chez les trotskystes, écrivit-il, l’essentiel est, et sera toujours — c’est dialectique — d’avoir raison. ») aime passionnément le désert algérien et a signé, en 2011, le puissant recueil Défenestration des anges aux éditions Les Voleurs de feu. Le présent texte ne manque pas d’ambitions puisqu’il s’attelle, d’un même élan, à dire, avec ses mots, ce qu’est l’essence de la poésie et le noyau de la pensée libertaire. Est ou, plutôt, peut ou pourrait être.
À l’heure où semble s’amorcer un retour à certaines valeurs païennes, aux instincts et à l’irrationnel.
On peut raisonnablement penser que la première fonction de l’art poétique, dès qu’il est apparu sous forme orale, dans la plus haute Antiquité, fut de moduler la danse innée des corps qui n’est rien d’autre que le prolongement du battement cardiaque des systèmes solaires, des galaxies, des étoiles, des acteurs et corps célestes, de toute dimension, visibles ou invisibles, qui nous composent, nous traversent, nous défont et nous recréent ensuite, à l’infini.
Bien sûr, les preuves matérielles manquent à l’appui de cette affirmation. Mais pas les indices de sa pertinence. Ils sont nombreux et, de surcroît, le phénomène est universel et transculturel. Musique, danse et chant ne sont pas de simples manifestations culturelles, des produits de la création artistique. Ils ont façonné l’homme de façon déterminante et, à travers lui, toutes les civilisations. À des degrés divers, sans doute, mais en profondeur toujours et durablement. Il n’est pas, en effet, un seul événement important, triste ou gai, de la vie de l’homme dans lequel n’interviennent musique, danse et chant. Nous n’y reviendrons pas. C’est donc de la poésie que l’homme brut a reçu sa première leçon de « mise en corps ». Le verbe, et avec lui, l’esprit, sont nés cette danse initiatique nécessaire à la mise sur pieds des corps et à leur transformation. Il fallait accorder progressivement à l’univers, cette chair première et brute de l’homme, pour qu’elle cesse de n’être que quelconque barbaque et festin pour les fauves.
« Et ils se sont aimés. Follement encore. »
Ce prodige, seul l’art poétique pouvait le réaliser et, lorsque par un privilège de bienheureux, il nous arrive encore de ressentir intimement les mouvements aériens de notre propre pensée, nous ne faisons ainsi qu’entendre nos tam-tams internes, suivre nos métronomes biologiques et vivre les transes qu’ils suscitent dans le grand concert de la vie. L’art poétique a pris sa source dans ces turbulences, dans ces flux et reflux, ces violents brassages essentiels et ces décharges électriques colossales des premiers temps de la vie. Il est né des vibrations de l’univers, de ses puissantes contractions de parturiente, des spasmes de son ventre. Autrement dit, il est enfant de la matière en gésine constante.
C’est à cet accouchement sans forceps mais cependant cataclysmique qu’il prit part. À sa faveur, sans doute, qu’il naquit et prospéra dans un prodigieux orgasmovagissement de commencement du monde. C’est à cela que l’art poétique a œuvré sitôt que l’homme apparaissant dans sa nudité lumineuse sur la scène de l’Histoire lui eut dit : chante-moi la vie et je t’aimerai. Et ils se sont aimés. Follement encore. De leurs jeux d’enfants lubriques sont nés des dieux, jeunes, joyeux et beaux. Des millions de dieux, et autre encore, en devenir, demandant à l’homme un peu de son souffle pour les animer et qu’ils se dressent.
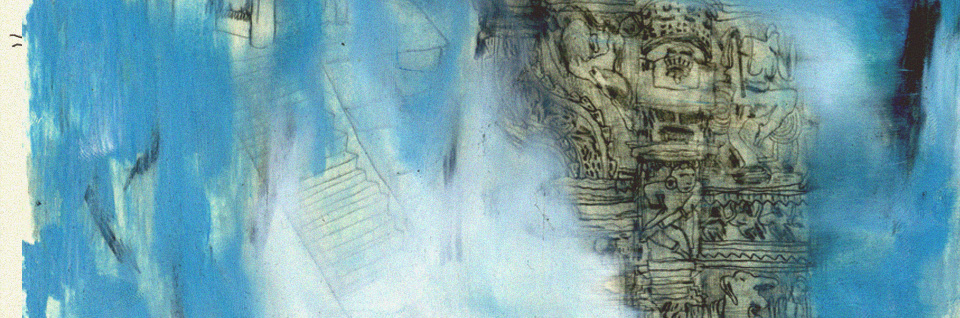
Nous les connaissons ces dieux débonnaires qui nous suffisaient bien ; les mêmes qui éblouissaient notre enfance et nous émerveillaient sans que jamais nous les nommions. Ceux-la même qui nous faisaient la vie douce et insouciante d’avant l’âge de raison. Nous les avons entendus souvent, qui disaient à l’homme, dans une sorte de chant d’exhortation : « Fais lever la beauté, dis-lui de marcher, qu’elle soit ton guide. Ni le soleil, ni les étoiles, ni la lune, ni la voie lactée ne le peuvent ; toi seul, Homme, connais la beauté et peux la séduire parce que tu n’ignores rien de la noirceur de ton être. Nous les dieux n’avons pas ton pouvoir parce que nés imparfaitement de toi nous ne connaissons pas notre dimension, celle même que tu nous as donnée, que tu gardes secrète et qui t’effraie parce qu’elle t’est nécessaire. Le temps des prêtres et de leurs affidés est révolu. D’autres dieux vont naître par milliers, des nouveaux géants précaires et vous vous réconcilierez au nom de cette fragilité commune. Vous vous y reconnaîtrez enfin. »
« La poésie est devenue d’une vacuité effrayante, faiseuse de beaux mots mais rarement de sens et de bon conseil. »
L’art poétique est né de cet amour. Il s’est mis à chanter les étoiles, leur lactescence, leur lumière, la terre, l’air, l’eau, le feu, qui sont part de notre chair elle-même part du ciel. En d’autres termes, il a été la voix des paroxysmes fondateurs en même temps que de la raison avant qu’elle ne devint exécrable. Le poète, quant à lui, est né de la nécessité de l’art poétique. Armé de sa seule sensibilité de vierge il a été, est devenu et s’est affirmé le grand médium des origines. Il l’a fait en favorisant les échanges entre sphères du connu et de l’inconnu ; en organisant et « mettant en musique » le ballet des dieux et divinités qui les habitaient à cette époque où profane et sacré ne faisait qu’un, où l’on trinquait avec Odin et prenait appui sur l’épaule de Bacchus. Il convia le peuple effrayé qui tremblait dans sa nuit existentielle à ces festivités dans les halles du Walhalla ou autour des autels de pierre du Macchu Pichu et conseilla les maîtres avisés qui recouraient à son éclairage. Il éloignait ainsi peu à peu les ténèbres sans exposer à ces coups de soleil brutaux que la science contemporaine, atomiquement parfois, nous assène aujourd’hui.
L’art poétique ne pourra esquiver, sans se trahir, une bonne part de cette fonction essentielle réactivée, revisitée, actualisée par l’effondrement du christianisme et le retour aux valeurs ancestrales du paganisme. La tâche est immense. Obérée par quasi deux millénaires de servage monothéiste, la poésie est devenue d’une vacuité effrayante, faiseuse de beaux mots mais rarement de sens et de bon conseil. Remuez dans vos tombes, ô grandes voix réfractaires désormais muettes : Nerval, Poe, Coleridge, Robin, Duprey, Artaud, Giauque, et tant d’autres. Le poète aujourd’hui n’est, trop souvent (et pas toujours de plein gré) que le comptable de la surenchère verbeuse d’une usine à mots fonctionnant à flux continu : on y fabrique de tout, des nouveaux vocables incongrus, des concepts relookés, des légions d’honneur et des rosettes pour revers… de veston… il n’y manque que la poésie… embarquée sur les routes du flux médiatique, gonflée par l’idéologie anthologiste, captive des contraintes économiques.

La poésie, les poètes, l’art poétique, se trouvent pourtant confrontés aujourd’hui à un défi de taille : réinjecter la vie dans la coquille du verbe laissée vide par deux mille ans de monothéisme. C’est à cela que devrait œuvrer le poète ; c’est là que la poésie est nécessaire et attendue. Mais : « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir vers Sainte Anne ? »… C’est malheureusement parce qu’elle s’en éloigne que j’interviens ici, en parfait iconoclaste et sans scrupules, sinon celui de n’engager que moi. C’est pour cette raison que je tiens à préciser comment je vois les choses et comment je fonctionne… comment doit, à mon avis, s’exprimer le poète libertaire et païen pour ne pas se nier, pour ne pas connaître l’infamie du militantisme… Car, pour demeurer crédible la démarche libertaire ne peut s’inscrire entre des marges inviolables. Elle doit prendre des risques, exiger un libre parcours sur la pleine page ainsi que la latitude permanente de se déployer tous azimuts, voire même dangereusement jusqu’aux extrêmes.
« Que les choses soient nommées, soit ! Encore faut-il ne pas les figer. Il ne peut y avoir de catéchisme libertaire, de mantras anarchistes »
Son encre doit être et rester délébile. Que les choses soient nommées, soit ! Encore faut-il ne pas les figer : l’infinitude (infinité³ ou « infinitude au cube ») sera donc le guide, le garde-fou auquel nous accorderons, magnanimes, de longs repos dilatoires et le droit au plein exercice de la paresse. Voyons de quoi il s’agit. Sachant que c’est dans les silences que niche la liberté, le libertaire aura soin de n’écrire sa saga qu’en y multipliant les interlignes. Il aérera son propos comme on le ferait d’un brassin à l’aube des bacchanales afin que capiteux il procure la plus grande félicité. Le flou du discours libertaire est sa seule auréole. Il sera son unique nimbe. L’approximation est sa coquetterie et sa vertu. Pour l’affirmer, nous partons du principe que les bons comptes ne font pas les bons amis ; que seuls les comptes approximatifs ont cette vertu parce que, précisément, ils ne sont déjà plus des comptes et que l’amitié vraie, celle justement qui se prodigue sans compter, s’en trouve confortée.
Le souci d’une authentique démarche libertaire postule le refus permanent et ferme de cerner les choses et de consacrer tel mode de pensée plutôt que tel autre, de célébrer l’illusoire triomphe du sophisme. L’essentiel n’est pas empaquetable et même l’urgence de prendre position ou de riposter à l’agression, en situation de crise ne le fera pas oublier : on ne le trouve pas dans les night-shops. La vitesse est ennemie de la liberté, elle tue et rien jamais ne justifiera, dans un univers infini, où même la vitesse de la lumière est une naine, qu’on l’érige en « moteur de progrès ». Ce que nous ne pourrons achever (et qui d’ailleurs, en y regardant bien, est proprement inachevable) d’autres l’achèveront… ou ne l’achèveront pas : qu’importe. Le rejet définitif de tout précepte sera la norme. Il ne peut y avoir de catéchisme libertaire, de mantras anarchistes. L’enfermement dogmatique est plus lourd de conséquences que la geôle : l’alcoolémie qu’il provoque exclut la remise de peine pour « bonne conduite ».

Lorsqu’elle se détache du corps, s’en évade ou fonctionne en « sur-régime », la pensée hypertrophiée est estropiante. Elle conduit à l’antichambre de la mort et le libertaire la tient pour suspecte. Il y voit l’indice de notre lente déchéance, de l’état famélique de nos sens usés. Il retient que Antonin Artaud, à juste titre, parlait des « puantes bestialisations de l’esprit » et se demande, intrigué, pourquoi « il n’y a rien de plus logique qu’un délire ». Il ne s’inquiète cependant pas de l’absence de réponse et s’offrira même, à l’occasion, le luxe d’ignorer la question : l’exercice bien compris de la liberté inclut un soupçon de paresse voire de frivolité. Il s’offre aussi cette latitude. Car le libertaire fuit comme la peste les nécropoles principielles et le sacre de toute pensée. Il sait que le champ du sacré, par son détachement du profane, est précisément le lieu négateur de toute liberté.
« La quête libertaire implique une attitude sceptique et infiniment nuancée. »
Tout au plus se hasarde-t-il à avancer des hypothèses, comme je le fais ici, avec d’autres flèches dans mon carquois, comme celles de Cupidon, par exemple. Car la pensée libertaire si elle n’était pas copulatoire, si elle ne pénétrait la matrice de l’être, si elle n’était sexuellement transmissible, s’il elle ne se lisait pas à jambes ouvertes et ne se proférait pas sur le mode éjaculatoire serait mort-née… chez le libertaire le sexe parle même encapuchonné : on ne le fait pas taire. La quête libertaire implique une attitude sceptique et infiniment nuancée. L’enfermement conceptuel, dogmatique, langagier ou autre serait sa négation. L’écriture, le langage, qui inscrivent et circonscrivent, peuvent, si l’on n’y prend garde, devenir de parfaits garde-chiourmes, les vecteurs de nouvelles églises, ligues ou fronts unanimes dans l’intolérance.
Le langage que nous allons restaurer et réinventer sera le garant du pouvoir fécondant du verbe. Soyons-en dignes. Il le mérite. Il nous a tout donné.
Toutes les illustrations sont © Zéphir.



