Entretien inédit pour le site de Ballast
Après avoir analysé deux cas de néopopulismes latino-américains (les gouvernements de Chávez au Venezuela et de Morales en Bolivie), le sociologue Federico Tarragoni s’est penché sur les « révolutions en cours », avec l’essai L’Énigme révolutionnaire, puis, en 2019, sur la notion de populisme, avec L’Esprit démocratique du populisme. À rebours du consensus médiatique, il y proposait la thèse suivante : le populisme n’a rien à voir avec la démagogie, le nationalisme et le totalitarisme ; il est l’idéologie démocratique, contradictoire, de la crise des régimes représentatifs et libéraux. Les chercheurs Arthur Borriello et Anton Jäger l’ont rencontré pour conclure ce dossier à trois voix, discordantes, consacré à la décennie populiste.

Nationalisme, autoritarisme, démagogie, populisme : quelles sont les apories et les risques que comportent l’association de ces termes et les confusions qu’elle engendre ?
Ces confusions sont devenues particulièrement frappantes dans ce que j’appelle la populologie, c’est-à-dire le courant dominant des études sur le populisme qui s’est construit dans les années 1980, en concomitance avec la montée de partis et mouvements d’extrême droite dans les sociétés occidentales. Ce courant a nourri un amalgame croissant entre le populisme — pour lequel il y avait une tradition de recherche plus ancienne, qui remontait aux années 1950 — et l’extrême droite. À partir de là, d’autres amalgames se sont créés, avec le nationalisme, la démagogie, l’autoritarisme, le fascisme. Et j’en passe. Le populisme est devenu un mot-valise — on en voit les conséquences dans les médias et la communication politique — qui sert à désigner d’autres choses par peur d’utiliser des mots encore plus forts. Mais au fond, son utilisation porte toujours le même message : en politique, il est dangereux d’appeler au peuple.
« Au fond, l’utilisation du terme
populismeporte toujours le même message : en politique, il est dangereux d’appeler au peuple. »
Dans ces amalgames que je pointe, il y a des apories, qui dérivent tout simplement d’un problème de classification : lorsqu’il est confondu avec d’autres concepts, le populisme devient une notion fourre-tout, qui défie les systèmes de classification des sciences sociales et politiques depuis 40 ans. Les analystes trouvent donc un tas d’excuses pour justifier cette impossible classification. La première à le faire a été Margaret Canovan : en 1981, elle écrivait ne pas vouloir trouver une définition de ce terme, mais plutôt construire une typologie par ensemble de cas différents. Chose inconcevable avec un concept de sciences sociales : ne pas le définir, mais l’appliquer quand même à tout un tas de phénomènes du passé et du présent, d’ici et d’ailleurs. Une autre solution que les théoriciens contemporains du populisme ont trouvée pour justifier ces difficultés classificatoires, c’est de réduire le populisme à un pur fait discursif. Derrière le nationalisme, l’autoritarisme et la démagogie, il y aurait un appel au peuple qui justifie le label populiste : confusion entre ethnos et demos dans le nationalisme, incarnation du peuple par un homme fort dans l’autoritarisme, communication politique qui flatte les bas instincts, qui est fondée sur la promesse et l’illusion dans le cas de la démagogie.
À partir du moment où le populisme est de nature fondamentalement discursive, il peut devenir tout et n’importe quoi. C’est donc l’aporie fondamentale : le laxisme conceptuel auquel le populisme pousse. Cette aporie comporte un risque, présent chez tous les usagers du populisme, des usagers savants aux usagers médiatiques et profanes, c’est celui d’étiqueter comme « populiste » tout et n’importe quoi dès lors que le mot peuple apparaît. Le populisme étant une insulte, le risque est alors aussi de faire du peuple une insulte, et d’abandonner ce mot central de la démocratie qui a servi par le passé à tous les mouvements d’émancipation.

[Tatsuya Tanaka]
Que cela soit dans le populisme contemporain ou chez les technocrates, l’axe gauche/droite est récusé. Mais n’y a‑t-il pas quelque chose de correct dans le diagnostic « ni de gauche, ni de droite » dès lors que l’on acte du déclin des grands « partis de masse » qui structuraient cette opposition idéologique ?
On peut entendre le clivage gauche/droite de trois façons différentes. Comme un clivage axiologique, d’abord, entre deux interprétations de la modernité politique et de la démocratie (entre ce que Balibar appelle l’« égaliberté » et la conception de la démocratie comme ordre). De ce point de vue, je maintiens, sur la base de mon enquête historique, que le populisme est fondamentalement de gauche. Comme clivage axiologique, le clivage gauche/droite est indépassable puisqu’il est consubstantiel à la modernité démocratique dans laquelle nous sommes : les différentes propositions politiques qui apparaissent dans nos sociétés contemporaines renvoient soit à la volonté d’élargir une démocratie considérée comme incomplète (auquel cas elles sont de gauche), soit à la volonté de la restreindre pour la stabiliser comme ordre (auquel cas elles sont de droite). Mais les démocraties ont changé, en tant que régimes politiques, au sein de cette même modernité. D’où la deuxième acception, idéologique, du clivage gauche/droite : la manière d’entendre idéologiquement l’espace de la gauche et de la droite change au cours du temps. Là aussi on peut trouver des affinités entre les populismes dits « de gauche » aujourd’hui et les manifestations historiques du populisme : des affinités bien plus fortes que celles que la droite actuelle entretient avec ces mêmes populismes historiques. Donc, si tant est qu’il faille interroger un concept à partir de ce qu’il a été historiquement — ce qui est discutable mais que je revendique comme démarche —, les « populismes de droite » sont effectivement un abus conceptuel. On ne peut pas parler de « populisme » pour des mouvements contemporains qui sont en réalité dans la continuité du nativisme1 tel qu’il s’est structuré entre la fin du XIXe siècle et le XXe siècle.
« Le clivage gauche/droite est indépassable puisqu’il est consubstantiel à la modernité démocratique dans laquelle nous sommes. »
Il y a enfin une troisième acception du clivage gauche/droite, comme clivage structurant de nos sociétés politiques, avec leurs institutions, leurs acteurs collectifs, leurs partis, leurs syndicats, etc. La politique telle qu’elle s’est structurée après 1945 autour des partis de masse, avec l’opposition entre le centre gauche et le centre droit, et le Parti communiste comme troisième pôle, a effectivement sombré avec l’émergence progressive des nouveaux partis d’extrême droite dans les années 1990 et des partis populistes de gauche à la suite de la crise des subprimes de 2008. De ce point de vue, quand ces partis populistes de gauche se disent « ni de droite, ni de gauche », c’est pour deux raisons. C’est en partie une affaire de marketing politique, car tous les partis ont intérêt à se distancier de ces étiquettes qui ont lassé l’électorat : Macron a fait la même chose, Berlusconi aussi. Mais c’est aussi une vraie réflexion que ces partis populistes portent sur le fait que les grands partis qui structuraient la démocratie d’après-guerre n’ont plus du tout la même hégémonie que dans les Trente Glorieuses, et qu’il faut donc « remplir » le vide creusé par leur déclin. D’ailleurs, la forme de parti qu’ils proposent est en décalage avec celle de l’après-guerre : au modèle du parti de masse, ils opposent le parti-mouvement, très en lien avec des mouvements sociaux, souvent contesté par sa propre base militante, etc. Cette forme du parti-mouvement ne leur est pas propre : elle est également adoptée par certaines formations d’extrême droite en Europe. Le Mouvement cinq étoiles est sans doute la manifestation la plus typique de ce modèle — il a en plus repris à son compte les technologies numériques pour repenser le lien entre institution politique et monde militant. Pour conclure, le dépassement du clivage gauche/droite s’observe pour le populisme non pas dans sa dimension axiologique ou idéologique, mais plutôt au niveau du système d’organisation et de représentation des groupes sociaux dans la politique institutionnelle.
Justement, en amalgamant la « montée du populisme » et ces grandes transformations organisationnelles-institutionnelles, on finit par voir n’importe quel nouveau parti — y compris des formations d’extrême droite ou des plateformes électorales du type LREM, au discours pourtant fortement antipopulaire — comme « populiste », au prétexte qu’il se différencie du modèle du parti de masse traditionnel. Est-ce qu’une partie de la confusion conceptuelle ne vient pas de cet amalgame ?
Absolument. C’est un biais bien connu de la sociologie : l’effet de structure. L’amalgame vient du fait qu’on n’a pas suffisamment pris en compte le fait que cette transformation des partis politiques relève d’une évolution structurelle des formes de mobilisation — elle n’est pas limitée aux héritiers actuels de l’idéologie populiste du XIXe et du XXe siècle, mais touche tous les acteurs politiques contemporains. On traite donc tous les « nouveaux » partis, qui s’opposent aux partis « traditionnels », comme « populistes ». Ce biais trouve son origine dans l’effet de « choc » qu’a produit l’émergence des partis « outsiders » d’extrême droite dans les années 1980 : le Front national, le Vlaams Belang, le FPÖ, la Ligue du Nord, etc. C’est évidemment très problématique. Cela prolonge les apories qu’on a évoquées : pour justifier sa difficulté à définir le populisme, la science politique a eu recours à des simplifications lui permettant de ne pas identifier une idéologie populiste à proprement parler, mais uniquement d’observer comment ces partis fonctionnent…

[Tatsuya Tanaka]
Vous déconstruisez le langage de la « populologie » en montrant que sa réduction du populisme à une « maladie » de la démocratie nourrit sa dépréciation normative, ainsi qu’une tentation thérapeutique chez les observateurs. Quelle serait donc la métaphore adaptée, si tant est qu’il y en ait une, pour décrire le rapport entre l’émergence du populisme et les phénomènes de dé-démocratisation auxquels il s’oppose ?
En tant que sociologue, je me méfie beaucoup des métaphores. Certes, elles ont une portée heuristique immédiate et permettent de saisir des phénomènes complexes à travers des images simples et chargées de passions. Mais il faut s’en méfier précisément parce qu’elles réduisent la complexité du phénomène considéré et qu’elles ont, en quelque sorte, une vie propre : une fois qu’elles passent les frontières du champ scientifique pour rentrer dans le monde social, elles fonctionnent justement comme des métaphores, c’est-à-dire que chacun y voit ce qu’il veut. C’est exactement ce qu’il se passe avec la « maladie » populiste. Canovan s’inquiétait déjà de l’usage de cette métaphore par les spécialistes du populisme dans son article « Trust the People ».
« Est-ce un hasard si sont jugés
populistesuniquement les référendums quitournent mal, c’est-à-dire ceux qui aboutissent à la décision contraire à celle faisant consensus dans la classe politique ? »
Maintenant, tout en gardant ces réserves à l’esprit, quelle serait la métaphore adaptée à ce phénomène social qu’est la genèse du populisme ? Il faut avant tout éviter les pires métaphores, médicales et religieuses, qui véhiculent une vision manichéenne de la politique et suggèrent l’idée que le monde social fonctionnerait comme un ordre, comme un corps avec ses organes, de manière « normale » ou « pathologique ». Il faudrait trouver une métaphore qui décrive le processus d’émergence du populisme comme radicalisation de la démocratie, puisque le populisme se manifeste toujours sous la forme de crises qui cherchent à refonder la démocratie sur de nouvelles bases, à partir de ses « racines » profondes : l’égalité, la justice, la souveraineté populaire. Les métaphores végétales seraient peut-être plus adaptées, mais un peu lointaines du monde social. Par conséquent, je pense que la solution la plus adaptée — mais je suis sociologue, pas poète (rires) —, ce serait d’avoir des métaphores sonores. Par exemple la métaphore de la dissonance ou de l’arythmie. Dans une société où la démocratie constitue la « musique de fond », le populisme correspond à la poussée d’un cri sonore — fort, rapide et éphémère comme le sont toutes les crises populistes — de la part d’une partie de la société. Cette métaphore permettrait de montrer à quel point coexistent, dans les crises populistes, la logique de la démocratie instituée et sa « musique de fond », d’une part, et d’autre part la tentative de créer une autre musique, de mettre différemment en musique la démocratie.
Vous dénoncez la méfiance à l’égard des classes populaires que sous-tendent, par exemple, les critiques des mécanismes de démocratie directe réclamés par certains mouvements populistes. Pierre Rosanvallon a publié un ouvrage dans lequel il critique le mécanisme référendaire au nom de la multiplication des processus démocratiques et de la nécessité de freiner la prise de pouvoir de l’exécutif sur le législatif. Que pensez-vous de son analyse ?
Si le référendum est limité à ce qui existe aujourd’hui en France — des référendums demandés et préparés par les élus, enchaînés sans débat préalable, sans formation des citoyens aux alternatives en jeu, etc. —, il peut nuire à l’équilibre des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif. Certes. Mais, bien que les théoriciens de la démocratie soient généralement hostiles au référendum — Laurence Morel l’a montré dans La Question du référendum —, une analyse technique plus poussée de la question révèle qu’il y a des avantages et des inconvénients, comme pour tout mode de décision politique. Surtout, cette critique du référendum comme « outil populiste » par excellence ne prend jamais en compte deux éléments. Le premier, c’est que le référendum est toujours pensé à partir de son modèle ultra-majoritaire : le référendum demandé par les élus. Mais je ne vois pas bien quels arguments on pourrait opposer à un référendum d’initiative citoyenne populaire. Cela rentre pleinement dans l’optique d’une démocratie mixte, dans laquelle plusieurs formes de légitimité démocratique s’articulent : la légitimité élective, la légitimité directe, la légitimité participative, etc. Le deuxième élément problématique, c’est que les critiques du référendum ne visent généralement pas le dispositif lui-même — de ce point de vue, Rosanvallon fait positivement exception — mais plutôt l’incompétence des citoyens à juger de sujets techniquement complexes. C’est comme ça que le vote du Brexit a été appréhendé en 2016 : on a culpabilisé les électeurs d’avoir pris la « mauvaise » décision. Est-ce un hasard si sont jugés « populistes » uniquement les référendums qui « tournent mal », c’est-à-dire ceux qui aboutissent à la décision contraire à celle faisant consensus dans la classe politique, tant de centre gauche que de centre droit ?
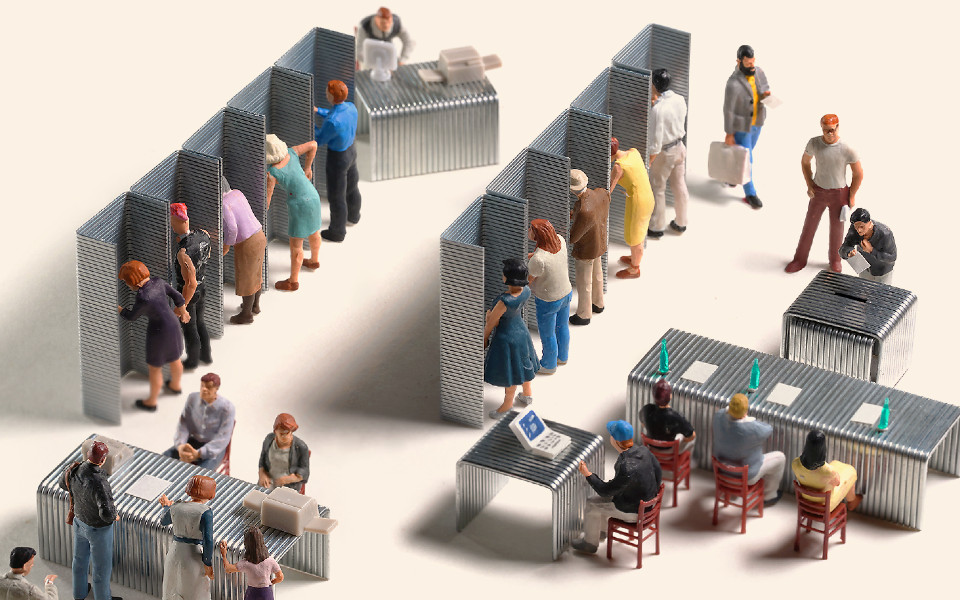
[Tatsuya Tanaka]
Plus largement, que pensez-vous de la critique du populisme au nom de l’érosion des libertés démocratiques qu’il produirait — du moins potentiellement ?
Qu’il faut l’étayer historiquement. Il faut comprendre cette érosion potentielle des libertés démocratiques dans le populisme en reliant systématiquement le niveau institutionnel de la politique et son niveau « souterrain » : le terrain de la conflictualité sociale. De ce point de vue, le livre de Rosanvallon pose doublement problème : trop léger sur le plan de l’investigation historique, il est uniquement centré sur la dimension institutionnelle de la politique. Son angle de vue est hémiplégique : il n’observe que les conséquences juridiques et institutionnelles du populisme. D’ailleurs, historiquement, il fait du bonapartisme le cas par excellence du populisme, ce qui ne va pas du tout de soi. Contrairement au narodnichestvo russe et au People’s Party étasunien, qui se sont autodésignés comme populistes et dont les militants ont écrit les pages de cette nouvelle idéologie politique, le Second Empire a donné lieu en son temps à une qualification conceptuelle bien différente : celle de « césarisme ». Le terme fut introduit, comme un néologisme, par Littré dans son Dictionnaire de la langue française en 1863, pour désigner « la domination […] des princes portés au gouvernement par la démocratie mais revêtus du pouvoir absolu ». Littré songeait précisément à Napoléon III. Il est pour le moins curieux qu’un historien comme Rosanvallon définisse le populisme à partir d’une expérience historique qui n’a, en termes de sources, aucun rapport objectif avec les manifestations fondatrices du phénomène, sur lesquelles toute la littérature spécialisée s’accorde (le narodnitchestvo, le People’s Party et les régimes nationaux-populaires en Amérique latine). Or, à partir du bonapartisme, il est aisé de démontrer que « des princes portés au gouvernement par la démocratie mais revêtus du pouvoir absolu » finissent par éroder les libertés démocratiques.
« Le populisme, lorsqu’il s’institutionnalise, met toujours en jeu une alchimie complexe entre l’érosion de certaines libertés et l’élargissement de certains droits. »
Cela dit, le constat de cette érosion est en partie correct : quand on observe les populismes institutionnalisés, notamment en Amérique latine, on remarque qu’ils ont effectivement tendance à réduire certaines libertés démocratiques. D’où un certain nombre de questions : quelles libertés réduisent-ils ? pourquoi ? quels en sont les effets ? La plupart du temps, les libertés fragilisées sont les libertés « libérales », c’est-à-dire les libertés que Isaiah Berlin appelait « négatives » : la liberté de la société d’être protégée vis-à-vis de l’État. L’État populiste va par exemple fermer des radios, limiter la liberté de presse, restreindre la liberté syndicale. Mais, à côté de ça, on élargit d’autres libertés : les libertés que Berlin appelait « positives », celles liées à de nouvelles capacités collectives. Les États populistes créent de nouveaux droits formels, comme les droits sociaux des travailleurs ou le droit de vote pour les femmes (en Argentine et en Équateur, par exemple). Ils promeuvent des droits substantiels, liés à la démocratisation du travail, de l’école, de la culture, de l’Université : de nouvelles chances pour les groupes défavorisés d’accéder à des ressources valorisées. Ils élargissent enfin des droits qui sont de l’ordre du symbolique ; ils font entrer de plain-pied les classes populaires dans la représentation légitime du monde social. Il faut prendre en compte cette complexité. Le populisme, lorsqu’il s’institutionnalise, met toujours en jeu une alchimie complexe entre l’érosion de certaines libertés et l’élargissement de certains droits. Est-ce que, une fois faites les sommes et les soustractions, le populisme réduit globalement les libertés ? Si on a une théorie libérale de la démocratie en tête, on considérera que la somme mathématique des deux processus conduit à une réduction globale des libertés. Cependant, cette réduction ne sera peut-être pas perçue comme telle par de nombreux individus qui, comme le signalait Gino Germani pour les péronistes en Argentine, auront plutôt l’impression d’avoir gagné de nouveaux droits.
Vous évoquez aussi la conception du populisme comme « moment » et phénomène transitoire. Pourriez-vous développer cette conception et la différencier, si nécessaire, des autres approches qui utilisent la même expression — pensons à Laclau et Mouffe, et à leur utilisation des concepts gramsciens de crise organique ou de dislocation ?
J’ai abouti à ce concept de « moment populiste » en observant les travaux classiques des années 1960, 70, 80 (Gellner et Ionescu, Canovan, Di Tella, Germani, etc.) et en remarquant qu’ils étaient hantés par la question de la qualification de tel ou tel mouvement politique comme populiste. Et, au fond, je pense que les études contemporaines ne sont pas sorties de cette question, qu’on ne cesse de ressasser, dans des listes qui ne cessent de s’agrandir, parce qu’on met dans cette catégorie de plus en plus de mouvements qui n’ont rien à voir les uns avec les autres. J’ai donc cherché à poser la question différemment, en émettant l’hypothèse que le populisme ne fut pas un mouvement mais un moment de la démocratie : une série de moments critiques dans l’histoire des démocraties représentatives libérales. L’une des constantes dans les populismes historiques que je compare, c’est qu’ils apparaissent toujours dans une configuration de crise et qu’ils suivent ensuite un rythme ternaire, qui, lui, est comparable d’un mouvement à l’autre : une séquence de crise, une séquence de mobilisation et, le cas échéant, une séquence d’institutionnalisation spécifique.

[Tatsuya Tanaka]
Ensuite je trouve que ce concept de « moment » est particulièrement intéressant par la vision stochastique2 du populisme qu’il autorise, à rebours des explications déterministes. Dans une configuration de crise de l’ordre politique, et lorsque la crise se développe d’une certaine manière, il y a la possibilité qu’un populisme naisse. Cela advient dans un cas bien spécifique : lorsqu’une crise socio-économique intervient dans un contexte de forte hausse des inégalités et est interprétée par la grande majorité des classes inférieures comme un problème démocratique. Il n’y a rien d’automatique là-dedans : la responsabilité d’une crise peut être attribuée, par exemple, à des boucs émissaires raciaux ou religieux ; dans le populisme, elle est attribuée aux élites, jugées coupables d’avoir confisqué la démocratie. La contestation sociale réunit alors différents groupes sociaux, aux intérêts potentiellement divergents : c’est toute la différence avec les mobilisations socialistes ou communistes, qui se font sur la base de l’appartenance de classe. Cette mobilisation peut se doter, au moment de son institutionnalisation politique, d’un leader charismatique, qui permet de canaliser les revendications plurielles dans l’espace partisan. C’est ensuite l’évolution du moment populiste qui fera pencher la balance des « gains » et des « pertes » démocratiques, en fonction de la place accordée au leader et de l’autonomie relative de la mobilisation. Comme tout phénomène de crise, le populisme évolue en fonction de la configuration qu’il crée dans l’espace politique.
« Qu’y a‑t-il de commun entre la politique contre-hégémonique de Podemos, qui incite le peuple à revendiquer des droits sociaux contre le néolibéralisme austéritaire, et celle de Trump, qui pousse le peuple à détruire les institutions démocratiques par la violence ? »
Cela suppose aussi qu’une mobilisation peut changer suivant les circonstances : un mouvement social peut emprunter à l’opposition « peuple-élite » lors d’un moment populiste, pas de toute éternité. Enfin, par rapport à Laclau et Mouffe, je commencerais par dire qu’il y a beaucoup d’affinités entre nos analyses. Nous partageons l’idée que dans les crises populistes, les repères sociaux, politiques et institutionnels défaillent — en un mot, l’hégémonie défaille : on assiste à sa dislocation, c’est-à-dire que tout ce qui était consensuel auparavant fait désormais dissensus. En revanche, je suis en désaccord avec l’interprétation purement discursive de l’hégémonie — et donc du populisme — que proposent Laclau et Mouffe : elle me semble très loin de la conceptualisation gramscienne. Alors que Gramsci ne perd jamais de vue la conflictualité sociale, dans toute sa matérialité historique, Laclau et Mouffe la réduisent à leur dimension discursive : d’un côté on a le discours du pouvoir, qui est le gardien de l’hégémonie en place, de l’autre le discours porté par les mobilisations contre-hégémoniques. Par conséquent, la bataille hégémonique, ce que Gramsci appelait la « guerre de position », se réduit à une simple lutte discursive entre un discours du pouvoir et un contre-discours. C’est très réducteur pour l’analyse du moment populiste.
Cela pousse à considérer que chaque fois qu’un contre-discours s’empare de la souveraineté du peuple pour l’opposer au pouvoir en place, on a affaire à du populisme. Cela, quelle que soit la définition donnée de la souveraineté du peuple et l’alternative politique défendue vis-à-vis de l’ordre en place. Laclau et Mouffe parviennent ainsi à la conclusion aporétique que le populisme serait l’essence même (agonistique) de la politique démocratique, lors même qu’il qualifie aussi, dans leur analyse, des mouvements d’extrême droite xénophobe (les « populismes de droite ») qui prônent une définition excluante et/ou autoritaire de la démocratie. Qu’y a‑t-il de commun, en termes de projet démocratique, entre la politique contre-hégémonique de Podemos, qui incite le peuple à revendiquer des droits sociaux contre le néolibéralisme austéritaire, et celle de Trump, qui pousse le peuple à détruire les institutions démocratiques par la violence ?

[Tatsuya Tanaka]
Dans La Raison populiste, Laclau prend le boulangisme comme un cas archétypal de populisme. Vous proposez au contraire de le considérer comme un cas emblématique de fascisme — à ne pas confondre, donc, avec le populisme.
Pourquoi le boulangisme est-il considéré comme un cas archétypal par la théorie discursive du populisme ? Car il met en scène un leader charismatique, le général Boulanger, qui articule, autour du peuple, les positions du « soldat », de l’« ouvrier » et du « paysan », tout en devenant lui-même le signifiant vide de cette articulation. Cette interprétation pourrait s’appliquer à peu près à tous les moments de crise politique dans lesquels émerge un discours alternatif à celui du pouvoir ! Qu’il s’agisse d’un discours d’extrême droite, d’extrême gauche, centriste, social-démocrate, ou autre. Cela ne se limite pas à Boulanger, d’ailleurs ; pour Laclau, Hitler, Mussolini, Atatürk, Berlinguer et Togliatti furent populistes. À cet égard, le cas de Boulanger est particulièrement intéressant pour différencier le populisme et le fascisme, car contrairement à ce qu’on lit souvent, le boulangisme ne fut pas du tout une crise populiste. Comme le montre l’historien Zeev Sternhell, l’épisode boulangiste incarne plutôt les prodromes d’un fascisme qui, heureusement, n’a pas vu le jour sous sa forme institutionnelle en France, mais qui y était latent depuis la fin du XIXe siècle. À tel point qu’on peut considérer que la France a inventé l’idéologie fasciste, avec Boulanger d’abord et l’Action française ensuite, bien avant que cette idéologie ne s’institutionnalise en Italie. Cette thèse permet de critiquer la supposée « exception fasciste » française.
« Les écrits des populistes russes, les pratiques militantes du People’s Party et les réalisations institutionnelles des populismes latino-américains montrent clairement la teneur démocratique du populisme. »
J’ajouterais qu’on remarque deux énormes différences par rapport aux cas historiques du populisme. La première, c’est l’absence d’une idéologie démocratique consolidée. Il y a chez Boulanger un appel à la refondation républicaine, mais qui est aussi indissociablement un appel à la refondation nationale. Ne s’étant jamais concrétisé dans l’assemblée constituante qu’il appelait de ses vœux, nous ne saurons jamais si cet appel était un simple clin d’œil démagogique ou un authentique projet démocratique — ce dont on peut légitimement douter, en raison du soutien massif que Boulanger reçut de la part des monarchistes, qui voyaient en lui un champion de la restauration monarchique. Bien au contraire, les écrits des populistes russes, les pratiques militantes du People’s Party et les réalisations institutionnelles des populismes latino-américains montrent clairement la teneur démocratique du populisme. La deuxième grande différence avec ces expériences, c’est que celles-ci mettaient systématiquement l’accent sur la participation populaire et se dotaient d’institutions permettant de la réaliser. C’est le cas du Mir en Russie, de la plateforme coopérative rurale aux États-Unis, des comités d’habitants et des sections syndicales locales en Amérique latine. Les seuls éléments potentiellement comparables dans le boulangisme, ce sont les comités républicains nationaux locaux (les sections locales du comité républicain national, le parti de Boulanger), mais ceux-ci n’encourageaient pas du tout la participation populaire et s’apparentaient simplement à des sections locales du parti. Donc il n’y a jamais eu de participation populaire à proprement parler dans l’expérience boulangiste. Si ces éléments ne suffisaient pas, on peut aussi faire remarquer que, dès 1892, les rangs boulangistes ont été massivement acquis à la cause antisémite, malgré quelques résistances marginales. Les cadres du parti partageaient donc une vision du peuple au mieux nationale, au pire nativiste et raciste.
Vous soulignez le caractère paradoxal de tout moment populiste, condamné à mourir en se réalisant. On pourrait lire ça comme un paradoxe démocratique. Si, en suivant Claude Lefort, la démocratie se caractérise par son ouverture à des processus d’émancipation qui ne peuvent jamais être complètement réalisés, le populisme n’est-il pas de ce point de vue plus démocratique que le messianisme marxiste ou le libéralisme procédural ?
Absolument. La difficulté, c’est qu’il n’existe pas de manifeste populiste dans l’Histoire, au contraire des autres idéologies politiques. Mais s’il y en avait eu un, je crois qu’il aurait effectivement tout misé sur les paradoxes constitutifs de la démocratie. Le populisme s’installe au cœur de la tension entre deux acceptions de la démocratie : l’acception utopique ou rédemptrice, qui fait primer le conflit (y compris contre la démocratie elle-même), et l’acception procédurale ou pragmatique, qui fait prévaloir la stabilité de l’ordre démocratique. En jouant sur cette tension, le populisme émet une critique vis-à-vis du libéralisme, qui est une pensée de la deuxième acception contre la première, tout en proposant une voie alternative à celle du messianisme marxiste. Certes, par rapport au marxisme, le populisme peut être critiqué au motif qu’il laisse de côté la question du capitalisme et de l’exploitation tant humaine que naturelle qui lui est consubstantielle ; cela dit, il montre qu’une réconciliation définitive de la société est impossible par définition et invite à cultiver de façon permanente le conflit en démocratie. Cela génère beaucoup de difficultés lorsque le populisme cherche à s’institutionnaliser et à durer, d’une part parce que le déplacement de cette conflictualité à l’échelle de l’État ajoute des tensions supplémentaires, et, d’autre part, parce que la polarisation peuple versus élites tend à « fatiguer », si je puis dire, les sociétés.

[Tatsuya Tanaka]
S’il y a un texte qui résume ce rapport du populisme à la démocratie, c’est peut-être une brochure de Perón qui, publiée en 1952, servait à former les jeunes cadres du parti justicialiste en Argentine3. Le général y affirmait deux choses. La première, c’est le primat de la participation et de l’autonomie populaires : le peuple doit s’organiser et communiquer ses revendications à l’État, notamment via les syndicats et les « unidades básicas » (sections militantes locales). Ensuite, la « raison d’État » poussera Perón à contrôler et enrégimenter de plus en plus ces institutions de l’autonomie populaire… La deuxième chose, c’est que le justicialisme est une révolution démocratique permanente. Perón reprend en quelque sorte la rhétorique de la révolution permanente de Trotsky — malgré sa forte opposition au marxisme — et l’adapte à la question démocratique. Cela revient à dire qu’on n’aura jamais fini de démocratiser une société, parce que le peuple aura toujours des revendications de droits, d’égalité, de justice, de dignité.
La France insoumise semble redevenir un parti de gauche classique, Podemos apparaît comme une simple forme renouvelée de la gauche communiste espagnole, le M5S — après son aventure avec la Ligue du Nord —, s’est allié au Parti démocrate. Comment interprétez-vous ces changements ?
« Le moment populiste n’est pas près de se clore, mais les stratégies de ces partis-mouvements ont évolué. »
Ces trois partis-mouvements du populisme de gauche en Europe ont effectivement évolué depuis la publication de mon livre. Avec Syriza, ils ont été les protagonistes du moment critique des démocraties néolibérales après la crise financière de 2008. Le moment populiste n’est pas près de se clore, mais les stratégies de ces partis-mouvements ont évolué. L’ADN de Podemos est en train de changer, suite à la querelle des deux leaders charismatiques, Pablo Iglesias et Iñigo Errejón. Leurs divergences portaient principalement sur l’alliance possible avec l’extrême gauche, donc sur le fait de se placer de façon claire à gauche de l’échiquier politique, en abandonnant l’hypothèse initiale d’un discours « peuple versus élite » capable de fédérer aussi une partie de l’électorat de droite. Le changement de Podemos doit beaucoup à l’alliance programmatique avec le PSOE. L’une des perspectives les plus réalistes du populisme en Europe, c’est justement de pousser vers des alliances de ce type-là, entre l’aile gauche des partis sociaux-démocrates et les partis populistes. Ces alliances permettent un équilibre intéressant : elles attirent à gauche des partis sociaux-démocrates en chute libre pour ne pas avoir su renouveler leur discours (social-libéral) après la crise de 2008 et elles corrigent les tendances « naturelles » du populisme à la polarisation et au personnalisme, en les ramenant dans les procédures plus classiques de la démocratie libérale. En définitive, on se retrouve avec une sorte de front populaire, une alliance de toute la gauche contre le libéralisme économique.
Pour Chantal Mouffe, le populisme de gauche reste la voie royale pour une politique progressiste en Europe au XXIe siècle…
Il faut souligner que la façon dont certains, dont elle, ont transformé l’analyse du populisme en stratégie électorale a fait des dégâts. D’une part, cela a conduit à simplifier énormément les choses et sous-estimer les contradictions constitutives du populisme, en en faisant en effet « la voie royale » pour sortir de nos malheurs démocratiques. D’autre part, cette stratégie a aussi été mal menée, puisqu’elle a souvent consisté à trouver un point commun entre les causes démocratiques supposées latentes de l’extrême droite et les causes démocratiques explicites, réelles, de l’extrême gauche. Il est évident qu’une telle stratégie ne peut trouver son point d’équilibre que dans la matrice nationaliste. Que peut-il y avoir de commun entre des pseudo-revendications démocratiques de l’extrême droite et celles de l’extrême gauche, si ce n’est l’idée de refonder l’État-providence sur une base purement nationale ? Une telle critique nationaliste des politiques néolibérales ne plaît pas à beaucoup de militants de Podemos, qui avaient déjà mal vécu l’évolution personnaliste et autoritaire du parti par rapport à ses débuts extrêmement participatifs, et qui voient d’un mauvais œil une stratégie qui consiste à flatter des électeurs qu’ils n’ont pas envie de voir dans le mouvement.

[Tatsuya Tanaka]
C’est également ce qui s’est passé avec la France insoumise. Elle a commencé à perdre des voix dès lors que Mélenchon s’est rangé à cette stratégie — à mon avis condamnée à l’échec. C’est un problème qui est indissociablement stratégique et analytique chez Mouffe. Analytique, parce qu’elle considère, sans enquêtes sociologiques à l’appui, qu’il y a des revendications démocratiques latentes dans la xénophobie des partis de droite. « Comme en témoigne le populisme de droite, écrit-elle en 2018, des demandes démocratiques peuvent être exprimées dans un vocabulaire xénophobe » ; aussi, « il est nécessaire de reconnaître le noyau démocratique d’une grande partie des demandes que [les populismes de droite] expriment ». Dans un article sur le FPÖ autrichien, écrit en 2002, elle écrivait que les « franges nostalgiques ne représentent qu’une très petite partie de son électorat » et que « quoique indéniables, les références à l’ère nazie ne tiennent pas une place importante dans l’idéologie du parti ». Selon elle, l’idéologie du FPÖ consistait plutôt à valoriser la souveraineté populaire en démocratie, en défendant, en particulier, la nécessité de consulter le peuple en matière d’immigration et de multiculturalisme. Cependant, le passage du parti au pouvoir (2000–2007, 2017–2019) montre le caractère irréaliste de cette hypothèse : le FPÖ n’a avancé aucune proposition concrète visant à rétablir la « souveraineté populaire » en démocratie.
Son « discours démocratique » n’a été, en réalité, que l’habillage démagogique d’une idéologie substantiellement raciste et xénophobe, héritée du nazisme, et tout à fait compatible, comme lui, avec une politique économique pro-élites. De cette erreur analytique découle l’erreur stratégique : selon Mouffe, il incomberait alors au populisme de gauche de « fédérer les demandes démocratiques en une volonté collective pour construire un nous
, un peuple
uni contre un adversaire commun : l’oligarchie. Cela exige d’établir une chaîne d’équivalences entre les demandes des travailleurs, des immigrés et de la classe moyenne en voie de précarisation, de même qu’entre d’autres demandes démocratiques, comme celles portées par la communauté LGBT ». Étrange pari que de rapatrier à l’extrême gauche des électeurs d’extrême droite en s’appuyant sur l’une des principales raisons pour lesquelles ils votent à droite : exclure du peuple les immigrés et les homosexuels ! Une telle stratégie politique à gauche ne peut qu’être déceptive pour les militants qui adhèrent à ces partis, justement parce qu’ils se considèrent de gauche.
- Courant politique de pays peuplés d’immigrants (États-Unis d’Amérique, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) qui s’oppose à toute nouvelle immigration.[↩]
- Qui se produit par l’effet du hasard.[↩]
- Juan Domingo Perón, Conducción politica, Buenos Aires, Ediciones « Mundo Peronista », 1952.[↩]

