Entretien inédit | Ballast
Romaric Godin s’était fait remarquer lorsqu’il publiait des articles sur la crise grecque dans La Tribune, en décalage avec la doxa dominante. Depuis 2017 à Mediapart, le journaliste économique y analyse avec pédagogie les rouages de la macroéconomie contemporaine. Dans son livre La Guerre sociale en France, il a retracé la façon dont le néolibéralisme a été imposé — non sans compromis — au pays, et comment le macronisme radicalise ce projet économique et politique. L’autoritarisme grandissant qui se déploie sous nos yeux est, analyse-t-il, la conséquence d’un néolibéralisme en crise : les gouvernants n’ont plus que la force pour mettre en œuvre un modèle auquel la majorité de la population française ne souscrit pas. Le mouvement social contre la réforme des retraites en est l’exemple même. Mais derrière cette crise du néolibéralisme se trouve en réalité celle du mode de production capitaliste : nous en discutons avec lui pour démêler tout ça.

Tout d’abord, l’histoire du capitalisme n’est pas faite de phases de ruptures abruptes, où on passerait rapidement, de façon claire, d’un monde à un autre. Ce sont des phénomènes de transformation avec des persistances d’anciennes pratiques qui, progressivement, se font chasser par d’autres — qui elles-mêmes prennent peu à peu des places dominantes, avec des variations selon les pays, les situations, les crises, etc. À titre personnel je ne parle pas de « fin du néolibéralisme » puisque, comme vous, je ne la vois pas ! En revanche, il y a une crise du néolibéralisme. Ce qui ne signifie pas que le néolibéralisme soit affaibli sur le plan politique ou en train de disparaître — ça veut dire qu’il essaie de survivre. Dans ce processus, ce pouvoir peut revenir de façon plus ou moins vive, selon les situations nationales ou régionales. On est entré dans le néolibéralisme à la fin des années 1970 aux États-Unis avec une rupture très forte, la destruction massive des organisations sociales, syndicales, des changements juridiques extrêmement puissants… L’évolution en France a été différente. Aujourd’hui le néolibéralisme est, aux États-Unis, dans une situation très précaire. Biden — qui n’est pas socialiste, bien sûr —, tente de définir une nouvelle forme de capitalisme alternatif au néolibéralisme : il n’y arrive pas complètement mais quelque chose se joue là-bas, avec en face une tentative fasciste via Trump. En France, on a encore un parti néolibéral qui est beaucoup plus fort parce qu’on n’est pas sur la même temporalité. Ce parti tâche d’imposer des réformes qui ont été imposées par d’autres il y a longtemps, avant la crise du néolibéralisme. Comme s’ils n’étaient pas conscients de celle-ci.
Comment relier cette crise du néolibéralisme au capitalisme actuel ?
La crise objective du néolibéralisme est en fait celle du capitalisme puisque le néolibéralisme, tel que je le conçois, est le mode de gestion contemporain du capitalisme. Donc ces gens, qui sont dans une temporalité politique différente, se font rattraper parce que notre pays est aussi dans cette crise du capitalisme néolibéral. C’est cette tension qui apparaît aujourd’hui : entre ceux qui vivent directement la crise du capitalisme (inflation, inégalités, monde du travail dégradé avec des emplois créés que personne n’a envie de faire, etc.) et un pouvoir qui continue de croire qu’il est en 1994, qu’il suffit de baisser le coût du travail et les impôts pour faire de la croissance, laquelle, à son tour, réglera tous les problèmes. Mais dans cette façon de raisonner, il y a un problème quasiment à chaque mot. Ce n’est donc pas tant la fin du néolibéralisme que sa crise, qui peut en réalité durer très longtemps ! Elle peut prendre des formes très différentes entre les États-Unis, la France, la Chine ou les pays émergents. La définition même du néolibéralisme est d’avoir un État fort qui organise les marchés et protège le capital. En France, l’État revient avec une fonction active dans l’économie et va encore plus loin dans le soutien au capital, à l’inverse de l’époque où il essayait de bâtir des compromis entre capital et travail. C’est ce qu’on voit avec les retraites : il faut dégager des moyens pour aider encore plus le capital, et ça, on va le chercher sur le reste de la destruction de l’État social et de la Sécurité sociale. Il se dessine quelque chose de « l’après », avec un État encore plus présent, qui organise, protège et garantit la poursuite de l’augmentation du taux de profit — j’appelle ça un socialisme de l’offre. On voit donc un changement qui fait partie de cette phase de transformation du capitalisme, qui est structurel. Marx le dit dès le départ dans le Capital : le capitalisme se transforme en permanence. C’est pourquoi il faut réfléchir en termes de mode de gestion du capitalisme face à l’intérieur du conflit capital/travail.
À partir de quand pourrait-on dater le début de cette crise ?
« La définition même du néolibéralisme est d’avoir un État fort qui organise les marchés et protège le capital. »
Le capitalisme fonctionne sur un modèle d’élargissement à la fois géographique et des marchés dans la société. À ce titre, le fordisme est son « point haut » : le capitalisme a produit pendant très longtemps des biens d’équipements et de luxe, et puis il lui a fallu produire massivement des biens de consommation. Cette phase a contraint le système à la redistribution parce qu’il faut bien que les gens puissent acheter ces biens. À la fin des années 1960, alors que les gains de productivité sont autour de 5–6 % en Occident, ce modèle fordiste entre dans une grave crise de profitabilité. La réponse apportée est d’une part de presser sur le monde du travail pour dégager de la plus-value, mais aussi d’élargir les marchés et la production par la mondialisation — pour réduire le coût de production et ouvrir de nouveaux marchés. C’est ça, le début du néolibéralisme. Mais ce qui est assez frappant, c’est que cet élargissement a un effet « apaisant » sur la crise, sans pour autant la régler. À partir du milieu des années 2000, et avec la crise de 2008, la financiarisation — une des grandes tendances du néolibéralisme — n’est plus réellement effective pour apporter une contre-tendance à ce mouvement de fond. Il y a donc un rattrapage des anticipations de gains de productivité, donc de profitabilité des marchés par rapport à la réalité. À cette crise, les banques centrales répondent en baissant leurs taux : cette fuite en avant de la financiarisation échoue en 2008. À ce moment, les banques centrales agissent encore davantage, mais elles courent toujours après cette crise. Le mode de gestion néolibéral n’est pas simplement une réponse à une crise : c’est une fuite en avant perpétuelle face à une crise sous-jacente. Ça en fait à la fois la violence, et les limites. Ce mode de gestion est en perpétuel changement. Je ne peux donc pas donner de date exacte du début de crise : ça peut être dès sa naissance — déjà critique en quelque sorte — avec la crise de 1973. Il faut réfléchir en termes de phases plutôt qu’en termes de ruptures simples, même si 2008 est une crise importante puisqu’il est certain qu’à partir de cette date, la sphère financière n’est plus vraiment effective dans la sauvegarde du néolibéralisme.
On retrouve là un élément que vous mettez souvent en avant dans vos analyses : la baisse structurelle des gains de productivité.
En effet, la crise profonde du capitalisme contemporain est sa baisse tendancielle du taux de productivité. Lors des deux précédentes révolutions industrielles, suffisamment de profits étaient dégagés pour développer des investissements et occuper les gens dans des emplois de plus en plus productifs. Ça ne se produit plus : là où il y a des gains de productivité, ils sont captés par les élites qui les mettent dans la sphère financière. Et de toute façon ces gains sont beaucoup trop faibles. Cette situation est extrêmement compliquée à gérer pour une économie capitaliste. Il y a aussi la crise de la mondialisation. On a beaucoup compté sur la Chine pour pouvoir jouer sur le travail bon marché, afin de réduire les coûts de production et de faire pression sur le travail dans les pays occidentaux. Sauf que la Chine se développe et elle n’a plus envie de rester à la place qu’on lui a assignée dans la division du travail internationale. Elle en a vu les conséquences : en 2008 elle a relancé l’économie avec des investissements très largement improductifs, ce qui a provoqué des problèmes, notamment cette bulle immobilière en train d’exploser, et ça en a retardé son propre développement. Il y a évidemment une partie de la production chinoise très bas de gamme qui est déjà partie au Viêtnam, et va continuer de partir au Bangladesh ou dans d’autres pays. Mais les investissements nécessaires et la mise en place des lieux de production en Chine impliquent qu’il est très compliqué de déplacer plus largement la production. On ne transfère pas l’usine d’iPhone de Foxconn du jour au lendemain. Ça pose aussi des problèmes d’impérialisme : chaque pays va tenter d’avoir sa zone de production et il y aura des conflits entre États… À partir de 2015, et encore plus depuis 2020, il est évident que la mondialisation est en crise. Plusieurs piliers tombent donc les uns après les autres : il en résulte une économie mondiale très tendue et très affaiblie. Des éléments extérieurs se rajoutent là-dessus, comme le Covid — mais le Covid est un virus qui vient sur un corps économique déjà malade.
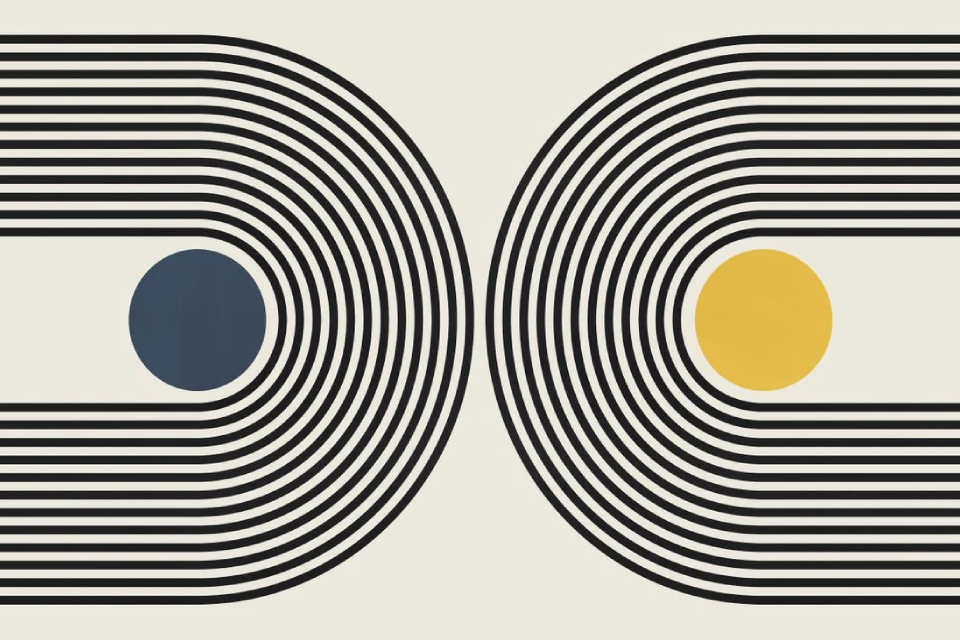
[Vitor Costa]
Dans votre livre La Guerre sociale en France, vous écrivez que « Le néolibéralisme a réussi ce pour quoi il a été construit : rétablir l’accumulation du capital, servir la classe qui le détient » ou encore que « [Le paradigme néolibéral] doit trouver le moyen que son existence et son développement ne soient pas freinés par la volonté des populations. Il agit de plusieurs manières ». Vous parlez du néolibéralisme comme si il avait une agentivité propre, une autonomie…
C’est un livre très modeste qui n’a pas vocation à développer une philosophie générale du capitalisme. Mais voilà comment on peut le concevoir : puisqu’il y a cette crise du capitalisme qui prend la forme du néolibéralisme, il y a des agents qui vont défendre les intérêts du capital. Ils sont de plusieurs types : des gens qui pensent qu’il faut sauver le système par principe et des gens qui ont des intérêts de pouvoir ou d’argent dans ce système, comme des dirigeants politiques et des chefs d’entreprises. Il y a aussi des structures culturelles qui renforcent cette agentivité des néolibéraux, au sens où ce mode de gestion s’incarne par des gens qui agissent sur la société. Le mode de gestion du capitalisme se répand dans la société par plusieurs modes opératoires. L’un, réflexe pourrait-on dire : « Comment je fais pour sauver mon profit ? » Il y a aussi les modes d’actions culturels, comme lire Ayn Rand, Hayek, Friedmann ou les économistes qui ont digéré ces livres, ce que j’appelle le consensus néolibéral en sciences économiques et qui influe à son tour sur la masse des économistes, des politiques et une partie de l’opinion. Dans une forme de simplification, j’explique que c’est le néolibéralisme qui fait ça. Mais la réaction à une crise du capitalisme se traduit bien par des agents concrets, par des réponses concrètes qui trouvent leurs formes à la fois dans des réalisations culturelles et des pratiques sociales. C’est pour ça que le néolibéralisme prend des formes extrêmement différentes selon les situations dans lequel il est. Entre le Brésil, la France, l’Allemagne ou les États-Unis, la façon dont redescend cette nécessité de sauvegarder le taux de profit prend des formes variées.
Vous parlez justement d’« élites néolibérales » françaises, qui n’ont pas cessé de prêcher en faveur du néolibéralisme. Quels corps sociaux mettez-vous plus exactement derrière ce terme ?
Le patronat français des années 1960–70 est beaucoup moins homogène qu’aujourd’hui (même si c’est un peu moins vrai depuis quelques années car il y a un patronat d’extrême droite en train de se développer autour des idées libertariennes). Jusque dans les années 2010, il y a une homogénéité autour du consensus scientifique néolibéral, qui permet à des groupes très différents tels que des néokeynésiens, des libertariens et des néoclassiques de se retrouver. Ces élites se pensent donc supérieures en tant qu’elles incarnent ce consensus. Cette homogénéité dans leur interprétation de la science économique se retrouve chez les patrons, les politiques, les économistes. Le terme d’« élites néolibérales » désigne ceux qui se reconnaissent dans ce consensus néolibéral, et donc dans les pratiques qui viennent répondre à la crise du capitalisme. Politiquement, il y a aussi une forme d’homogénéité entre le Parti socialiste, les Républicains [UMP et RPR, auparavant, ndlr], l’UDF et le Front national [RN aujourd’hui, ndlr], qui n’ont jamais remis en cause ces approches économiques. Cette homogénéité politique est le reflet de l’homogénéité patronale et de l’homogénéité scientifique économique. À l’intérieur, il y a également des conflits d’influence : entre Nicolas Sarkozy et François Hollande on constate des dissensions. Mais à partir de 2007–2010, je vois une rupture avec Sarkozy qui décide d’aller très fort dans le néolibéralisme, ignorant totalement la réponse de la société. Et ça se prolonge par les lois Travail de 2015 et 2017 sous le quinquennat Hollande — qui parfois va plus loin que Sarkozy.
À propos de la science économique, un article de 2015 du Monde diplomatique s’intitulait « Police de la pensée économique à l’Université » et tendait à montrer que la pensée économique universitaire était largement dominée par le courant néoclassique (rejetant tout pluralisme et particulièrement toute tendance hétérodoxe). La science économique française fonctionne-t-elle en circuit fermé ?
« Il est désormais extrêmement difficile en France, pour les économistes hétérodoxes d’être à l’Université, de faire des carrières. »
J’apporterais une précision : je ne crois pas que le problème soit le courant néoclassique en tant que tel, mais justement cette fameuse synthèse qui naît dans les années 1990 entre le néokeynésianisme et le « nouveau » néoclassicisme. Le néoclassicisme en tant que tel, plus personne n’y croit réellement… Les tentatives de renaissance n’ont eu pour fonction que de réinjecter du néoclassicisme dans le keynésianisme pour donner naissance à ce consensus (qui s’appelle officiellement néokeynésianisme). Ce sont les keynésiens qui ont injecté du néoclassicisme dans leur pensée, notamment avec les modèles DSGE. Les sociaux-démocrates ont l’impression d’y trouver leur compte, sauf que ça défend des politiques qui mènent au monde rêvé des néoclassiques. La domination intellectuelle du néoclassicisme prend donc une forme détournée. Depuis 2015, la situation s’est dégradée. Il est désormais extrêmement difficile en France, pour les économistes hétérodoxes — ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette synthèse là —, d’être à l’Université, de faire des carrières. Le système est verrouillé par le principe de validation par les pairs : s’ils sont tous néokeynésiens et qu’un économiste veut faire carrière, il se trouve face à un mur. En 2016 la tentative de créer une filière hétérodoxe a été repoussée par les ministres de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, après que Jean Tirole s’y soit opposé, au prétexte d’obscurantisme ! Il y a eu une reprise en main par tous les pontes de l’Université française qui ont pignon sur rue et des entrées dans les ministères et les lieux de pouvoir. Beaucoup d’hétérodoxes ont du mal à vivre de leur propre métier de recherche. Ou bien ils quittent la France. Il y a donc un problème de formation des futurs économistes, mettant en péril la vivacité de la pensée économique en France — qui a pourtant historiquement beaucoup contribué à la science économique.
Le pamphlet des économistes orthodoxes Pierre Cahuc et André Zylberberg, Le Négationnisme économique, paru en 2016, procède-t-il de cette tentative de reprise en main ?
Tout à fait. Ce livre vise à convertir le grand public français, qui, globalement, ne croit pas à tout ça… Ces gens exercent une domination élitaire et ont un mal fou à descendre dans la société. Cette phase du néolibéralisme a en quelque sorte été ratée, en France. Il y a aussi eu une réaction de l’hétérodoxie française pour contrer le négationnisme économique — les Économistes atterrés ont eu, à l’époque, une fonction importante. À mon avis, l’offensive orthodoxe n’a pas si bien marché : ce qui s’est passé depuis et ce qu’il se passe en ce moment le prouve.
À quoi pensez-vous exactement ?
Le mouvement social contre les lois Travail, contre la précédente réforme des retraites, les gilets jaunes, les luttes à la SNCF, le mouvement contre la réforme actuelle… On se trouve dans la même situation, avec une minorité au pouvoir persuadée d’avoir raison et d’être dans la science, de savoir ce qu’il faut faire, et puis la masse, perçue comme un ensemble de ploucs. Dans son intervention télévisée du 22 mars, c’est ce que dit Macron : « Moi, je fais ce qu’il faut faire. » Il se présente comme porteur de la vérité tandis que les autres seraient dans l’erreur. Ce qui justifie son passage en force : « Il y a une tendance dans nos démocraties à vouloir s’abstraire du principe de réalité. »

[Vitor Costa]
Le néolibéralisme s’est donc moins déployé en France, oppositions obligent. Il y a eu une forme de compromis — un « modèle hybride » français, dites-vous — et Macron serait le premier président réellement néolibéral. Le macronisme relève d’une différence de nature, non de degré ?
Le macronisme s’inscrit dans une rupture de nature avec la gestion néolibérale de la période 1977–2010, qui est marquée par une forme de néolibéralisme prudent. La France connaît à cette époque des politiques néolibérales marquées, avec de l’austérité, une libéralisation de la finance et des réformes des retraites, mais la résistance de la société est prise en compte. On propose certaines compensations : un maintien des dépenses sociales, de nouveaux droits (comme les 35 heures ou le RSA) et une préservation du domaine du travail (assurance chômage et droit du travail). C’est cette politique qui est remise en cause à partir de la présidence Sarkozy et c’est la rupture avec cette politique qui est promue par la fameuse commission Attali. À partir de 2010, la rupture est claire : la réforme des retraites Fillon passe en force malgré une mobilisation massive et le budget 2011 est ultra-austéritaire. En 2015–2017, cette politique est poursuivie par Hollande avec les lois Travail, qui s’attaquent directement au droit du travail. Le macronisme s’inscrit dans cette logique de différence de nature avec la période précédente. Sa focalisation sur les « réformes » le situe dans un rejet du « chiraquisme », perçu comme le lieu du recul néolibéral face aux masses. Mais à cela s’ajoute une différence de degré ! Macron veut aller plus loin que Sarkozy et Hollande en modifiant davantage encore le droit du travail, l’assurance chômage, le statut de la fonction publique et des entreprises publiques. Macron a officiellement démissionné en 2016, en désaccord avec la loi Travail trop modérée à son goût ! Le macronisme est l’aboutissement de deux trajectoires : la rupture avec le chiraquisme et le changement de degré, où on monte en réformes et en violences. En parallèle, la crise capitaliste continue : le macronisme entend donc aller plus loin. C’est une fuite en avant à marche forcée. Il se durcit par sa logique propre mais aussi par la « nécessité » externe de la logique capitaliste. Le macronisme n’a aucune consistance sur la plupart des sujets : il peut flirter avec l’extrême droite et se draper dans un progressisme « sociétal », mais il ne varie pas sur les réformes néolibérales parce que c’est le cœur de son identité.
Depuis quelques années, la notion de « démocraties illibérales » a été mobilisée, en opposition à nos démocraties libérales. Mais ce concept a‑t-il un sens ?
J’ai critiqué cette dichotomie. Il y a plutôt un mouvement général autoritaire au sein du capitalisme contemporain, qui prend des formes différentes, mais c’est un mouvement de fond. L’économiste Banko Milanovic a publié un livre intitulé Le Capitalisme, sans rival, où il définit les formes du capitalisme contemporain autour de deux variantes : un capitalisme méritocratique libéral et un capitalisme politique. Mais, en fait, il commence à y avoir une forme de capitalisme politique généralisé — au sens où l’État vient au secours du capital de façon active. Ce mouvement s’accompagne d’un durcissement politique. Dans les démocraties occidentales, il y a une convergence générale vers des formes de plus en plus autoritaires de mode de gestion du capitalisme. Le néolibéralisme est peut-être en train de se modifier dans un capitalisme plus autoritaire, de rente, protégé par l’État et fondé sur une exploitation accrue du travail. La contestation est donc beaucoup moins acceptable. Le terme de démocratie illibérale pouvait définir il y a quelques années des États comme la Hongrie, la Pologne. Dorénavant, on peut se poser la question pour la France. Le pouvoir macroniste a eu un recours inédit aux violences policières et à l’encadrement policier du droit de manifestation et de grève. Il y a une aggravation de la situation du point de vue démocratique qui doit nous alarmer. Ces dernières semaines ont été exemplaires de ce point de vue : on peut constater un scandale par jour.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, « la France se dote d’un État social puissant et largement redistributeur », écrivez-vous. L’économiste Nicolas Da Silva estime pour sa part que l’État social est un adversaire du mouvement social autogéré car il a aussi eu pour rôle de « maintenir l’ordre social ». À cet État social, il oppose la Sociale (qu’il définit comme la « protection sociale auto-organisée contre l’État, contre le capital et contre les formes de paternalisme antérieur »). Comment vous positionnez-vous par rapport à cette idée ?
« Dans les démocraties occidentales, il y a une convergence générale vers des formes de plus en plus autoritaires de mode de gestion du capitalisme. »
J’ai beaucoup apprécié le livre de Nicolas Da Silva, avec lequel je partage bien des choses. Évidemment, la fonction de l’État social ou de l’État providence n’est pas une fonction révolutionnaire. Pendant les premières années du XXe siècle, certains réformistes comme Bernstein pouvaient attribuer à l’État social une fonction de transformation révolutionnaire de la société. Mais cette idée a disparu progressivement. L’État social est devenu de façon consciente un soutien au développement capitaliste, notamment sous l’effet de la pensée keynésienne. Ce qui a alors dominé, c’est l’idée d’une complémentarité entre l’État social et le capitalisme. Ça permet d’avoir des travailleurs qui travaillent mieux, plus longtemps, et qui consomment. La bourgeoisie française a eu beaucoup de mal à comprendre ça — d’où les crises des années 1920 et 30. Elle ne l’a toujours pas complètement compris, d’ailleurs. L’État social est protecteur de la population et, en même temps, c’est un outil du capitalisme. Dans les années 1940 à 60, il était en soutien de la production de valeur : il soutenait le développement de la société de consommation, l’augmentation de la productivité (qui se traduisait notamment par l’intensification du travail). Il faut des gens en bonne santé pour ça. L’État social est donc un instrument du capitalisme, mais le capitalisme n’est pas un bloc : il y a des conflits internes au capital. À partir des années 1970–80, avec la crise de la productivité, il y a un problème avec cet État social qui coûte cher aux capitalistes : ils entrent donc en conflit avec lui.
Il faut regarder le rôle de l’État dans ce conflit qui contribue lui-même à la déconstruction de l’État social, et c’est peut-être ici où je me sépare de de l’analyse de Nicolas Da Silva. Ce dernier montre d’ailleurs très bien que la destruction de l’hôpital public est une réponse au mouvement social victorieux de 1995. La réforme de 1996 du gouvernement Juppé met en place l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie1 (Ondam) (qui sera respecté surtout après 2010) et l’amortissement de la dette sociale (Cades), qui coûte 16 milliards d’euros à la Sécurité sociale chaque année, avec de nouvelles baisses de cotisations sociales. Le conflit s’est déplacé. Quand on détruit l’hôpital public ainsi, on détruit l’État social et c’est l’État qui est à la manœuvre. C’est pareil pour la casse du système de retraites. La destruction de l’État social s’intègre dans la lutte capital/travail. Aujourd’hui, on se bat tous pour la défense des retraites, qui est une forme d’État social dans sa construction actuelle (la Sécurité sociale étant très largement étatisée, comme le montre Da Silva). Mais la vraie question est la suivante : l’État social tel qu’il a été construit est-il soutenable dans le cadre du capitalisme contemporain ? Et c’est là que je rejoins Da Silva : peut-être qu’il faut construire une forme de solidarité et de protection qui ne soit plus dépendante du mode de production de valeur capitaliste. Car quand bien même on obtiendrait le retrait de cette réforme des retraites, dans quelques années le même problème reviendra — ou bien sous d’autres formes — du fait de la dynamique même du capital.

[Vitor Costa]
Dans vos articles et dans vos interventions, vous vous référez fréquemment à Marx, parfois à Polanyi et de temps à autres à Keynes. Comment ces pensées peuvent-elles être actualisées pour saisir le capitalisme contemporain et ses crises ?
Pour être honnête, j’ai beaucoup plus de mal aujourd’hui à mobiliser la pensée de Keynes, voire de Polanyi, qu’il y a quelques années pour expliquer la situation actuelle. Elles ne sont pas sans intérêt, bien sûr, et d’autres y parviennent très bien. Mais il me semble qu’il existe une pertinence de la pensée marxiste dans la situation présente, dont l’évidence se retrouve dans le désarroi des économistes mainstream. L’économiste mainstream ne comprend rien à ce qu’il se passe, notamment concernant la productivité. Cette incompréhension me ramène à la critique que Marx fait de ce qu’il appelle les « économistes vulgaires », ceux pris dans le courant sans pouvoir prendre le recul nécessaire pour saisir le tableau d’ensemble. L’avantage de la pensée marxiste est qu’on remonte au mode de production pour essayer de saisir l’essence de la crise. Il existe des conflits pour savoir quel Marx on mobilise, quel pan de la pensée de Marx on reprend, etc. Mais le Marx qui décrit la crise structurelle du capitalisme par la baisse tendancielle du taux de profit (livre III du Capital), tout comme des éléments du livre I, font écho à ce qu’on vit. Des penseurs marxistes ont réfléchi à ces crises et y apportent des réponses. Les autres courants économiques ont beaucoup plus de mal à expliquer notre réalité.
Dans ma lecture de Marx, je suis frappé par le fait que le capitalisme est un élément dynamique : il évolue, change de formes. C’est presque une domination sans sujet, au sens où les capitalistes font des choses parce qu’ils sont poussés par le mouvement propre de ce mode de production. Comment voulez-vous comprendre cet entêtement des élites françaises à nous imposer cette réforme des retraites alors qu’ils ont perdu la bataille des idées, perdu la bataille démocratique, quasiment perdu la bataille parlementaire ? En lisant Marx, on a des réponses à ça. Marx, c’est une pensée historiquement située : il ne s’agit pas de reprendre le Capital de 1867 et de le plaquer sur la situation actuelle. Ça nous oblige à avoir une traduction dans notre situation historique présente. La réponse ne peut pas se faire comme en 1917, comme en 1848, comme en 1936 ou en 1968. Ça pose tout un tas de questions sur la stratégie, l’organisation de la société, etc.
On semble assister à un retour du marxisme dans les pensées critiques, ces dernières années…
« Il existe une pertinence de la pensée marxiste dans la situation présente, dont l’évidence se retrouve dans le désarroi des économistes mainstream. »
On voit clairement un mouvement se dessiner. Le mot « communisme » est remis en avant — avec Frédéric Lordon, Bernard Friot, Isabelle Garo ou encore le Japonais Kohei Saito, qui défend un « communisme décroissant ». Cette pensée assez vigoureuse est une réaction à l’après-chute du Mur, où le marxisme avait été jeté aux oubliettes de l’Histoire. Quelque chose se passe, même si ça reste très minoritaire. Mais c’est assez notable pour inquiéter. On a vu ce bandeau sur CNews : « Doit-on craindre le retour du communisme ? » Durant la campagne de 2022, la macronie avait joué la carte de la « peur rouge » face à la Nupes. C’est assez significatif qu’une proposition parlementaire d’une radicalité modérée, et dont l’influence marxiste était très contrebalancée par une influence post-keynésienne très forte, soit jugée comme une forme de retour à l’Union soviétique ! Ça montre qu’ils ont peur parce qu’ils sentent bien que quelque chose ne fonctionne plus.
Dans un entretien croisé avec Razmig Keucheyan, vous disiez : « On ne peut pas être anticapitaliste sans aujourd’hui à mon sens poser la question de là où se situe le centre névralgique de la production capitaliste, c’est-à-dire l’Asie. On ne peut pas faire de l’anticapitalisme sans se poser la question de la possibilité de la mobilisation des travailleurs asiatiques aujourd’hui. » Cette question est-elle trop peu souvent posée au sein de la gauche radicale ?
Même si chaque capitalisme a une réalité nationale, le mode de production est mondialisé : il est dominant sur l’ensemble de la planète, avec des interdépendances mutuelles. En regard, les luttes restent très nationales, parfois même très locales à l’intérieur des nations. Toute lutte est bonne à prendre mais si on veut aller plus loin, il faut se poser la question de l’internationalisme de la lutte. Je sais que Frédéric Lordon explique qu’il faut bien commencer par quelque chose et que, dès lors, il faudra commencer la transformation dans un cadre national. Je ne suis pas un stratège et je n’ai pas réfléchi à ces questions en détail, mais ce qui est sûr, c’est qu’à un moment cette lutte doit pouvoir se diffuser. Quand bien même il y aurait une contestation nationale très forte qui déboucherait sur une volonté de changement du mode de production national, on serait soumis à des dépendances vis-à-vis de pays capitalistes. Le danger serait alors de recourir à des logiques autoritaires, ou d’abandonner la partie. Si on prend l’horizon du dépassement du mode de production au sérieux et qu’on cherche à instituer une société qui soit gérée par les besoins et qui, en cela, soit une société plus libre, on va devoir réfléchir à cette question. Je ne dis pas du tout qu’il ne faut rien faire tant qu’on n’a pas la grande Internationale des travailleurs — d’autant que le dépassement du capitalisme sera sans doute aussi un processus plus qu’un « Big Bang ». Mais, oui, il me semble indispensable de poser la question de l’internationalisme.
Illustration de bannière : Vitor Costa
Photographie de vignette : Sébastien Calvet
- L’Ondam fixe un objectif annuel de dépenses d’assurance maladie à ne pas dépasser.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Claude Didry : « Le salariat, une classe révolutionnaire ? », avril 2020
☰ Lire notre article « Les racines néolibérales de la révolte chilienne », Lissell Quiroz, novembre 2019
☰ Lire notre entretien avec Bernard Friot : « La gauche est inaudible parce qu’elle ne politise pas le travail », juin 2019
☰ Lire notre entretien avec Maud Simonet : « Travail gratuit ou exploitation ? », février 2019
☰ Lire notre entretien avec Alain Bihr : « Aux sources du capitalisme », octobre 2018


