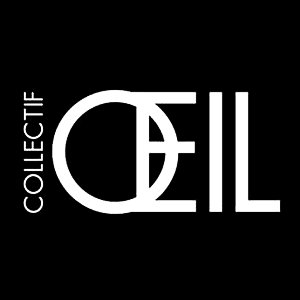Entretien inédit pour le site de Ballast
Nous croisons régulièrement leurs photos sur les réseaux sociaux : pour cause, elles escortent les luttes sociales françaises depuis plusieurs années. NnoMan et Julien Pitinome ont monté le Collectif Œil en 2012. Ces deux photographes autodidactes, issus des quartiers populaires des régions parisienne et lilloise, revendiquent une éthique du photojournalisme : que leurs images puissent rendre dignité et voix à celles et ceux qui n’ont pas leur place, ou peu, ou mal, dans le paysage médiatique. « Si tu te sens pas représenté dans les médias, il faut créer le tien », encourage Pitinome — ce qu’ils ont appris de leur engagement, de leur expérience du monde associatif et de celle de journalistes indépendants, ils s’en font des passeurs : dans les colonnes de leur magazine Fumigène, dans les écoles, les maisons de quartier, dans les prisons ou les pages de la revue États d’urgence. Nous les rencontrons autour d’un thé, entre six yeux.
« Ce que nous voyons, ce que nous capturons, ce que nous montrons, est ce que nous pouvons et devons changer », dites-vous : voir pour agir, donc ?
Julien Pitinome : Les luttes qu’on couvre nous touchent toujours indirectement. On vient tous deux de milieux populaires : quand les postiers se mobilisent, c’est quelque chose que nous pouvons vivre. On inscrit notre travail dans un temps long, le documentaire ; pendant un certain nombre d’années, on est présents sur un sujet : ce travail est une trace de ce qu’il se sera passé. « Notre œil est la vie » [leur slogan, ndlr], ça signifie redonner la parole aux personnes qui ne l’ont pas, ou ne l’ont plus.
NnoMan : Avec Fumigène, on fait beaucoup d’ateliers avec des jeunes dans des maisons de quartier, dans des lycées ou en milieu carcéral. Ça permet de prendre du recul : quand on présente un travail, ce sera rarement les photos de la manif’ du matin ! Il nous faut alors réfléchir aux images qu’on montre : à qui elles vont servir, et pourquoi.
« On parle aujourd’hui de médias
militantsouengagés, mais le fondement du journalisme, ce n’est pas la neutralité ! »
Julien Pitinome : La spécificité de notre travail, c’est de pouvoir être dans des endroits où il n’est pas simple d’être. Ce prisme journalistique qui nous mettrait dans une position de non « neutralité » ou de trop forte implication, on n’y croit fondamentalement pas. On parle aujourd’hui de médias « militants » ou « engagés », mais le fondement du journalisme, ce n’est pas la neutralité !
Pour vous, « chacun est légitime de sa réalité ».
Julien Pitinome : Comment permettre à des personnes d’exprimer ce qu’elles vivent ? Comment créer des espaces pour que ces personnes s’expriment par elles-mêmes ? Comment permettre que cette parole soit diffusée, diffusable et réalisable par les habitants eux-mêmes ? C’est la question de l’éducation populaire, finalement. Si on veut donner la parole aux gens, il ne faut pas la transformer : quand les deux protagonistes, le photographié et le photographe, sont satisfaits, cette production peut vivre n’importe où.
NnoMan : On a pris la mauvaise habitude d’écouter les médias comme une parole sacrée. Sur les chaînes d’infos en continu, on nous ramène systématiquement des experts — souvent autoproclamés, mais quand tu vois « expert » ou « docteur », c’est-à-dire quelqu’un qui se présente comme supérieur à toi, tu vas l’écouter et obéir. Ça rappelle l’expérience de Milgram. Nous, on inverse ce truc en affirmant que chacun est légitime de sa réalité. Qui est plus légitime pour parler de la situation des élèves au lycée que des élèves de lycée ? Sur des enjeux qui concernent les femmes, ce sont des hommes blancs qui seront sur les plateaux télé pour en parler. Sur la question de la précarité, ce sont des journalistes non précaires qui s’expriment ; c’est ainsi à tous les niveaux. Sans forcément faire du reportage ou chercher à être publié, on a tous un stylo, de quoi faire des photos : on peut raconter.
Vous évoquiez un jour le sentiment de prise en otage vécu par les gens qui apparaissent dans les reportages consacrés aux quartiers populaires mais ne bénéficient que rarement d’un droit de réponse. Comment la photo intègre-t-elle cette notion ?
Julien Pitinome : La question du droit de réponse se pose car ce que tu dis ou montres reste toujours une interprétation de la réalité : il faut lui laisser la place de s’organiser. Quand on forme des gens à la production journalistique, on doit le prévoir, et ceux qui apprennent doivent le prendre en compte. C’est affaire de confiance — si ton travail est réglo, ça ne sera pas nécessaire ; c’est un cercle vertueux. Ça permet aussi de démystifier le rôle du journaliste.

[« La Jungle de Calais, la vie s’en est allée », 2016 | Julien Pitinome | Collectif Œil]
Concrètement, le Collectif Œil fonctionne comme une agence de presse ?
NnoMan : On avait d’abord vocation à travailler entre nous : on faisait nos reportages sans faire de diffusion presse ; on était quatre photographes (deux sont partis, deux sont rentrés1). On a aujourd’hui un statut associatif et un site Internet. Quand on a relancé Fumigène, c’est le Collectif Œil qui l’a porté comme éditeur. À un moment s’est posée la question d’intégrer, à titre individuel, de grosses agences de presse : pour ça, il faut prouver la valeur de ton travail, il faut prendre rendez-vous avec quelqu’un ; en un mot : quémander. On n’en a pas envie. Je n’ai jamais supplié personne pour bosser ou avancer dans la vie — on a des potes qui peuvent attendre des mois qu’on daigne regarder leur travail, et on leur demande de rappeler dans 6 mois… Au lieu d’intégrer une agence qui distribue via une plateforme, on paie un abonnement mensuel directement à la plateforme de distribution — Pixpalace —, où on met nos photos. On s’est donc lancés en agence de presse : on a gardé les mêmes statuts mais on distribue nos images. L’idée était d’éviter de faire un fourre-tout idéologique, comme par exemple chez Hans Lucas — on a plein de potes chez eux, et c’est très bien, mais on voulait garder une identité forte, avoir une cohérence jusqu’à ce que notre collectif soit reconnu comme une agence de photographes engagés. On refuse de couvrir les meeting du FN, comme c’est le cas de certains, qui n’ont aucun scrupule idéologique avec ça. Ce sont des choses non négociables.
Julien, vous avez une série de photos du camp de Calais. Le lieu est fantomatique, les ciels sont très présents. On ne se croirait pas en France. Pouvez-vous nous raconter ces images ?
« On refuse de couvrir les meeting du FN. »
Julien Pitinome : Nous sommes plusieurs photographes, et c’est la fin du démantèlement de la « jungle » de Calais. Il doit rester un jour ou deux avant que tout ne soit rasé. C’est un lieu que nous connaissons bien car nous y venons depuis longtemps. Nnoman me suggère de faire des poses longues. Au bout de deux essais, les lumières du ciel se révèlent vraiment bien graphiquement. Montrer la « jungle » de Calais, habituellement peuplée de milliers de personnes, dans un moment sans vie… Car ce sont des lieux de vie : il y a un restaurant, une boutique… Ça bougeait encore le jour-même. De la vie, puis plus rien, suite à la décision de l’État de raser. C’est difficile de figer ce type de moment. Tout ce travail sur Calais était souvent fait dans l’urgence. Et là, c’est le no man’s land. C’est aujourd’hui que je peux le conscientiser ainsi : il importait de faire des images à contre-courant de la mascarade médiatique organisée par la préfecture et le gouvernement, lequel a accrédité des photographes — nous en faisions partie. Cette série de photos a peu vécu car on n’y voit personne, mais elle est importante dans mon travail. Ce sont presque des traces anthropologiques qui documentent un type d’habitat — des cabanes de bois qui, forcément, pouvaient brûler très vite.
Vous êtes allés ensemble faire un reportage dans un autre camp de réfugiés, celui des Rohingya au Bangladesh. Une expérience que vous comparez à ce que vous avez vécu à Calais.
Julien Pitinome : Ce qu’on a vu à Calais, même si c’est évidemment très différent, était « pire ». Au Bangladesh, les réfugiés sont accueillis dans des camps militaires : il y a des ONG partout, les camps sont organisés, il y a des rues. Le drame est proche, c’est vrai : ils sont à 30 minutes du lieu de certains massacres. Ce ne sont pas les mêmes parcours de migration (à Calais, il y a des personnes qui peuvent avoir parcouru 3 à 6 000 kilomètres !), mais il y a des infrastructures au Bangladesh ; en France, c’est une politique de non-accueil, même par – 5 °C. Dans le camp de Grande-Synthe, un couple de Kurdes nous disait qu’il ne voulait pas rester car « la France les accueille dans 20 centimètres de boue »…
NnoMan : Un matin, à Calais, très tôt — l’un de ces matins de l’expulsion de la zone Sud —, j’ai croisé un jeune Syrien de 17 ans. Je lui demande comment il va, dans nos anglais respectifs compliqués ; il m’explique de but en blanc qu’il va tout faire pour retourner en Syrie : « Je préfère mourir sous les bombes dans mon pays que mourir de froid ici, ou sous les coups de vos CRS. » Cette phrase m’a marqué. En arrivant au Bangladesh, j’appréhendais vachement. On a mis du temps à mettre des mots : ça me gênait presque de me dire que les camps rohingya ne me choquaient plus tant… J’étais conscient d’être dans l’un des pays les plus pauvres du monde, dans l’un des camps les plus grands du monde, et de n’être pas sous le choc. J’ai tilté plus tard : à Calais, où on s’est énormément investis, où on a rencontré beaucoup de monde, tout nous apparaissait bien pire, oui. Rencontrer des Rohingya qui vivent quasiment dans la même situation que les paysans locaux des campagnes alentour et savoir qu’à Calais, les habitants méprisent les réfugiés… En France, on aurait l’argent pour accueillir autrement !

[Dans le camp des réfugiés rohingya, décembre 2017 | NnoMan | Collectif Œil]
Pour nombre de vos reportages, vous avez un lien de proximité avec les personnes que vous suivez ; pas au Bangladesh. Cela explique peut-être également ce décalage dont vous parlez.
NnoMan : C’est surtout qu’on n’a pas la main sur ce qu’il se passe dans les camps rohingya. Alors qu’à Calais… Les flics qu’on croise, le président que la France a élu : s’il fallait changer cette situation, on serait en capacité de le faire. Ça me rappelle mon passage en Palestine : toutes les atrocités qu’on voit et le peu de pouvoir qu’on a sur l’information ! Je n’ai aucun pouvoir sur l’armée israélienne et, dans les camps rohingya, on ne peut que monter une association, comme le font Moussa2 et d’autres… Mais le lien émotionnel se crée aussi à l’étranger, même si on reste moins longtemps : un enfant rohingya qui raconte qu’il a vu l’hélicoptère arriver au-dessus de son village et tirer sur tout le monde ; un ancien, venu me voir avec sa carte d’identification — il s’appelait Nouman —, qui m’a demandé de le filmer pour raconter ce qu’il avait vécu, de transmettre son histoire.
Julien Pitinome : Quand on arrive dans les camps de Rohingya, les militaires nous disent de les prévenir de nos entrées et sorties. Avec Moussa, à l’hôtel, le commissaire a débarqué pour vérifier nos identités : on est sous surveillance. On a tenu à y aller sans reproduire les images Unicef — il y a d’ailleurs un sponsoring Unicef de fou. On a été rencontrer les pêcheurs qui vivent autour, qui sont pour la plupart rohingya mais ne le revendiquent pas. Un reportage comme ça, c’est 3 000 euros, sur lequel on ne vendra rien. Il y a plusieurs explications à ça : ça avait été très couvert pendant la crise des réfugiés et on est arrivés après.
Depuis quatre ans, vous couvrez les luttes sociales ensemble. L’année 2016 est une année importante : mobilisations contre la loi Travail, démantèlement de Calais et meurtre d’Adama Traoré. Avez-vous noté une évolution, comme photographes, sur le terrain ?
« Nos pratiques ont évolué puisqu’il y a une judiciarisation et une répression plus importantes sur les manifestants comme sur les photojournalistes. »
NnoMan : On a dû adopter des réflexes de protection et de défense qu’on avait un peu moins avant. On a vu arriver plein de journalistes casqués — nous portions les nôtres depuis 2013 car il y avait déjà ponctuellement des manifestations qui dégénéraient. À Calais, en 2016, on était équipés car on savait que dans des situations de grandes tensions et d’extrême détresse, l’affrontement est souvent inévitable. Mais on a un peu changé notre manière de travailler par la suite : avant, je prenais tout en photo (en sachant qu’il y aurait des trucs un peu chauds à diffuser) ; maintenant, il y a un tas de choses que je ne prends plus du tout car trop risqué dès la capture d’image : si tu te fais arrêter par les flics deux mètres plus loin, ils pourront te confisquer ta carte mémoire sans aucun scrupule. En 2015, après les attentats, a eu lieu l’une des premières manifestations interdites dans Paris ; la manif’ se fait, on passe en force le barrage des gendarmes sous les applaudissements. Je me souviens avoir fait une vidéo live des gens présents, heureux : plus tard, des personnes ont été identifiées et interpellées par les gendarmes à cause de caméras… Aujourd’hui, c’est impensable pour moi de faire un live pendant une manifestation interdite. Notre travail évolue avec cette notion de sécurisation des manifestants et des manifestantes : mes disques durs ne sont plus chez moi et quand j’en utilise un, je prends des précautions, je me déconnecte d’Internet.
Julien Pitinome : Nos pratiques ont évolué puisqu’il y a une judiciarisation et une répression plus importantes sur les manifestants comme sur les photojournalistes — encore plus quand ils sont indépendants. Ça force à se demander : comment tu peux faire des images en étant le plus safe possible ? Dans le Nord, j’ai presque carte blanche car les gens savent que je ne vais pas les mettre en galère. Et ça sert aussi quand certains se font défoncer par les flics. Le 31 mars 2016, pendant la loi Travail, un mec qui s’appelle Florian est allé à la manif’ le matin ; tombé dans un coupe-gorge, tout le monde se met à courir et lui se fait défoncer par quatre policiers locaux. Les photos que j’ai faites ont tourné partout car c’était de la violence à l’état pur. Mais l’enquête de l’IGPN ne les a condamnés à rien du tout parce qu’il n’y avait pas la photo avec la matraque qui touchait la tête… Se sécuriser, donc, mais aussi sécuriser nos productions, et se sécuriser entre nous : on a Œil, on a Fumigène, mais on connaît, professionnellement ou amicalement, plein d’autres photo-journalistes indépendants — et pas seulement. Si un photographe de la Meute est en galère, on va le chercher ! Le 14 juin de la même année, lors de la manifestation qui a complètement dégénéré à Paris (la presse n’a parlé que de l’hôpital Necker), un mec se prend quelque chose dans la nuque et tombe, un autre se fait taper par les flics et tombe : qui s’occupe de ces blessés ? Ce sont les quelques photographes indépendants qui étaient là ! Jusqu’à ce que d’autres prennent le relais.

[Marge d’une manifestation à Lille, 31 mars 2016 | Julien Pitinome | Collectif Œil]
NnoMan : Quand on ramène des photos de violences policières et qu’on entend le soir à la TV qu’il y a eu cinq policiers blessés contre un manifestant, on sait que ces chiffres ne sont pas possibles : nous, on a les photos. On peut nous répondre que notre position de photographes militants et « engagés » biaise. Mais quand, à nos photos, s’ajoutent le live apolitique de Brut et les photos de tout le monde… La multiplication des sources est importante — même si ça ouvre aussi la porte à plein de médias conspirationnistes d’extrême droite, qui filment le chaos et dépolitisent la question pour montrer des débordements…
Ce souci constant de protéger les manifestants doit grandement restreindre la possibilité de vendre vos clichés. Comment concilier l’éthique militante et la nécessité de gagner son pain ?
NnoMan : On n’en vit pas. Deux jours par semaine, je suis surveillant en lycée. La dernière fois que j’ai vendu une photo, ça remonte… On ne veut pas vendre à n’importe quel prix. Surtout que le prix de la presse aujourd’hui, sur le Web, c’est 30 euros ! Il est hors de question de me faire 30 euros bruts sur une photo qui va à l’encontre de mes valeurs. Avec le Collectif Œil, on a fait le choix de limiter certains médias à la diffusion ; avec une seule photo, tu peux dire tout et son contraire : quand tu fais une photo du seul point d’eau à Calais où plus de cinq mille personnes s’abreuvent, que tu la fais pour dénoncer et que cette photo arrive dans un journal qui pourrait titrer « De quoi se plaignent les réfugiés, ils ont de l’eau courante dans la jungle ! », c’est inenvisageable. Alors on verrouille et ça a un coût financier évident. Je connais des photographes de presse qui me disent en off : « On adore ce que vous faites, la ligne est claire, on aime le ton et vos photos, mais on ne peut pas vous liker sur Facebook pour ne pas laisser de trace de notre soutien à votre travail. » Ce sont parfois des personnes que j’estime qui peuvent me dire ça, mais qui ont peur que leur « neutralité » soit remise en cause. On en est là. Mais on a la conscience tranquille : je n’ai jamais eu peur de croiser quelqu’un qui me dise « Tu m’as pris en photo, il y a un problème ». Ce prix qu’on paie, c’est aussi pour ça qu’on peut se balader dans un bloc de mille personnes cagoulées sans l’être nous, et qu’il nous arrive peu de choses.
Nnoman, vous suivez depuis le début la lutte du comité Adama, personnifiée par sa sœur, Assa Traoré. Comment envisagez-vous le combat que porte cette femme que l’on voit s’affirmer politiquement dans vos photos ?
« Nuit Debout aura permis à certains de comprendre dans leur chair ce que c’est que de prendre un coup de tonfa. »
NnoMan : Un soir, à Nuit Debout, Amal Bentounsi était venue s’exprimer — son frère a été tué par une balle de policier tirée dans le dos, en 2012 : quand elle parlait en évoquant les violences policières, des gens — des militants blancs de Paris, de gauche — faisaient le geste de tourner les mains afin que la parole soit abrégée. C’était rare d’entendre une histoire comme la sienne : on était choqués. Depuis la mort d’Adama, des centaines, voire des milliers de gens, ont réussi à mettre des images sur les violences policières dont on n’entendait pas parler, qui étaient un mythe pour les manifestants parisiens. Nuit Debout aura permis à certains de comprendre dans leur chair ce que c’est que de prendre un coup de tonfa, de réaliser que ça touche les quartiers depuis des années. Si j’étais un peu mauvais, je dirais : tant mieux — ton bleu va disparaître, mais la violence, elle, reste. Assa a fait ce travail extraordinaire de parler à presque tout le monde, de s’adresser à toutes les instances ; aujourd’hui, quand tu parles à des syndicalistes, ils ne peuvent plus ignorer cette violence-là.
Julien Pitinome : C’est qu’elle s’impose aussi ! Le comité a pris la tête du cortège en mai 2018, lors d’un mouvement social important. Les quartiers n’étaient plus relégués ! On ne peut donc plus ignorer ce qu’il s’y passe ! Le malheur de la mort d’Adama a fait passer quelque chose médiatiquement et dans la conscience collective — il n’y a pas que le comité Adama qui a permis ça, évidemment, mais ça a été un tournant.

[Marche à Beaumont, une année après la mort d’Adama Traoré, 2017 | NnoMan | Collectif Œil]
NnoMan : Historiquement, quand des groupes essayaient de prendre la tête de cortège, les syndicats et les partis de gauche se battaient pour l’empêcher. Quand le comité Adama a annoncé qu’il prendrait la tête, personne n’a osé le remettre en question. Il y avait cette banderole « C’est nous le grand Paris », phrase tirée d’une chanson de Médine, et c’était vraiment ça. Assa a cette force. Malheureusement, on voit que, deux ans après, malgré tout le travail extraordinaire qu’elle fait, ça n’avance pas assez vite. On aimerait voir tout le mouvement social se mobiliser quand un CRS touche un jeune des quartiers ou un étudiant. Et Gaël Quirante [secrétaire départemental de SUD Poste 92, ndlr] a raison : quand des flics viennent déloger des étudiants de Nanterre qui veulent juste avoir une place en fac, ce sont des ouvriers de partout qui devraient venir. Dans les usines, il y a beaucoup de gens des quartiers. Il suffit de fréquenter les piquets de grève pour réaliser combien on est loin de l’imaginaire que j’avais moi-même il y a encore quelque temps : une gauche blanche et masculine. Sur les piquets de La Poste, de la SNCF ou d’Air France, on voit des gens des quartiers, des Arabes, des Noirs, des femmes. Le mouvement syndical représente aussi les quartiers. Mais tout ça devrait s’imbriquer avec beaucoup plus de force — ce que fait Assa ne marche pas à cause de ceux qui freinent en face.
Nnoman, parmi les nombreuses photos que vous avez prises du comité Adama, il y a celle de la mère d’Adama Traoré, « Tata ». Racontez-nous cette image.
« On n’invente pas la photo engagée ni la photo militante : notre travail a été nourri par des plus anciens. »
NnoMan : C’est à la marche, un an après la mort d’Adama. On est entre Champagne et Beaumont, où il habitait. Tout devant, en violet, la maman d’Adama a le poing levé. On a quelques photos des proches qui sont en larmes, en deuil, mais les images qu’on veut véhiculer sont plutôt celles de la force qui se dégage des quartiers populaires, la force de ceux qui se mettent en mouvement. Dans 10, 20 ou 30 ans, elle ne sera plus une simple photo de presse, elle pourrait devenir symbolique — comme cette photo de Winnie Mandela qui lève le poing devant la prison. Une maman qui arrive, malgré l’assassinat de son fils, malgré l’emprisonnement d’un autre fils, malgré les perquisitions, à être au-devant d’une manifestation le poing levé, c’est fort. À vivre, c’était tout aussi intense. Quand j’étais plus jeune, je me faisais souvent contrôler par les flics dès que je montais sur Paris. Ça ne me paraissait pas normal, mais en y faisant attention, beaucoup de contrôles auxquels j’assistais concernaient des Noirs ou des Maghrébins. On n’invente pas la photo engagée ni la photo militante : notre travail a été nourri par des plus anciens. En fréquentant des personnes comme Almamy Kanouté ou Samir Baaloudj, le cofondateur du MIB, on prend conscience d’un héritage colonial. Dans les années 1980, tu trouveras les mêmes photos de manif’ contre les violences policières, pour l’exigence de logements décents pour tous… C’est là qu’on regrette que le MIB n’ait pas réussi à faire cette transmission si importante : ça explique le désert politique sur ces questions.
Kapuscinski, le reporter polonais, convoquait « les faits authentiques, les personnes authentiques, les événements authentiques ». Et ajoutait : « Puisque la langue journalistique ne peut pas nous raconter les couleurs, les ambiances, la lumière, j’ai décidé d’écrire ce que l’on pourrait appeler la limite du descriptible en utilisant tous les moyens littéraires qui nous permettent d’approcher la réalité en nous montrant sa richesse. » Comment ceci se traduit-il en photo ?
Julien Pitinome : En acceptant l’esthétisation du travail qu’on peut faire. Mais les luttes aussi s’esthétisent ! Quand t’as des fumigènes qui crament, ce n’est pas toujours pour alerter des gens ! Le pas de côté, c’est aussi, pour nous qui tentons de vivre de nos productions, d’accepter qu’on fait de l’art.
Dans le dernier numéro de la revue États d’urgence, vous rencontrez une femme âgée qui s’occupe d’animaux en difficulté, cela malgré ses maigres moyens. Ce reportage est un peu à part dans le numéro. Comment êtes-vous arrivés à ce sujet ?
Julien Pitinome : Cette dame, Christine, m’a dit : « C’est moi, l’état d’urgence. » Il y a des gens qui mettent leur vie en bascule : c’est son cas. Elle a été obligée de vendre la ferme suite au suicide de sa demi-sœur, et les droits de succession sont faramineux… Elle vit dans des conditions matérielles des années 1950. J’ai des photos de la chambre de sa demi-sœur : il y a 25 urnes de chiens ! Pendant presque un an, je suis venu la voir tous les mois — et je vais y retourner encore. Des liens forts se sont créés. C’est une lutte individuelle qui se greffe à une lutte plus globale : il y a peut-être des centaines d’autres personnes qui viennent en aide à des animaux en France. La temporalité de ce reportage est autre, il y a quelque chose qui pourrait paraître plus léger mais qui ne l’est pas.

[« Les écuries du dernier recours », 2018 | Julien Pitinome | Collectif Œil]
Nous sommes actuellement en plein mouvement social, celui des gilets jaunes. Un mouvement, on le sait, qui tranche avec les cortèges habituels… Vous avez couvert des manifestations parisiennes ainsi que des piquets de grève dans le nord de la France. Vos ressentis ?
NnoMan : Je ne suis pas encore très à l’aise dans les manifestations des gilets jaunes. C’est hors cadre, ça bouleverse beaucoup de codes et rassemble des gens tellement différents que, malgré le bordel que ça crée, je ne me suis jamais senti ni en confiance, ni exalté par ce que je voyais se dérouler devant moi. Je me suis senti neutre dans ce que je prenais en photo, entouré de gens habillés en treillis militaire et chantant la Marseillaise. Je faisais mes photos en me concentrant sur mes réglages, en réfléchissant à mes angles. Le seul moment où je me suis senti en confiance, c’est sur la dernière que j’ai couverte, quand un cortège de l’intergare des cheminots s’est mis à clamer des chants en référence à la lutte des classes, aux inégalités… La présence de l’extrême droite est forte et réelle : on entend de nombreuses références patriotiques. Chez les vieux, chanter la Marseillaise signifie autre chose, de plus fort peut-être, de différent, mais quand tu as une trentaine de jeunes à moitié cagoulés qui ont les bras en l’air et la chantent, tu comprends bien que ce ne sont pas des camarades. En discutant, beaucoup se disent apolitiques… mais s’interrogent sur la pertinence de Marine Le Pen.
« Il y a donc de tout : des chômeurs, des précaires, des étudiants, des retraités, des cadres, mais aussi des gens avec des affiliations politiques extrêmement louches — des royalistes, etc. »
On n’est pas face à des frontistes acharnés, mais, par exemple, j’ai discuté avec des jeunes blancs de quartier, prolos, du 91 : c’était leur première manif’, ils n’avaient pas suivi celles sur la loi Travail, mais là, c’en était trop pour eux, ils sont descendus dans la rue. J’ai trouvé leur discours plutôt bien. Mais juste avant de se dire au revoir, je leur ai demandé s’ils avaient voté ; l’un d’eux me répond : « On s’en fout un peu, mais tu connais, Marine for life. » En tapant sur son cœur. Son pote enchaîne avec « Quitte à se faire enculer, autant se faire enculer par elle ». On retrouve chez certains ce champ lexical hyper homophobe et viriliste. Malgré tout ça, il y a une force chez les gilets jaunes qui est indéniable. Mais j’ai pour le moment du mal à me positionner… Je garde l’espoir que les gens en souffrance se connectent au mouvement social actuel, et réalisent que leur souffrance au travail est liée à un système de dominations qu’ils pourraient rompre par la grève générale.
Julien Pitinome : Je suis parti en reportage pour L’Huma à Dunkerque, sur un piquet, puis j’ai couvert deux mobilisations à Lille. Pour une fois, ce n’est pas porté par un syndicat ou un parti, donc plus de gens peuvent s’identifier. Il y a de tout : des chômeurs, des précaires, des étudiants, des retraités, des cadres, mais aussi des gens avec des affiliations politiques extrêmement louches — des royalistes, etc. Ils cohabitent en se disant qu’après tout, peu importe d’où ils viennent, ils se mettent ensemble. Ça questionne, ça a ses limites. Un mouvement qui part du « peuple » au sens large, c’est intéressant. Maintenant, on doit être super vigilants. Tu ne sais pas à qui tu as affaire en faisant ton travail de photographe. La situation que les classes moyennes vivent, et expriment à travers les revendications des gilets jaunes, c’est une question qui se pose depuis vingt ou trente ans dans les quartiers — où la question de la survie s’est déjà installée. Quelque chose qui part des centre-villes ne touchera pas forcément des gens des quartiers populaires dans cette forme de mobilisation. Dans les quartiers, les gens soutiennent mais se mobilisent peu.

[Mobilisation des Gilets Jaunes à Paris, 2018 | NnoMan | Collectif Œil]
Pour finir : quelles images, croisées durant l’enfance ou l’adolescence, ont pu contribuer à nourrir le travail photographique que vous menez ?
NnoMan : Question difficile ! Je me souviens d’une photo de Robert Capa, celle du soldat qui se prend une balle et tombe. Dans la chambre de mon oncle il y avait cette photo, avec une phrase qui disait « L’armée recrute ». Ça m’avait marqué. Plus tard, j’ai croisé les photos de Tian’anmen — l’homme devant le char… Puis une autre photo m’a marqué, au collège : les tours du World Trade Center dans mon manuel d’histoire-géographie. J’avais envisagé de la découper pour la vendre en pensant que dans dix ou vingt ans, cette photo allait coûter cher puisque les tours n’existeraient plus ! (rires) Après, j’ai compris qu’il y avait des images partout et que ça ne vaudrait rien…
Julien Pitinome : Je n’ai pas de souvenirs extrêmement précis, mais j’ai été très marqué, gamin, par les campagnes de pub de Benetton ! Des campagnes souvent fortes, très provoc’. Plus tard, il y a eu la photo de la jeune fille, Kim Phuc, qui court nue recouverte de napalm au Vietnam. Et pour le côté esthétique : Jean-Paul Gaultier.
Et vous l’avez eu à quel âge, votre premier appareil ?
« En 2006, j’étais lycéen, contre le CPE : je me suis aperçu du décalage entre ce que les médias montraient et ce que la lutte concrète représentait pour nous. »
Julien Pitinome : 12 ans. Puis j’ai mis ça de côté. La photo telle que je la pratique aujourd’hui s’est construite par mon passé de travailleur social : animateur dans le nord de la France, né à Roubaix, grandi à Tourcoing. On ne nous donnait pas la parole, il s’agissait donc de créer des espaces pour parler. La photo était un bon biais. Je tente maintenant de vivre seulement d’elle, et plus largement de la réflexion et de la pratique des médias telles qu’on les aborde avec le Collectif Œil ou le LABO 148, un projet que je coordonne dans le Nord. L’idée, c’est de se dire qu’on peut faire des images avec n’importe quoi. On a des téléphones : ce ne sont pas seulement des outils de consommation. Je fabriquais mes modeleurs de lumière de flash avec des bols en inox : c’est comme ça qu’on a appris ! On vient du Do It Yourself — c’est le résultat qui va compter.
NnoMan : Je fais de la photo depuis que j’ai 17 ans — j’en ai 30. J’ai commencé beaucoup plus jeune avec des appareils jetables et, avec mon frère, on voulait créer un magazine sur les graffitis. On faisait des photos dès qu’on voyait des RER graffés (on en voyait plus à l’époque que maintenant)… On ne l’a jamais fait, ce magazine, mais on a toujours les photos. À 17 ans, je me suis mis à l’argentique avec un appareil que mon grand-père m’avait offert — c’était un passionné mais assez mauvais photographe. J’ai ensuite voulu articuler la photo avec mon militantisme. En 2006, j’étais lycéen, contre le CPE : je me suis aperçu du décalage entre ce que les médias montraient et ce que la lutte concrète représentait pour nous, notamment en termes de violence policière. Puis j’ai rencontré Julien et quelques autres personnes, et plutôt que de se prévenir par textos des rassemblements et manifestations, on s’est assis autour de la table, on a dit qu’il fallait faire plus fort : on a créé le Collectif Œil.

[Calais, novembre 2016 | NnoMan | Collectif Œil]
Photographie de bannière : Julien Pitinome | Collectif Œil
- Les photographes Léo KS et Maxwell Aurélien James sont également membres du Collectif Œil.[↩]
- Moussa Ibn Yacoub est un humanitaire, incarcéré au Bangladesh en 2015 et libéré en 2016.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Gilets jaunes : carnet d’un soulèvement », décembre 2018
☰ Voir notre portfolio « Jaune rage », Cyrille Choupas, novembre 2018
☰ Lire notre témoignage « La révolte des cheminots », novembre 2018
☰ Lire notre témoignage « Montrer que la lutte paie », juillet 2018
☰ Lire notre entretien avec le Comité Adama : « On va se battre ensemble », mai 2018
☰ Lire notre entretien avec Saïd Bouamama : « Des Noirs, des Arabes et des musulmans sont partie prenante de la classe ouvrière », mai 2018
☰ Lire notre entretien avec Assa Traoré : « Allions nos forces », décembre 2016
☰ Lire notre entretien avec Almamy Kanouté : « Il faut fédérer tout le monde », juillet 2015