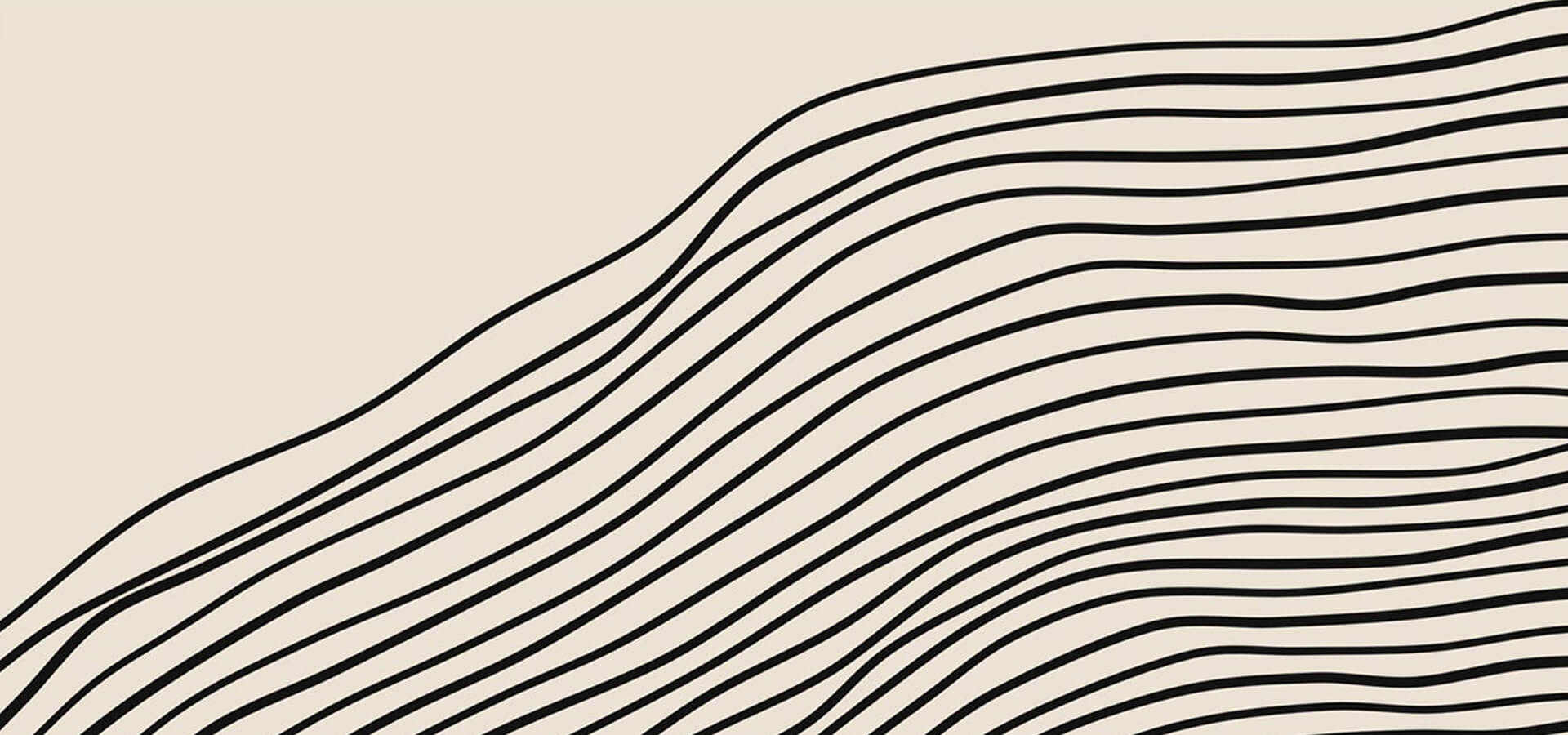Texte inédit pour le site de Ballast
Un chiffre : entre la session 2019 et 2020 du concours d’enseignant en lycée professionnel, le nombre de candidats a diminué de 20 %. Une déclaration : en visite la semaine dernière dans un lycée professionnel d’Indre-et-Loire, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a loué « les ressources humaines, l’épanouissement des personnels, le bonheur au travail ». Entre les deux : un fossé. Celui d’un quotidien réellement vécu, que la communication du pouvoir enjambe toute honte bue. Hugues Fardao, professeur de lettres dans un lycée polyvalent normand jusqu’à cette année, a choisi de démissionner pour protester contre ce qu’il appelle la « francetélécommisation de l’Éducation nationale » et « la casse du service public ». Si certains enseignants continuent de miser sur la lutte syndicale ou politique, il estime, lui, n’être plus en mesure de surmonter les contradictions éthiques et professionnelles imposées par le ministère. Une décision difficile qu’il nous raconte.
 L’École républicaine signifie beaucoup pour moi : c’est l’idée que le savoir permet de s’émanciper, de se libérer. Parce qu’on appréhende mieux le monde qui nous entoure quand on sait des choses et que ce savoir est accessible et universel. Dans le même temps, je suis partisan de George Steiner lorsqu’il explique que la culture ne peut pas vaincre la barbarie — mais au moins, on essaie. Ça ne fait pas de moi un idéaliste, dans la mesure où l’expérience face aux élèves et dans la vie quotidienne met à nu les problèmes d’accès au savoir, ainsi que l’inégalité des capacités de chacun. J’ai moi-même mes limites : je sais que je ne peux pas faire telles ou telles études ni accéder à un certain niveau. Il faut cependant offrir les meilleures conditions d’accès . « Croyant laïc », alors, certainement. On ne peut pas faire de miracles mais on doit avoir la foi. J’ai la conviction inébranlable qu’on peut améliorer l’être humain par la culture et les connaissances, parce que ça le rend meilleur, et par « ça le rend meilleur » j’entends : parce qu’il analyse l’univers et sa relation aux autres de façon plus précise. On sait que ce n’est pas l’intelligence qui donne accès au langage, c’est le langage qui développe notre intelligence — de intellegere : comprendre. Le langage, lui, se développe par le contact avec l’autre, la lecture, l’apport de nouvelles connaissances. On ouvre l’élève à l’autre, à la différence, on lui permet de relativiser et de juger plus justement. Il serait vaniteux de croire que le prof fait tout : un élève qui refuse de travailler un minimum ne va pas aller loin. Mais on a une part de responsabilité dans ce qu’il devient. Et puis, parfois, il y a un déclic.
L’École républicaine signifie beaucoup pour moi : c’est l’idée que le savoir permet de s’émanciper, de se libérer. Parce qu’on appréhende mieux le monde qui nous entoure quand on sait des choses et que ce savoir est accessible et universel. Dans le même temps, je suis partisan de George Steiner lorsqu’il explique que la culture ne peut pas vaincre la barbarie — mais au moins, on essaie. Ça ne fait pas de moi un idéaliste, dans la mesure où l’expérience face aux élèves et dans la vie quotidienne met à nu les problèmes d’accès au savoir, ainsi que l’inégalité des capacités de chacun. J’ai moi-même mes limites : je sais que je ne peux pas faire telles ou telles études ni accéder à un certain niveau. Il faut cependant offrir les meilleures conditions d’accès . « Croyant laïc », alors, certainement. On ne peut pas faire de miracles mais on doit avoir la foi. J’ai la conviction inébranlable qu’on peut améliorer l’être humain par la culture et les connaissances, parce que ça le rend meilleur, et par « ça le rend meilleur » j’entends : parce qu’il analyse l’univers et sa relation aux autres de façon plus précise. On sait que ce n’est pas l’intelligence qui donne accès au langage, c’est le langage qui développe notre intelligence — de intellegere : comprendre. Le langage, lui, se développe par le contact avec l’autre, la lecture, l’apport de nouvelles connaissances. On ouvre l’élève à l’autre, à la différence, on lui permet de relativiser et de juger plus justement. Il serait vaniteux de croire que le prof fait tout : un élève qui refuse de travailler un minimum ne va pas aller loin. Mais on a une part de responsabilité dans ce qu’il devient. Et puis, parfois, il y a un déclic.
« La goutte d’eau, c’est la perte de sens de mon métier. La réforme pour une
École de la confiance, c’est un rouleau compresseur qui nous tombe dessus. »
Mais là, la goutte d’eau, c’est la perte de sens de mon métier. D’ordinaire, à chaque réforme, on prend ce qui marche et on laisse le reste, selon les classes, les niveaux ou notre pédagogie. On amortit le choc, on protège les élèves en faisant ce qui nous semble bon, avec l’expérience de ce qui fonctionne ou non. Mais la réforme pour une « École de la confiance », c’est un rouleau compresseur qui nous tombe dessus : ça verrouille tout, c’est imposé dans l’urgence et sans concertation. C’est une réforme profondément inégalitaire. Le choix libre et varié vanté par le ministre, c’est faux ! Tous les lycées n’offrent pas les mêmes spécialités. Si vous habitez dans une grande ville, pas de problème, mais les lycées de province n’ont pas toutes les matières : il faut donc que l’élève aille étudier loin de chez lui. Ce sont des coûts pour les familles modestes. Des lycées d’une même ville mutualisent les matières et les élèves circulent d’un établissement à un autre avec souvent des difficultés matérielles — tant pour eux que pour l’administration. Pour la DRH1 du rectorat, rien de choquant : ils ont une petite carte devant eux et se disent que les gens peuvent bouger. Non ! Pas toujours. Il y a des disparités énormes et des difficultés sociales incroyables qui entravent l’accès à l’éducation : le grand qui garde ses frères et sœurs car l’unique parent travaille tard, l’internat qui coûte cher, le manque d’informations des parents… et tant d’autres problèmes ! Avec la désorganisation complète mise en œuvre actuellement, c’est pire.
Alors oui, la présentation de la réforme est parfaitement mensongère. D’un point de vue pratique, pour les enseignants, c’est sans compter les contrôles en cours de formation dont nous n’avons pas encore les barèmes — pratique, pour organiser les bacs blancs ! — ou les attendus de Parcoursup pas encore dévoilés. Ou bien les professeurs principaux qui deviennent de fait des conseillers d’orientation… 1 000 tracas qui prouvent la totale précipitation du ministère et son mépris envers les enseignants et les élèves. Et comme tout arrive en même temps, on ne sait plus comment lutter. C’est un mur incroyablement épais dont chaque brique de non-sens est soudé par le ciment du mépris — en bonus, l’ignorance du public, au mieux ; sa haine anti-profs, au pire. C’est à pleurer de rage, quand on croit dur comme fer à l’instruction, de se rendre compte que les pauvres vont morfler comme pas possible, encore plus qu’avant, avec en plus le sourire de façade du ministre et l’appui béat et hypocrite des inspecteurs. Car le corps d’inspection censé nous aider est de plus en plus… doit-on dire « inutile » ou « impuissant » ? En tout cas, il ne sert plus que de rouage : il transmet la réforme, c’est tout.

[DR]
À mon niveau, je me sens bloqué. Si je dévie de la route tracée par les programmes de français, les élèves ne seront pas préparés à l’épreuve, laquelle est désormais assez cadrée. Or le programme de français au lycée technologique est costaud, depuis la réforme, mais on n’a pas plus d’heures… On a le double de livres à faire lire aux élèves, de la grammaire, plus les textes complémentaires habituels — mais avec trois heures par semaine en Première techno et quatre en Première générale. C’est du gavage, il n’y a pas d’autre mot. On veut aborder la littérature en faisant réfléchir les élèves, en travaillant les textes… C’est ce qu’on nous demande officiellement : faire lire, faire aimer la lecture, que les élèves s’approprient les textes, qu’ils tiennent un journal de lecture. Las !… L’institution se moque de nous : nous sommes contraints par le temps d’avancer à marche forcée dans les parcours imposés par le programme. Parcours qui, parfois, sont débiles : travailler, par exemple, la relation maître/valet dans Le Mariage de Figaro, c’est stupide tant cette œuvre est riche de subversion et représente l’esprit des Lumières. L’impossibilité de réellement travailler les œuvres, comme on le faisait depuis des années, est criminel. On a l’effet d’annonce « Super programme, plus de français, applaudissez le bateleur-ministre ! », et, dans le même temps, le même volume horaire pour trois fois plus de choses à voir avec les élèves. C’est méprisant. Je refuse d’en être complice. Bien entendu, les meilleurs réussiront sans l’aide des profs, s’adapteront, auront leur culture personnelle et/ou familiale pour les aider. Les autres ? Je n’ose pas y penser.
« La
confianceannoncée par le ministre est orwellienne puisqu’on cadre de plus en plus les profs, qu’on se méfie de leur liberté, tant pédagogique qu’intellectuelle. »
Une démission collective conduirait simplement à recruter des contractuels en masse. Je ne crois pas à un soutien massif de la société. Il y a déjà des décrets autorisant le recrutement d’étudiants à temps partiel, dès la deuxième année universitaire. Ça veut dire que tout le monde peut être prof, du moment qu’on suit comme un mouton le programme et les directives. La « francetélécommisation » de l’Éducation nationale, ça vient. Comment s’établit la mainmise managériale chez nous ? Le ministre applique les règles de grammaire et de rhétorique qu’on trouve explicitées dans 1984 d’Orwell. Je sais que c’est une comparaison usée jusqu’à la corde, souvent exagérée et perdant donc de son efficacité ; soyons donc précis : si on pointe spécifiquement le langage utilisé dans le roman d’Orwell, on a une correspondance. Il s’agit d’utiliser des antithèses. Dans le livre, « La guerre c’est la paix » et on maquille les événements politiques : la vérité devient relative. La « confiance » annoncée par le ministre est orwellienne puisqu’on cadre de plus en plus les profs, qu’on se méfie de leur liberté, tant pédagogique qu’intellectuelle, et qu’on bloque leur parole lorsqu’ils veulent faire remonter les faits depuis le terrain. Le fameux « pas-de-vague ». Or nous sommes tout de même des universitaires ou, pour les profs de matière technique, des professionnels ; nous sommes tous, de ce fait, tout à fait légitimes pour imposer notre point de vue en tant que connaisseurs, spécialistes. Mais cette légitimité est niée.
Il y a une infantilisation — encore au sens latin infans : qui ne sait pas encore parler — de la profession par l’institution. Nous sommes détenteurs d’un savoir critique, et ce savoir analytique, nous entendons bien le partager avec les élèves. Pour en faire quoi ? Des citoyens ! Et que veut le ministère ? Il nous demande de faire de nos élèves des citoyens mais nous refuse le savoir critique : c’est insensé. Parallèlement, on accable les enseignants, surtout les profs principaux, de tâches qui n’ont rien à voir avec leur travail — elles étaient assurées par des agents administratifs ou des copsys2. Les recteurs, eux, gèrent des flux : ils ne pensent plus à l’humain. Cette attitude se propage dans les rouages de la machine, et l’institution se déshumanise. Or nous, profs, sommes confrontés chaque jour aux rapports humains et sociaux. Mais la hiérarchie nie la possibilité de ces rapports sociaux à notre échelle ; elle nie que nous soyons capables de les appréhender — alors que nos études nous ont donné les outils intellectuels, didactiques et culturels pour le faire. La négociation par la parole entre les citoyens qui constituent le peuple et l’acceptation à consentir à des efforts pour le bien commun, c’est pourtant la base de la démocratie et de notre République.

[DR]
Mes collègues sont dégoûtés. Mais comment partir ? Certains ont des enfants étudiants, il faut payer les études, les appartements. D’autres sont très proches de la retraite, ils pensent tenir le coup. Et s’ils partent maintenant, à quoi cela servirait-il ? D’autres ne savent pas quoi faire comme métier à part prof. D’autres restent pour lutter… Mais tous sont effondrés. Et puis la peur de pénaliser les élèves est très présente : beaucoup d’enseignants n’ont pas fait grève en juin dernier par crainte de faire du mal aux futurs bacheliers. Il ne faut pas juger l’inaction. Les collègues sont aussi blessés par les injonctions à la veille des corrections d’examens : avoir la moyenne, surnoter — en LVE3, c’est flagrant —, avoir le sentiment de brader le bac. On reproche aux lycéens leur manque de travail ? Le signal vient d’en haut ! D’un autre côté, avec la réforme, les exigences de certaines matières, comme en mathématiques ou en français, vont monter d’un cran. Il y aura de la casse. Va-t-on accepter au ministère de voir les résultats du bac s’effondrer ? J’en doute fort. Une belle façade pour le public, un décor en ruines en coulisses pour les enseignants. Pas facile de se motiver pour monter sur scène et représenter la farce. Quant aux symboles républicains affichés : joli, mais nous on veut du marbre, pas du stuc.
« C’est une logique comptable qui préside au regroupement de filières et à la baisse des horaires. »
La voie professionnelle est, elle aussi, une catastrophe. J’ai travaillé un an en lycée professionnel, en 2005/2006, et mon lycée actuel est un lycée polyvalent qui accueille autant d’élèves en général et technologique qu’en professionnel. On croise nos collègues du LP4 chaque jour et on échange avec eux. Il y a encore 10 ans, le bac professionnel s’obtenait en 4 ans : deux ans de BEP5, puis deux ans de bac pro, et les élèves sortaient avec de l’expérience, un âge un peu plus avancé et plus de maturité — et ils savaient bosser. Puis on est passé à 3 ans : Seconde, Première, Terminale pro. Encore une fois la novlangue orwellienne était là : « C’est pour faire comme le bac général ou techno, en 3 ans, tout pareil, pas de discrimination, on revalorise le bac pro. » « Revaloriser », dans le langage : « casse », en réalité. Typique. Parce que bien entendu, tu vas apprendre en 3 ans ce qu’on apprenait en 4 ! Et cette année les matières générales sont littéralement et exactement amputées de moitié. Le LP va fabriquer des pousse-boutons. C’est scandaleux. Ajoutons à cela la Seconde pro qui regroupe désormais des classes par filière, avec plus d’élèves par classe… Quand on connaît certains publics difficiles au LP, c’est incroyable ! En réalité, c’est une logique comptable qui préside au regroupement de filières et à la baisse des horaires. Le but du LP, normalement, c’est d’avoir des ouvriers qualifiés qui pourront évoluer dans leurs entreprises, ou d’avoir de bons élèves qui seront motivés par le BTS6.
Et puis le mépris, encore et toujours le mépris. Les élève du LP n’ont donc plus besoin de français ou d’histoire-géographie ? C’est épouvantable. Le LP est une chance pour des élèves non-scolaires qui peuvent se découvrir une vocation… Encore faudrait-il qu’un maximum de filières soient représentées dans chaque bassin d’éducation, ce qui n’est pas le cas. J’ajoute qu’il me semble inutile de tenir le discours de l’adéquation du bassin d’emploi de la région et de l’adaptabilité du LP à ce bassin : dans un monde en constante évolution, ouvrir une classe sur un secteur porteur ne garantit pas d’offrir un emploi aux futurs diplômés. En 3 ou 4 ans, l’offre professionnelle peut changer : que faire, alors, de ceux qui se lancent dans telle ou telle filière qui se tarie ? Arrêtons de croire que mettre de l’argent dans l’école est une dépense : c’est un investissement. Le savoir « bourgeois » — et je le dis sans être péjoratif, mais dans le sens de la culture héritée du XIXe siècle — est regardé par les classes sociales supérieures comme une chasse gardée : si le peuple s’en empare, qu’est-ce qui donnerait à ces classes supérieures la légitimité de placer ses descendants aux meilleurs postes ? Il s’agit d’une classe qui veut s’enfermer dans un entre-soi idéologique et social en verrouillant toutes les portes d’accès à l’éducation supérieure. Que veut-on partager ou non, et dans quel but ? Dans sa conférence gesticulée sur l’Éducation nationale, Franck Lepage l’explique bien lorsqu’il relate son expérience à Sciences Po : il est un excellent élève mais, issu d’un milieu très populaire, n’a pas l’attitude ou la « culture de classe » nécessaire pour réussir.
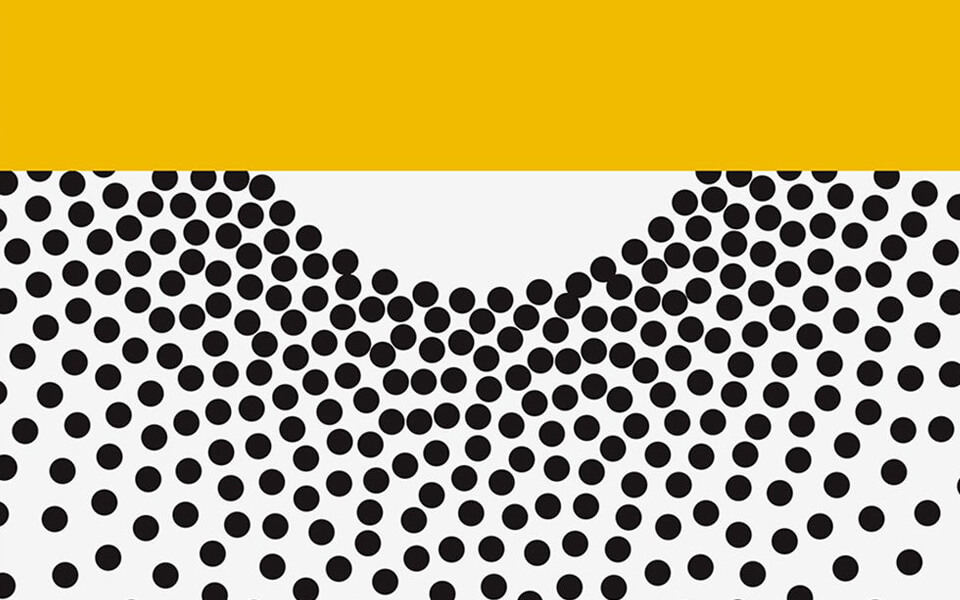
[DR]
Sur le terrain, les syndicalistes au sein de chaque établissement nous défendent becs et ongles : ils sont formidables au niveau local. Je suis plus critique quand on monte dans les hauteurs : la traditionnelle grève de rentrée ne sert à rien. Il faut un blocage massif, et là, ça heurte une pensée ancrée chez les profs : si je n’enseigne pas, qui le fera ? Les élèves perdent des heures, des jours de cours ; c’est un déchirement pour beaucoup de collègues. La mobilisation est donc difficile. D’autant qu’un gouvernement libéral attaque sur plusieurs fronts, et que la convergence des luttes est difficile avec d’autres professions. On est payés au-dessus du SMIC, on a des vacances : évidemment, on travaille, mais on a une liberté incroyable en matière d’organisation : ça ne permet pas de nous poser en malheureux devant un salarié qui trime 47 semaines par an pour 1 000 balles par mois. Alors qu’à notre échelle, vu les responsabilités, la longueur des études, le temps consacré au travail, on devrait être payés davantage : la vocation a bon dos, le ministre sait s’en servir ! Mais on peut avoir la foi et vouloir vivre décemment, ce ne doit pas être incompatible. La volonté d’appliquer à l’Éducation nationale le langage et les méthodes de l’entreprise néolibérale, vraiment, ça bousille tout.
Propos recueillis par Noé Roland.
- Directeur ou directrice des ressources humaines.[↩]
- Conseillers d’orientation psychologues.[↩]
- Langue vivante étrangère.[↩]
- Lycée professionnel.[↩]
- Brevet d’études professionnelles.[↩]
- Brevet de technicien supérieur.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Laurence de Cock : « L’enseignement de l’histoire est pris en étau », avril 2019
☰ Lire notre entretien avec Véronique Decker : « Aux côtés des élèves, jamais face à eux », septembre 2018
☰ Lire notre entretien avec Franck Lepage : « L’école fabrique des travailleurs adaptables et non des esprits critiques », juin 2015