Texte inédit pour le site de Ballast
« [T]out le sang de la famille était du sang d’usine », écrit Georges Navel dans Travaux, son premier livre. Il le révèle comme auteur au sortir de la Seconde Guerre mondiale : il a 41 ans. Son père était manœuvre dans les hauts-fourneaux, sa mère travaillait aux champs et aux bois ; le fils touchera à tout : manœuvre, terrassier, ouvrier, correcteur, apiculteur. Ami de Giono, un temps syndicaliste et toute sa vie sympathisant communiste libertaire, l’écrivain qu’il n’était alors pas encore s’était rendu en Espagne dans l’espoir d’appuyer la révolution antifasciste. Portrait d’une figure de la littérature prolétarienne. ☰ Par Roméo Bondon
 Il faut imaginer deux hommes à bicyclette, touristes en apparence, trimardeurs en vérité. Qu’on se garde de confondre.
Il faut imaginer deux hommes à bicyclette, touristes en apparence, trimardeurs en vérité. Qu’on se garde de confondre.
Nous sommes en 1939 et deux semaines de congés payés ont été octroyées trois années plus tôt aux travailleurs et aux travailleuses du pays. Parmi eux, donc, deux saisonniers qui n’en profiteront guère. Ils viennent de « [s’occuper] les bras au coltinage des cageots de tomates à Cavaillon » et s’apprêtent à « couper les lavandes d’un paysan de Saint-Saturnin-d’Apt1 » dans le Luberon tout proche. L’un s’appelle Georges Navel. Il a 35 ans. Leurs premiers tours de roue les ont menés en contrebas des reliefs, à Sault. Ils ont quelques jours devant eux. Dans leur dos se dresse cet amas calcaire qu’un poète florentin a jugé bon de gravir un jour d’avril 1336 et qu’on nomme mont Ventoux2. Dans le prolongement de celui-ci, au-devant, une montagne semblable, celle de Lure.
« Syndicaliste quelques années, communiste-libertaire sa vie durant, son investissement politique ne fait aucun doute. Mais réduire ses écrits à cela serait passer à côté de la poésie qui s’en dégage. »
Deux jours, cela devrait suffire pour saisir ce qui se trame par là-bas, en un lieu qui fait grand bruit : Contadour. « Balades, promenades, longues causeries, j’avais vécu deux jours de fêtes3 », se souviendra Navel. L’endroit avait de quoi intriguer. Depuis un jour fameux de 1935 où une marche a conduit une cinquantaine de personnes à investir le décor des premiers romans de Giono — cette montagne de Lure qui est comme la protagoniste de Colline ou Un de Baumugnes —, artistes et pacifistes s’y rencontrent chaque été et lisent, conversent, écrivent ou simplement s’abreuvent des ciels plus larges qu’offrent les pays de montagne. Un homme allègre fait ciment : il est à la fois peintre et poète, répond au nom de Lucien Jacques. Mais c’est pour la compagnie d’un autre que beaucoup se pressent à Contadour. Jean Giono fait ici figure de sage, voire de maître, à faire ou à penser, propre à dispenser ses « leçons de joie4 ». Lorsque Georges et son ami Pierre — « copain de jeunesse, de trimard5 » — arrivent à Contadour, Giono n’est pas là. La rencontre se fera plus tard. « J’étais un ami parmi ses nombreux amis6 », dira Navel — rien de plus, rien de moins. De cette amitié naîtra une courte préface. Le texte qui précède Chacun son royaume, troisième des cinq livres de l’auteur, se conclut ainsi : « Cette patiente recherche du bonheur qui est le nôtre nous la voyons ici exprimée avec une bonne foi tranquille. C’est un travail de héros grec : nous sommes dans les Travaux et les Jours d’un Hésiode syndicaliste7. » L’expression fait sourire. Elle passe néanmoins à côté de l’essentiel.
Laborieux, Georges Navel l’était à coup sûr. Syndicaliste quelques années, communiste libertaire sa vie durant, son investissement politique ne fait aucun doute. Mais réduire ses écrits au témoignage de cela serait passer à côté de la poésie qui s’en dégage et ferait peu cas de la démarche qui les sous-tendent. Si Giono a cherché dans ses premiers romans et jusqu’aux essais d’avant-guerre « les gestes premiers dans les champs et dans les villages […], dans la cour des fermes ou bien sur la place des villages quand l’après-midi d’arrière-saison est roux et un peu pâteux comme un abricot trop mûr8 », Navel a usé de ces mêmes gestes et les a incarnés avant de les décrire. Tandis que les hommes et les femmes que Giono observe sont selon ses termes des êtres « limpides », d’une pureté paysanne qui doit beaucoup aux fantasmes de l’écrivain, c’est le mot « lucide » qu’aurait employé Navel, et qu’on a employé pour lui9. Aussi est-ce un auteur en constant éveil qu’il convient de dépeindre, attentif à ses propres actes comme à ceux qu’il partage avec sa classe.
⁂
1915. La ligne de front est à quelques kilomètres, sur l’autre rive de la Moselle. On s’est battu dans la forêt non loin de la maison, celle de Maidières, là où treize enfants sont nés et dont Georges est le dernier. Les hussards passent sous les fenêtres depuis plusieurs mois et parfois les chevaux s’en reviennent sans les hommes. Devant un prunier — c’est en mai, des fleurs recouvrent le bois noir et nu — une mère, deux fils et une fille. Jeanne, main droite sur la hanche, visage rond, yeux froncés, est la plus grande. La mère a les mains jointes, semble sur le point de se remettre à l’une de ses tâches. René, presque aussi haut que Jeanne, porte les bottes des cavaliers et tient main gauche un chapeau de monsieur. Georges, le plus jeune et le plus petit, est en chemise. Main sur la hanche lui aussi, il a le pantalon trop court pour rejoindre ses chausses. Les cheveux sont ramassés sur le côté : on a pris soin de sa mise pour prendre le cliché. Dans quelques jours il rejoindra l’Algérie afin de fuir les combats. Pour l’heure, il contient l’énergie de ses 10 ans. On ne souhaite pas tirer une image floue.
⁂

[André Derain]
En la ville de Pont-à-Mousson, la Moselle incise des roches que l’on dit du Jurassique et des limons charriés sur des années en tas, que l’entendement saisit par mille. De la rivière qui traverse la ville, Georges Navel a peu parlé. Tout juste s’est-il dit surpris, un jour de 1915, à constater que sa couleur ne changeait pas lorsqu’il s’est hasardé « au point probable des lignes ennemies10 » qui s’étaient fixées sur ses rives. C’est pourtant sur ces dernières qu’il a hurlé une première fois le 30 octobre 1904, puis ri et pleuré bien d’autres encore en un village tout proche. Celui-là s’appelle Maidières, un bourg qu’on croirait hameau. Y vivent le père Pierron et sa mine de cadavre, le Victor à « la découpure d’un terrassier11 » et sa femme, la Favier, qui fait toujours bon accueil à l’arrivant. Les descriptions successives du voisinage, de Travaux à Passages, montrent une attention circulant à mesure que sont ressassés les visages scrutés au temps de l’enfance. L’année suivant la naissance de Georges voit une grève secouer la fonderie de Pont-à-Mousson. Ce sera la seule, un échec, dont le père — « droiture de citoyen, bon patriote et honnête ouvrier12 » — employé en ce lieu comme tant d’hommes à Pont-à-Mousson, ne tirera que de la résignation. La moustache de celui-ci se fronce d’un mauvais sourire quand l’aîné, Lucien, s’en revient de ses itinérances en tant que vendeur de journaux, sali par les routes mais ragaillardi par les idées entendues. Louise Michel ou Bakounine sont des noms qui sonnent tôt aux oreilles de Georges : Lucien les assène comme des arguments au père qui n’y comprend rien.
« Son temps lui paraît pauvre en événements. Voici pourtant qu’un conflit mondial s’annonce. »
Ainsi le treizième et plus petits des Navel glane-t-il les idées du moment dans les discussions familiales comme sous les tables du café. Poincaré, Briand, loi des Trois ans. Les mots sont ternes, les formulations pataudes pour un enfant qui cherche quelque émotion sur les champs de bataille de 1870. Il se languit d’une école qu’il dira avoir « détesté […] avec la même intensité que tous les lieux où il m’a fallu vivre enfermé, école, usine, caserne13 ». Son temps lui paraît pauvre en événements. Voici pourtant qu’un conflit mondial s’annonce. « La déclaration de guerre de 1914 me fit l’effet d’une miraculeuse surprise14 » et l’enfant d’aller clamer la bonne nouvelle au père qui rentre de l’usine. On songe à l’écrivain Louis Calaferte. Autre guerre, une manière de l’écrire bien différente, mais commune expérience : « Je ne sais pas ce que c’est que la mobilisation générale, mais je suis bien content que ce soit la guerre », dira de 1939 l’auteur de Septentrion. Puis, revenant à la ligne comme si les deux pensées n’avaient de lien que sur la page : « J’ai onze ans15. » Même âge ou presque et un conflit qui dure pareillement. À quelques kilomètres du village, Georges peut entendre les obus et frissonner tandis qu’ils explosent. La ligne se rapproche, puis se fixe non loin. La vie se poursuit toutefois : « Comme à l’ordinaire, les tas de fumier le long de la rue fumaient dans la froidure16 », et comme à l’ordinaire on bêche un carré de jardin car « Il faut des pommes de terre, même près du front17 ». Deux frères sont engagés, l’enfant s’interroge : « Sauf la sauvegarde du territoire national, ils n’avaient ni biens, ni propriété à défendre18. » Et Georges d’en tirer les conclusions qui conviennent à son âge : « Leur présence à l’armée me donnait le droit […] d’aller prendre quelques poires dans l’enclos d’un riche propriétaire19. » Si les bombardements sont quotidiens, les civils ne sont pas touchés. On propose néanmoins d’emmener les enfants en Algérie pour les mettre à l’abri. Georges remplit le formulaire sans en toucher mot ; le père est contre mais la mère craint les éclats de Shrapnels. Un convoi de la Croix-Rouge embarque le jeune garçon.
L’Algérie, c’est d’abord le père.
Il s’est engagé dans les bataillons d’Afrique après la défaite de 1870, en est revenu fier des galons acquis. « Il me disait des mots en arabe, me promettait d’écrire à Abd el-Kader qui m’enverrait un cheval pommelé20. » S’ajoute à ces promesses une culture coloniale quotidienne : à l’usine des Forges, on chemine du hall du Tonkin à celui du Maroc ; dans les journaux illustrés, les explorateurs font encore feuilleton. Forts de ces images, Georges est surpris par ce qu’il trouve à son arrivée. S’il n’accorde qu’une phrase à cet épisode dans Travaux, il en fera un récit détaillé dans son dernier ouvrage, Passages. À Philippeville21 où le convoi débarque, c’est la bonne société coloniale qui fait accueil — quatre années auparavant, une grève dans la ville avait vu s’agiter pour la première fois le drapeau vert frappé d’un croissant. C’est auprès d’un paysan dauphinois arrivé voici trente ans pour cultiver les terres expropriées, à Yusuf22, dans ce que l’administration française appelle alors le Constantinois, que Georges séjourne. Son souvenir le marquera durablement : pendant des années il souhaitera retrouver la lumière de l’Algérie. Mais la famille quitte Maidières pour Lyon, et voici que Georges les rejoint. Cette ville nouvelle, qu’il décrira souvent comme « acide », sera pour lui tutélaire : il y apprendra un métier et s’abreuvera de politique.

[André Derain]
⁂
1934. Des doigts gercés par le froid se saisissent de janvier et un scandale éclot de l’empoignade. Un gouvernement démissionne et ceux qui forment le suivant limogent un préfet de police. Février s’ouvre sur une émeute en plein Paris que d’aucuns disent fasciste et se clôt sur l’union des formations de gauche. Aussi, on enterre la mère à Lunéville, on convie le père à Lyon pour que ses jours finissent tranquilles. Là, devant une tapisserie de feuilles, ce dernier s’appuie sur une canne. Les moustaches tombent comme s’affaissent les épaules. À sa droite, sa fille Marguerite est un peu raide, les bras nus. À sa gauche, éloigné d’un pas de plus, se tient Georges, dont la présence soulage le vieux plus qu’un morceau de bois. Il a revêtu le pantalon de la terrasse ou du bâtiment, porte un tricot large et évasé. Des frusques dans lesquelles on l’imagine à l’aise, plus que dans l’uniforme qui lui grattait la peau quelques semaines plus tôt.
⁂
« On discute de la Révolution russe, de l’insurrection spartakiste à Berlin, et Georges lit abondamment la littérature anarchiste. »
« J’étais sans révolte, bien adapté à la condition ouvrière, heureux de devenir fort ou heureux de devenir habile23. » Un bonheur tout relatif à son ignorance, encore, des structures sociales qui conditionnent ce prolétariat auquel il appartient. Très vite, Lucien se charge de déciller le regard de son cadet. Ce sont « ces années ardentes de 1919, 1920, 1921, où bolcheviks et libertaires se sentaient frères d’aspirations et d’idées24 ». Mais le désespoir accompagne la conscience de classe : « Je ne pouvais plus vivre dans la vérité du monde que Lucien me révélait25. » Alors un voyage en guise d’échappée et c’est l’Algérie, dont le souvenir est encore marquant, qui s’offre comme horizon. Mais la route de Georges s’arrête, comme à maintes reprises, avant le lieu prévu. Une blessure le cloue deux mois dans un hôpital de Marseille où il apprend la fin de la guerre. Il rentre à Lyon et s’adonne de plus bel à ses activités, dans l’atelier comme en dehors. Il apprend le métier d’ajusteur et fréquente assidument l’Union des syndicats du Rhône qui lui donne une image tout autre du prolétariat. Si les hommes embauchés à Pont-à-Mousson lui semblaient autant d’esclaves, « les ouvriers de la grande ville pouvaient se défendre, s’unir, former une force26 » — et Georges de s’épanouir auprès d’eux. À l’Union, il suit les causeries après la journée de travail. Il a alors 14 ans. Une intervention sur Fernand Pelloutier l’impressionne, les discussions sur Francisco Ferrer et les anarchistes espagnols le passionnent. Parmi les sensibilités représentées, ce sont les groupes libertaires qui l’attirent plus sûrement — c’est derrière le drapeau noir qu’il défile le 1er mai 1919. On discute de la Révolution russe, de l’insurrection spartakiste à Berlin, et Georges lit abondamment la littérature anarchiste, comme dix ans plus tard, déçu quelque peu par la pratique libertaire, il dira lire « Marx et la littérature marxiste pour [se] réintégrer consciemment au milieu révolutionnaire27 ». Si la politique le suivra jusqu’à sa mort, au seuil du siècle suivant, Navel avouera ne s’être « jamais guéri de 191928 ».
Cette année est suivi d’un terrible contre-coup. La possibilité de la révolution s’éloigne et le travail à l’usine se fait plus rude dès lors qu’en échapper devient illusoire. Un soir, Georges se jette dans le Rhône, dérive avec le fleuve puis se relève, de l’eau jusqu’à mi-corps. Il doit repartir ou la grisaille de la ville envahira son être tout entier : « Quitter la vie, c’est un acte sérieux29. » Aussi lui faut-il attendre encore, repousser toujours cette mort avec laquelle il vivra constamment. C’est d’abord la campagne qui l’accueille, où il se fait vacher pour quelques semaines, lisant Stirner et les individualistes durant son temps libre. Là, il reconnaît, stoïque, que « le communisme-libertaire est une utopie30 » mais n’abandonne pas ses principes pour autant : la fréquentation des individualistes, au-delà de leurs écrits, à Lyon, Paris et à plusieurs reprises dans la colonie libertaire de Bascon, dans l’Aisne, l’influence mais ne le convainc pas tout à fait — « Ça n’avait rien à voir avec la transformation de la société31 », dira-t-il plus tard de ces expériences libertaires. Sa déception le mène en Algérie, où il retourne enfin. Georges veut être berger près de Yusuf, mais la misère est telle qu’il ne peut s’y résoudre. Il s’embauche à la ville, dans un atelier de réparation, s’en détourne bien vite : « Dans les pays de soleil, c’était encore plus dur d’être enfermé32. » Il ne cessera pas de chercher ce soleil, par la suite, dans ses tâches successives ou une fois celles-ci achevées. Soleil des Halles de Paris, à midi, après une mâtinée enfermé sous terre ; soleil sur la route, qu’il s’agisse de cueillir pêches et cerises ou de ratisser le sel près de Hyères ; soleil en Espagne ou à Nice, soleil près de Die où il finira sa vie à l’automne 1993. Aussi est-ce la mort dans l’âme qu’il retrouve l’usine à son retour d’Algérie, à Lyon, Paris et jusqu’à Pont-à-Mousson, dans les pas des frères et du père. S’il rêve sa jeunesse durant de s’embarquer pour des terres lointaines, s’employer sur un bateau plutôt qu’en ville, Georges voyagera finalement peu. Le sud de la France sera pour lui tous les pays jamais entrevus.

[André Derain]
Une exception toutefois. À deux reprises Georges traverse les Pyrénées pour suivre un élan révolutionnaire ou insurrectionnel. En 1925, d’abord. Le Maroc, que se partagent la France et l’Espagne, est secoué depuis quatre ans par les assauts de tribus berbères qui, après avoir mis en déroute la puissance coloniale à Anoual, ont décrété la naissance de la République du Rif dans la région montagneuse du même nom. Tandis qu’en métropole, un gouvernement de socialistes et de radicaux fait bloc contre les insurgés, le récent Parti communiste mène, selon l’historien Claude Liauzu, « la première grande campagne anticolonialiste de l’histoire de France33 ». Nul doute que Navel lit la presse, entend ses camarades échanger sur la situation. On dit que quelques Européens s’engagent avec les Rifains. Il n’en faut pas plus pour décider le jeune homme que l’aventure aiguillonne — il le confirmera ainsi dans un entretien : « [C]’était pas la cause marocaine… j’avais une sorte de vision stendhalienne, j’avais compris des trucs, vivre pour l’énergie34… » Un plan sitôt s’élabore : « Mon projet était de franchir sans passeport la frontière espagnole pour m’engager au Tercio et arriver au Maroc, de déserter pour passer du côté des tribus insoumises35. » Le train qui l’emporte longe la Méditerranée jusqu’à Perpignan, d’où il compte atteindre à pied la frontière en gravissant pour la première fois cette montagne qu’il dit « de velours sombre36 ». Dans une auberge on lui propose de rejoindre un groupe d’ouvriers forestiers. Voilà qu’il accepte : il ne verra jamais le Maroc.
« Il élève des poules, cultive, écrit. Il est alors encarté au PC, soucieux de l’organisation du mouvement révolutionnaire. »
L’Espagne une seconde fois, en 1936. Lors, « il ne s’agissait pas d’un voyage
mais d’aller là-bas pour prendre part aux combats sur les barricades37 ». C’est que des généraux ont prêté serment pour renverser le Frente popular nouvellement élu et que cela produit des soulèvements en nombre dans la péninsule. Georges, lui, vit depuis une année dans un domaine reculé du Var, près de Sainte-Maxime où sa compagne l’a rejoint. Il élève des poules, cultive, écrit. Il est alors encarté au PC, soucieux de l’organisation du mouvement révolutionnaire. S’il a tâté de l’uniforme une première fois quelques années auparavant, c’était contre son gré : insoumis depuis l’appel de sa classe d’âge, il s’est rendu en 1933 après plusieurs années dans l’illégalité. L’armée, la guerre, il n’en veut pas. Mais à l’écoute des nouvelles il n’hésite aucunement — l’enjeu est tout autre : « Il y a un pays où on fait la révolution : c’est l’Espagne. Un où elle semble être faite : c’est la Russie. Je sens qu’il est de mon devoir d’aller là où elle commence, d’être participant et témoin de l’événement38. » Il connaît le milieu anarchiste, en a côtoyé de nombreux sympathisants venus faire une saison de travail en France. Il parvient à franchir la frontière et on le conduit à la capitale catalane. « Mon impression : Barcelone, c’était vivant, exaltant même. Il faisait chaud, tout le monde se parlait, les gens dormaient peu. On avait plutôt une impression de joie, de fête. Dans les rues de la ville, on brûlait un peu d’essence, par plaisir. Des voitures sillonnaient Barcelone avec des gars juchés sur les marchepieds en levant le poing ou en agitant un drapeau noir et rouge. Il restait encore des chicanes, des restes de barricades. On ne sentait aucune terreur ambiante39. » Il condense ainsi son ressenti : « L’événement n’apparaît pas dans les choses : il est sur les visages40. » On se rappelle alors l’enfant ennuyé d’une époque sans remous. Peut-être Georges s’en souvient-il lui aussi au moment de se porter volontaire — « On était dans l’Histoire41 », osera-t-il ajouter. Après quelques jours à Barcelone, le moment vient de choisir des compagnons et une destination : ce sera Saragosse avec les anarchistes de la CNT, dans une colonne qui porte le nom d’un camarade mort aux premiers jours du coup d’État. Bien vite les manquements sautent aux yeux du jeune engagé : la nourriture est difficile à trouver, les musettes sont désespérément vides de munitions, les commandements n’arrivent pas. La désorganisation règne et Navel regrette qu’il n’y ait pas de « théorie libertaire de l’armée42 », seulement des principes vagues et peu opérants dans les situations qu’il est amené à traverser. On va de village en village, on entend les obus qui s’égrainent, quelques fusillades. Impossible d’y comprendre quelque chose. Une insolation affaiblit soudain Navel, avant qu’une gastrite ne le renvoie vers l’arrière. Il n’en reviendra pas. Après un mois et demi en Espagne il quitte définitivement le pays, contrit : « Mal en point mais non blessé, les remords ou les tourments de conscience m’agitent, j’échappe au danger avec trop de soulagement43 ». De retour en France, l’expérimentation partisane s’achève. Il démissionne du PC et reprend les routes.
⁂
1937. Voici qu’on fête, esplanade des Invalides, les « Arts et Techniques appliquées à la vie moderne ». Des pavillons se dressent — miracle qui tient à une cohorte de manœuvres — et deux bâtiments, vastes et neufs, enserrent les trois-cent vingt-quatre mètre de ferraille qui font phare et ville en même temps. L’un est surmonté d’un aigle sombre, l’autre d’un couple peu vêtu, tenant faucille et marteau. Et donc les manœuvres pour les bâtir. On voit quatre terrassiers à leur tâche sur l’esplanade. Des poutres, des piliers, des échelles et une brouette pour cadre et personnages. Chacun porte le gilet, deux ont une veste en surplus, et les mêmes sont coiffés d’une casquette. Georges, le plus grand d’entre tous, a les manches relevées et le front découvert. Dans ses mains, le bois sec d’une pelle. De ces mains, de ces camarades et de cette pelle il tient journal. Il en fera un menu récit qu’on lira bientôt dans les pages d’une fameuse revue littéraire puis, quelques années plus tard, dans celle d’une livre à son nom.
⁂
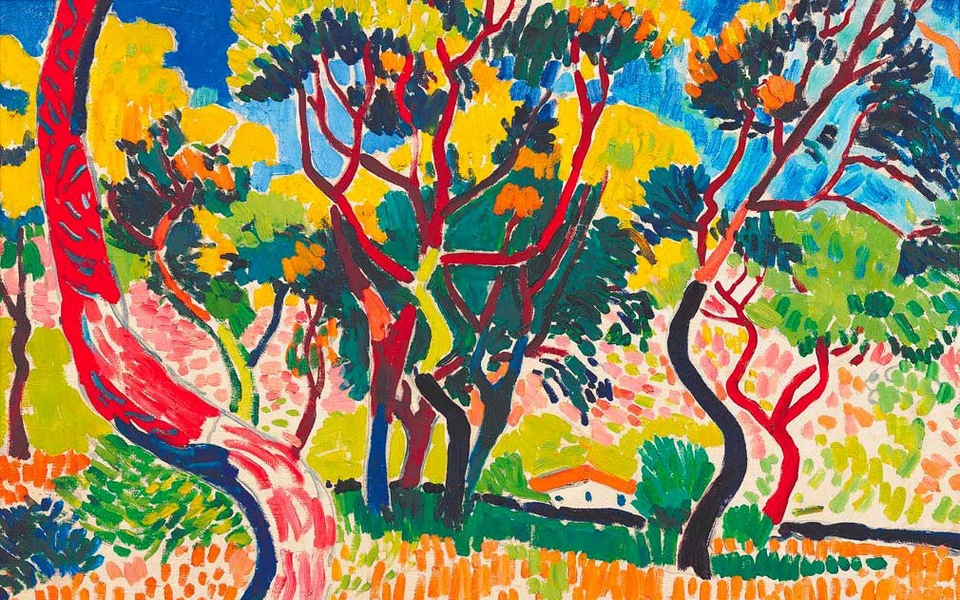
[André Derain]
Si les derniers mots de Travaux montrent un homme « moralement […] d’accord avec [sa] classe44 », Georges ne parvient pas à travailler enfermé avec ses camarades ouvriers, comme il l’a fait un temps chez Berliet à Vénissieux ou chez Citroën à Saint-Ouen. Dès que l’usine vibre trop dans le corps de Georges un désir d’extérieur le prend, désir qu’accompagne une dure mélancolie — il parlera ainsi fréquemment de « tristesse ouvrière » ou d’« angoisse ouvrière » pour qualifier ce sentiment qu’il perçoit également chez autrui. Entre 1920 et 1940, il manie ainsi la pioche comme terrassier et le râteau dans les salins, use de ses mains pour cueillir des fruits et de la serpe pour couper la lavande, il œuvre à Paris auprès des peintres en bâtiment ou à Nice en compagnies de jardiniers. En somme, il vagabonde et aime cela : « Vagabond, c’était un terme de louange. Tous nous avions lu Gorki, Panaït, London45 », déclare-t-il — tous, c’est-à-dire ceux qui, comme lui, traînent leurs semelles sur les routes pour travailler à l’air libre. On les nomme en ce temps-là « trimardeurs ».
« Dès que l’usine vibre trop dans le corps de Georges un désir d’extérieur le prend, désir qu’accompagne une dure mélancolie. »
« Le trimardeur
moderne était le démuni qui, n’appartenant à aucune cause
, transformait sa dépossession en intelligence du réel et vie libre46 . » Le terme n’avait pas ce lustre au siècle précédent, mais un exilé polonais s’en est emparé entre temps, intitulant un journal à ce titre. Né comme le Lorrain sur les rives d’un cours d’eau — fleuve et non rivière, celui-ci s’appelant Vistule —, Mécislas Golberg n’est certainement pas inconnu de Navel. Pierre Aubéry, biographe de l’un et ami de l’autre s’en est entretenu à coup sûr avec Georges. Ainsi Golberg reprenait-il à son compte les théories de Bakounine sur celles et ceux qui, plus bas que prolétaires, ne peuvent pas même prétendre à l’emploi salarié. On imagine Georges sensible à de telles songeries, les reprenant volontiers : « Si le prolétaire est l’homme qui, ne possédant rien, loue son travail, il existe encore une classe en dessous même au paradis de l’avenir : c’est l’homme qui ne peut plus rien louer47. » Ainsi l’image du trimardeur a‑t-elle évolué sous la plume de Golberg : « L’activiste était devenu écrivain et le trimard
une utopie poétique autant que politique48 », dira de ce dernier la chercheuse en littérature Catherine Coquio. On note un cheminement pareil pour Georges, qui le confirme après être revenu sur ces engagements politiques successifs aux côtés des militants anarchistes : « Je me suis dit que j’étais davantage écrivain que militant49. »
Aussi s’agit-il d’écrire, de d’écrire les gestes des travaux entrepris. À mesure qu’il vieillit, les mots s’entrechoquent de plus en plus dans la tête de Georges et jusque sur une feuille. Ce sont d’abord de brefs poèmes. L’un d’eux trouve une place en 1925 dans la revue Manomètre, « revue cosmopolite à 300 exemplaires50 » dont il connaît le principal artisan, le docteur Émile Malespine. Y collaborent les avant-garde yougoslaves, russes et polonaise, ainsi que les surréalistes et dadaïstes Tzara, Soupault ou Péret. Puis c’est la NRF qui l’accueille en 1933 — de la poésie encore, mais précédée d’un récit qui contient tous les thèmes à venir. Depuis les premiers vers lyonnais, Navel a vécu. « Je falotte51 », psalmodiait-il en 1925 ; « Le monde n’a pas besoin de poète », écrira-t-il huit ans plus tard avant de conclure de la tâche d’écrire : « Il ne s’agit pas de tuer le temps52. » Georges a découvert la poésie avec Verlaine, s’est dit hanté par Rilke un temps et marqué par Rimbaud. Il se souviendra de ses premiers élans : « Il m’importait de traduire mon aventure à Nice, celle d’un état d’exaltation et d’euphorie, état cultivé par la marche nocturne, les veilles, une sorte d’effort vers la voyance, l’état de la plus grande réceptivité53. » Bien vite, il ne s’agira plus seulement d’accueillir l’illumination dans le dérèglement de tous les sens, mais plutôt de s’accorder au monde et à ce qu’on en fait, et ce jusque dans les choses les plus coutumières. Cela a été dit ailleurs : l’écriture de Navel est celle d’un éveil travaillé, d’une rigoureuse attention54. Il l’a affirmé lui-même, et peut-être mieux : « Je me suis dit que j’allais devenir attentif à ce que je faisais. Je voulais trouver un accord dans le réel. Le maniement de l’attention intérieure retournée sur l’outil, sur la pelle, sur la pioche, m’ont permis de découvrir un merveilleux moyen d’illumination55. »

[André Derain]
Lorsque la seconde expérience espagnole prend fin, Georges s’est remis à écrire sous l’impulsion d’un philosophe allemand qui prendra la nationalité française, Bernard Groethuysen et de sa femme Alix Guillain, une communiste belge. Il ne cessera d’échanger avec le premier, correspondance qui sera publiée sous le beau titre de Sable et limon. « Ce témoin que les croyants trouvent en Dieu, je lui avais découvert un rival en rencontrant le philosophe56. » L’homme ouvre à Georges le milieu des revues littéraires et lui fait rencontrer Jean Paulhan qui dirige alors la NRF, mensuel où l’on croise à cette période les textes de Gide, Malraux, Cocteau, Claudel. Mais il ne suffit pas de connaître celles et ceux qui animent la littérature d’une époque pour y contribuer. Aussi Groethuysen et Guillain incitent-ils Georges à mettre en récit ses expériences laborieuses. « Je me suis mis à écrire sans trop savoir ce que je dirais57 », se souviendra-t-il. Un premier ouvrage est proposé à l’édition, ouvrage que l’on refuse. Impression de l’auteur : « Je me sentais un peu comme une botte de poireaux19. » Il remise ses envies littéraires. La poésie n’a plus cours dans le corps de l’écrivain, une morne dépression le guette : « Il faut de la folie pour peindre, écrire ou dessiner, orner son esprit, alors que d’un moment à l’autre une balle ou les gaz, ou bien volontairement la corde, peuvent mettre fin à de si nobles efforts58. »
« Il prête main forte à la Résistance quand il le peut et devient apiculteur, métier auquel il ne connaît rien — mais qu’importe ! »
Puis vient à Georges l’idée d’une singulière méthode : prêter attention, plus que de coutume et garder l’éveil tout au long du jour, jusque dans les choses les plus communes. Qu’il s’agisse de saler une soupe, raser des joues pourtant glabres ou sarcler une culture, « c’est de la présence de ces gestes ménagers que je tirais songes ou réflexion59 ». Si la pratique trouve ses premiers linéaments deux ou trois années avant-guerre, ça n’est qu’à partir de 1942 que Georges s’adonne tout à fait à l’écriture. Il a passé les premiers mois du conflit en Lorraine, dans la DCA60, avant d’être affecté dans une usine. La débâcle l’année suivante le conduit dans le Var où sa femme et leurs jumeaux le rejoignent. Il prête main forte à la Résistance quand il le peut et devient apiculteur, métier auquel il ne connaît rien — mais qu’importe ! « [L]e rucher m’occupait plus l’esprit que les mains. Il me restait beaucoup de temps pour travailler notre grand jardin ou revenir à la plume, à mes cahiers61. »
⁂
1980. 1981. L’âge fait tache sur le front, celui-là plus vaste un peu chaque année. La main tient une plume — main unique dès lors que seul persiste le métier d’écrire. Autour, une pièce que le noir et blanc rend secondaire. On y devine une fraîcheur de vieilles pierres alors même que, tout au sud d’un plateau calcaire où la Résistance s’est fait un nom, l’été est synonyme de fournaise. En ce lieu, penché sur une feuille, Georges seulement, de face ou de profil selon le cliché. Les mots qui s’accumulent sur la page diffèrent peu de ceux déjà mis bout à bout. L’agencement, néanmoins, en renouvèle la teneur. On le percevra dans dix années, lorsqu’ils seront imprimés sur de nombreux feuillets, ceux-là rassemblés, reliés puis collés sur une tranche de carton beige. Ce sera le dernier ouvrage ayant pour en-tête le nom de Navel.
⁂

[André Derain]
Un premier livre paraît enfin et Georges a 41 ans. Les retours sont bons, les ventes pas mauvaises et on pressent l’auteur pour le Goncourt. Alors que certains intriguent dans les cafés parisiens pour gagner des voix, Georges s’occupe de ses abeilles, tâche à laquelle il a pris goût et qu’il poursuivra pendant dix ans encore. Dès lors il ne cesse d’écrire — écrire ou plutôt réécrire une existence qui aurait pris fin avec les années 1940, faisant dire à l’éditeur Maurice Nadeau que Georges Navel est « un auteur si peu auteur qu’il remet sans le vouloir les pieds dans les pas de son premier livre : Travaux62 ». C’est qu’on peine à trouver la catégorie adéquate pour parler de cet homme-là. Après l’usine et le trimard, l’apiculture et l’écrit, Georges est embauché dans plusieurs rédactions parmi lesquelles L’Humanité en tant que correcteur d’imprimerie, métier dont il s’acquittera jusqu’à sa retraite au début des années 1970.
« Alors que certains intriguent dans les cafés parisiens pour gagner des voix, Georges s’occupe de ses abeilles. »
S’il a pris, alors, ses distances avec le militantisme, la politique ne le quitte pas pour autant. Il signe avec Sarraute, Sartre, Glissant ou Guérin le Manifeste des 121 en faveur de l’insoumission pendant la guerre d’Algérie. Il reviendra sur cette période dans ses échanges avec le poète libertaire Claude Kottelanne, correcteur pour L’Humanité lui aussi. Georges n’est pas des plus à l’aise parmi ses nouveaux collègues : « Il n’est pas bon d’avoir écrit quand on est correcteur, on passe pour poète63 ». On imagine l’écrivain appliquer aux épreuves qu’on lui fournit ce qu’il a mis en œuvre dans ses propres textes : « [C]hoisir toujours le mot le plus humble ; ne pas avoir de souci de style. Considérer l’écriture uniquement comme une sténographie57. » Servir la parole par des signes, voici ce qu’a pu rechercher Navel : « J’écrivais parce qu’au fond j’étais bègue3 », affirmera-t-il, expliquant ainsi son attrait pour la correspondance, ajoutant que « ma communication la plus naturelle, c’est une lettre adressée à quelqu’un3. » En somme, se dessine une pratique de la littérature qui ne peut s’envisager qu’accompagné : « Hors de l’amitié, je suis sans ressources pour communiquer64. »
Aussi un dialogue amical peut-il donner matière à conclusion.
Claude Kottelanne a mis en évidence une mauvaise manière de lire son ami : passeront à côté de Travaux — et des textes suivants — celles et ceux qui « ne retiendront de ce récit que sa chaîne autobiographique, que son support temporel65. » En cela il suit Georges, leurs mots dans un même sillage, ce dernier préférant entre toute démarche celle laissant place au « recul de la large esquisse qui ne s’encombre pas trop de la marche des faits et des chronologies66 ». Reculer, donc, dans le temps comme en soi, pour délivrer les souvenirs remâchés, les faits trop connus, en une ébauche toujours nouvelle, à reprendre continuellement.
Les photographies décrites sont réunies dans l’ouvrage collectif Georges Navel ou la seconde vue, Le Temps qu’il fait, 1982.
- Georges Navel, « Les rencontre de Contadour », dans l’ouvrage collectif Georges Navel ou la seconde vue, Le Temps qu’il fait, 1982.[↩]
- Pétrarque, L’Ascension du mont Ventoux, Sillage, 2011.[↩]
- Ibid.[↩][↩][↩]
- Jean-Yves Laurichesse, « La joie à l’épreuve de l’histoire : Giono ou le maître désenchanté », dans Cristina Noacco (dir.), Figures du maître : De l’autorité à l’autonomie, Presses universitaires de Rennes, 2013.[↩]
- Lettre à Claude Kottelanne, 12 novembre 1971, dans L’Écriture et la vie, Les Éditions libertaires, 2003, p. 194.[↩]
- « Jean Giono », dans Georges Navel, op. cit.[↩]
- Georges Navel, Chacun son royaume, Gallimard, 1960.[↩]
- Jean Giono, Les Vraies richesses (1936), Grasset, 2002, p. 77.[↩]
- Voir à ce propos les contributions de Gérard Meudal, Philippe Petit et Yves Lévy dans Georges Navel, op. cit.[↩]
- Georges Navel, Parcours, Gallimard, 1950, p. 59.[↩]
- Georges Navel, Passages, Gallimard, 1991, p. 13.[↩]
- Passages, p. 31.[↩]
- Georges Navel, Travaux (1945), Folio, 1995, p. 36.[↩]
- Parcours, p. 44.[↩]
- Louis Calaferte, C’est la guerre, Gallimard, 1993, p. 13.[↩]
- Parcours, p. 51.[↩]
- Passages, p. 93.[↩]
- Passages, p. 80.[↩]
- Ibid.[↩][↩]
- Travaux, p. 22.[↩]
- Aujourd’hui Skikda.[↩]
- Aujourd’hui Aïn El Assel.[↩]
- Travaux, p. 45.[↩]
- Georges Navel, « Zola chez les ouvriers », dans Georges Navel, op. cit.[↩]
- Travaux, p. 47.[↩]
- Parcours, p. 83.[↩]
- Chacun son royaume, p. 284.[↩]
- Travaux, p. 50.[↩]
- Travaux, p. 59.[↩]
- Parcours, p. 113.[↩]
- « Une aventure espagnole. Entretien avec Georges Navel », dans L’Écriture et la vie, op. cit., p. 156.[↩]
- Travaux, p. 61.[↩]
- Claude Liauzu, Histoire de l’anticolonialisme en France (2007), Pluriel, 2012, p. 267.[↩]
- « Les lendemains d’Octobre : la jeunesse ouvrière française entre le bolchevisme et la marginalité. Entretien avec Maurice Jacquer et Georges Navel », Les Révoltes Logiques, n° 1, 1975, p. 92.[↩]
- Parcours, p. 132.[↩]
- Parcours, p. 134.[↩]
- « Des briques dans la ciel bleu. Entretien avec Georges Navel », Les Révoltes Logiques, n° 14–15, 1981, p. 77.[↩]
- Ibid., p. 78.[↩]
- « Une aventure espagnole », op. cit., p. 164.[↩]
- Parcours, p. 189.[↩]
- « Une aventure espagnole », op. cit., p. 167.[↩]
- Ibid, p. 170.[↩]
- Parcours, p. 211.[↩]
- Travaux, p. 247.[↩]
- Parcours, p. 149.[↩]
- Catherine Coquio, « Un
trimardeur
au sana en 1907. Mécislas Golberg, science de demain et science du mourant », Tumultes, vol. 36, n° 1, 2011, p. 191.[↩] - Chacun son royaume, p. 287.[↩]
- Catherine Coquio, art. cit., p. 191.[↩]
- « Une aventure espagnole », art. cit., p. 175.[↩]
- Lettre à Claude Kottelanne, 28 février 1972, dans L’écriture et la vie, op. cit., p. 202.[↩]
- Georges Navel, « Messe », paru dans le numéro 8 de la revue Manomètre, reproduit dans Georges Navel, op. cit.[↩]
- Contribution de Georges Navel sous le nom de Philippe Latour au « Tableau de poésie » de la NRF, n° 240, 1933, reproduit dans Georges Navel, op. cit.[↩]
- Lettre à Claude Kottelanne, 28 février 1972, dans L’écriture et la vie, op. cit., p. 205.[↩]
- Voir Arlette Grumo, « Le travail de la main à plume », dans L’écriture et la vie, op. cit.[↩]
- Georges Navel, « Le travail d’écrire », Georges Navel, op. cit.[↩]
- Chacun son royaume, p. 278.[↩]
- « Le travail d’écrire ».[↩][↩]
- Chacun son royaume, p. 288.[↩]
- Travaux, p. 208.[↩]
- « Défense contre les aéronefs » ou « défense contre avions », sigle de la défense anti-aérienne.[↩]
- Chacun son royaume, p. 320.[↩]
- Maurice Nadeau, « L’exemple de Georges Navel », dans Georges Navel, op. cit.[↩]
- Lettre à Claude Kottelanne, 1er juin 1991, dans L’écriture et la vie, op. cit., p. 224.[↩]
- Lettre à Paul Géraldy, citée par Pierre Aubéry, « Georges Navel et l’art d’écrire », dans Georges Navel, op. cit.[↩]
- Claude Kottelanne, « Préface à Travaux, pour un disque mort-né », dans L’écriture et la vie, op. cit., p. 183.[↩]
- Sable et limon, p. 399.[↩]

