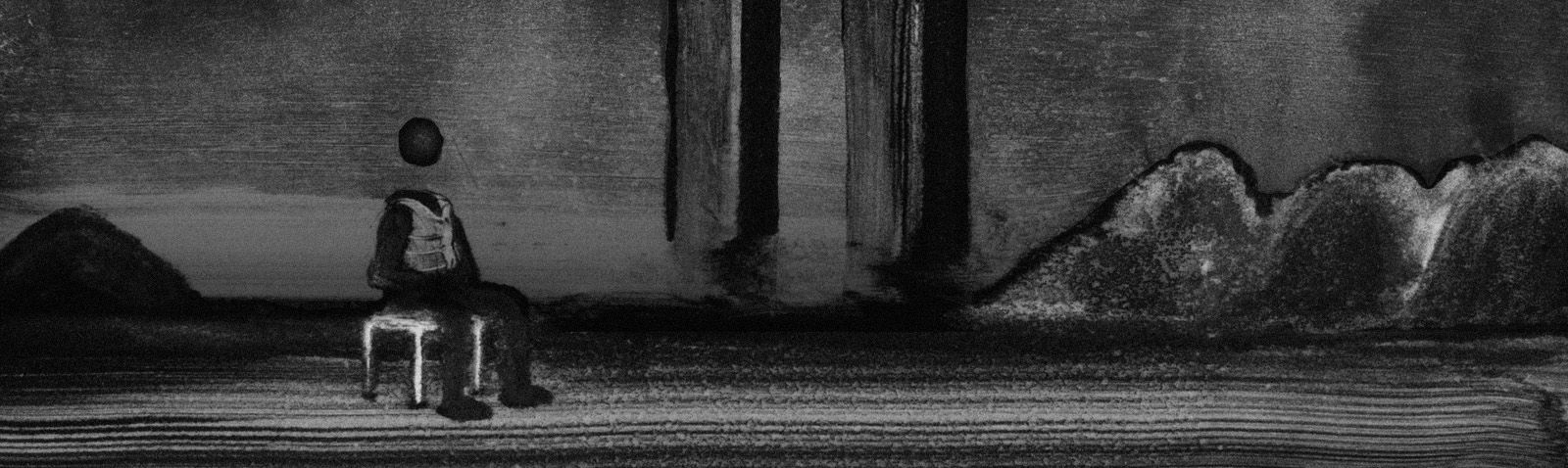Entretien inédit pour le site de Ballast
Notre époque considère trop souvent que la poésie, saturée de formol, est chose morte et mortellement ennuyeuse. Sauf que les poètes sont bien vivants et ne rêvent plus ni de jouer aux dés avec Mallarmé ni de courir les marchés d’esclaves avec Rimbaud. Vers Écouen, dans le Val-d’Oise, on en trouve qui lisent de la science-fiction et croient que les mots ne sont pas faits pour le décor, mais pour le combat. Pied à pied, poème après poème, revue après revue. Loin des artifices et du verbalisme, du cynisme et de la décoration culturelle, ils désirent que le poème traduise et illumine le vécu de l’homme ordinaire. Ils le disent depuis un demi-siècle, ils sont ceux qui font la revue Les Hommes sans épaules. Nous avons sollicité son directeur de publication, le poète Christophe Dauphin : il nous parle de « l’émotivisme », ce lyrisme de combat.

Le titre est en effet extrait du roman préhistorique Le Félin géant, qui a paru en 1918. Rosny l’Aîné y met en scène deux amis, Aoûn, le fils du chef de la tribu, une brute mais capable de pardonner à l’ennemi terrassé, et Zoûhr, un surdoué fragile. Tous deux ont besoin de nouer leurs qualités et leur ruse pour tenter de reconquérir le Feu perdu, sinon la tribu ne survivra pas. Alors, oui, les temps (mais est-ce nouveau ?) sont aux fardeaux. Zoûhr, lui, ne peut rien accrocher à son corps mais cela lui évite au moins de rouler sa carrure au rythme du tocsin. Zoûhr est tout occupé à conserver et entretenir le Feu. L’imagination, comme l’a écrit Bachelard, travaille à son sommet, comme une flamme.
L’aventure de cette revue est l’une des plus durables dans le paysage poétique français du XXe siècle : elle voit le jour entre 1953 et 1956, s’interrompt pour reprendre de 1991 à 1994, puis renaît en 1997. Pourquoi reprendre un titre plutôt que d’en créer un autre ?
Sur le plan générationnel, nous n’avons pas eu à rejeter nos aînés, tout comme durent le faire les surréalistes, et même un Jean Breton, obsédé par la tabula rasa vis-à-vis du passé et du père. Ainsi, nous nous inscrivons dans notre histoire et entretenons notre filiation, fiers et riches d’en avoir une, et nous nous y sentons bien. Cela ne revient nullement à dire que nous nous inscrivons dans un suivisme quelconque. Au contraire : nous actualisons, développons et augmentons de nos propres acquis les actions de nos aînés.
Votre credo relève de « l’émotivisme » et fait la part belle à de grands anciens — songeons à Reverdy. Vous avez écrit vous-même une quinzaine d’essais sur des poètes, comme Jean Rousselot, Sarane Alexandrian, Jean Breton ou Jacques Simonomis. Comment définiriez-vous cette lignée dont vous vous réclamez ?
« Les poètes qui refusent de voir la vie affective enterrée sous les supputations linguistiques et le chloroforme pseudo-philosophique. »
Je pense que le temps n’est plus à l’esprit unilatéral et étroit des tentatives séparées, mais à la synthèse. Parti de l’exploration parcellaire de ma sensibilité, j’en suis arrivé à la synthèse de l’émotivisme, qui est une synthèse moderne et d’ouverture des courants et mouvements révolutionnaires que sont la poésie pour vivre (qui exprime les émotions de l’homme ordinaire, en butte au réel) et le surréalisme (qui est l’irruption du rêve dans la réalité, soit l’osmose du surréel). Sous la « bannière » de l’émotivisme se retrouvent les poètes qui refusent de voir la vie affective enterrée sous les supputations linguistiques et le chloroforme pseudo-philosophique et qui, au contraire, enrichissent l’intimisme. Toutes les personnes que vous venez de citer et qui me sont chères l’illustrent à merveille. Quant à Pierre Reverdy, que vous mentionnez très justement, je ne peux qu’être solidaire de lui. L’émotivisme est la création par une œuvre esthétique — grâce à une certaine association de mots, de couleurs ou de formes qui se fixent et assument une réalité incomparable à toute autre — d’une émotion particulière, et non truquée, que les choses de la nature ne sont pas en mesure de provoquer en l’homme. Car la poésie est uniquement en l’homme et c’est ce dernier qui en charge les choses, en s’en servant pour s’exprimer.
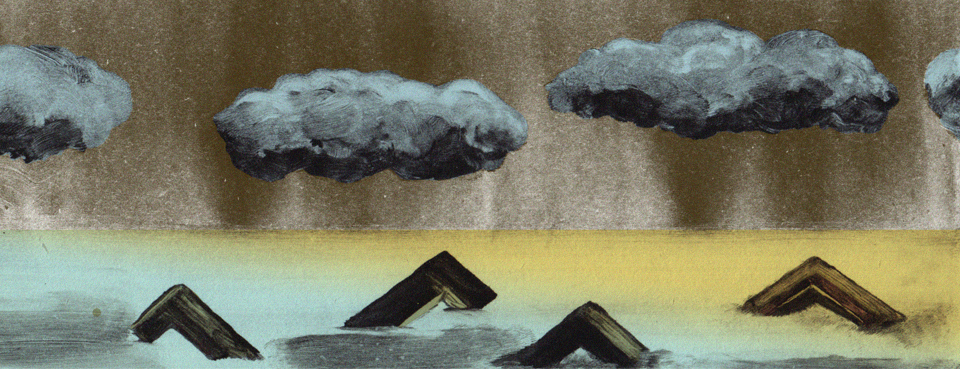
Si reconnus soient-ils par les lecteurs de poésie, les noms des poètes contemporains atteignent rarement le grand public. La poésie reste perçue par les médias comme ésotérique ou élitiste : elle fait peur, quand elle ne provoque pas des moues ironiques. Comment s’expliquer cette situation ?
Il n’y a rien à attendre. Les médias, à de très rares exceptions, n’accordent plus, et depuis longtemps, aucune place aux poètes. Nous le savons et cela ne changera pas. Aucun média n’a le désir, la volonté et surtout la compétence pour parler de la poésie. Rien de nouveau. Ce qui l’est, en revanche, c’est d’assister paradoxalement, aujourd’hui, en France — comme l’a remarqué Martin Rueff — à un étrange phénomène sémantique : non seulement le nom « poésie », dont l’adjectif « poétique » est tiré, n’est plus considéré comme son porteur naturel, mais encore on va jusqu’à dénier aux poètes la poésie qu’on prête aux non-poètes… Dans le langage commun, poète est un titre de gloire que l’on va prêter à tel chanteur, tel couturier et je ne sais qui encore… À tout le monde en fait, sauf au poète.
Le champ éditorial de la poésie vous semble-t-il injustement dominé par de fausses valeurs ? Faudrait-il réécrire aujourd’hui Les Impostures de la poésie de Roger Caillois ?
« La poésie est un vivre et non un dire. »
Il ne faut pas idéaliser le milieu de la poésie. Il ne s’agit jamais que d’un milieu guère pire, guère meilleur qu’un autre. On y retrouve par exemple la quête perpétuelle et continuelle du pouvoir. Le pouvoir en poésie ? Cela peut prêter à rire. Certes, je vous l’accorde. Mais aussi petit soit-il, le pouvoir reste le pouvoir et ce microcosme poétique n’est jamais que le reflet de la société. Le champ éditorial est vaste. Il est surtout porté par une pléthore de revues et d’éditeurs spécialisés. Les poètes sont nombreux. Il y en a pour tous les goûts. Certains s’expriment en haut d’une tour, d’autres au fond d’une cave, d’autres sont dans la foule. S’il y a indéniablement de très bons poètes en France, on ne doit pas perdre de vue que le poème, lorsqu’il donne dans un excès de formalisme, de culture ou de sensiblerie, ne peut que se transformer en un vain bibelot. L’objet langagier n’est pas un poème, c’est un objet langagier. La poésie est un vivre et non un dire.
Comment échapper à l’entre-soi où « les poètes parlent aux poètes », et toucher plus largement les gens ?
Il faut de la curiosité, se frotter aux textes, aux poètes. Faire son tri. Il faut aussi de la culture. Faire des efforts. Si la poésie reste incompréhensible à beaucoup, c’est justement parce que ceux-ci cherchent à la comprendre très partiellement et intellectuellement. À la traduire au lieu de la vivre. La poésie réclame du lecteur une participation totale. Non seulement sa logique, sa rigueur, son intellect sont mobilisés, mais aussi son imagination, sa sensibilité, sa sensualité.
En tirant un peu le fil, comment rendre à la poésie sa puissance populaire, sortir du prophétisme ou du jargonnesque, rétablir le lien avec la vie quotidienne ?
Le jargonnesque, la rupture avec le « frère humain », n’est pas l’apanage de tous les poètes. Certes, il y a eu, il y a et il y aura toujours des « faiseurs », des fabricants de vers ou des bricoleurs sonores et autres performers de plats réchauffés. Mais que voulez-vous que les gens pensent de cela ? D’un gugusse qui écrit et lit que « le bâton est un bout et qu’au bout du bâton il y a un autre bout, etc. », le tout sur vingt pages ? Ou alors d’un autre zig qui va déblatérer des inepties tout en jouant de la guitare électrique ? Avec ou sans guitare, un bon poème reste un bon poème et une connerie une connerie. Mais il n’y a pas que cela. Bien des poètes n’ont jamais perdu le fil ; mais sans doute sont-ils moins mis en valeur. J’ai le souvenir de quelques lectures ou rencontres avec des classes de lycéens et collégiens, où, je peux vous l’assurer, le courant est réellement passé. Il est vrai, pour les rencontres en classe, que les professeurs avaient entrepris un gros travail de préparation avec leurs élèves en amont.

Mais faut-il être heureux qu’il y en ait « pour tous les goûts » — de la poésie sonore la plus expérimentale à la poésie amoureuse la plus lyrique ? Ou faut-il, au contraire, s’attacher à tracer une ligne de démarcation entre l’Art pour l’Art, purement conceptuel, et, pour citer Lautréamont, la « poésie par tous, pour tous » ?
À la lecture de certaines revues et de bon nombre de recueils, significatifs de la production poétique de notre temps, on se demande si Paul Valéry n’a, en fin de compte, pas été pris au pied de la lettre par beaucoup lorsqu’il affirme : « Certains se font une idée si vague de la poésie qu’ils prennent ce vague pour l’idée même de la poésie. » Certes, il n’est pas aisé de s’y retrouver, mais je ne déplore pas cette diversité de champs et d’écritures. Mais, là où toutes les dimensions humaines ne sont pas brassées par elle, la poésie ne signifie rien, elle rampe, et il est absurde de lui accorder la moindre importance, dès lors que l’émotion ne constitue pas son passeport pour l’absolu. L’important, c’est d’ouvrir en soi le plus de portes possibles et d’aller loin dans ce que l’on cache d’habitude. Mais il est primordial d’être à l’écoute d’une pulsion exempte de toute fabrication et tout trucage. Tant pis si ces portes qu’on se risque à ouvrir (dans l’interdit ?) vous en ferment d’autres : il s’agit de rendre le tréfonds de l’individu. La forme qui vaut toutes les formes s’adapte à la mort comme aux grincements de plaisir profond d’un corps écartelé – et niant l’impossibilité d’être.
Vous avez défendu l’idée que le poète est révolutionnaire par essence, même s’il ne doit pas mettre sa poésie au service d’une quelconque idéologie, fût-elle révolutionnaire. Le poète au cœur de la Cité ne peut s’abstraire des questionnements politiques mais tient par ailleurs plus que tout à sa liberté. Y a‑t-il une sorte de lien consubstantiel entre poésie et anarchisme ?
« Là où toutes les dimensions humaines ne sont pas brassées par elle, la poésie ne signifie rien, elle rampe, et il est absurde de lui accorder la moindre importance. »
N’oublions pas la leçon de vie exemplaire de Benjamin Péret qui, bien que militant politique, ne fut pas moins avant tout un poète (et quel poète !) qui a toujours dénoncé la récupération du poétique par le politique. Je pense, tout comme Péret, que le poète n’a pas à désarmer les esprits en leur insufflant une confiance sans limites en un père ou un chef, contre qui toute critique devient sacrilège. Bien au contraire, c’est au poète de prononcer les paroles toujours sacrilèges et les blasphèmes permanents. Le poète doit d’abord prendre conscience de sa nature et de sa place dans le monde et combattre sans relâche les dieux paralysants, acharnés à maintenir l’homme dans sa servitude à l’égard des puissances sociales et de la divinité, qui se complètent mutuellement. Le poète combat pour que l’homme atteigne une connaissance à jamais perfectible de lui-même et de l’univers. Il ne s’ensuit pas qu’il désire mettre la poésie au service d’une action politique, même révolutionnaire. Mais sa qualité de poète en fait un révolutionnaire qui doit combattre sur tous les terrains : celui de la poésie par les moyens propres à celle-ci, et sur le terrain de l’action sociale — sans jamais confondre les deux champs d’action, sous peine de rétablir la confusion qu’il s’agit de dissiper et, par suite, de cesser d’être poète, c’est-à-dire révolutionnaire.
Alain Jouffroy, qui vient de nous quitter, a écrit un livre important sur l’individualisme révolutionnaire. Alain écrit notamment, à propos des poètes, qu’ils ne seront jamais les laquais d’aucune puissance dominante. Qu’ils feront toujours parler, le plus fort possible, la puissance dominée. « Alors, oui, parlons-en, parlons de ceux-ci, qui se taisent, et à qui depuis bientôt deux siècles, on n’a jamais demandé leur avis sur rien : les opposants, les rétifs, les récalcitrants, les gêneurs, les ennemis entêtés de l’ordre et du désordre établis. Ils sont l’histoire en gésine, la force enténébrée des matins sourds. » J’ajoute que le « je » est la valeur qui doit être protégée contre les attaques du pouvoir aussi bien que des idéologies qui le fustigent. À l’économisme totalitaire, il faut opposer le rôle pratique et révolutionnaire de chaque individu dans la vie de tous les individus, sachant bien que toutes les révolutions intellectuelles, politiques et artistiques naissent, avant tout, d’individus, pour la plupart rebelles. Il faut s’ériger contre les théories qui censurent l’existence et le rôle des individus dans le monde d’aujourd’hui.
Alain Jouffroy, justement, écrivait dans son Manifeste de la poésie vécue : « Mon utopie, la voici : libérer la poésie de ce vieux carcan solipsiste, narcissique et autosatisfait en raccordant l’écriture à tout ce qui lui est extérieur. » Vous signez ?
Ce n’est pas une utopie, mais une réalité entretenue par de nombreux poètes. La réalité de la parole poétique est celle de parler face à l’abîme que nous sommes et ne cesserons jamais d’être. Le poète résiste dans la fêlure. Son rapport au langage, à ses émotions, nous renvoie de plein fouet au rapport que nous entretenons avec le monde, à renfort de mots coups de poing, de mots coups de sang, pour exister. Pour le poète, il n’existe pas un espace sans combat. Pas un atome sans cri. Mais seulement, à bout portant : le langage, l’émotion, le rêve, la réalité, le mot coup de tête.
Toutes les illustrations sont de Baptiste Deyrail, pour Ballast.
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Reza Afchar Naderi, « Ici, la poésie est coupée de l’homme », janvier 2016
☰ Lire notre article « Jean-Pierre Siméon, la poésie comme force d’objection radicale », décembre 2015
☰ Lire notre article « André Laude, poète anarchiste », André Chenet, octobre 2015
☰ Lire notre entretien avec Breyten Breytenbach : « On n’a pas nettoyé les caves de l’Histoire ! », juin 2015
☰ Lire notre entretien avec Tristan Cabral : « J’ai la chance de n’être pas dans le milieu soi-disant littéraire », mai 2015
☰ Lire notre article « Lili Brik & Vladimir Maïakovski : les amants de la Révolution », mars 2015
☰ Lire notre article « Poésie, anarchie et désir », Adeline Baldacchino, décembre 2015