Un anthropologue anarchiste, les lumières d’un cirque, l’histoire de la dépression, une révolution sans chefs et oubliée, l’inframonde parisien, un roman mélancolique et bizarre, la jeunesse italienne en bande-dessinée, des gravures en pleine Seconde Guerre mondiale, les lettres d’exil d’un révolutionnaire syrien, des pistes pour comprendre la guerre en Ukraine : nos chroniques du mois de septembre.
☰ Pour une anthropologie anarchiste, de David Graeber

Lux, 2006
☰ L’Attente du soir, de Tatiana Arfel

Il y a des heures que l’on attend chaque jour impatiemment et d’autres qu’on ne cesse de rejeter. Pour Giacomo, Mlle B. et le môme, ce sont les premiers instants du soir qui soulagent le mieux. Mais s’ils attendent de concert une pareille nuit, ces trois-là ne l’aiment pas pour les mêmes raisons. Prenons Giacomo. Il a le nom de son père, qui avait le nom du sien. Ce nom, c’est aussi celui du cirque dans lequel on est clown de génération en génération malgré les errements de l’Histoire. Le soir de Giacomo est bardé de lampions, de cris d’enfants, de caniches acrobates et de trapézistes. C’est le soir qui dure autour du feu de camp, qui est aussi un feu de joie. Mlle B., pour sa part, attend le soir pour ne plus voir le jour. Depuis sa naissance ses parents, puis toutes les personnes qu’elle côtoie, lui dénient le droit d’avoir un visage. On ne la regarde pas. Alors quand vient la nuit, quand sonne l’heure de s’éteindre enfin, Mlle B. n’attend pas. Et le môme, à quoi ressemble le soir qu’il aime tant ? Il ne le dirait pas lui-même, parce qu’il n’a pas l’usage des mots. Sûrement le peindrait-il avec les couleurs qu’il affectionne. La nuit, le môme quitte le terrain vague qui l’abrite pour chercher nourriture et matériaux dans les poubelles des environs. Il se gave de goûts et d’odeurs afin de peindre tout le jour. Pourquoi ces trois personnages devraient-ils se rencontrer ? Comment leurs parcours pourront-ils converger ? Tatiana Arfel a saisi trois fils aux teintes franches, à la texture rêche et en a fait une pelote épaisse qu’on se plaît à dévider en sa compagnie. Ces trois fils se nomment Giacomo, Mlle B., le môme. D’un même élan, ils participent à redresser un cirque autant que les torts dus au hasard d’une naissance, aux accidents d’une vie. [E.M.]
Corti, 2018 (2008)
☰ L’Empire du malheur — Une histoire de la dépression, de Jonathan Sadowksy
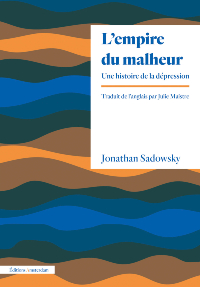
pilules du bonheur
[…] est impropre, et elle a quelque chose d’humiliant pour les personnes déprimées. Les traitements peuvent soulager les gens d’une souffrance inutile, mais ils ne suffisent certainement pas en eux-mêmes à les rendre heureux. » Car si la pleine compréhension de cette maladie semble difficile pour celles et ceux qui ne l’ont pas vécue, il s’agit bien de la prendre au sérieux. Et comme nous y invite l’ouvrage, cela implique de reconnaître la dimension politique de la dépression, fortement inégalitaire. [M.B]
Amsterdam, 2022
☰ Asturies 1934 — Une révolution sans chefs, d’Ignacio Díaz
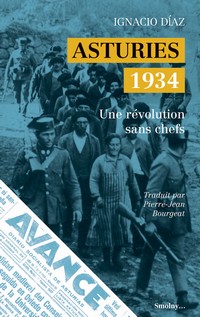
Smolny, 2021
☰ Les Sauvages de la civilisation — Regards sur la Zone, d’hier à aujourd’hui, de Jérôme Beauchez

La Zone. Une bande de terre située au pied des fortifications de Paris, coincée entre la capitale et les banlieues ouvrières, et bâtie de constructions (illégales) de bric et de broc, roulottes sur pilotis ou masures en planches au toit de tôle. « Cet inframonde parisien, fruit amer d’une modernité qui aurait déposé là toutes ses misères, passait pour une sorte de capitale des classes dangereuses
» qui aurait engendré des « sauvages de la civilisation » selon le regard surplombant que portent sur ses habitant·es les classes dominantes — mais aussi les révolutionnaires, méfiants face à ce qu’ils considèrent comme le lumpenprolétariat. C’est d’abord à ces regards que s’intéresse Jérôme Beauchez. La méthode archéographique de l’auteur s’attache « aux façons de dire, de faire entendre et de montrer la marginalité, ainsi constituée en objet d’histoires, mais aussi de pouvoirs, de dominations et de contrôles sociaux ». Alors qu’il n’existe finalement quasiment pas de témoignages directs des zoniers, les discours de politiques, de journalistes, d’artistes extérieurs à la Zone ont construit la représentation d’un territoire de non-droit, abritant une menace pour la société. Il s’agit alors pour les classes dominantes d’y remettre de l’ordre, à la fois dans l’espace en rasant les constructions illégales pour les remplacer par des immeubles, et chez les individus en leur imposant les normes du travail, de la religion, de la famille… Le régime de Vichy accélérera le processus de démantèlement de la Zone, qui finira après-guerre par être remplacée par le périphérique parisien. Mais plutôt que disparaître, elle se dématérialise et se recompose dans les interstices de la ville. À partir des années 60, les « zonards », skinheads, punks, squatteurs, cherchent des façons de vivre à l’écart des normes imposées, dans des espaces plus alternatifs qu’oppositionnels. Allant d’une fin de siècle à une autre, l’étude n’aborde pas la question de ce qu’on appelle aujourd’hui « les banlieues », pour lesquelles l’auteur appelle à « d’autres développements ». [L.]
Amsterdam, 2022
☰ Jean-Luc et Jean-Claude, de Laurence Potte-Bonneville
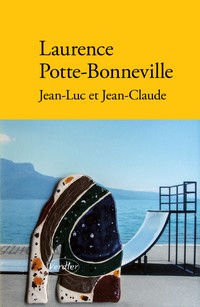
Verdier, 2022
☰ Au-delà des décombres, de Zerocalcare

Cambourakis, 2019
☰ Dans la nuit, de Erich Glas
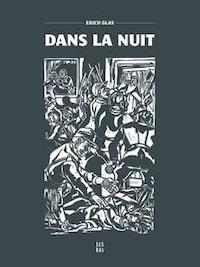 Un matin d’hiver de 1942, Erich Glas se réveille d’une nuit de cauchemars, se tenant la tête à deux mains. L’artiste du Bauhaus est dans une chambre de l’hôpital d’un kibboutz en Palestine sous mandat britannique. Il y vit depuis 1934, après avoir dû quitter l’Allemagne alors que commençaient les persécutions du régime nazi envers les Juifs, lui faisant perdre son poste d’enseignant. Les massacres commis ne font alors l’objet que de rumeurs. Et pourtant, « dans la nuit » que raconte l’artiste à travers une série de 28 linogravures, tout est là. Il se représente avec un personnage décharné, squelettique, debout derrière lui, une main sur son épaule, l’autre posée sur la sienne qui tient son crayon. S’ensuit une série d’images terrifiantes, parfois difficilement soutenables, qui parfois évoquent les représentations médiévales de l’Enfer. Le trait est net, l’encre noire contraste avec la blancheur du papier. Les corps brisés, tordus, expriment une souffrance intense. Car l’artiste voit tout : les pogroms commis par les troupes allemandes, les soldats grimaçant comme des démons et portant des insignes nazis, qui déportent, tuent, détruisent, et la fuite des exilés qui souvent se termine par la mort. Pourtant, ce n’est pas celle-ci qui conclut l’ouvrage. Ne se résolvant pas à la fatalité, les deux dernières images appellent à la résistance et montrent un peuple qui prend les armes. Est-ce l’expérience de la violence lors de la Première Guerre mondiale qui a guidé l’intuition de Erich Glas ? A‑t-il eu accès à des informations qu’à l’époque peu connaissaient ? Toujours est-il qu’au moment de leur réalisation, il peine à montrer et éditer ses images, que l’on refuse de voir. C’est finalement une maison d’édition sud-africaine qui réalisera un petit tirage de l’ouvrage en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Par sa forme, on peut le considérer comme précurseur des romans graphiques, que les éditions Ici-bas sont les premières à publier en français. [L.]
Un matin d’hiver de 1942, Erich Glas se réveille d’une nuit de cauchemars, se tenant la tête à deux mains. L’artiste du Bauhaus est dans une chambre de l’hôpital d’un kibboutz en Palestine sous mandat britannique. Il y vit depuis 1934, après avoir dû quitter l’Allemagne alors que commençaient les persécutions du régime nazi envers les Juifs, lui faisant perdre son poste d’enseignant. Les massacres commis ne font alors l’objet que de rumeurs. Et pourtant, « dans la nuit » que raconte l’artiste à travers une série de 28 linogravures, tout est là. Il se représente avec un personnage décharné, squelettique, debout derrière lui, une main sur son épaule, l’autre posée sur la sienne qui tient son crayon. S’ensuit une série d’images terrifiantes, parfois difficilement soutenables, qui parfois évoquent les représentations médiévales de l’Enfer. Le trait est net, l’encre noire contraste avec la blancheur du papier. Les corps brisés, tordus, expriment une souffrance intense. Car l’artiste voit tout : les pogroms commis par les troupes allemandes, les soldats grimaçant comme des démons et portant des insignes nazis, qui déportent, tuent, détruisent, et la fuite des exilés qui souvent se termine par la mort. Pourtant, ce n’est pas celle-ci qui conclut l’ouvrage. Ne se résolvant pas à la fatalité, les deux dernières images appellent à la résistance et montrent un peuple qui prend les armes. Est-ce l’expérience de la violence lors de la Première Guerre mondiale qui a guidé l’intuition de Erich Glas ? A‑t-il eu accès à des informations qu’à l’époque peu connaissaient ? Toujours est-il qu’au moment de leur réalisation, il peine à montrer et éditer ses images, que l’on refuse de voir. C’est finalement une maison d’édition sud-africaine qui réalisera un petit tirage de l’ouvrage en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Par sa forme, on peut le considérer comme précurseur des romans graphiques, que les éditions Ici-bas sont les premières à publier en français. [L.]
Ici-bas, 2022
☰ Lettres à Samira, de Yassin Al Hadj Saleh

Elle s’appelle Samira Al-Khalil et a disparu le 9 décembre 2013, à Douma, dans la Ghouta orientale, en Syrie. Tandis que depuis deux ans une révolution secoue le pays, que des milliers de morts sont déjà dénombrés et que des centaines de milliers vont s’ajouter, Samira Al-Khalil est enlevée, avec plusieurs de ses collègues militant·es pour les droits humains, par un groupe islamiste. La couverture du livre présente Samira. Celui qui a écrit les lettres qui le composent, lui, pour sa part, s’adresse à Sammour. Il s’agit de son compatriote, camarade politique et mari Yassin Al Hadj Saleh, l’une des principales figures de la révolution syrienne en exil. Il dit : « le monde, Sammour, est une grande Syrie » et encore : « Sammour, nous avions réclamé le pluralisme politique et nous avons obtenu une pluralité de guerres et de pays en Syrie ». Les phrases pèsent dans le ventre de celui ou de celle qui les lit, d’autant plus sachant qu’elles ne sont pas pour soi, ou pas seulement. De 2017 à 2019 Yassin Al Hadj Saleh a écrit de longues lettres à sa compagne disparue, qu’il a diffusé sur Internet. Une manière de maintenir un lien, de poursuivre une lutte, de continuer à vivre. « Les réserves d’espoir sont au plus bas depuis des générations » commente l’auteur qui, pourtant, a connu les prisons de Hafel el-Assad et de son fils Bachar el-Assad — lui, donc, qui connaît l’espoir muré. C’est que la prison a pris une autre forme depuis un exil précipité, alors que Samira reste. La révolution n’a pas seulement été annihilée, elle a aussi été le prétexte à des interventions multiples des puissances étrangères pour des intérêts qui, la plupart du temps, sont les leurs et non ceux du peuple soulevé. Ainsi Yassin Al Hadj Saleh constate « l’effondrement du cadre national du conflit syrien » et le fait que la « révolution des anonymes et des insignifiants » ait été « enfouie sous une épaisse couche d’impudence internationale ». L’amertume est immense, mais les capacités critiques surnagent — mieux, l’auteur s’acharne à les renouveler pour ne pas perdre la juste mesure de ce qui se passe. Pour cela, deux boussoles : tout dire à Samira et, incidemment, aux lecteurs de ces lettres ; ne jamais perdre de vue que ce qu’il faut, « c’est la dignité, une vie décente et faire le bien ». [R.B.]
Éditions Les Lisières, 2021
☰ Jamais frères ? Ukraine et Russie : une tragédie postsoviétique, de Anna Colin Lebedev
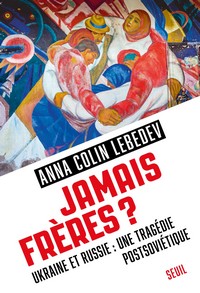
« Donner du sens aujourd’hui aux événements est politiquement indispensable, mais scientifiquement impossible » écrit la politologue Anna Colin Lebedev. Elle qui est née en Russie et y a grandi avant de rejoindre la France, qui travaille depuis deux décennies sur l’Ukraine contemporaine, sait que ses mots vont être scrutés. Depuis le 24 février 2022 pour certain·es, depuis l’année 2014 ou depuis plus loin encore pour d’autres, le besoin de comprendre les situations postsoviétiques s’est soudainement fait pressant. On se demande quels sont les liens culturels, politiques, linguistiques ou encore historiques entre la Russie et l’Ukraine ; quels peuvent être les raisons ayant conduit à une telle rupture, rendant, selon son principal instigateur Vladimir Poutine, la guerre inévitable. Anna Colin Lebedev revient dans un essai opportun sur les relation entre l’Ukraine et la Russie ces trente dernières années. Elle met de côté les mots et les outils de la géopolitique pour leur préférer l’analyse sociologique et historique, mieux à même de décrire les sociétés russes et ukrainiennes contemporaines. C’est la mémoire collective qui, d’abord, l’interpelle, avant de se pencher sur l’histoire de l’usage des langues russes et ukrainiennes. Si le récit national ukrainien a longtemps occulté l’implication des nationalistes dans la Shoah et a passé sous silence les pogroms perpétrés par ces derniers, un travaille mémoriel est entamé. En Russie, l’Histoire ne s’écrit même plus, ou seulement en termes victorieux : la Shoah a disparu des programmes scolaires, les vainqueurs et les victimes sont les mêmes, soit les vétérans de la « Grande Guerre patriotique ». C’est ensuite la mémoire récente qu’interroge l’autrice : la société ukrainienne après l’effondrement de l’URSS, l’appréhension par ses habitant·es d’une Russie instigatrice de guerres répétées sur ses bords, les réalités d’un métissage important que les récents événements ont fait voler en éclat. Anna Colin Lebedev donne par son approche culturelle des clés de lecture déterminantes pour affronter une actualité qu’on ne peut scruter sans inquiétude. [E.M.]
Seuil, 2022
Photographie de bannière : Laszlo Moholy-Nagy

