Une rue de Lituanie, les oubliés de Tchernobyl, les souvenirs d’une femme maudite, un père ballotté par l’Histoire, un avion puis la révolution, le b.a.-ba du féminisme, braquer des banques, des machines et des bêtes, penser la poésie et construire un destin commun : nos chroniques du mois de septembre.
☰ Un certain M. Piekielny, de François-Henri Désérable
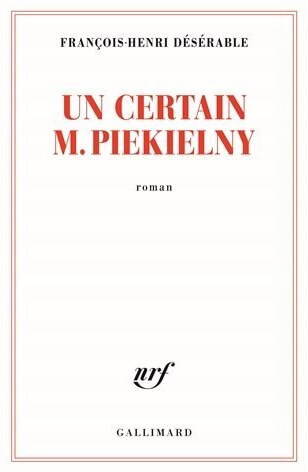
Éditions Gallimard, 2017
☰ La Supplication, de Svetlana Alexievitch
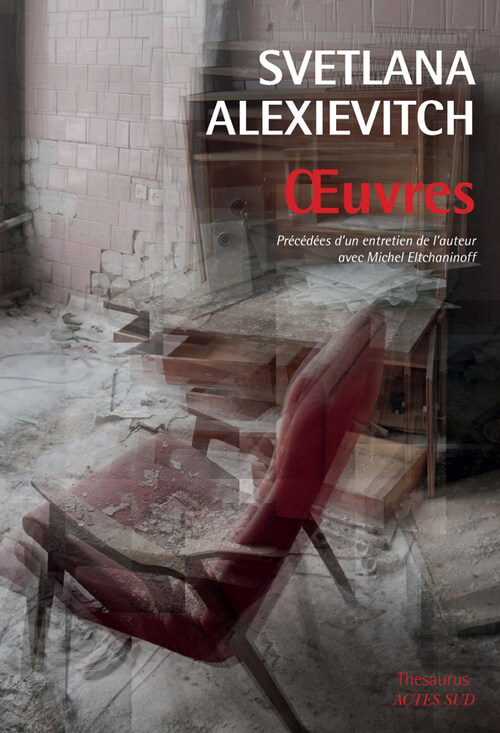 Sergueï Gourine, Anatolie Chimanski, Zoïa Danilovna Brouk… Autant de noms lus, autant de noms immédiatement oubliés. Les parcours arrêtent plus facilement l’attention : un tel était cadreur, tel autre physicien, telle autre professeure de littérature russe. Mais plus encore que les itinéraires, ce sont les voix qui restent. Si chacune a une teneur particulière due au destin qui la porte, elles finissent par se superposer pour ne plus formuler qu’une longue plainte. Celle de femmes qui n’ont pas voulu abandonner leurs maris condamnés, celle d’hommes n’imaginant pas contredire les ordres venus de Minsk ou de Moscou, celle d’enfants ayant grandi avec Tchernobyl, et pour qui Tchernobyl est une part de leur identité — et de leur intégrité. L’explosion de la centrale le 26 avril 1986 eut un retentissement et des répercussions sur chaque continent. Mais c’est le peuple le plus touché par les radiations, le peuple biélorusse, qui fut le moins informé et le moins bien encadré. Son ignorance pointe dans chacun des discours. La plupart des habitants interrogés n’entendent rien aux mesures de la radioactivité ; ceux qui savent doivent se taire. Biélorusse elle-même, la Prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch se propose caisse de résonance aux supplications inaudibles des oubliés de Tchernobyl. Et c’est peut-être une des voix du « chœur de soldats » qui résume le mieux le sentiment partagé par tous : « Nous n’avons pas tout compris, mais nous avons tout vu. » L’auteure nous propose le contraire : comprendre ce que les autres ont vu, ont subi, ont vécu — et vivent encore aujourd’hui, s’ils ne sont pas morts. [R.B.]
Sergueï Gourine, Anatolie Chimanski, Zoïa Danilovna Brouk… Autant de noms lus, autant de noms immédiatement oubliés. Les parcours arrêtent plus facilement l’attention : un tel était cadreur, tel autre physicien, telle autre professeure de littérature russe. Mais plus encore que les itinéraires, ce sont les voix qui restent. Si chacune a une teneur particulière due au destin qui la porte, elles finissent par se superposer pour ne plus formuler qu’une longue plainte. Celle de femmes qui n’ont pas voulu abandonner leurs maris condamnés, celle d’hommes n’imaginant pas contredire les ordres venus de Minsk ou de Moscou, celle d’enfants ayant grandi avec Tchernobyl, et pour qui Tchernobyl est une part de leur identité — et de leur intégrité. L’explosion de la centrale le 26 avril 1986 eut un retentissement et des répercussions sur chaque continent. Mais c’est le peuple le plus touché par les radiations, le peuple biélorusse, qui fut le moins informé et le moins bien encadré. Son ignorance pointe dans chacun des discours. La plupart des habitants interrogés n’entendent rien aux mesures de la radioactivité ; ceux qui savent doivent se taire. Biélorusse elle-même, la Prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch se propose caisse de résonance aux supplications inaudibles des oubliés de Tchernobyl. Et c’est peut-être une des voix du « chœur de soldats » qui résume le mieux le sentiment partagé par tous : « Nous n’avons pas tout compris, mais nous avons tout vu. » L’auteure nous propose le contraire : comprendre ce que les autres ont vu, ont subi, ont vécu — et vivent encore aujourd’hui, s’ils ne sont pas morts. [R.B.]
Éditions Acte Sud, collection Thesaurus « Œuvres », 2015
☰ Louise Colet : du sang, de la bile, de l’encre et du malheur, de Joëlle Gardes
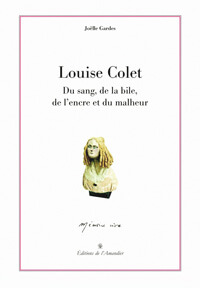
Éditions de l’Amandier, 2015
☰ Dans l’épaisseur de la chair, de Jean-Marie Blas de Roblès

Exercice de haute volée que celui-ci, réussi haut la main quand bien même les chausses-trappes invisibles ne manquaient pas. Tout commence quand un écrivain tombé à l’eau lors d’une partie de pêche voit non pas sa vie, mais celle de son père, défiler sous ses yeux tandis qu’il cherche un moyen de remonter à bord. La veille, Manuel Cortès vient de jeter à son fils qu’il « ne sera[it] jamais un vrai pied-noir ». Celui-ci, né à Sidi bel-Abbès mais rétif à tout étiquetage, attentif aux malheurs du siècle et bien trop conscient des ramifications infinies de la culpabilité pour s’associer à la geste des vaincus ou à la gloriole des vainqueurs, tente de reconstituer l’histoire familiale. Tandis que le perroquet Heidegger susurre des blagues à l’oreille du futur noyé, l’Histoire qui se déroule sous nos yeux promène d’abord un homme un peu paumé à travers ses labyrinthes : Manuel, le père du narrateur, gamin espagnol aux amis juifs et arabes, voué à reprendre le café de son père Juanico, traverse la Seconde Guerre mondiale comme médecin auxiliaire avec les troupes marocaines, assiste à des viols en série dans les Alpes italiennes, se trouve embarqué dans des expéditions punitives à son retour en Algérie, devient chirurgien, voit le monde dérouler sa folie sous ses yeux sans bien comprendre le rôle qu’il y joue. C’est un hymne au père, sans complaisance ni cynisme, sans excuses ni reproches. Parsemé de notations drôlatiques et de souvenirs intempestifs, plein de personnages truculents et terribles, avides ou généreux. On y croise les Romains, des pogroms, des bandits d’honneur, des salauds ordinaires, des joueurs d’échec et Ali Belloul, le muletier des tabors devenu conservateur du cimetière européen. Le tout va son train d’une érudition fine et jamais pesante. Le livre est conçu comme un journal de bord pour réinventer la mémoire d’un autre qu’on aime et qu’on ne comprendra jamais tout à fait. L’âme d’un père balloté par l’Histoire, revivifiée par la plume d’un fils, « non par souci de vérité — cette chose affreuse — mais pour faire mienne sa blessure, coïncider avec elle dans l’épaisseur de la chair ». [A.B.]
Éditions Zulma, 2017
☰ La Rencontre de Santa Cruz, de Max-Pol Fouchet
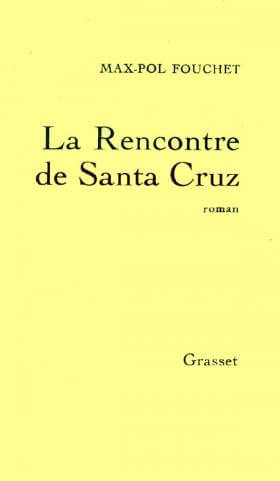 Un avion manque la piste et s’échoue contre des arbustes. Personne n’est blessé et tous les passagers sont relogés dans les hôtels d’une ville que l’on ne saurait clairement situer, sinon qu’elle se nomme Santa Cruz, comme tant d’autres en Amérique latine. Le narrateur, dont on ne tarde pas à deviner qu’il a partie liée avec l’auteur, s’en réjouit : de l’imprévu, enfin. Et, refusant d’être rapatrié, le voici qu’il transmue l’incident en aventure — « Je décidai d’abandonner, de disparaître dans une fuite anonyme. » Le narrateur, qui n’a pas de nom, se dit « malade de l’Europe malade » ; il entend bien se guérir dans la boue de ce village dont il ignore tout et qui le lui rend bien, lui l’écrivain célèbre, là-bas, dans la France de Valéry Giscard d’Estaing. La paix à trouver dans le geste d’une page que l’on tourne : adieu les livres et les siens, la famille et les copains, la patrie et les pogroms d’un continent ravagé il y a trois décennies de cela. Adieu l’espoir, aussi. Celui d’un monde que l’expression consacrée veut meilleur, celui des drapeaux rouges et des Communes flinguées. L’homme renaissant s’en tiendra donc à ses yeux, regarder, voilà tout, ne plus y croire, ne rien jurer : la révolution n’a jusqu’ici accouché que de « mal-foutus, de mongoliens, de mort-nés ». Aimer une prostituée aux jambes lourdes, découvrir un ciel jaune, rappeler à son souvenir le littoral algérien de son enfance ; et puis céder, lorsque les révolutionnaires de Santa Cruz s’en viendront le solliciter… De ce premier roman paru en 1976 — le Che est mort voilà neuf ans, les Tupamaros sont en exil et Pinochet règne sur un Chili meurtri —, de ce récit qui se plaît à perdre son lecteur (il s’agit bien d’une fiction), Max-Pol Fouchet fit savoir, lors d’un entretien, qu’il s’agissait d’un « livre de la mystique contre la politique », de l’idéal étouffé sous la nécessité. Le poète se fit romancier et l’œil s’en réjouit lui aussi. [E.C.]
Un avion manque la piste et s’échoue contre des arbustes. Personne n’est blessé et tous les passagers sont relogés dans les hôtels d’une ville que l’on ne saurait clairement situer, sinon qu’elle se nomme Santa Cruz, comme tant d’autres en Amérique latine. Le narrateur, dont on ne tarde pas à deviner qu’il a partie liée avec l’auteur, s’en réjouit : de l’imprévu, enfin. Et, refusant d’être rapatrié, le voici qu’il transmue l’incident en aventure — « Je décidai d’abandonner, de disparaître dans une fuite anonyme. » Le narrateur, qui n’a pas de nom, se dit « malade de l’Europe malade » ; il entend bien se guérir dans la boue de ce village dont il ignore tout et qui le lui rend bien, lui l’écrivain célèbre, là-bas, dans la France de Valéry Giscard d’Estaing. La paix à trouver dans le geste d’une page que l’on tourne : adieu les livres et les siens, la famille et les copains, la patrie et les pogroms d’un continent ravagé il y a trois décennies de cela. Adieu l’espoir, aussi. Celui d’un monde que l’expression consacrée veut meilleur, celui des drapeaux rouges et des Communes flinguées. L’homme renaissant s’en tiendra donc à ses yeux, regarder, voilà tout, ne plus y croire, ne rien jurer : la révolution n’a jusqu’ici accouché que de « mal-foutus, de mongoliens, de mort-nés ». Aimer une prostituée aux jambes lourdes, découvrir un ciel jaune, rappeler à son souvenir le littoral algérien de son enfance ; et puis céder, lorsque les révolutionnaires de Santa Cruz s’en viendront le solliciter… De ce premier roman paru en 1976 — le Che est mort voilà neuf ans, les Tupamaros sont en exil et Pinochet règne sur un Chili meurtri —, de ce récit qui se plaît à perdre son lecteur (il s’agit bien d’une fiction), Max-Pol Fouchet fit savoir, lors d’un entretien, qu’il s’agissait d’un « livre de la mystique contre la politique », de l’idéal étouffé sous la nécessité. Le poète se fit romancier et l’œil s’en réjouit lui aussi. [E.C.]
Éditions Grasset, 1976
☰ Le Féminisme, d’Anne-Charlotte Husson et Thomas Mathieu
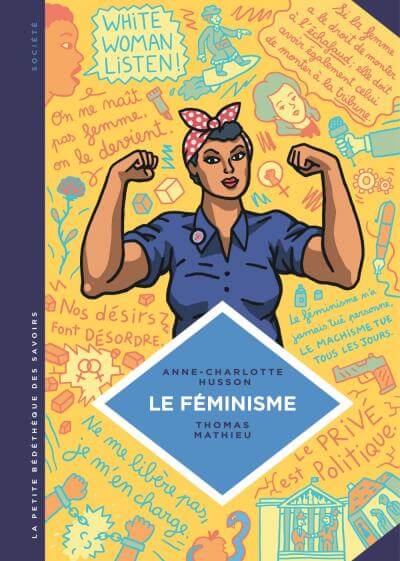 Cette bande dessinée est réalisée par Anne-Charlotte Husson (doctorante en sciences du langage, auteure du blog « Genre ! ») et Thomas Mathieu (qui a mis en dessin des histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire avec le blog « Projet crocodiles »). Comment aborder un sujet aussi vaste que celui du féminisme dans une BD de ce (petit) format ? Ou, plutôt, des féminismes — il est d’emblée précisé que si « il existe une cause des femmes », il est de nombreux désaccords et divergences. Les auteur.e.s proposent d’« écouter les féministes et leurs revendications […] à travers leurs slogans et citations ». Cela s’ouvre sur la figure d’Olympe de Gouges, qui rédigea en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Tout en pointant la fausse universalité de la déclaration de 1789 — qui ne concernait en réalité que les hommes —, elle exigeait les mêmes droits politiques pour les femmes. Les revendications s’étendent aussi à la sphère privée (« Le privé est politique »), à l’image du procès de Bobigny, qui marqua son époque. Du fameux « On ne naît pas femme, on le devient » exprimé par Simone de Beauvoir jusqu’aux violences subies par les femmes, en passant par les questions de genre et de sexualité, nous parcourons ainsi l’histoire des mouvements et des problématiques féministes — dont beaucoup sont d’une grande actualité. L’ouvrage n’omet pas le Black feminism : il émergea de l’invisibilisation des femmes noires dans la pensée féministe de la seconde vague et fit notamment apparaître le concept, désormais connu, d’intersectionnalité. La dernière partie donne directement la parole à des féministes, qui s’expriment sur le slogan « Ne me libère pas, je m’en charge » et sur ce que signifie le féminisme pour elles. Tour de force que voici : l’album, synthétique, initie et invite le tout-venant à approfondir. [M.B.]
Cette bande dessinée est réalisée par Anne-Charlotte Husson (doctorante en sciences du langage, auteure du blog « Genre ! ») et Thomas Mathieu (qui a mis en dessin des histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire avec le blog « Projet crocodiles »). Comment aborder un sujet aussi vaste que celui du féminisme dans une BD de ce (petit) format ? Ou, plutôt, des féminismes — il est d’emblée précisé que si « il existe une cause des femmes », il est de nombreux désaccords et divergences. Les auteur.e.s proposent d’« écouter les féministes et leurs revendications […] à travers leurs slogans et citations ». Cela s’ouvre sur la figure d’Olympe de Gouges, qui rédigea en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Tout en pointant la fausse universalité de la déclaration de 1789 — qui ne concernait en réalité que les hommes —, elle exigeait les mêmes droits politiques pour les femmes. Les revendications s’étendent aussi à la sphère privée (« Le privé est politique »), à l’image du procès de Bobigny, qui marqua son époque. Du fameux « On ne naît pas femme, on le devient » exprimé par Simone de Beauvoir jusqu’aux violences subies par les femmes, en passant par les questions de genre et de sexualité, nous parcourons ainsi l’histoire des mouvements et des problématiques féministes — dont beaucoup sont d’une grande actualité. L’ouvrage n’omet pas le Black feminism : il émergea de l’invisibilisation des femmes noires dans la pensée féministe de la seconde vague et fit notamment apparaître le concept, désormais connu, d’intersectionnalité. La dernière partie donne directement la parole à des féministes, qui s’expriment sur le slogan « Ne me libère pas, je m’en charge » et sur ce que signifie le féminisme pour elles. Tour de force que voici : l’album, synthétique, initie et invite le tout-venant à approfondir. [M.B.]
Éditions du Lombard, 2016
☰ Fractures d’une vie, de Charlie Bauer
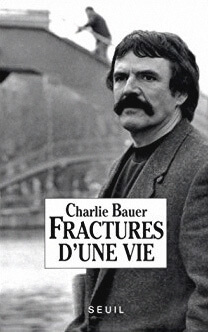 C’est l’histoire d’un révolté que la vie, l’État et la prison n’ont cessé de vouloir briser. C’est l’histoire d’une lutte pour la vie ou d’une vie pour la lutte. Cette histoire, c’est celle de Charlie Bauer, passé en quelques années de minot de l’Estaque, quartier pauvre de Marseille, à complice de « l’ennemi numéro un » de la fin des années 1970, Jacques Mesrine. Les différentes fractures de sa vie, Bauer les conte sans chapitres ni parties, une vie d’un bloc au cours de laquelle les quartiers de haute sécurité succèdent aux cachots, aux transferts de prison en prison et aux tentatives d’évasion. Très tôt, le jeune Charlie sut que quelque chose clochait dans la société au sein de laquelle il vivait : une sorte d’intuition — le problème vient précisément de ce système, qui entretient les inégalités et l’injustice. Il entre au Parti communiste, comme la majorité des gens du quartier (sympathisants pour la plupart, militants parfois) ; déjà, les premières désillusions : le Parti est là mais ne change pas les choses, ne donne pas plus de pain aux pauvres ni ne les sort du caniveau. Bauer a envie d’agir. Il entre dans les eaux troubles de l’illégalisme : braquages, pillages de trains, cambriolages — à chaque fois, une part du butin est destinée à la redistribution. Le Parti n’appuie guère la méthode et la rupture est consommée lorsque les communistes votent les pouvoirs spéciaux pour l’armée en Algérie, en mars 1956. Les actions continuent, mais pas pour longtemps : arrestation, emprisonnement. La répression s’accentue : torture, coups, humiliations. Bauer dit tout et nous embarque. Ce qui a fracturé sa vie sans jamais briser sa révolte et sa volonté de lutter. La philosophie et les sciences sociales, qui l’ont aidé à tenir, à comprendre, à ne pas seulement haïr les hommes qui lui faisaient subir le pire. Et les cicatrices jamais refermées. [R.L.]
C’est l’histoire d’un révolté que la vie, l’État et la prison n’ont cessé de vouloir briser. C’est l’histoire d’une lutte pour la vie ou d’une vie pour la lutte. Cette histoire, c’est celle de Charlie Bauer, passé en quelques années de minot de l’Estaque, quartier pauvre de Marseille, à complice de « l’ennemi numéro un » de la fin des années 1970, Jacques Mesrine. Les différentes fractures de sa vie, Bauer les conte sans chapitres ni parties, une vie d’un bloc au cours de laquelle les quartiers de haute sécurité succèdent aux cachots, aux transferts de prison en prison et aux tentatives d’évasion. Très tôt, le jeune Charlie sut que quelque chose clochait dans la société au sein de laquelle il vivait : une sorte d’intuition — le problème vient précisément de ce système, qui entretient les inégalités et l’injustice. Il entre au Parti communiste, comme la majorité des gens du quartier (sympathisants pour la plupart, militants parfois) ; déjà, les premières désillusions : le Parti est là mais ne change pas les choses, ne donne pas plus de pain aux pauvres ni ne les sort du caniveau. Bauer a envie d’agir. Il entre dans les eaux troubles de l’illégalisme : braquages, pillages de trains, cambriolages — à chaque fois, une part du butin est destinée à la redistribution. Le Parti n’appuie guère la méthode et la rupture est consommée lorsque les communistes votent les pouvoirs spéciaux pour l’armée en Algérie, en mars 1956. Les actions continuent, mais pas pour longtemps : arrestation, emprisonnement. La répression s’accentue : torture, coups, humiliations. Bauer dit tout et nous embarque. Ce qui a fracturé sa vie sans jamais briser sa révolte et sa volonté de lutter. La philosophie et les sciences sociales, qui l’ont aidé à tenir, à comprendre, à ne pas seulement haïr les hommes qui lui faisaient subir le pire. Et les cicatrices jamais refermées. [R.L.]
Éditions du Seuil, 1990 (réédition Agone, 2004)
☰ Abattoirs de Chicago — Le monde humain, de Jacques Damade
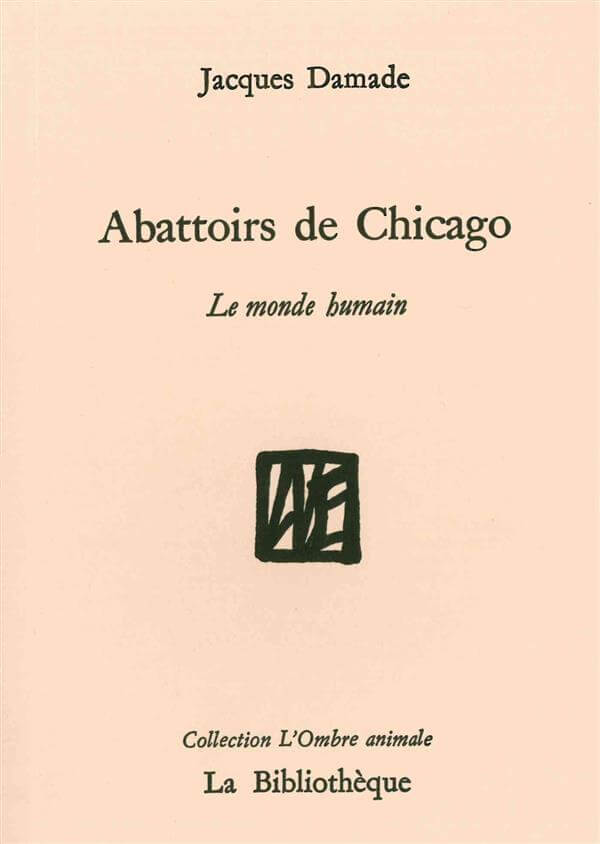 « Qu’est-ce que le réel, ou plutôt qu’est-ce que notre réel ? » C’est sous la forme d’une question que s’ouvre le livre. L’auteur s’avance plus loin que la simple chronique. Le sous-titre est un indice ; par là, il entend « une terre entièrement vouée à l’homme, à son unique intérêt, où, pour finir, rien d’autre que l’homme ne fait vis-à-vis ». Son regard sur les relations entre humains et animaux se teinte d’une critique qu’il puise dans l’Histoire. Celle de Chicago commence au XVIIIe siècle, alors que les États-Unis n’existent pas encore sous ce nom, que des guerres intestines sont livrées entre colons, peuples indiens et puissances européennes. Très vite, la ville grossit : « ville champignon », sa croissance est démentielle et elle dépasse Cincinnati dans le marché florissant des abattoirs. L’auteur, également éditeur, nous renseigne sur les acteurs, les moyens et les innovations qui ont façonné les abattoirs de la ville. Des origines de l’industrialisation des productions animales, ou même de l’industrialisation tout court — Ford s’est inspiré de Chicago pour rationaliser la production de son fameux modèle T —, Damade, entre passé et présent, nous convie à questionner notre rapport aux animaux. Car « prendre le parti des animaux, c’est prendre le parti de l’homme, bien plus, c’est le restituer » : sans les animaux, il n’y a pas de monde humain. [R.B.]
« Qu’est-ce que le réel, ou plutôt qu’est-ce que notre réel ? » C’est sous la forme d’une question que s’ouvre le livre. L’auteur s’avance plus loin que la simple chronique. Le sous-titre est un indice ; par là, il entend « une terre entièrement vouée à l’homme, à son unique intérêt, où, pour finir, rien d’autre que l’homme ne fait vis-à-vis ». Son regard sur les relations entre humains et animaux se teinte d’une critique qu’il puise dans l’Histoire. Celle de Chicago commence au XVIIIe siècle, alors que les États-Unis n’existent pas encore sous ce nom, que des guerres intestines sont livrées entre colons, peuples indiens et puissances européennes. Très vite, la ville grossit : « ville champignon », sa croissance est démentielle et elle dépasse Cincinnati dans le marché florissant des abattoirs. L’auteur, également éditeur, nous renseigne sur les acteurs, les moyens et les innovations qui ont façonné les abattoirs de la ville. Des origines de l’industrialisation des productions animales, ou même de l’industrialisation tout court — Ford s’est inspiré de Chicago pour rationaliser la production de son fameux modèle T —, Damade, entre passé et présent, nous convie à questionner notre rapport aux animaux. Car « prendre le parti des animaux, c’est prendre le parti de l’homme, bien plus, c’est le restituer » : sans les animaux, il n’y a pas de monde humain. [R.B.]
Éditions La Bibliothèque, 2016
☰ Poésie et magie, de Thomas M. Greene
 Autant vous prévenir : voici un livre à peu près introuvable — c’est bien dommage. Raison de plus, si le hasard de vos pérégrinations vous amenait à croiser sa route, pour interpréter cela comme un hasard objectif, et ne surtout pas lui résister. Court mais très dense texte théorique, issu de conférences données au Collège de France, cet essai tente de remonter aux sources du phénomène poétique sous un angle résolument anthropologique. À quoi bon des poètes, et pourquoi la poésie survit-elle comme genre à travers l’Histoire ? L’hypothèse est assumée, jubilatoire : les poètes seraient d’une certaine manière héritiers des chamans, seuls à tenter de tisser, entre la solitude insupportable et notre désir inassouvi, un châle de mots dans lesquels se draper pour (espérer) survivre au néant. Ce qui différencie le poète du prêtre ? Sa lucidité, peut-être, car c’est en pleine connaissance de cause de l’impuissance du langage à faire la seule chose qui compterait — ressusciter les morts, combler le vide, inventer la joie ? — que le poète tente malgré tout l’impossible : ordonner le chaos extérieur, tenter d’exister comme un sujet stable dans un monde mouvant. La poésie sert à vivre, en ce qu’elle combat l’entropie, fabrique du dicible avec ce qui paraîtrait autrement ineffable : nos peurs, nos désir, nos émotions vivantes et pulsatiles. « Il nous reste un texte qui se comporte comme si il était doté d’efficience magique, du pouvoir d’invoquer, de lier et d’enchanter, mais qui en même temps renonce implicitement à ce pouvoir. » Et c’est dans ce renoncement même, qui est aussi la part d’acquiescement au réel, que se situe peut-être l’honneur du poète, quand il choisit d’écrire la vie comme si il pouvait la changer — quand il admet avoir voulu être un chaman, et n’être rien d’autre, mais c’est déjà beaucoup, qu’un magicien. [A.B.]
Autant vous prévenir : voici un livre à peu près introuvable — c’est bien dommage. Raison de plus, si le hasard de vos pérégrinations vous amenait à croiser sa route, pour interpréter cela comme un hasard objectif, et ne surtout pas lui résister. Court mais très dense texte théorique, issu de conférences données au Collège de France, cet essai tente de remonter aux sources du phénomène poétique sous un angle résolument anthropologique. À quoi bon des poètes, et pourquoi la poésie survit-elle comme genre à travers l’Histoire ? L’hypothèse est assumée, jubilatoire : les poètes seraient d’une certaine manière héritiers des chamans, seuls à tenter de tisser, entre la solitude insupportable et notre désir inassouvi, un châle de mots dans lesquels se draper pour (espérer) survivre au néant. Ce qui différencie le poète du prêtre ? Sa lucidité, peut-être, car c’est en pleine connaissance de cause de l’impuissance du langage à faire la seule chose qui compterait — ressusciter les morts, combler le vide, inventer la joie ? — que le poète tente malgré tout l’impossible : ordonner le chaos extérieur, tenter d’exister comme un sujet stable dans un monde mouvant. La poésie sert à vivre, en ce qu’elle combat l’entropie, fabrique du dicible avec ce qui paraîtrait autrement ineffable : nos peurs, nos désir, nos émotions vivantes et pulsatiles. « Il nous reste un texte qui se comporte comme si il était doté d’efficience magique, du pouvoir d’invoquer, de lier et d’enchanter, mais qui en même temps renonce implicitement à ce pouvoir. » Et c’est dans ce renoncement même, qui est aussi la part d’acquiescement au réel, que se situe peut-être l’honneur du poète, quand il choisit d’écrire la vie comme si il pouvait la changer — quand il admet avoir voulu être un chaman, et n’être rien d’autre, mais c’est déjà beaucoup, qu’un magicien. [A.B.]
Éditions Julliard, Collège de France, 1991
☰ La Cause des animaux — Pour un destin commun, de Florence Burgat
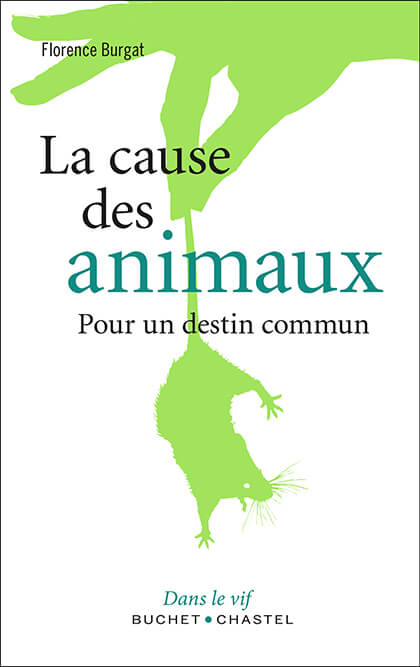 Il existe au moins des limites à la guerre que les hommes se livrent entre eux depuis la nuit des temps ; elles disparaissent sitôt que ceux-là guerroient contre les bêtes : c’est en substance l’épigraphe que la philosophe place en ouverture ce petit livre aux allures de manifeste. Chaque seconde, sur Terre, plus de 1 900 animaux sont abattus pour leur chair. Un paradoxe s’impose sitôt : pourquoi tant de citoyens estiment-ils que les animaux ne sont pas des « biens meubles » s’ils n’en tirent aucune conclusion logique : cesser de les traiter comme de simples marchandises privées d’émotions et de désirs. « Qui mangeons-nous ? », demande Florence Burgat. Qui, oui. Des subjectivités, des individualités. Mais les hommes préfèrent se raconter des histoires : on peut tuer avec humanité ; on peut égorger avec éthique ; on peut amputer avec respect ; on peut chosifier avec estime ; bref, la viande n’est plus un cadavre mais un plaisir, un signifiant rendu indépendant « de son signifié ». Et l’auteure de mettre en évidence « l’orthodoxie humaniste » pour partie responsable de cette quotidienne occultation de masse — chiffres (vertigineux) à l’appui, au fil des pages : chasse, abattoirs, expérimentations… L’Histoire est celle de la lutte des classes, juraient Marx et Engels ; elle est aussi, ajouterait sans doute Burgat, celle de l’exploitation des animaux. Les pensées courtes ne manquent jamais une occasion de crier fort : le souci de ces derniers trahirait quelque désintérêt pour les siens. La philosophe met un terme à ce dilemme qui jamais n’en fut un : « Loin d’être volée aux êtres humains, l’attention portée aux animaux, en plus d’être directement tournée vers eux et à ce titre pleinement justifiée, concourt très sûrement à la pacification des relations interhumaines. Car, en effet, comment abaisser le niveau de violence entre les êtres humains tant que l’on enseignera que la mise à mort est la relation normale avec les animaux ? » Tout un chantier. [E.C.]
Il existe au moins des limites à la guerre que les hommes se livrent entre eux depuis la nuit des temps ; elles disparaissent sitôt que ceux-là guerroient contre les bêtes : c’est en substance l’épigraphe que la philosophe place en ouverture ce petit livre aux allures de manifeste. Chaque seconde, sur Terre, plus de 1 900 animaux sont abattus pour leur chair. Un paradoxe s’impose sitôt : pourquoi tant de citoyens estiment-ils que les animaux ne sont pas des « biens meubles » s’ils n’en tirent aucune conclusion logique : cesser de les traiter comme de simples marchandises privées d’émotions et de désirs. « Qui mangeons-nous ? », demande Florence Burgat. Qui, oui. Des subjectivités, des individualités. Mais les hommes préfèrent se raconter des histoires : on peut tuer avec humanité ; on peut égorger avec éthique ; on peut amputer avec respect ; on peut chosifier avec estime ; bref, la viande n’est plus un cadavre mais un plaisir, un signifiant rendu indépendant « de son signifié ». Et l’auteure de mettre en évidence « l’orthodoxie humaniste » pour partie responsable de cette quotidienne occultation de masse — chiffres (vertigineux) à l’appui, au fil des pages : chasse, abattoirs, expérimentations… L’Histoire est celle de la lutte des classes, juraient Marx et Engels ; elle est aussi, ajouterait sans doute Burgat, celle de l’exploitation des animaux. Les pensées courtes ne manquent jamais une occasion de crier fort : le souci de ces derniers trahirait quelque désintérêt pour les siens. La philosophe met un terme à ce dilemme qui jamais n’en fut un : « Loin d’être volée aux êtres humains, l’attention portée aux animaux, en plus d’être directement tournée vers eux et à ce titre pleinement justifiée, concourt très sûrement à la pacification des relations interhumaines. Car, en effet, comment abaisser le niveau de violence entre les êtres humains tant que l’on enseignera que la mise à mort est la relation normale avec les animaux ? » Tout un chantier. [E.C.]
Éditions Buchet Chastel, 2015
Photographie de bannière : soudeuses, Pascagoula, Mississippi, 1943.

