Anarchiste, écrivain, punk, photographe ou graphiste : bien des mots pourraient décrire Canek Sánchez Guevara. Si son tempérament et son goût pour le voyage rappellent son légendaire grand-père, l’homme n’a jamais voulu qu’on le considère comme « le petit-fils du Che » : impossible, répétait-il, d’incarner ce pantin exemplaire tant attendu par le régime. Il choisit dès lors de s’éloigner de Cuba, en quête d’anonymat. ☰ Par Marti Blancho
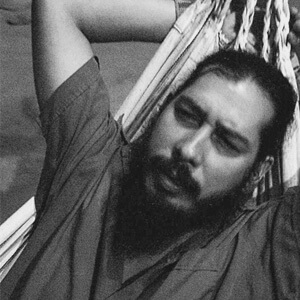 Fils de la Péruvienne Hilda Guevara Gadea, aînée du premier mariage du Che, et d’Alberto Sánchez Hernández, un communiste mexicain réfugié à Cuba, Canek — « serpent noir », en langue maya — naît en 1974 dans une maison havanaise du quartier de Miramar. La petite famille voyage beaucoup : entourée de réfugiés politiques et d’activistes locaux, elle s’installe à Milan, Barcelone et Mexico pour finalement rentrer à Cuba. Canek y reste jusqu’à la mort de sa mère ; il a alors 22 ans et décide d’abandonner l’île pour rejoindre la ville d’Oaxaca, au Mexique. « En marge de tout principe politico-idéologique, il y a deux choses que j’admire grandement chez Ernesto Guevara : son internationalisme et sa témérité, desquels je me suis sans doute nourri », dira-t-il en 2012, au cours d’une interview pour le quotidien brésilien La Folha de Sao Paulo.
Fils de la Péruvienne Hilda Guevara Gadea, aînée du premier mariage du Che, et d’Alberto Sánchez Hernández, un communiste mexicain réfugié à Cuba, Canek — « serpent noir », en langue maya — naît en 1974 dans une maison havanaise du quartier de Miramar. La petite famille voyage beaucoup : entourée de réfugiés politiques et d’activistes locaux, elle s’installe à Milan, Barcelone et Mexico pour finalement rentrer à Cuba. Canek y reste jusqu’à la mort de sa mère ; il a alors 22 ans et décide d’abandonner l’île pour rejoindre la ville d’Oaxaca, au Mexique. « En marge de tout principe politico-idéologique, il y a deux choses que j’admire grandement chez Ernesto Guevara : son internationalisme et sa témérité, desquels je me suis sans doute nourri », dira-t-il en 2012, au cours d’une interview pour le quotidien brésilien La Folha de Sao Paulo.
« Je trouve gênant un certain type de guévaristes, plus proches de la rhétorique chrétienne que de l’implacable athéisme du vieux guérillero. »
Mais nous sommes en 1986 et voilà vingt ans que ledit Guevara est mort. Le guérillero argentin n’est plus seulement un personnage historique mais un mythe révolutionnaire mondialement connu, une figure légendaire que le gouvernement cubain continue de célébrer. Dès l’enfance, Canek s’est rendu compte qu’être le descendant du Che impliquait une grande responsabilité. À son arrivée sur l’île, on exigea de lui un comportement digne de son grand-père ; on lui expliqua « comment [se] conduire, ce qu’il doit faire et ne pas faire, ce qu’il doit dire et ce qu’il doit taire ». Les barbudos au pouvoir aspiraient à le hisser sur quelque piédestal afin que le peuple pût contempler à travers le jeune héritier l’esprit du héros défunt. Mais Canek refuse en grandissant de devenir cette idole de propagande : « Être le petit-fils du Che
fut extrêmement difficile ; j’avais l’habitude d’être moi-même, rien d’autre. Je n’étais qu’un crado
de plus, un désaffecté
, un antisocial
et je me rapprochais beaucoup — selon les archétypes policiers — d’un lumpen. » Il souhaite seulement vivre sans avoir à porter la charge de son ascendance, sans devoir adapter son comportement aux injonctions officielles. Rébellion d’adolescence, disent d’aucuns. Canek exaspère l’oligarchie cubaine, en plus de ses parents. « Considéré comme un pestiféré par la plupart des soumis à Fidel et compagnie, qui lui ont tourné le dos de la façon la plus abjecte pour avoir été courageux dès son plus jeune âge, il dénonçait sans hésiter les aventures tout sauf révolutionnaires de ceux qui abandonnèrent son grand-père », expliquera son cousin, Martin Guevara, dans une lettre publiée en 20151.
Mais le détachement n’est pas total. Canek désire uniquement s’éloigner de ceux qui cherchent à instrumentaliser les actes et les idéaux de son aïeul. Loin de refuser d’évoquer le Che, il collabore avec Radamés Molina Montes à une édition commentée de son Journal de Bolivie. Et justifie sa mise à l’écart volontaire par une défiance à l’endroit des dogmes et des simplifications — ce manichéisme propre au traitement des figures révolutionnaires modernes, en somme. « Je trouve gênant un certain type de guévaristes, plus proches de la rhétorique chrétienne que de l’implacable athéisme du vieux guérillero. Sa diabolisation me dérange tout autant, celle qui le présente comme un criminel sanguinaire jubilant dès qu’il fusille », écrira ainsi Canek dans son Journal sans motocyclette — un titre en écho, bien sûr, au Voyage à motocyclette du Che.

[Extrait d'une toile d'Antonio Vidal]
Une nouvelle bourgeoisie et un socialisme d’État
« La Révolution cubaine n’a pas été démocratique puisqu’elle a engendré les classes sociales qui l’en ont empêché : la révolution a enfanté une bourgeoisie, un appareil répressif prêt à la défendre du peuple et une bureaucratie pour l’éloigner de ce dernier. Mais, avant tout, elle a été antidémocratique en raison du messianisme religieux de son leader », ira-t-il jusqu’à dire. Fort de son patronyme, Canek connaît les fils et les filles des grandes familles de la bourgeoisie. Si ce mot sonne comme une insulte à Cuba, il n’en est d’autres pour désigner une classe sociale qui existe bel et bien. Seulement, Canek « ne vi[t] pas enfermé dans une petite bulle de cristal » ; il fréquente les fortunés autant que les plus humbles. C’est par la diversité de ses amitiés qu’il en arrive à la conclusion que la société cubaine demeure une société de classes : « Je commençais à comprendre que Peuple est une belle abstraction aux multiples usages, surtout rhétoriques… », expliquera-t-il. Canek critique le système politique cubain mais ne s’attaque pas au corpus idéologique dans lequel celui-ci assure puiser : le petit-fils dénonce simplement la contradiction qu’il constate entre le discours officiel et la réalité sociale, les idéaux communistes et le mode de gouvernement castriste. Propagande, censure, répression et inégalités font partie de la vie quotidienne à Cuba : elles ont à ses yeux peu à voir avec la théorie marxiste.
« Propagande, censure, répression et inégalités font partie de la vie quotidienne à Cuba : elles ont à ses yeux peu à voir avec la théorie marxiste. »
Fidel Castro et son armée de barbudos ont débarrassé l’île de l’impérialisme nord-américain, c’est un fait, mais l’instauration d’un État soi-disant « socialiste » a vu l’élan émancipateur amorcé par les révolutionnaires s’enliser. Dans une interview accordée au magazine Proceso, Canek expliquera que « tous [ses] reproches visant Fidel Castro et ses épigones proviennent de leur éloignement des idéaux libertaires, de leur trahison du peuple de Cuba et de l’affreuse surveillance mise en place pour préserver l’État par-dessus son peuple
». La ressemblance entre l’analyse formulée par Canek Sánchez Guevara et la critique du bolchevisme produite en son temps par l’anarcho-syndicaliste Rudolf Rocker saute aux yeux. « Sous la dictature du prolétariat
s’est effectivement développée en Russie une nouvelle classe, celle des membres de cette commissariocratie que la majorité de la population considère et subit aujourd’hui comme d’aussi évidents oppresseurs qu’autrefois les représentants de l’ancien régime. […] Ils ont accaparé les meilleurs logements et sont abondamment pourvus de tout, tandis que la grande masse du peuple continue à souffrir de la faim et d’une terrible misère », écrivait en effet Rocker dans Les Soviets trahis par les bolcheviks, au lendemain de la révolte matée de Kronstadt, en 1921. Les bolcheviks et les guérilleros, une fois parvenus au pouvoir, ont fini par ressembler à la bourgeoisie qu’ils avaient pourtant renversée…
Un punk à Cuba
Lors d’une émission consacrée au punk cubain, le journaliste Rafael Uzcátegui fera savoir que le groupe Rotura, dont fit partie Canek, « était connu pour être un des premiers groupes punk sur l’île », à une époque où « le rock en général et le punk en particulier étaient proscrits, et alors qu’on savait que plusieurs rockeurs avaient été arrêtés pour le prétendu délit de dangerosité sociale
». Ce mouvement musical, porté par une frange de la jeunesse cubaine, se constitua avant tout autour du rejet de la culture officielle. Un moyen d’exprimer son refus de l’uniformité « socialiste » face à un gouvernement les décrivant comme autant de « jeunes aliénés par l’impérialisme qui voulaient détruire les institutions de l’île ». Rien moins. Canek dépeindra cette contre-culture bouillonnante dans 33 révolutions, avec l’ironie et l’autodérision dont faisaient preuve les « frikis » — déformation de « freaks », en espagnol —, ces punks ados de la Havane qui se surnommaient « l’Étron, le Boiteux et le Borgne » et écoutaient « el Miclláguer, el Lenon, el Santana, el Aironmaiden ».

[Extrait d'une toile d'Antonio Vidal]
Un unique livre
Canek écrit régulièrement pour des revues littéraires, comme Replicante, Letras Explícitas ou Letras Libres. De 2008 à 2012, pour le journal mexicain Milenio et Le Nouvel Observateur, il tient une chronique sur ses pérégrinations en Europe et en Amérique du Sud2. 33 révolutions est son unique roman, publié à titre posthume à l’initiative de son père, Jesús Alberto Sánchez Hernández, qui disait de lui « qu’il n’était pas intéressé par la gloire, [qu’]il ne prétendait pas écrire des livres sensationnels ». 33 révolutions, comme les tours d’un vinyle : « Le pays entier est un disque rayé (tout se répète : chaque jour est une répétition de l’antérieur, chaque semaine, mois, année ; et de répétition en répétition le son se dégrade jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un vague et méconnaissable souvenir du son original — la musique disparaît, la remplace un murmure sablonneux incompréhensible). »
Le disque de Canek Sánchez Guevara s’est arrêté de tourner le 21 janvier 2015 à Mexico. Inconnu du grand public par volonté propre et briseur de destin : il réussit à devenir beaucoup plus que le petit-fils du Che.
Illustration de bannière : Antonio Vidal
- Sur le site Café Fuerte.[↩]
- Voir le recueil Journal sans motocyclette, uniquement publié en espagnol aux éditions Pepitas de Calabaza.[↩]

